Le Fonds Antoine Meillet
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Indo-European Linguistics: an Introduction Indo-European Linguistics an Introduction
This page intentionally left blank Indo-European Linguistics The Indo-European language family comprises several hun- dred languages and dialects, including most of those spoken in Europe, and south, south-west and central Asia. Spoken by an estimated 3 billion people, it has the largest number of native speakers in the world today. This textbook provides an accessible introduction to the study of the Indo-European proto-language. It clearly sets out the methods for relating the languages to one another, presents an engaging discussion of the current debates and controversies concerning their clas- sification, and offers sample problems and suggestions for how to solve them. Complete with a comprehensive glossary, almost 100 tables in which language data and examples are clearly laid out, suggestions for further reading, discussion points and a range of exercises, this text will be an essential toolkit for all those studying historical linguistics, language typology and the Indo-European proto-language for the first time. james clackson is Senior Lecturer in the Faculty of Classics, University of Cambridge, and is Fellow and Direc- tor of Studies, Jesus College, University of Cambridge. His previous books include The Linguistic Relationship between Armenian and Greek (1994) and Indo-European Word For- mation (co-edited with Birgit Anette Olson, 2004). CAMBRIDGE TEXTBOOKS IN LINGUISTICS General editors: p. austin, j. bresnan, b. comrie, s. crain, w. dressler, c. ewen, r. lass, d. lightfoot, k. rice, i. roberts, s. romaine, n. v. smith Indo-European Linguistics An Introduction In this series: j. allwood, l.-g. anderson and o.¨ dahl Logic in Linguistics d. -

D101 Forewordtoanessay.Pdf (927.5Kb)
A foreword to an essay by Charles de Lamberterie The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Nagy, Gregory. 2017.11.17. "A foreword to an essay by Charles de Lamberterie." Classical Inquiries. http://nrs.harvard.edu/ urn-3:hul.eresource:Classical_Inquiries. Published Version https://classical-inquiries.chs.harvard.edu/draft-of-a-foreword-to- an-essay-by-charles-de-lamberterie/ Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:40827372 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Classical Inquiries Editors: Angelia Hanhardt and Keith Stone Consultant for Images: Jill Curry Robbins Online Consultant: Noel Spencer About Classical Inquiries (CI ) is an online, rapid-publication project of Harvard’s Center for Hellenic Studies, devoted to sharing some of the latest thinking on the ancient world with researchers and the general public. While articles archived in DASH represent the original Classical Inquiries posts, CI is intended to be an evolving project, providing a platform for public dialogue between authors and readers. Please visit http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.eresource:Classical_Inquiries for the latest version of this article, which may include corrections, updates, or comments and author responses. Additionally, many of the studies published in CI will be incorporated into future CHS pub- lications. Please visit http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.eresource:CHS.Online_Publishing for a complete and continually expanding list of open access publications by CHS. -

Calvert Watkins
CALVERT WARD WATKINS Calvert Watkins, a towering figure in historical and Indo-European linguistics and president of the LSA in 1988, died unexpectedly in Los Angeles on March 20, 2013, a week after his eightieth birthday. At the time of his death he was Distinguished Profes - sor in Residence of the Department of Classics and the Program in Indo-European Studies at UCLA. He had moved to UCLA after a long career at Harvard, where he re - tired as Victor S. Thomas Professor of Linguistics and the Classics in 2003. Though born in Pittsburgh and raised more in New York than anywhere else, Cal (as he was to all who knew him ) did not feel himself an unhyphenated East Coaster . His parents , Ralph James Watkins and Willye Ward Watkins, were both from San Marcos, Texas; Ralph was an economist and government advisor whose career brought him north . Cal was intensely proud of his Texas roots, and cultivated a faintly detectable Texas drawl to the end of his days . But he was hardly ever more than a visitor to his an - cestral home state. After graduating from Friends Seminary in Manhattan , he entered Harvard with the class of 1954. He stayed there, apart from leaves and fellowships, until the last decade of his life. Cal began as a prodigy and never stopped being one. Exposure to Latin and Greek in school made him hungry for more, and by the time he was fifteen he had decided to be an Indo-Europeanist. He had already shown himself to be a remarkable practical lan - guage learner. -

Review of ML West, Indo-European Poetry and Myth
Review of M. L. West, Indo-European Poetry and Myth (Oxford 2007). The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Gregory Nagy. 2008. Review of M. L. West, Indo-European Poetry and Myth (Oxford 2007). Indo-European Studies Bulletin 13, 60–65. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12305812 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Open Access Policy Articles, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#OAP Review of M.L. West, Indo-European Poetry and Myth (Oxford 2007) Gregory Nagy [[This review was first published in Indo-European Studies Bulletin 13 (2008) 60– 65.]] West’s book is most useful for researchers in the Classics and in Indo-European studies. I have produced two different and mutually complementary reviews of it, one for Classicists and one for Indo-Europeanists, with the collegial permission of the book- review editors of Classical Review and Indo-European Studies Bulletin. In the present review for IESB, I concentrate on the usefulness of the book for those who are already well versed in Indo-European studies. The book offers a synthesis of research done by Indo-Europeanists on poetic and mythmaking traditions as reflected in Indo-European languages. As such, it rivals other recent books about these traditions. Readers of the IESB will not need to be reminded of the more general book of Jaan Puhvel (1987) or of the more eclectic book of Calvert Watkins (1995). -

Milman Parry and AL Kroeber: Americanist Anthropology and The
Oral Tradition, 16/1 (2001): 58-84 Milman Parry and A. L. Kroeber: Americanist Anthropology and the Oral Homer John F. García The view of Homer which . was to render earlier scholarship obsolete . was apparently arrived at by the reaction of an unusual mind to the text of Homer: nothing in Parry’s background (middle-class, not particularly intellectual, Welsh Quaker origins), nor in the place where he was born and lived until he went to France in 1923 . makes that reaction likely. Parry’s teachers in Greek at the University of California included two of the finest Hellenists of their generation, George Calhoun (1888-1942) and Ivan Linforth (b. 1879). Both men knew Homer well and had a sensitive understanding of his poetry. But they were not the source of any of Parry’s specific ideas. His work was as much a surprise to them as to the rest of the world. The mind that presented Homer to the world as the singer of traditional poetry was itself the product of no traditions. A. Parry 1971:xxii-xxiii Introduction Milman Parry’s mythic reputation derives from the brilliance of his scholarship, the suaveness of his rhetoric, a mysterious and untimely death, and above all his standing as a revered ancestor of American Homeric scholarship in the predominant form it now takes. Adam Parry’s words enhance the sense of something unaccountable, even miraculous, in his father’s genius; yet we can read them today, if we want to take the study of intellectual history seriously, only with a skeptical eye. -

4 the History of Linguistics
The History of Linguistics 81 4 The History of Linguistics LYLE CAMPBELL 1 Introduction Many “histories” of linguistics have been written over the last two hundred years, and since the 1970s linguistic historiography has become a specialized subfield, with conferences, professional organizations, and journals of its own. Works on the history of linguistics often had such goals as defending a particu- lar school of thought, promoting nationalism in various countries, or focuss- ing on a particular topic or subfield, for example on the history of phonetics. Histories of linguistics often copied from one another, uncritically repeating popular but inaccurate interpretations; they also tended to see the history of linguistics as continuous and cumulative, though more recently some scholars have stressed the discontinuities. Also, the history of linguistics has had to deal with the vastness of the subject matter. Early developments in linguistics were considered part of philosophy, rhetoric, logic, psychology, biology, pedagogy, poetics, and religion, making it difficult to separate the history of linguistics from intellectual history in general, and, as a consequence, work in the history of linguistics has contributed also to the general history of ideas. Still, scholars have often interpreted the past based on modern linguistic thought, distorting how matters were seen in their own time. It is not possible to understand developments in linguistics without taking into account their historical and cultural contexts. In this chapter I attempt to present an overview of the major developments in the history of linguistics, avoiding these difficulties as far as possible. 2 Grammatical Traditions A number of linguistic traditions arose in antiquity, most as responses to linguistic change and religious concerns. -

Structural Linguistics Citation for Published Version: Joseph, JE 2015, Structural Linguistics
Edinburgh Research Explorer Structural linguistics Citation for published version: Joseph, JE 2015, Structural linguistics. in K Allan (ed.), The Routledge handbook of linguistics. Routledge, London & New York, pp. 431-446. <http://translate.google.co.uk/translate?hl=en&sl=fr&u=http://www.droz.org/en/revues/%3Fcollection_id%3D 17&ei=pg5zT_uDNcrd8AOwleTdDw&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&sqi=2&ved=0CCYQ7gEwAA &prev=/search%3Fq%3Dcahiers%2Bferdinand%2Bde%2Bsaussure%26hl%3Den%26client%3Dfirefox- a%26rls%3Dorg.mozilla:en-GB:official%26biw%3D1264%26bih%3D815%26prmd%3Dimvns> Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: The Routledge handbook of linguistics General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 STRUCTURAL LINGUISTICS John E. Joseph 1 Introduction The term ‘structural linguistics’ gained currency quite quickly starting in 1940, in both English and French. It was generally associated with the approach set out in the Cours de linguistique générale (Course in General Linguistics), published in 1916 and based on lectures given at the University of Geneva by Ferdinand de Saussure (1857-1913) between 1907 and 1911. -

The History of the Concept of Grammaticalisation
THE HISTORY OF THE CONCEPT OF GRAMMATICALISATION VOLUME I by Therese Åsa Margaretha Lindström Submitted for the degree of PhD Department of English Language and Linguistics, University of Sheffield June 2004 TABLE OF CONTENTS Table of Contents ..........................................................................................................i VOLUME I .................................................................................................. V Acknowledgements .....................................................................................................vi List of Abbreviations ............................................................................................... viii Part 1: Introduction..................................................................................9 1. Introduction............................................................................................................10 1.0.1 Grammaticalisation Defined? .....................................................................13 1.0.2 The History of the Concept of Grammaticalisation....................................14 1.1 Aims and Objectives...........................................................................................14 1.2 Methodology ......................................................................................................18 1.2.1 A General Methodology of the Historiography of Linguistics...................19 1.2.1.1 Metalanguage.......................................................................................22 -

Collègede France 1968And 1969
138mm ÉM ‘Émile Benveniste was a giant whose influence has been felt ILE across semiotics and linguistics. Yet, as John E. Joseph says in the Be Introduction to his much anticipated magisterial translation of N Benveniste’s final lectures, many have “seen his work referred to ve reverentially, but have not necessarily read it themselves”. Ranging NI s across language, writing and general semiology, the sixteen lectures T presented here, along with notes for a seventeenth, will serve as a e coruscating introduction for the uninitiated Anglophone and as a reminder of the greatness of Benveniste for the already converted.’ Last Lectures: Collège Last Lectures: Paul Cobley, Middlesex University London Benveniste’s lectures had a shaping influence on a generation of scholars that Collège de includes Barthes, Deleuze, Bourdieu, Derrida, Kristeva and Todorov. Here, for the first time, these lectures are made available in English for a new generation of linguists and philosophers of language. This book includes the full course of lectures that Benveniste gave in the Collège de France on the Rue des Écoles in France Paris between December 1968 and December 1969. Benveniste’s work as offered here presents the first serious attempt at reconciling the sign theories of Saussure and Peirce and draws together language, writing and society into a comprehensive 1968 and theory of signifying. Benveniste’s philosophy of language considers key concepts such as utterance, enunciation, speaker, discourse and subjectivity and, as such, is de central to the areas of discourse analysis, text linguistics, pragmatics, semantics, France 1968 conversational analysis, stylistics and semiotics. 1969 Key Features: • Introduction from editors Jean-Claude Coquet and Irène Fenoglio ÉMILE • New introduction by the translator John Joseph • Preface by Julia Kristeva • Includes Benveniste’s course of lectures BeNveNIsTe • Afterword by Tzvetan Todorov and ÉmIle BeNveNIsTe (1902–1976) was the pre-eminent linguist in France for 1969 three decades beginning in the late 1930s. -
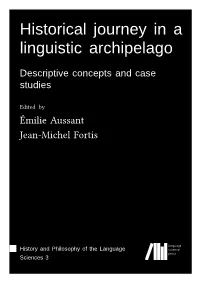
Historical Journey in a Linguistic Archipelago
Historical journey in a linguistic archipelago Descriptive concepts and case studies Edited by Émilie Aussant Jean-Michel Fortis language History and Philosophy of the Language science press Sciences 3 History and Philosophy of the Language Sciences Editor: James McElvenny In this series: 1. McElvenny, James (ed.). Form and formalism in linguistics. 2. Van Rooy, Raf. Greece’s labyrinth of language: A study in the early modern discovery of dialect diversity. 3. Aussant, Émilie & JeanMichel Fortis (eds.). Historical journey in a linguistic archipelago: Descriptive concepts and case studies. ISSN (print): 26291711 ISSN (electronic): 2629172X Historical journey in a linguistic archipelago Descriptive concepts and case studies Edited by Émilie Aussant Jean-Michel Fortis language science press Aussant, Émilie & Jean-Michel Fortis (eds.). 2020. Historical journey in a linguistic archipelago: Descriptive concepts and case studies (History and Philosophy of the Language Sciences 3). Berlin: Language Science Press. This title can be downloaded at: http://langsci-press.org/catalog/book/286 © 2020, the authors Published under the Creative Commons Attribution 4.0 Licence (CC BY 4.0): http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ISBN: 978-3-96110-292-1 (Digital) 978-3-96110-293-8 (Hardcover) ISSN (print): 2629-1711 ISSN (electronic): 2629-172X DOI: 10.5281/zenodo.4269397 Source code available from www.github.com/langsci/286 Collaborative reading: paperhive.org/documents/remote?type=langsci&id=286 Cover and concept of design: Ulrike Harbort Typesetting: Katharina Berking, Felix Kopecky, Sebastian Nordhoff Proofreading: Adrien Barbaresi, Agnes Kim, Amir Ghorbanpour, Annika Schiefner, Aviva Shimelman, Christopher Straughn, Felipe Neis Araujo, Francesco Screti, Jeroen van de Weijer, Jessica Brown, Lachlan Mackenzie, Linda Leembruggen, Plinio Barbosa, Sebastian Nordhoff, Selçuk Eryatmaz, Yvonne Treis Fonts: Libertinus, Arimo, DejaVu Sans Mono, Source Han Serif Typesetting software:Ǝ X LATEX Language Science Press xHain Grünberger Str. -

The Case of Ferdinand De Saussure in Cultural Sociology
Becoming A Dominant Misinterpreted Source: The Case of Ferdinand De Saussure in Cultural Sociology Dustin S. Stoltz University of Notre Dame1 Cultural analysts in sociology typically cite the work of Ferdinand de Saussure to motivate a narrow theory of meaning. In so doing, sociologists incorrectly attribute to Saussure: (1) the postulate that meaning is arbitrary (2) the idea that signs gain meaning only through relations of opposition to other signs, and (3) the view that there is an isomorphic correspondence between linguistic signs and all cultural units of analysis, ergo culture is fundamentally arbitrary, and finally (4) he offers a Durkheimian theory of culture (i.e. Saussure was follower of Durkheim). Saussure’s project, rather, was specific to linguistics, and mainly one of theoretical and methodological clarification regarding phonology. Saussure never intended his analytical model of phonology to apply to the real operation of meaning in general, as done by contemporary interpreters and, furthermore, never argued that meaning is arbitrary. Keywords: Saussure, Durkheim, Linguistics, Cultural Sociology, Arbitrary, Meaning 1 This paper was awarded the 2018 Graduate Student Paper Award from the History of Sociology Section of the American Sociological Association. I would like to thank Omar Lizardo, Vanina Leschziner, and Michael Wood for helpful comments on previous drafts. 1 Sociologists often cite Ferdinand de Saussure to assert that the meaning of cultural elements is fundamentally arbitrary and that signs gain meaning only through relations of opposition to other signs.2 That is, rather than interpreting Saussure as primarily contributing to the philosophy of linguistics (i.e. how language is to be studied as a science), sociologists read his work as foremost an intervention in the philosophy of language (i.e. -

ANCESTRY-CONSTRAINED PHYLOGENETIC ANALYSIS SUPPORTS the INDO-EUROPEAN STEPPE HYPOTHESIS Will Chang Chundra Cathcart
ANCESTRY-CONSTRAINED PHYLOGENETIC ANALYSIS SUPPORTS THE INDO-EUROPEAN STEPPE HYPOTHESIS Will Chang Chundra Cathcart University of California, Berkeley University of California, Berkeley David Hall Andrew Garrett University of California, Berkeley University of California, Berkeley Discussion of Indo-European origins and dispersal focuses on two hypotheses. Qualitative evi - dence from reconstructed vocabulary and correlations with archaeological data suggest that Indo- European languages originated in the Pontic-Caspian steppe and spread together with cultural innovations associated with pastoralism, beginning c. 6500–5500 bp . An alternative hypothesis, according to which Indo-European languages spread with the diffusion of farming from Anatolia, beginning c. 9500–8000 bp , is supported by statistical phylogenetic and phylogeographic analyses of lexical traits. The time and place of the Indo-European ancestor language therefore remain dis - puted. Here we present a phylogenetic analysis in which ancestry constraints permit more accurate inference of rates of change, based on observed changes between ancient or medieval languages and their modern descendants, and we show that the result strongly supports the steppe hypothe - sis. Positing ancestry constraints also reveals that homoplasy is common in lexical traits, contrary to the assumptions of previous work. We show that lexical traits undergo recurrent evolution due to recurring patterns of semantic and morphological change. * Keywords : lexical change, linguistic phylogenetics, Indo-European chronology, Indo-European dispersal, steppe hypothesis This article has three main goals. First, we show that statistical phylogenetic analysis supports the traditional steppe hypothesis about the origins and dispersal of the Indo- European language family. We explain why other similar analyses, some of them widely publicized, reached a different result.