Stéphan VALLÉE SAMUEL DE CHAMPLAIN
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
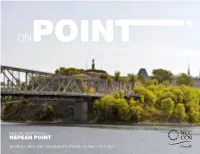
Nepean Point
ON DESIGN COMPETITION NEPEAN POINT STAGE 01 - REQUEST FOR QUALIFICATIONS - AL1682 // 19.01.2017 Request for Qualifications - Stage 01 1 Cover: View of Nepean Point ON POINT ON POINT Design Competition for Nepean Point Stage 01 - Request for Qualifications - AL1682 19.01.2017 Nepean Point - Detail of existing fence TABLE OF CONTENTS A. Summary........................................................................................... p.06 01. Canada’s Capital ........................................................................... p.09 02. The Project .................................................................................... p.13 03. The Design Competition ................................................................ p.29 04. Stakeholders and Partners ........................................................... p.39 05. Additional Information ................................................................... p.46 Appendix 1 - Jury Biographies ............................................................ p.49 A SUMMARY The National Capital Commission (NCC) is pleased to launch the first COMPETITION PROCESS phase of a two-stage international design competition for Nepean Point, a promontory at the symbolic heart of Canada’s Capital, Ottawa. In the midst All interested design teams are invited to participate, but teams must be of numerous important public and private cultural institutions, the Nepean led by a landscape architect eligible to be licensed in Ontario, Canada. Point competition site, including two entranceways, is -

Monuments and Memories in Ontario, 1850-2001
FORGING ICONOGRAPHIES AND CASTING COLONIALISM: MONUMENTS AND MEMORIES IN ONTARIO, 1850-2001 By Brittney Anne Bos A thesis submitted to the Department of History In conformity with the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada (September 2016) Copyright ©Brittney Anne Bos, 2016 ii Abstract Commemorations are a critical window for exploring the social, political, and cultural trends of a specific time period. Over the past two centuries, the commemorative landscape of Ontario reaffirmed the inclusion/exclusion of particular racial groups. Intended as static markers to the past, monuments in particular visually demonstrated the boundaries of a community and acted as ongoing memorials to existing social structures. Using a specific type of iconography and visual language, the creators of monuments imbued the physical markers of stone and bronze with racialized meanings. As builders were connected with their own time periods and social contexts, the ideas behind these commemorations shifted. Nonetheless, creators were intent on producing a memorial that educated present and future generations on the boundaries of their “imagined communities.” This dissertation considers the carefully chosen iconographies of Ontario’s monuments and how visual symbolism was attached to historical memory. Through the examination of five case studies, this dissertation examines the shifting commemorative landscape of Ontario and how memorials were used to mark the boundaries of communities. By integrating the visual analysis of monuments and related images, it bridges a methodological and theoretical gap between history and art history. This dissertation opens an important dialogue between these fields of study and demonstrates how monuments themselves are critical “documents” of the past. -

Painting and Sculpture in Canada
PAINTING AND SCULPTURE IN CANADA M. 0. HAMMOND HEN Louis Jobin, the wood carver of Ste. Anne de Beaupre, W passed away in 1928, at the age of 86, he severed a link which united primitive and modern art in Canada. Through his long life he had created figures in wood, the last of a noted line of artists in their own field. Ancient calvaires beside Quebec highways, fading wooden Indians in front of cigar stores, surviving figure heads on sailing ships, religious figures on the fa~ades of French Canadian churches, as at Ste Famille on Isle d 'Orleans, dating from 1749---these are relics of the wood-carving age in Canadian art, that may be found by diligent search. Jobin's own life spanned the developing years of the newer art in Canada, the art of painting. We may pass over the efforts of the Indians, visible in the decorative totem poles, carvings in bone, shell and ivory, and the painted ceremonial faces of the red men, and ignore the efforts of educated Frenchmen in the days of New France. If art in Canada lacked adequate support almost down to the relatively fat times of to-day, how much less could it thrive in the era of the explorer and the coureur-de-bois? There has been virtually a century of painting in Canada, from the days of Paul Kane, Cornelius Krieghoff and George T. Berthon, to the present, and half way down that century occurred in 1880 the organization of the Royal Canadian Academy, the jubilee of whose launching is being observed in this year 1930. -

Tonya Katherine Davidson
University of Alberta Stone Bodies in the City: Unmapping Monuments, Memory and Belonging in Ottawa by Tonya Katherine Davidson A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Sociology ©Tonya Katherine Davidson Fall 2012 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. This dissertation is dedicated to my parents Tom and Katherine Davidson. Abstract In this ethnographic study of the dynamic lives of a population of monuments in Ottawa, I argue that long after they have been unveiled, monuments are imbued with many capacities to act. Monuments inspire loathing or affection, and settle or disturb dominant understandings of place, nation, race, and gender. I suggest that monuments have these affective capabilities because they operate like ‘stone bodies’ in their urban environments. Additionally, spirited with a certain life-force, monuments have the ability to haunt, unsettling relationships between place, memory, and belonging. These affective charges of monuments are felt and expressed through articulations of imperial and colonial nostalgia, feminist and other activist mobilities and various articulations of patriotism. -

Request for a Standing Offer Agreement (Rfso) Maintenance & Conservation of Ncc Cultural Assets National Capital Commission (Ncc) Tender File # Nr209
REQUEST FOR A STANDING OFFER AGREEMENT (RFSO) MAINTENANCE & CONSERVATION OF NCC CULTURAL ASSETS NATIONAL CAPITAL COMMISSION (NCC) TENDER FILE # NR209 REQUEST FOR A STANDING OFFER (RFSO) ADDRESS ENQUIRIES TO: BID DEADLINE: Nathalie Rheault, Sr. Contract Officer [email protected] June 9, 2021 at 3:00pm EDT [email protected] RETURN TO: Submit your proposal, price, including this Subject line of e-mails must make cover page and return to: reference to the NCC tender number: Paper copy and faxes are no longer accepted. All bids NR209 Maintenance & Conservation of must be forwarded to this email address only. Non- compliance with this requirement will result in NCC Cultural Assets disqualification of your tender. Note: the email attachment size is set at a maximum of 150 MB. This page is to be dated, signed and returned with your proposal, thereby acknowledging having read, understood and accepted the Terms of Reference of this RFSO which includes all other attachments referred to herein. We hereby OFFER to sell and/or supply to the National Capital Commission upon the terms and conditions set out herein, the supplies and/or services listed above and on any attached sheets at the submitted price(s). Consultant’s Name & Address Print Name Signature Tel: Email(s): Date ADDENDUM ACKNOWLEDGEMENT: I/We __________________________________ acknowledge receipt of the following addendums and Bidder to enter the number of addendums have included for the requirement of it/them in my/our issued (i.e. #1, #2, etc.) if any. tendered price: 202-40 Elgin Street, Ottawa, Canada K1P 1C7 40, rue Elgin, pièce 202, Ottawa, Canada K1P 1C7 Page 1 of 7 REQUEST FOR A STANDING OFFER AGREEMENT (RFSO) MAINTENANCE & CONSERVATION OF NCC CULTURAL ASSETS NATIONAL CAPITAL COMMISSION (NCC) TENDER FILE # NR209 1.0 INSTRUCTIONS TO BIDDERS 1.1 Submit your technical proposal and financial proposal to provide services for the National Capital Commission (referred to as the "Commission" or the "NCC"), as described in the attached Terms of Reference document. -

Jvaanriaitntt Nî (Eanata
Oh* JVaanriaitntt nî (Eanata dottïte Eatahllelfro in (Banana 8>Qmt ijftatorir BiUB ...t«... Œanaoa anb Nerofnnnblanb Annual Strçrurt 19ir Qfat J\a00riattan o, au* E:;iablitïlnù in (Cauaba #0m? étaient &\UB ...ttt. (Eanana ann NpuifmtttMatrâ Annual BiUnurt RE -LAYING OF THE CORNER STONE OF THE NEW PARLIAMENT BUILDINGS BY HIS ROYAL HIGHNESS THE DUKE OF CONNAUGHT. GOVERNOR-GENERAL OF CANADA. 1ST OF SEPT.. 1916 PAGE 30 îfy'iBtuvu IGanômarka Àfiaonation nf Ûlattaba Patron FIELD MARSHAL HIS ROYAL HIGHNESS, THE DURE OF OONNAUGHT AND STRATHEARN, K.G., G.C.M.G., Etc. Visitor HIS EXCELLENCY THE DUKE OF DEVONSHIRE, K.G., G.C.M.G., Etc. Governor General of Canada. Honorary President THE RT. HONORABLE .SIR ROBERT LAIRD BORDEN, P.C., G.C.M.G. Prime (Minister. President PEMBBRTON SMITH, Esq., Montreal. Vice-Presidents P. B. CASGRAIN, Esq., K.C., Quebec. W. D. LIGHTHALL, KJC, F.R.S.C., Montreal. SIR EDMUND WALKER, C.V.O., LLJD., FJLS.C, Toronto. General Secretary MRS. J. B. SIMPSON, 173 Percy St., Ottawa. French Secretary BENJAMIN SULTE, LLJD., F.R.S.C, Ottawa. Treasurer GEORGE DURNFORD, Esq., FJCA., Montreal. COUNCIL—-The.President, Vice-iPresidents, Secretaries, Treasurer, all subscribing Fellows of Sections I and II of the Royal Society of Canada, and one representative from each corresponding Society (with power to add.) ANNUAL MEETING—Held yearly in connection with the meeting of the Royal Society of Canada. 3 GUIDE. TO "HISTORICAL SOCIETIES" ESTABLISHED IN CANADA. (Corresponding Members of the Historic Landmarks Association) ANTIQUARIAN AND NUMISMATIC SOCIETY OP MONTREAL. Chateau de Ramezay. W. D. Lighthall, Esq., K.C., F.R.S.C, President, Quebec Bank Building, Montreal, Que. -

(Title of the Thesis)*
BECKONING BODIES, MAKING SUBJECTS: INTERACTIVE AND IMMERSIVE TECHNOLOGIES IN CANADIAN MUSEUMS, 1967-2014 by May Chew A thesis submitted to the Department of Cultural Studies In conformity with the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Queen’s University Kingston, Ontario, Canada (March, 2015) Copyright © May Chew, 2015 Abstract Focusing on the uses of interactive and immersive technologies in Canadian exhibits from 1967 to the present, this dissertation investigates how embodied rites of cultural citizenship summon subjects to interface with nation and heritage in supposedly postcolonial and multicultural frameworks. The technologies I examine encompass the diverse processes and materials that render abstract notions of nation, heritage and citizenship into tangible archives that we encounter directly through our bodies. The first chapter centres on Iris Häussler’s immersive installation, He Named Her Amber, staged in Toronto’s historic Grange manor in 2008. This work elucidates the processes through which settler colonial history is rebranded through neoliberal Creative City discourses, and the audience is affectively positioned as naturalized settler who, unlike displaced Indigenous communities, is endowed with the right to occupy the home. Following this, the National Gallery of Canada’s introduction of the audio guide for its monumental 1967 Centennial exhibit provides the historical context from which to investigate the celebration and consecration of Canada’s technological modernity. This chapter analyzes how the construction of an interactive art-historical audio-scape facilitated the citizen’s entrance into national modernity through technological access and participation. The next chapter surveys the implementation of digital touchscreens at UBC’s Museum of Anthropology, arguing that the expanded haptic interface is drafted as both material and rhetorical apparatus to strategically proclaim inclusive, multicultural paradigms. -
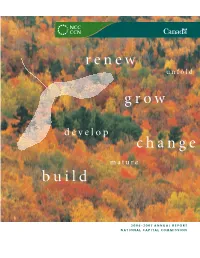
Annual Report, 2006–2007
COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE CAPITALE LA DE COMMISSION RAPPORT ANNUEL 2006-2007 ANNUEL RAPPORT renew édifier unfold grandir grow changer progresser RAPPORT ANNUEL 2006-2007 COMMISSION DE LA CAPITALE NATIONALE DE LA CAPITALE COMMISSION ANNUEL 2006-2007 RAPPORT develop 2006–2007 ANNUAL REPORT NATIONAL CAPITAL COMMISSION CAPITAL NATIONAL REPORT 2006–2007 ANNUAL change croître mature éclore build devenir 2006–2007 ANNUAL REPORT NATIONAL CAPITAL COMMISSION ISBN: ISBN: 978-0-662-69946-0 Catalogue number: W number: Catalogue 91-2007 2006–2007 Annual Report: A Capital in Evolution in Capital A Report: Annual 2006–2007 Table des matières Commission Capital National 2 Message du président 3 Message de la première dirigeante 76 NCC Contact Information Contact NCC 4 Introduction 75 12 Faits saillants de l’année Terms of Glossary III: Appendix 74 14 À propos de la CCN Sponsors and Partners NCC II: Appendix 16 Gouvernance Committees Advisory and 72 Appendix I: NCC Committees to the Board the to Committees NCC I: Appendix Récapitulation de l’année 72 24 Appendices 24 Activité de programme I : Animation et promotion 60 de la capitale Statements Financial to Notes 55 28 Activité de programme II : Planification, design 2006–2007 Statements, Financial 40 et utilisation des sols Analysis and Discussion Management 38 30 Activité de programme III : Gestion des biens immobiliers Services Corporate IV: Activity Program 35 Le parc de la Gatineau 35 Gatineau Park Gatineau 38 Activité de programme IV : Services généraux 30 Program Activity III: Real Asset -

Le Souvenirs De La Famille Perron
Le ulletin BBulletin no 18 Décembre 2007 Souvenirs de la famille Perron ous consacrons une bonne partie de ce numéro à la N famille Perron. Ces protestants convaincus ont marqué de leur action le milieu canadien-français et nous voulons ici leur rendre hommage. Plongeons d’abord dans les souvenirs de Wilfrid-Henri Perron qui se remémore ses débuts à l’Institut de la Pointe-aux-Trembles en 1911 et un premier Noël loin de chez lui. Nous donnerons ensuite quelques indications sur sa vie, sa famille et son entreprise. Un autre Perron, Louis, paysagiste de renom, mérite aussi qu'on souligne ses réalisations. n o r r La famille Perron e P s D’après un manuscrit inédit de Wilfrid-Henri Perron, voici i u o L comment la famille se serait convertie. Son père Arthur et sa m mère Olivine Gagnon étaient de bons catholiques et ils ont bap - u b l A tisé leurs premiers enfants selon les règles. Ils avaient accepté un : e c jour qu’un colporteur méthodiste leur laisse une bible. S’ils la r u o trouvaient intéressante, il viendrait se la faire payer plus tard. S Olivine qui savait lire et écrire 1 trouvait ce livre tout à fait à son Arthur et Olivine Perron vers 1898 goût et y intéressa son mari. Survient alors le curé qui aperçoit (Arthabaska) dans la région des Bois-Francs 6. Huit années la Bible sur la table de la cuisine et interdit à Arthur de la lire et durant, Arthur et sa famille regagnait en hiver l’usine des États- lui ordonne même de la brûler. -

OUR STORIES in STONE PART 1 in Ottawa, We're So
OUR STORIES IN STONE PART 1 In Ottawa, we’re so accustomed to statues and memorials that we no longer see them. They are … Sites unseen CHRIS MIKULA, THE OTTAWA CITIZEN But Citizen writer ROBERT SIBLEY and photographer CHRIS MIKULA, left, stopped to take a closer look. Here are their impressions of our memorials — and what they tell us about ourselves and the soul of the city. Stopping among statues Monuments are stories in stone and bronze that reflect who we are and where we came from. Here in Ottawa, we’re so used to these memorials that we no longer see them. But say you made time to stop? Where would you go? And where would it take you? ROBERT SIBLEY finds out on a hunt for the soul of the city CHRIS MIKULA , THE OTTAWA CITIZEN Simply walking by Sir Galahad will be harder to do once you know the story of the brave and selfless Henry Albert Harper. verybody ignores Sir Galahad. For one, to stop at Sir Galahad, a statue flip-flops take pictures of each other be- an hour I’ve been parked on a dedicated a century ago to the memory neath the famous cross-country runner’s Ebench at the corner of Metcalfe of Henry Albert Harper that occupies bronze legs, natural and artificial. A mid- and Wellington streets, watching early prime real estate on Wellington in front dle-aged couple in shorts and sun hats morning strollers, office workers and of a Parliament Hill gate. follow suit. Another young couple reads tourists. -

Manuscript Collection in the Toronto Public Libraries
GUIDE TO THE MANUSCRIPT COLLECTION IN THE TORONTO PUBLIC LIBRARIES TORONTO PUBLIC LIBRARIES 1954 GUIDE TO THE MANUSCRIPT COLLECTION IN THE TORONTO PUBLIC LIBRARIES TORONTO PUBLIC LIBRARIES 1954 PRINTED IN CANAllA THORN PRESS, TORONTO PREFATORY NOTE The manuscript collection of the Toronto Public Libra~ies consists mainly of Canadian, and more particularly of Upper CanadIan historical manuscripts, with a few British and American items. There are several large sets of personal papers and many single pieces, in cluding diaries, account-books, letter-books, and single documents. The collection has grown steadily since it was begun in 1886 with the purchase by Dr. James Bain, historian, collector, and first librarian, of the manuscript, An account of the Seven Years' War, 1757-1759. About the turn of the century half a dozen large sets were given to the library by Toronto families whose members have been outstanding in the early history of the country. Through the years the collection has been en riched by the gifts of generous and history-minded benefactors, and by purchase. In the more recent acquisitions there is greater emphasis on business history, and on regions farther afield from Toronto. A Preliminary guide to the manuscripts was published in 1940. It was intended to be no more than a rough guide to be used until sufficient work on the material warranted the publication of a definitive catalogue. Now, fourteen years later, it is again necessary to apologize for the long uncalendared sets, the unidentified or undated single pieces. The work goes steadily on, but if the public are to know and use the large number of acquisitions since 1940, another preliminary guide is needed. -

Under the Astrolabe with Hercules
Under the Astrolabe with Hercules Fig. 1, S1, S2, S3. Samuel de Champlain with astrolabe, Ottawa. "And I built in Urbs in Rure, for minne elskede, my shiny brows, under astrolobe from my upservatory, an erd- closet"(551.24-26) Enclosed within a very long sentence (see ST1) the above line describes, on one level, the monument to Samuel de Champlain1, 17th century explorer and cartographer, atop Nepean Point, overlooking the Rideau Canal where it steps down to the Ottawa River, Ottawa. The sentence is constituted of 680 words however the density of these words and passage, as well as the echoes farther afield, are vast. The “:” technique which Joyce uses, in this sentence, appears to allow a change in narrator over a range of subjects, places, and times. In this particular case (550-552), the sentence displays a layering of themes much like Fig. 2, S4. Topo sheet 31G/5, the stack of scribable acetates that were Ottawa. used in creating a topographical (Ordnance Survey) map during the last century: separate layers for relief (contour lines mimicking hills, ravines and so on -- natural or man-made); drainage (rivers! lakes, bogs, estuaries...); vegetation; settlement (towns, mines, military installations...); transportation (railways, roads...); cultural features (edifices, monuments, historical landmarks...); and coordinates (Lat. & Long., UTM); reference marks for alignment before photographing; much like separate Ukiyo-E wood blocks for each colour are aligned on reference points to produce one print). I mean to review the part of the sentence contained by page 551 (see ST1) in relation, mostly, to the colossus theme of Finnegans Wake2, of which Champlain is a member.