Realisation Des Infrastructures Et Analyses Del L’Eau Pour Un
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tana Lsms Hh
This PDF generated by katharinakeck, 1/24/2017 10:08:32 AM Sections: 10, Sub-sections: 38, Questionnaire created by opm, 8/4/2016 10:22:56 AM Questions: 366. Last modified by katharinakeck, 1/24/2017 3:00:47 PM Questions with enabling conditions: 206 Questions with validation conditions: 30 Shared with: Rosters: 18 opm (last edited 10/19/2016 10:14:02 AM) Variables: 34 aarau (last edited 10/25/2016 9:18:23 AM) seanoleary (last edited 10/17/2016 4:20:41 PM) arinay (never edited) rharati (never edited) kirsten (never edited) andrianina (never edited) mmihary_r (never edited) sergiy (never edited) janaharb (last edited 10/21/2016 4:55:02 PM) opm (last edited 10/19/2016 10:14:02 AM) gabielte (never edited) TANA_LSMS_HH START Sub-sections: 4, No rosters, Questions: 23, Variables: 5. CONSENT FORM No sub-sections, No rosters, Questions: 1, Static texts: 2. ROSTER No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 5, Static texts: 2, Variables: 2. RESPONDENT SELECTION No sub-sections, No rosters, Questions: 7, Variables: 3. MAIN RESPONDENT Sub-sections: 22, Rosters: 10, Questions: 236, Static texts: 4, Variables: 5. CONSUMPTION Sub-sections: 6, Rosters: 5, Questions: 18, Static texts: 4, Variables: 13. HOUSEHOLD HEAD Sub-sections: 2, Rosters: 1, Questions: 18, Static texts: 1, Variables: 3. LABOUR Sub-sections: 4, Rosters: 1, Questions: 42, Variables: 3. OBSERVATIONS No sub-sections, No rosters, Questions: 12. RESULT No sub-sections, No rosters, Questions: 4. APPENDIX A — INSTRUCTIONS APPENDIX B — OPTIONS APPENDIX C — VARIABLES LEGEND 1 / 65 START EA ID NUMERIC: INTEGER ea_id SCOPE: PREFILLED DWELLING ID NUMERIC: INTEGER dwllid SCOPE: PREFILLED TYPE DWELLING ID AGAIN NUMERIC: INTEGER dwllid2 V1 self==dwllid M1 Dwelling ID does not match V2 ea_id*100+1<=self && self <=ea_id*100+30 M2 Dwelling ID and EA ID do not match VARIABLE DOUBLE dwlnum dwllid-100*ea_id THIS IS A REPLACEMENT DWELLING. -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Cas De La Commune Rurale Talata Volonondry
UNIVERSITE DE TANANARIVE FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE DEPARTEMENT SOCIOLOGIE MEMOIRE DE MAITRISE ________________________________ DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT : CAS DE LA COMMUNE RURALE TALATA VOLONONDRY Présenté par : RANDRIANATOANDRO Ny Onjamiampitasoa Sambatra Rapporteur : Monsieur Razafindralambo Martial Année universitaire : 2006-2007 Date de soutenance : 12 Avril 2007 DECENTRALISATION ET DEVELOPPEMENT : CAS DE LA COMMUNE RURALE TALATA VOLONONDRY REMERCIEMENTS Ce travail n’aurait pu être accompli sans la contribution d’honorables personnalités envers lesquelles je tiens à exprimer toute ma gratitude, à savoir : - Madame RAZAFINDRALAMBO Martial, notre encadreur de recherche, qui a bien voulu nous orienter dans le cadre de cette étude. Sans son aide, ce travail n’aurait pu être mené à terme. - En outre, nous sommes redevables de l’aide technique sincère de tous les membres de l’équipe de la commune rurale Talata Volonondry - Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à toutes les personnes enquêtées, sans oublier celles qui, de loin ou de près, nous ont apporté leur contribution. Qu’ils soient tous assurés de notre profonde gratitude ! SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE I- CADRE GENERAL DE L’ETUDE I-1: Cadre théorique I-2 : Etat des lieux Conclusion partielle II- LES ATOUTS ET LES BLOCAGES DE LA COMMUNE POUR LA REUSSITE DE LA DECENTRALISATION II-1: Les atouts de la commune pour la réussite de la décentralisation II-2: Les blocages de la commune dans le cadre de la décentralisation. Conclusion partielle III - ESSAI DE PROPOSITIONS DE SOLUTIONS. III-1: Solutions avancées par l’Etat. III-2: Les stratégies avancées par la commune pour la réussite de la décentralisation. -

Gunnar Färber Minerals Systematic - Minerals from All Over the World 2020/05/17
Gunnar Färber Minerals Systematic - Minerals from all over the world 2020/05/17 Afwillite xls Zeilberg Quarry, Maroldsweisach, Lower Franconia, Bavaria / Germany; Colorless long prismatic crystals of 5 mm, rich on elongated cavities of fossil belemnites (squid) in metamorphic limestone.; KS 28,00; NS 65,00 Ammoniotinsleyite xls Punta de Lobos, 90 km south of Iquique, I Region, Tarapaca / Chile; Pinkish crystals of up to 1 mm, in addition to colorless small gypsum crystals on large fracture zones in granodiorite. Pretty and richly specimens of the rare new Ammonium-Phosphates. KS 85,00; NS 125,00 Avicennite xls Lookout Pass Thallium Prospect, Little Valley, Sheeprock Mts., Vernon, Tooele Co., Utah / USA; The exceptionally rare Thallium-Oxide, forms deep dark brown, iridescent (blue-green-yellow), spherical crystal aggregates around 2 mm in size, on leaching cavities in black Jasper. Old newly examined samples from the original material, found around 1987; KS 48,00 Azurite xls Gunsight Pass, Helvetia, Santa Rita Mts., Pima Co., Arizona / USA; Blue spherical crystal aggregates of 4 mm, rich in addition to green spherical Malachite on rhyolite matrix. Pretty Azurite specimens from a "rare location"; NS 28,00; HS 38,00 Baghdadite xls Fuka Mine, Bicchu-cho, Takahashi City, Okayama Pref. / Japan; Light pinkish brown (fluorescent in UV-light bright yellow) crystal aggregates of 5 mm, together with some dark brown perovskite in calcite matrix. Excellent specimens of the rare Zirconium Silicate. KS 48,00; NS 95,00 Borcarite xls Fuka Mine, Bicchu-cho, Takahashi City, Okayama Pref. / Japan; Light green crystal aggregates of 5 mm in size made of small diamond-lustery borcarite crystals. -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Cadre Politique De Réinstallation Des Populations (CPRP) Rapport Final
Octobre 2019 Cadre Politique de Réinstallation des Populations (CPRP) Rapport final Accord-cadre pour le soutien des activités des services de conseil de la BEI à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE des 28 LOT 1: ENVIRONNEMENT Etude préparatoire du projet AEP Antananarivo TA 2017151MGIF3 Contrat CC10192 BANQUE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT MADAGASCAR ACCORD-CADRE POUR LE SOUTIEN DES ACTIVITES DES SERVICES DE CONSEIL DE LA BEI A L’INTERIEUR ET A L’EXTERIEUR DE L’UE DES 28 Lot 1 – Environnement TA 2017151MGIF3 Contrat CC10192 Etude préparatoire du projet AEP Antananarivo Cadre Politique de Réinstallation des Populations Rapport final Octobre 2019 Composition de l’équipe: Marie D’ARIFAT – Chef d’équipe Pascal DE GIUDICI – Expert environnemental et social Valérie AUDIBERT – Economiste Tiana RAKOTONDRAINIBE – Expert en aspects sociaux Aline MAGRA – Expert en santé et sécurité au travail Projet mis en œuvre par: ESPELIA & SEURECA « La présente opération d’assistance technique est financée dans le cadre de l’Accord de partenariat de Cotonou. Cet accord prévoit des aides non remboursables pour appuyer l’activité d’investissement que la BEI déploie dans les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. » « Les auteurs assument l’entière responsabilité du contenu du présent rapport. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’avis de l’Union Européenne ni celui de la Banque Européenne d’Investissement. » Accord-cadre pour le soutien des activités des services de conseil de la BEI à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE des 28 Etude préparatoire -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Faritany Region District Commune
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana – Tanindrazana – Fandrosoana COMMISSION ELECTORALE NATIONALE INDEPENDANTE _______________ ANNEXE DE LA DELIBERATION N°012 /CENI/D/2020 DU 12 OCTOBRE 2020 Fixant la liste et l’emplacement des bureaux de vote pour les élections sénatoriales de 2020 FARITANY REGION DISTRICT COMMUNE FOKONTANY CV CODE BV EMPLACEMENT BV ANTANANARIVO ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO AMBOHIDRATRIMO AMBOHIDRATRIMO TRANOMPOKONOLONA 110101 TRANOMPOKONOLONA ANTANANARIVO ANALAMANGA ANDRAMASINA ANDRAMASINA ANDRAMASINA TRANOMPOKONOLONA ANDRAMASINA 110201 TRANOMPOKONOLONA ANTANANARIVO ANALAMANGA ANJOZOROBE ANJOZOROBE ANJOZOROBE TRANOMPOKONOLONA 110301 TRANOMPOKONOLONA ANTANANARIVO ANALAMANGA ANKAZOBE ANKAZOBE ANKAZOBE I BUREAU FKT ANKAZOBE I 110401 BUREAU FKT ANKAZOBE I ANTANANARIVO ANALAMANGA ANTANANARIVO-ATSIMONDRANO BEMASOANDRO ANOSIMASINA COMMUNE 110501 SALLE DE MARIAGE ANTANANARIVO ANALAMANGA ANTANANARIVO AVARADRANO SABOTSY NAMEHANA NAMEHANA LAPAN'NY TANANA 110601 LAPAN'NY TANANA ANTANANARIVO ANALAMANGA ANTANANARIVO-RENIVOHITRA C.U ANTANANARIVO NANISANA BUREAU CER ANALAMANGA 110701 BUREAU CER ANALAMANGA ANTANANARIVO ANALAMANGA MANJAKANDRIANA C.U MANJAKANDRIANA MANJAKANDRIANA BUREAU CED 111301 BUREAU CED ANTANANARIVO BONGOLAVA FENOARIVOBE FENOARIVOBE FENOARIVOBE TRANOMPOKONOLONA 120101 TRANOMPOKONOLONA ANTANANARIVO BONGOLAVA TSIROANOMANDIDY C.U TSIROANOMANDIDY TSIROANOMANDIDY ATSIMO BUREAU CED 120201 BUREAU CED ANTANANARIVO ITASY ARIVONIMAMO Arivonimamo I Arivonimamo Centre Lapan'ny Tanana Arivonimamo I 130101 Salle de mariage ANTANANARIVO -
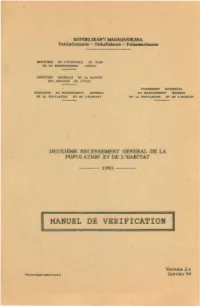
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

Liste Des Officines a Madagascar - Decembre 2020
LISTE DES OFFICINES A MADAGASCAR - DECEMBRE 2020 PHARMACIENS TITULAIRES / Année de PHARMACIES ADRESSE N° TEL. ADRESSE E MAIL ASSOCIES / GERANTS création REGION ANALAMANGA ANTANANARIVO RENIVOHITRA : 78 ARRONDISSEMENT TANA I : 23 Mme RASAMOELY Nampoina 39 rue Ratsimilaho Pharmacie PERGOLA 22 237 17 [email protected] 1963 Priscilla Antaninarenina B.P.756 8, Bloc Commercial Sud Cité Pharmacie des 67 HA SARLU Mme RAKOTOSOA Marthe des 67 Ha en face Eglise 22 253 61 [email protected] 1972 Luthérienne 10, rue Indira Gandhi, 22 207 37 Pharmacie NOUVELLE Mme RABIA Bakoly [email protected] 1973 Tsaralalana 034 22 370 03 Pharmacie de l'OCEAN INDIEN M. RAKOTOMAMPIANDRA 18, avenue de l'Indépendance 22 224 70 [email protected] 1975 SARL Georges Mlle RANDRIANASOLO RAMANGALAHY Kaithy Princia (Pharmacien Responsable 22 236 81 Pharmacie d'ANALAKELY Sarl Stagiaire) 3, rue Refotaka Analakely pharmari@moov,mg 1980 032 07 236 34 M. RANDRIANASOLO Jean Charles (tuteur) 22 286 85 Pharmacie FANOMEZANTSOA Mme RAJONSON Anna Lot près II D 4 Ambondrona [email protected] 1989 033 02 207 53 Mme RAHARINIRINA Hantamalala Pharmacie d'ISORAKA Société 34 Avenue Grandidier Isoraka 22 285 04 [email protected] 1990 en commandite Simple M. RANDRIANARIMANANA Nirina Fanomezana (Pharmacien assistant) Pharmacie 56, Avenue du 26 juin 1960, 22 234 04 Mme RAZAFIMANDRANTO Sylvia [email protected] 1990 RAZAFIMANDRANTO Analakely 22 22890 Bloc 4 logement 3, cité des Pharmacie MAMY M. RANDRIAKOTO Mamy 22 318 21 [email protected] 1991 67Ha Nord-Est Pharmacie d'AMPEFILOHA Mme RAKOTOVAO Daniela Logt n° 433 Ampefiloha 22 249 57 pharmacieampefiloha @blueline.mg 1993 18, rue Andrianampoinimerina Pharmacie IARIVO Mme RABODOLALAO Antoinette 22 224 26 [email protected] 1993 Analakely M. -

Quantification of Antimalarial Medicines Requirements for Madagascar
Quantification of Antimalarial Medicines Requirements for Madagascar Grace Adeya Jean Désiré Rakotoson April 2005 Rational Pharmaceutical Management Plus Center for Pharmaceutical Management Management Sciences for Health 4301 N. Fairfax Drive, Suite 400 Arlington, VA 22203 Phone: 703-524-6575 Fax: 703-524-7898 E-mail: [email protected] Supported by U.S. Agency for International Development Quantification of Antimalarial Medicines Requirements for Madagascar This report was made possible through support provided by the U.S. Agency for International Development, under the terms of cooperative agreement number HRN-A-00-00-00016-00. The opinions expressed herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the U.S. Agency for International Development. About RPM Plus The Rational Pharmaceutical Management Plus (RPM Plus) Program, funded by the U.S. Agency for International Development (cooperative agreement HRN-A-00-00-00016-00), works in more than 20 developing countries to provide technical assistance to strengthen drug and health commodity management systems. The program offers technical guidance and assists in strategy development and program implementation both in improving the availability of health commodities—pharmaceuticals, vaccines, supplies, and basic medical equipment—of assured quality for maternal and child health, HIV/AIDS, infectious diseases, and family planning and in promoting the appropriate use of health commodities in the public and private sectors. This document may be reproduced if credit is given to RPM Plus. Please use the following citation. Recommended Citation Adeya, G., and J. D. Rakotoson. 2005. Quantification of Antimalarial Medicines Requirements for Madagascar. Submitted to the U.S. Agency for International Development by the Rational Pharmaceutical Management Plus Program.