Dossier De Presse
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Illuminating the Old Masters and Enlightening the British Public
Illuminating the Old Masters and Enlightening the British Public: Anna Jameson and the Contribution of British Women to Empirical Art History in the 1840s Susanna Avery-Quash Within the Victorian art world, the wind of change was signalled early on in a very visible way when, in April 1838, the Queen opened the National Gallery in its new, purpose-built home on Trafalgar Square. The relocation from its original cramped quarters at 100 Pall Mall, where the gallery had been since its foundation in 1824, would have brought to mind the recent debates addressed by a select committee of 1835 concerning the public util- ity of art institutions including the adequacy of the national collection and its future purpose.1 Numerous other governmental inquiries would pursue these matters in the 1840s and 1850s, culminating in the select committee of 1853, which led to the gallery’s reconstitution in 1855. Outside Parliament a host of voices was also lobbying for change, among them Anna Jameson, a well-known figure in her day.2 Her contribution is notable because she was a woman in a male-dominated arena and because her message was heard early on and by a wide audience. With the recent interest in women’s con- tributions to scholarship, her work has been re-evaluated, especially in rela- tion to what she published on early Italian art and religious iconography.3 1 On this topic, see Nicholas M. Pearson, The State and the Visual Arts: A Discussion of State Intervention in the Visual Arts in Britain, 1760–1981 (Milton Keynes: Open University, 1982); Christopher Whitehead, The Public Art Museum in Nineteenth Century Britain: The Development of the National Gallery (Aldershot: Ashgate, 2005). -

Charles De La Fosse (Or Delafosse) Occasionally 1; New Haven 2009
Neil Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800 Online edition LA FOSSE, Charles de J.442.106 Allégorie de Louis XIV, cr. clr/ppr, Paris 15.VI.1636–13.XII.1716 26.5x31.5 (British Museum 1962,0714.41. Iolo Primarily a history painter (agréé 1671, reçu 1673), Williams; legs 1962). Exh.: London 1962c, no. Charles de La Fosse (or Delafosse) occasionally 1; New Haven 2009. Lit.: Hedley 2001, p. 23, executed heads in pastel (although most of the fig. 11, as pstl, by Lafosse; Gustin-Gomez sheets so described are in trois crayons with 2006, II, no. D.R. 46, rejected, as ?Laguerre. touches of pastel), some of which are studies for Olim attr. Louis Laguerre, as study for tapestry figures in his compositions while others are of Queen Anne’s victories ϕ?α portraits. There is little consistency in the technique of the few known examples, and attributional errors seem likely. Bibliography Bellier de La Chavignerie & Auvray; Bénézit; Grove 1996; Clementine Gustin-Gomez, Charles de La Fosse 1636–1716, Dijon, 2006; Hedley 2001; New York 1999c; Prat 2013; Rambaud 1965–71, I, p. 171; II, p. 307f; Ratouis de Limay 1946; Sanchez 2004; Toledo 1975; Washington J.442.108 Huit têtes, la plûpart en pastel (Pierre 2009 Crozat; vente p.m., Paris, Mariette, 10.IV.– 13.V.1741, Lot 1056, 18 livres 15; Tessin) Pastels J.442.109 Un beau sujet de composition, pstl J.442.101 Tête d’un agréable jeune homme, pstl/ppr gr., 33x26.3 (Julllienne; Paris, Martin, (Cottin; Paris, salle des Grands Augustins, Grignard, Helle & Glomy, 27.XI.1752 & seq., Remy, 30.III.–22.V.1767, Lot 763, 24 livres; Liancourt) Lot 263, 17 livres; d’Argenville) J.442.11 Tête, pstl (Julllienne; Paris, Martin, Remy, J.442.102 Jeune femme, la tête inclinée et regardant à g. -

En Chemin Pour L'étoile
AIX!LUYNES | BOUC!BEL!AIR | SIMIANE!COLLONGUE | MIMET FR GREASQUE | GARDANNE | MEYREUIL FR CIRCUIT PATRIMOINE SACRÉ N°1 EN CHEMIN POUR L’ÉTOILE out en visitant chapelles, églises et monastères, posez un regard sur un espace naturel Tpeu connu : l’Etoile, massif calcaire séparant le Pays d’Aix de Marseille par de belles forêts méditerranéennes. Ses crêtes rocheuses nous incitent à découvrir, à distance, lors d’une balade au panorama époustouflant un site de recueillement habité depuis le Néolithique : l’ancien ermitage de Notre-Dame des Anges. Mais ces chapelles et églises nous amènent également à porter un autre regard sur ce qui fut un important bassin minier aux XIXe et XXe siècles : l’a!ux de main-d’oeuvre y entraîna la construction d’édifices religieux simples et fonctionnels et le culte de Sainte Barbe, la patronne des mineurs, dont les représentations (oratoires, statuaires) ne manquent pas. 04 42 24 99 99 D17 D96 AIX!EN!!PROVENCEPROVENCE LELE THOLONET THOLONET 04 42 16 11 61 04 42 66 90 41 A8 BEAURECUEIL BEAURECUEIL LES MILLES D18 04 42 66D58 92 90 16 15 CHATEAUNEUF LUYNES MEYREUIL MEYREUIL 04 42 58 62 01 LUYNES1 04 42 65 90 65 14 A51 D6 N96 D7 GARDANNE BOUC!BEL!AIR GARDANNE BOUC3 !BEL!AIR FUVEAU 04 42 942 93 93 04 42 51 02 73 FUVEAU04 42 50 49 77 11 12 10 13 9 4 GREASQUEGREASQUE SIMIANE!COLLONGUE 04 42 69 72 16 SIMIANE04 42 22 69 98 D58 COLLONGUE D46 5 D7 6 MIMET7 04 42 12 62 42 OILE MIMET L’ÉT E DE CHAIN 8 COUPS DE COEUR D908 INFORMATIONS TOURISTIQUES Longueur du parcours 60km N!D DE L’ESPÉRANCE ! BOUC!BEL!AIR ÉGLISE SAINT!GEORGES -

Fw ^Ifjljtlintii \^Jfflti4rij the METROPOLITAN MUSEUM of ART
4 awfw ^ifjljtLintii \^Jfflti4rij THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART Succeeding the majesty of the Sun King's reign, the courts oi Louis XV and XVI turned artistic canons from splendid pomp to the quintessence of grace. Charming refinements ruled manners and tastes throughout the eighteenth cen tury until, with the monarchy, they were overthrown and re placed by the austere classicism of Napoleon's Empire. Eighteenth-century art ists, many of whom de pended upon royal pa tronage, were masters at recording and popu larizing the balls and banquets, the theatrical per formances, the hunts and picnics that were the daily distractions of a pleasure-hungry court. Highly creative and receptive to a wide range of subject matter these artists found inspiration as readily on OF THE EIGHTEENTH CENTURY Mount Olympus as in the shepherd's bower or the rococo drawing room. A shift in interest from the lives of gods and heroes to the pleasures of contemporary life, particularly the delights of the privileged classes, is evident in the estampes galantes, elaborately engraved after designs by Moreau Le Jeune, Baudouin, and Lavreince. They are the most illuminating documents of aristocratic manners, of costume, and of the decoration of houses and palaces. These documents of not acquire original drawings. And reproduc worldly pleasures were complemented by a tions of paintings were produced by skilled pro vigorous academic tradition concerned with fessional engravers to meet the demands of an large-scale historical and mythological paint increasingly avid public. ing, splendidly exemplified in this exhibition Etching, a process more rapid and free by Carle Van Loo's large drawn model for a than engraving and in many ways akin to picture painted for Frederick the Great of drawing, provides some of the most interesting Prussia (no. -

Charles De La Fosse, L'automne, Figuré Par Bacchus Et Ariane
musée des beaux-arts dijon lumière sur… Charles de la Fosse L’Automne, figuré par Bacchus et Ariane En 1679, Louis XIV, «lassé à la fin du beau et de la foule, se persuada qu’il voulait quelquefois du petit et de la solitude», raconte le célèbre mémorialiste Saint-Simon. Le roi décide alors de créer à Marly, non loin de Versailles, un château d’agrément consacré à ses invités personnels, d’où provient L’Automne de Charles de la Fosse. 1 Aujourd’hui disparu car détruit peu après la Révolution, le septembre : « il faut faire travailler à quatre tableaux comme château de Marly eut une grande importance et fut même, à vous le proposez, il faut bien choisir les peintres et ne pas la fin de la vie du roi, le lieu où celui-ci passait le plus clair de les presser pour qu’ils soient beaux. » son temps, au cours des « marlys », les séjours qu’il réservait à ses invités, pendant lesquels l’étiquette était allégée. Cette Le choix des quatre saisons est particulièrement adapté au faveur fut très recherchée, ce qui fut moqué par Saint-Simon, décor d’une résidence royale, car l’alternance des saisons citant une réplique faite par le cardinal de Polignac au roi : « Ce n’est rien, Sire, la pluie de Marly ne mouille point. » Le château de Marly suivait une conception radicalement différente de celle de Versailles : au lieu d’un immense bâtiment 2 construit au plus haut point d’un parc, Marly était constitué de treize pavillons (un par signe du Zodiaque et un pour la famille royale) nichés au sein d’un vallon (fig. -

Of Painting and Seventeenth-Century
Concerning the 'Mechanical' Parts of Painting and the Artistic Culture of Seventeenth-CenturyFrance Donald Posner "La representation qui se fait d'un corps en trassant making pictures is "mechanical" in nature. He understood simplement des lignes, ou en meslant des couleurs, est proportion, color, and perspective to be mere instruments in consider6e comme un travail m6canique." the service of the painter's noble science, and pictorial --Andre F61ibien, Confirences de l'Acadimie Royale de Pezn- elements such as the character of draftsmanship or of the ture et de Sculpture, Paris, 1668, preface (n.p.). application of paint to canvas did not in his view even warrant notice-as if they were of no more consequence in les Connoisseurs, ... avoir veus "... apr6s [les Tableaux] judging the final product than the handwriting of an author d'une distance s'en en raisonnable, veiiillent approcher setting out the arguments of a philosophical treatise.3 Paint- suite pour en voir l'artifice." ers who devoted their best efforts to the "mechanics of the de Conversations sur connoissance de la -Roger Piles, la art" were, he declared, nothing more than craftsmen, and 300. peinture, Paris, 1677, people who admired them were ignorant.4 Judging from Chambray's text, there were a good many A of Champion French Classicism and His Discontents ignorant people in France, people who, in his view seduced ca. 1660 by false fashion, actually valued the display of mere craftsman- In Roland Freart de his 1662 Chambray published IdMede la ship. Chambray expresses special -

Actes De La Journée De Réflexion Tous Différents ! Tous Citoyens ?
Actes de la journée de réflexion Tous différents ! Tous citoyens ? Avec la participation des clowns analystes du Tous différents ! Tous citoyens ? Journée de réflexion organisée à l’occasion des 50 ans du CREAI PACA et Corse Sommaire Pages Ouverture de la journée Gaëlle LENFANT, Vice Présidente de la Région Provence, Alpes Côte d’Azur 6 Présentation de la journée Serge DAVIN, Président du CREAI PACA et Corse 8 50 ans d’histoire du CREAI PACA et Corse, 50 ans d’adaptation Roland CANOVAS, Président d’honneur du CREAI PACA et Corse 10 Intervention du Bataclown 15 Avenir du secteur de l’action sociale, réalités et contradictions Régis PIERRET, Sociologue, responsable de la recherche, ITS Auvergne 18 Place des usagers : un enjeu de cohésion sociale et de démocratie Anne-Marie GARCIA, Chargée de mission Expert en travail social, DGCS Paris 27 Réforme territoriale et avenir des institutions Jacques NODIN, Président du CREAI Bourgogne 33 Intervention du Bataclown 43 10 ans après la loi du 11 février 2005 Jean-Louis MORACCHINI, Conseiller du recteur Académie de Corse pour le handicap 48 Une approche psychosociale de l’exclusion sociale dans le contexte du handicap : Le regard des représentations sociales Thémis APOSTOLIDIS, Directeur du Laboratoire de psychologie sociale Aix-Marseille Université 73 Débat et échanges avec l’auditoire 81 Intervention du Bataclown 86 Bibliographie 88 6 Ouverture de la journée Gaëlle LENFANT, Vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur Je suis vraiment ravie de vous accueillir ici, dans cet hémicycle, dont je vous reparlerai peut-être dans quelques instants, au nom du Président Michel Vauzelle qui m'a demandé de vous transmettre son salut et ses amitiés. -

Maurice-Quentin De La Tour
Neil Jeffares, Maurice-Quentin de La Tour Saint-Quentin 5.IX.1704–16/17.II.1788 This Essay is central to the La Tour fascicles in the online Dictionary which IV. CRITICAL FORTUNE 38 are indexed and introduced here. The work catalogue is divided into the IV.1 The vogue for pastel 38 following sections: IV.2 Responses to La Tour at the salons 38 • Part I: Autoportraits IV.3 Contemporary reputation 39 • Part II: Named sitters A–D IV.4 Posthumous reputation 39 • Part III: Named sitters E–L IV.5 Prices since 1800 42 • General references etc. 43 Part IV: Named sitters M–Q • Part V: Named sitters R–Z AURICE-QUENTIN DE LA TOUR was the most • Part VI: Unidentified sitters important pastellist of the eighteenth century. Follow the hyperlinks for other parts of this work available online: M Matisse bracketed him with Rembrandt among • Chronological table of documents relating to La Tour portraitists.1 “Célèbre par son talent & par son esprit”2 – • Contemporary biographies of La Tour known as an eccentric and wit as well as a genius, La Tour • Tropes in La Tour biographies had a keen sense of the importance of the great artist in • Besnard & Wildenstein concordance society which would shock no one today. But in terms of • Genealogy sheer technical bravura, it is difficult to envisage anything to match the enormous pastels of the président de Rieux J.46.2722 Contents of this essay or of Mme de Pompadour J.46.2541.3 The former, exhibited in the Salon of 1741, stunned the critics with its achievement: 3 I. -

Cahiers De La Méditerranée, 96 | 2018 La Peste À Marseille Et Dans Le Sud-Est De La France En 1720-1722 : Les Épidé
Cahiers de la Méditerranée 96 | 2018 Les parlementaires méditerranéens. France, Espagne, Italie, XIXe-XXe siècles La peste à Marseille et dans le sud-est de la France en 1720-1722 : les épidémies d’Orient de retour en Europe Michel Signoli et Stéfan Tzortzis Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/cdlm/10903 DOI : 10.4000/cdlm.10903 ISSN : 1773-0201 Éditeur Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine Édition imprimée Date de publication : 15 juin 2018 Pagination : 217-230 ISSN : 0395-9317 Référence électronique Michel Signoli et Stéfan Tzortzis, « La peste à Marseille et dans le sud-est de la France en 1720-1722 : les épidémies d’Orient de retour en Europe », Cahiers de la Méditerranée [En ligne], 96 | 2018, mis en ligne le 15 décembre 2018, consulté le 08 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/ cdlm/10903 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cdlm.10903 Ce document a été généré automatiquement le 8 septembre 2020. © Tous droits réservés La peste à Marseille et dans le sud-est de la France en 1720-1722 : les épidé... 1 La peste à Marseille et dans le sud- est de la France en 1720-1722 : les épidémies d’Orient de retour en Europe Michel Signoli et Stéfan Tzortzis Introduction 1 Dans l’imaginaire commun, la peste personnifie encore, sans doute plus que toute autre maladie, la mort de masse par excellence. Cette terrible réputation, loin d’être usurpée, se nourrit des assauts meurtriers que le « fléau » infligea des siècles durant aux sociétés humaines. La maladie toucha notamment l’Europe et le bassin méditerranéen, où elle causa des épidémies récurrentes durant une grande partie du Moyen-Âge et de l’époque moderne. -

BON BOULLOGNE Paris, 1649 – Paris, 1717 UN CHEF D’ÉCOLE AU GRAND SIÈCLE
Aide à la visite BON BOULLOGNE Paris, 1649 – paris, 1717 UN CHEF D’ÉCOLE AU GRAND SIÈCLE Musée national Magnin, Dijon du 5 décembre 2014 au 5 mars 2015 présentation de l’exposition Actif à la n du règne de Louis XIV, Bon Boullogne fut de son vivant et tout au long du XVIIIe siècle l’un des peintres d’histoire français les plus admirés. Doué pour illustrer les sujets mythologiques et bibliques, l’artiste fut sollicité pour décorer résidences royales et édices religieux. Auteur de grands décors comme de petits tableaux recherchés par les collectionneurs, Bon Boullogne était également apprécié comme portraitiste. Il avait surtout la rare capacité de peindre selon diérentes manières et de réaliser des pastiches susceptibles de tromper les amateurs. Passée la Révolution, Bon Boullogne et les meilleurs peintres d’histoire de sa génération - Louis de Boullogne (son frère cadet), Charles de La Fosse, Antoine Coypel, Jean Jouvenet et Nicolas Colombel - furent l’objet d’une désaection. Ces artistes connaissent depuis quelques années un regain d’intérêt à l’exception de Bon Boullogne. Aussi la rétrospective qui s’ouvre au musée Magnin est-elle l’occasion de lui rendre justice: les tableaux, dessins et gravures d’interprétation qui ont été réunis restituent les multiples facettes d’un art qui a souvent déjoué l’avis des connaisseurs. Les œuvres présentées évoquent tantôt l’art des peintres bolonais du XVIIe siècle (Le Dominiquin, L’Albane), tantôt l’art amand (Van Dyck). L’exposition est également l’occasion de présenter certaines « contrefaçons ». Conservée pendant près de deux siècles au musée des beaux-arts d’Orléans sous des noms italiens, la petite Assomption est l’une d’elles. -
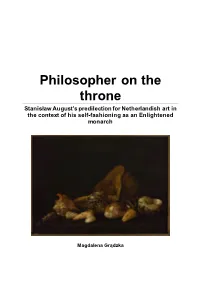
Open Access Version Via Utrecht University Repository
Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Philosopher on the throne Stanisław August’s predilection for Netherlandish art in the context of his self-fashioning as an Enlightened monarch Magdalena Grądzka 3930424 March 2018 Master Thesis Art History of the Low Countries in its European Context University of Utrecht Prof. dr. M.A. Weststeijn Prof. dr. E. Manikowska 1 Philosopher on the throne Magdalena Grądzka Index Introduction p. 4 Historiography and research motivation p. 4 Theoretical framework p. 12 Research question p. 15 Chapters summary and methodology p. 15 1. The collection of Stanisław August 1.1. Introduction p. 18 1.1.1. Catalogues p. 19 1.1.2. Residences p. 22 1.2. Netherlandish painting in the collection in general p. 26 1.2.1. General remarks p. 26 1.2.2. Genres p. 28 1.2.3. Netherlandish painting in the collection per stylistic schools p. 30 1.2.3.1. The circle of Rubens and Van Dyck p. 30 1.2.3.2. The circle of Rembrandt p. 33 1.2.3.3. Italianate landscapists p. 41 1.2.3.4. Fijnschilders p. 44 1.2.3.5. Other Netherlandish artists p. 47 1.3. Other painting schools in the collection p. 52 1.3.1. Paintings by court painters in Warsaw p. 52 1.3.2. Italian paintings p. 53 1.3.3. French paintings p. 54 1.3.4. German paintings p. -

Gemälde Galerie Alte Meister Gemäldegalerie Alte Meister Gemäldegalerie Alte Gemälde Galerie Alte Meister
Museumsführer Museumsführer GEMÄLDE GALERIE ALTE MEISTER GEMÄLDEGALERIE ALTE MEISTER GEMÄLDEGALERIE ALTE GEMÄLDE GALERIE ALTE MEISTER Herausgegeben von den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, Stephan Koja Stephan Koja Eine derart groß angelegte Sammeltätigkeit war möglich, weil das Kurfürsten tum Sachsen zu den wohlhabendsten Gebieten des Heiligen Römischen Reiches Deut- »Ich wurde ob der Masse des scher Nation gehörte. Reiche Vorkommen wertvoller Erze und Mineralien, die Lage am Schnittpunkt wichtiger Handelsstraßen Europas sowie ein ab dem 18. Jahrhun- Herrlichen so konfus« dert hochentwickeltes Manufakturwesen ermöglichten den Wohlstand des Landes. Die Dresdner Gemäldegalerie Neuordnung der Sammlungen unter August dem Starken 1707 ließ August der Starke die Gemäldesammlung aus den allgemeinen Beständen der Kunstkammer herauslösen und die besten Bilder in einem eigenen Raum im Schloss unterbringen. 1718 zogen sie weiter in den Redoutensaal, schließlich 1726 in den »Riesensaal« und dessen angrenzende Zimmer. Die übrigen Objekte der »Die königliche Galerie der Schildereien in Dresden enthält ohne Zweifel einen Kunstkammer bildeten den Grundstock für die anderen berühmten Sammlungen Schatz von Werken der größten Meister, der vielleicht alle Galerien in der Welt Dresdens wie das Grüne Gewölbe, die Porzellansammlung, das Kupferstich-Kabinett, übertrifft«, schrieb Johann Joachim Winckelmann 1755.1 Schon 1749 hatte er be- den Mathematisch-Physikalischen Salon oder die Skulpturensammlung. Denn schon eindruckt seinem Freund Konrad Friedrich Uden mitgeteilt: »Die Königl. Bilder um 1717 hatte August der Starke, wohl inspiriert durch dementsprechende Eindrü- Gallerie ist […] die schönste in der Welt.«2 cke auf Reisen, eine Funktionsskizze4 für die Aufteilung der Sammlung entworfen, In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die Dresdner Gemäldegalerie nach der das Sammlungsgut und nicht die historische Klassifizierung das Ordnungs- bereits ein Anziehungspunkt für Künstler, Intellektuelle und kulturaffine Reisende kriterium darstellte.