MALLARMÉ Devant Ses Contemporains 1875-1899
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
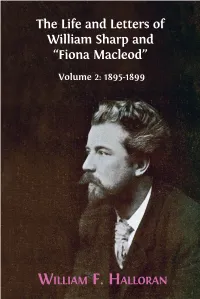
The Life and Letters of William Sharp and “Fiona Macleod”
The Life and Letters of William Sharp and “Fiona Macleod” Volume 2: 1895-1899 W The Life and Letters of ILLIAM WILLIAM F. HALLORAN William Sharp and What an achievement! It is a major work. The lett ers taken together with the excellent H F. introductory secti ons - so balanced and judicious and informati ve - what emerges is an amazing picture of William Sharp the man and the writer which explores just how “Fiona Macleod” fascinati ng a fi gure he is. Clearly a major reassessment is due and this book could make it ALLORAN happen. Volume 2: 1895-1899 —Andrew Hook, Emeritus Bradley Professor of English and American Literature, Glasgow University William Sharp (1855-1905) conducted one of the most audacious literary decep� ons of his or any � me. Sharp was a Sco� sh poet, novelist, biographer and editor who in 1893 began The Life and Letters of William Sharp to write cri� cally and commercially successful books under the name Fiona Macleod. This was far more than just a pseudonym: he corresponded as Macleod, enlis� ng his sister to provide the handwri� ng and address, and for more than a decade “Fiona Macleod” duped not only the general public but such literary luminaries as William Butler Yeats and, in America, E. C. Stedman. and “Fiona Macleod” Sharp wrote “I feel another self within me now more than ever; it is as if I were possessed by a spirit who must speak out”. This three-volume collec� on brings together Sharp’s own correspondence – a fascina� ng trove in its own right, by a Victorian man of le� ers who was on in� mate terms with writers including Dante Gabriel Rosse� , Walter Pater, and George Meredith – and the Fiona Macleod le� ers, which bring to life Sharp’s intriguing “second self”. -

PHILLIP J. PIRAGES Catalogue 66 BINDINGS Catalogue 66 Catalogue
Phillip J. Pirages PHILLIP J. PIRAGES Catalogue 66 BINDINGS Catalogue 66 Items Pictured on the Front Cover 172 176 58 114 92 3 52 167 125 115 192 28 71 161 1 196 204 116 Items Pictured on the Back Cover 152 109 193 9 199 48 83 18 117 25 149 59 83 77 90 60 175 12 149 50 41 91 55 171 143 66 50 126 65 80 98 115 To identify items on the front and back covers, lift this flap up and to the right, then close the cover. Catalogue 66: Interesting Books in Historically Significant and Decorative Bindings, from the 15th Century to the Present Please send orders and inquiries to the above physical or electronic addresses, and do not hesitate to telephone at any time. We would be happy to have you visit us, but please make an appointment so that we are sure to be here. In addition, our website is always open. Prices are in American dollars. Shipping costs are extra. We try to build trust by offering fine quality items and by striving for precision of description because we want you to feel that you can buy from us with confidence. As part of this effort, we unconditionally guarantee your satisfaction. If you buy an item from us and are not satisfied with it, you may return it within 30 days of receipt for a full refund, so long as the item has not been damaged. Most of the text of this catalogue was written by Cokie Anderson, with additional help from Stephen J. -

The Prodigal Son 57.5 Cm High
George Minne (Ghent 1866 - Sint-Martens-Latem 1941) The Prodigal Son 57.5 cm high Conceived in 1896, and cast in the artist’s lifetime Along with Couple Embracing and Men Fighting (both dating to around 1886) this is another fine example of Minne’s earlier, explorative sculpture. One of his most significant works, it is full of the emotion that so brilliantly anticipates the Expressionist movement. The expressive power of works such as Prodigal Son led to Minne being recognised by many Symbolist poets of the period, including Maurice Maeterlinck, Charles Van Lerberghe and Grégoire Le Roy - who saw in his work an expression of their own sceptical view of modern life. This led to Minne becoming involved with the progressive avant-garde in Brussels and in 1890 he exhibited with the Les XX in Brussels, and two years later he participated in the Salon de la Rose and Croix in Paris. Subsequently, he also exhibited in the Secession exhibitions in Berlin and Vienna and the Biennales in Venice. It was in Vienna that his work attracted the attention of artists such as Gustav Klimt, Egon Schiele and Oskar Kokoschka, his style being not only directly comparable but also hugely influential on these Viennese Symbolist painters. Minne explored the concept of the Prodigal Son in several drawings in his sketchbook. The daring curved form of the work owes, as with much sculpture of the period, gratitude to the work of the great master Auguste Rodin (see Rodin’s I am Beautiful, 1882, fig.2). However, the degree to which Minne realises the expression of the event portrayed is entirely his own comprehension. -

Brussels, the Avant-Garde, and Internationalism
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Ghent University Academic Bibliography <new page>Chapter 15 Met opmaak ‘Streetscape of New Districts Permeated by the Fresh Scent of Cement’:. Brussels, the Avant-Garde, and Internationalism1 La Jeune Belgique (1881–97);, L’Art Moderne (1881–1914);, La Société Nouvelle (1884–97);, Van Nu en Straks (1893–94; 1896– 1901); L’Art Libre (1919–22);, Signaux (1921, early title of Le Disque Vert, 1922–54);, 7 Arts (1922–8);, and Variétés (1928– 30). Francis Mus and Hans Vandevoorde In 1871 Victor Hugo was forced to leave Brussels because he had supported the Communards who had fled there.2 This date could also be seen as symbolisiizing the 1 This chapter has been translated from the Dutch by d’onderkast vof. 2 Marc Quaghebeur, ‘Un pôle littéraire de référence internationale’, in Robert Hoozee (ed.), Bruxelles. Carrefour de cultures (Antwerp: Fonds Mercator, 2000), 95–108. For a brief 553 passing of the baton from the Romantic tradition to modernism, which slowly emerged in the 1870s and went on to reach two high points: Art Nouveau at the end of the nineteenth century and the so-called historical avant-garde movements shortly after World War I. The significance of Brussels as the capital of Art Nouveau is widely acknowledged.3 Its renown stems primarily from its architectural achievements and the exhibitions of the artist collective ‘Les XX’ (1884–93),4 which included James Ensor, Henry Van de Velde, Théo van Rysselberghe, George Minne, and Fernand Khnopff. -

"Fiona Macleod". Vol
The Life and Letters of William Sharp and “Fiona Macleod” Volume 2: 1895-1899 W The Life and Letters of ILLIAM WILLIAM F. HALLORAN William Sharp and What an achievement! It is a major work. The lett ers taken together with the excellent H F. introductory secti ons - so balanced and judicious and informati ve - what emerges is an amazing picture of William Sharp the man and the writer which explores just how “Fiona Macleod” fascinati ng a fi gure he is. Clearly a major reassessment is due and this book could make it ALLORAN happen. Volume 2: 1895-1899 —Andrew Hook, Emeritus Bradley Professor of English and American Literature, Glasgow University William Sharp (1855-1905) conducted one of the most audacious literary decep� ons of his or any � me. Sharp was a Sco� sh poet, novelist, biographer and editor who in 1893 began The Life and Letters of William Sharp to write cri� cally and commercially successful books under the name Fiona Macleod. This was far more than just a pseudonym: he corresponded as Macleod, enlis� ng his sister to provide the handwri� ng and address, and for more than a decade “Fiona Macleod” duped not only the general public but such literary luminaries as William Butler Yeats and, in America, E. C. Stedman. and “Fiona Macleod” Sharp wrote “I feel another self within me now more than ever; it is as if I were possessed by a spirit who must speak out”. This three-volume collec� on brings together Sharp’s own correspondence – a fascina� ng trove in its own right, by a Victorian man of le� ers who was on in� mate terms with writers including Dante Gabriel Rosse� , Walter Pater, and George Meredith – and the Fiona Macleod le� ers, which bring to life Sharp’s intriguing “second self”. -

Laurence Binyon and the Belgian Artistic Scene: Unearthing Unknown Brotherhoods
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by Ghent University Academic Bibliography Laurence Binyon and the Belgian Artistic Scene: Unearthing Unknown Brotherhoods Marysa Demoor and Frederick Morel On September 11, 2008, at 10:11am, at a New York City ceremony honouring victims of the 9/11 terrorist attacks, New York former mayor Rudy Giuliani concluded his speech with a quote from the poem ―For the Fallen.‖ Mr. Giuliani spoke the words with a certain flair, respecting the cadence, stressing the right words, and honouring the pauses: They shall grow not old, as we that are left grow old: Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun and in the morning We will remember them.1 ―For seven years,‖ Mr. Giuliani continued, ―we‘ve come back here to be together, to feel how the entire world is linked in our circle of sorrow. And mostly to remember, those we lost, who are never lost. The poem reminds us how brightly their memories burn.‖2 Ever since Laurence Binyon wrote these four lines in north Cornwall in 1914, they have been recited annually at Remembrance Sunday services worldwide, and people will keep on doing so to commemorate tragic events, even those still to come because they capture the right feelings unerringly. But, ironically, if the lines have become immortal and they are there to commemorate the dead, their author, Laurence Binyon, is all too often unknown. Binyon, poet and art historian, was born in Lancaster on the 10th of August, 1869, to an Anglican clergyman, Frederick Binyon, and his wife Mary. -

Bulletin Des Amis D'andré Gide
BULLETIN DES AMIS D'ANDRÉ GIDE XXVIe ANNÉE - VOL. XXI N097 JANVIER 1993 BULLETIN DES AMIS D'ANDRÉ GIDE :S.EVUE TRIMESTRIELLE publiée par le CENTRE D'ÉTUDES GIDIENNES DEL'UNIVERSITÉ LUMIÈRE (LYON) avec l'aide du CENTRE NATIONAL DES LETTRES . pour L'ASSOCIATION DES AMIS D'ANDRÉ GIDE VINGT-SIXIÈME ANNÉE 1993 VOL. XXI ASSOCIATION DES Amis d'André Gide COMITÉ D'HONNEUR Maurice RHEIMS, de l'Académie française, Robert ANDRÉ, Jacques BRENNER, Michel BliTOR, Jacques DROUIN, Dominique FERNANDEZ, Pierre KLOSSOWSKI, Robert MALLET, Jean MEYER, Robert RICATIE, Roger VRIGNY CONSEIL D'ADMINISTRATION Présidenl d'honneur : ÉTIEMBLE Présidenl: Claude MARTIN Vice-Présidenl : Daniel MOliTOfE . Secrélaire général : Henri HEINEMANN Trésorier: Jean CLAUDE Conseillers: Claude ABELÈS, Irèn~ de.BONSTETIEN, Daniel DUROSA Y. Alain GOULET, Pierre MASSON, Pascal MERCIER, Bernard MÉTAYER, Roger STÉPHANE, Marie-Françoise VAUQUELIN-KLINCKSIECK ReprésenJanl du Comité américain: Elaine D. CANCALON COMITÉ AMÉRICAIN CatharineS. BR OSMAN; Elaine D. CANCALON, N. DavidKEYPOUR, WalterC. PUTNAM Responsable : Elaine D. CANCALON (Department of Modem Languages, The Rorida State University, Tallahassee, Aa. 32306, États-Unis) CENTRE D'ÉTUDES GIDIENNES Directeur : Claude MARTIN (3, rue Alexis-Carrel, 69110 Ste-Foy-lès-Lyon, Tél. 78.59.16.05, Fax : même n°) Bulletin des.Amis d'André Gide JANVIER 1993 le Bulletin des Amis d'André Gide revue trimestrielle fondée en 1968 par Claude Martin, dirigée par Claude Martin (1968-1985), puis par Daniel Moutote (1985-1988), Daniel Durosay (1989-1991) et Pierre Masson (1992 ~ ), publiée avec l'aide du CEN1RE D'ÉTUDES GIDIENNES de l'Université Lumière (Lyon) et le concours du CENTRE NATIONAL DES LETIRES, paraissant en janvier, avril, juillet et octobre, est principalement diffusé par abonnement annuel ou compris dans les publications servies aux membres de l'ASSOCIATION DES AMIS D'ANDRÉ GIDE au titre de leur cotisation pour l'année en cours. -

Symbolism, Popular Drama, and Politics and Art in Belgium, 1886-1910
CLCWeb: Comparative Literature and Culture ISSN 1481-4374 Purdue University Press ©Purdue University Volume 5 (2003) Issue 3 Article 2 Symbolism, Popular Drama, and Politics and Art in Belgium, 1886-1910 Joan Gross Oregon State University Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/clcweb Part of the Comparative Literature Commons, and the Critical and Cultural Studies Commons Dedicated to the dissemination of scholarly and professional information, Purdue University Press selects, develops, and distributes quality resources in several key subject areas for which its parent university is famous, including business, technology, health, veterinary medicine, and other selected disciplines in the humanities and sciences. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, the peer-reviewed, full-text, and open-access learned journal in the humanities and social sciences, publishes new scholarship following tenets of the discipline of comparative literature and the field of cultural studies designated as "comparative cultural studies." Publications in the journal are indexed in the Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey), the Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters ISI), the Humanities Index (Wilson), Humanities International Complete (EBSCO), the International Bibliography of the Modern Language Association of America, and Scopus (Elsevier). The journal is affiliated with the Purdue University Press monograph series of Books in Comparative Cultural Studies. Contact: <[email protected]> Recommended Citation Gross, Joan. "Symbolism, Popular Drama, and Politics and Art in Belgium, 1886-1910." CLCWeb: Comparative Literature and Culture 5.3 (2003): <https://doi.org/10.7771/1481-4374.1191> This text has been double-blind peer reviewed by 2+1 experts in the field. -

Tome XXXIV, No. 4
Tome XXXIV - N<> 4. ANNÉE 1956 BULLETIN DE L'Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises PALAIS DES ACADÉMIES X, RUE DUCALE BRUXELLES SOMMAIRE / pages Propos sur Mallarmé (Lecture faite par M. Robert Goffin, à la séance mensuelle du 10 novembre 1956) 229 Hommage à Charles Van Lerberghe. (Séance publique du 8 décembre 1956). Discours de M. Henri Davignon 242 >> » M. Henri Clouard 251 Un oncle de Colette. Eugène Landoy journaliste franco- belge, par MM. Albert Kies et Clause Pichois 260 RAPPORTS : Prix Académiques 1956, par M. Luc Hommel 271 Rapport du Jury chargé de juger le Concours scolaire national de l'année 1956, par Mme Marie Gevers 275 CHRONIQUE 287 Propos sur Mallarmé Lecture faite par M. Robert GOFFIN à la séance mensuelle du 10 novembre 1956. Mallarmé est à Tournon et son amour pour Marie, son épouse, n'inspirera pas ses poèmes ! Réfléchissons un instant à sa situa- tion morale de manière à mieux atteindre la source de sensibilité du poète. Pendant de longs mois, Mallarmé a été en Angleterre et les critiques ne semblent pas avoir attaché assez d'importance au drame intérieur qui bouleverse le jeune homme. Nous n'en con- naissons d'ailleurs les détails que par des extraits de lettres que le Dr Mondor a publiées dans sa biographie. Il me paraît pourtant que les critiques de l'avenir, en posses- sion de la correspondance complète, reverront cette situation qu'ils ont considérée de façon un peu élémentaire. Mais le Dr Mondor, lui-même, m'ouvre les battants d'une supposition qu'il faudra un jour étudier jusque dans ses plus ténues conséquences ! Quel est le rôle exact que joua Ettie Yapp dans la vie senti- mentale de Mallarmé ? Elle devint la maîtresse de Cazalis, pen- dant longtemps le meilleur ami de Stéphane ! Ils s'étaient ren- contrés, tous, au cours d'une excursion à Fontainebleau et le moins qu'on puisse dire est que Mallarmé fut ébloui par la blonde jeune fille. -

Post-Wagnerian Concepts in French Vocal Music and Poetry
POST-WAGNERIAN CONCEPTS IN FRENCH VOCAL MUSIC AND POETRY: WITH SPECIAL REFERENCE TO MALLARME AND DEBUSSY. by JOSEPHINE RAYNER Submitted for the degree of D. Phil, Department of Music 1968 Tu te leves. Tu te leves lleau se deplie Tu te couches lleau sl6panouit Tu es lIeau detournee de ses abImes Tu es la terre qui prend racine Et sur laquelle tout slietablit Tu fais des bulles de silence dans le desert des bruits Tu chantes des hymnes nocturnes sur les cordes de llarc-en-ciel Tu es partout tu abolis toutes les routes Tu sacrifies le temps A lle"ternelle jeunesse de la flamme exacte Q,ui voile la nature en la reproduisant Femme tu mets au monde un corps toujours pareil Le tien Tu es la ressemblance Paul Eluard from "Facile" 1935, fr- II ABSTRACT Post-Wagnerian tendencies in French music and poetry; with special reference to Mallarme and Debu§-§Z. Fundamentally, the thesis concerns itself with late nineteenth and early twentieth century concepts of poetry and song in France, resulting from the upheaval of Wagnerianism, in which the Teutonic composer assumes the role of an allegorically significant mandrake figure. With the ubiquitous Tristan theme as the background ideal, English Aestheticism and Pre-Raphaelitism are discussed, and the paradox of mock-Mediaevalism pitted against new clean linear importances emerges, A discussion of five early post-Wagnerian songs by Chausson, Chabrier and Duparc precedes comment on Mallarme's 1poetiquel, and the approach, through magic and symbols in Yeats and overall simultanism, to Sartre's eventual existentialism. I'LlApres-Midi d1un Faune" is treated fully both from symbolic and analytical premisses and involves brief discussion on the growth and relevance of sonata form, which is ise i tself zaiPpllý'Ctýo the po; itic analysis. -

Modernist Tendencies in the Literature of the Low Countries 1880-19'20
Modernist Tendencies in the Literature of the Low Countries 1880-19'20 A.P. Dierick to the majority of European citizens that a radical questioning of the very foundations and structures of Western society might be in order. I Fin de Siecle And yet such questioning and probing had already taken place in the initial phase of the bourgeoisie's The end of the nineteenth century and the begin rise to power. The conflict between the demands of ning of the twentieth is a period of transition in society and those made by the individual is stated the arts, often compared by historians and critics in philosophical terms by Jean Jacques Rousseau, in with earlier periods like the Baroque and Roman his contrast between natural and political man, in ticism. The term "mannerism" has been proposed his basic rejection of the "blessings" of civilization to describe such periods, in opposition to so-called and in his propagation of the myth of the "noble "classicist" periods. Whereas the latter may pro savage." In much more crude, but also more aggres duce art which, at its best, is exemplary and valid sive terms, the· Marquis de Sade elaborates a view for all times, or, conversely, art which is conven in which "natural" man is one, as Richard Gilman tional, derivative and facile, "mannerist" art periods writes, who "refuses to be bound by established val tend to break down the formal balance achieved in ues, inherited and institutionalized pieties" (81). In classicism, not through incompetence, but through Gilman's view, Sade was "the originator or, more a wilful calling into question of the norms by which accurately, the first compelling enunciator in mod the previously stable period of art has come to define ern times of the desire to be other than what soci itself. -

Life and Writings of Maurice Maeterlinck by the Same Author
"6reat Writer*." LIFE AND WRITINGS OF MAURICE MAETERLINCK BY THE SAME AUTHOR The Minnesingers. Vol. I. Translations Longmans, Green & Co. 55. net Contemporary German Poetry " " Canterbury Poets Series, is. Contemporary Belgian Poetry " " Canterbury Poets Series, is. Contemporary French Poetry "Canterbury Poets" Series, is. W. B. Yeats. Traduction de Franz Hellens. Brussels : H. Lamertin, 2 fr. Turandot, Princess of China (Plays of To-day and To-morrow) Fisher Unwin. 2s. 6d. net. Life and Writings of Maurice Maeterlinck BY JETHRO BTTHELL Condon and ?ellina=on=pne : THE WALTER SCOTT PUBLISHING CO., LTD NEW YORK AND MELBOURNE (All rights reserved) 1.635 TO ALBERT MOCKEL, THE PENETRATING CRITIC, THE SUBTLE POET " Maurice Maeterlinck. II debuta . dans La Pleiade par un chef-d'oeuvre : Le Massacre des Innocents. Albert Mockel devint plus tard son patient et infatigable apotre a Paris. C'est lui qui nous fit connaitre Les Serres Chaudes et surtout cette Princess* Maleine qui formula definitive- ment 1'ideal des Symbolistes au theatre." STUART MERRILL, Le Masque, Srie ii, No. 9 and 10. PREFACE IT is not an easy task to write the life of a man who is still living. If the biographer is hostile to his subject, the slaughtering may be an exciting spectacle; if he wishes, not to lay a victim out, but to pay a tribute of admiration tempered by criticism, he has to run the risk of offending the man he admires, and all those whose admiration is in the nature of blind hero-worship. If he is conscientious, the only thing he can do is to give an honest expression of his own views, or a mosaic of the views of others which seem to him correct, knowing that he may be wrong, and that his authorities may be wrong, but challenging contra- vii viii PREFACE diction, and caring only for the truth as it appears to him.