Victor Hugo Et L'espagne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

COMÉDIE CLASSIQUE, DRAME ROMANTIQUE : LA BD MODE D’EMPLOI Marie-José Fourtanier
Document généré le 25 sept. 2021 17:54 Revue de recherches en littératie médiatique multimodale COMÉDIE CLASSIQUE, DRAME ROMANTIQUE : LA BD MODE D’EMPLOI Marie-José Fourtanier Vers une didactique de la multilecture et de la multiécriture littéraire Résumé de l'article Volume 1, janvier 2015 Cette communication se propose de présenter diverses modalités de lecture de deux pièces canoniques du répertoire théâtral, mais aussi des programmes URI : https://id.erudit.org/iderudit/1047805ar scolaires français, L’Avare de Molière (souvent étudié au collège) et Ruy Blas de DOI : https://doi.org/10.7202/1047805ar Victor Hugo (plutôt au lycée) par le truchement de deux adaptations du plasticien J.-P. Lihou en bande dessinée. Aller au sommaire du numéro Au-delà de l’étude conjointe de ces oeuvres littéraires et de leur transposition en bande dessinée permettant de comparer les modes d’expression respectifs de ces deux formes artistiques et les spécificités de chaque système narratif, je me demanderai si la bande dessinée à elle seule ne constitue pas une oeuvre Éditeur(s) « spectaculaire » à part entière, texte et représentation étant doublement Groupe de recherche en littératie médiatique multimodale assumés par le dessin et la mise en page. ISSN 2368-9242 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Fourtanier, M.-J. (2015). COMÉDIE CLASSIQUE, DRAME ROMANTIQUE : LA BD MODE D’EMPLOI. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 1. https://doi.org/10.7202/1047805ar Tous droits réservés © Revue de recherches en littératie médiatique Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des multimodale, 2015 services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. -

By Victor Hugo P
BRUSSELS COMMEMORATES 150 YEARS of ‘LES MISÉRABLES’ SIZED FOR VICTOR HUGO PRESS KIT CONTENTS Brussels commemorates 150 years of ‘Les Misérables’ by Victor Hugo p. 3 On the programme p. 4 Speech by the Ambassador of France in Belgium p. 5 I. Les Misérables, Victor Hugo and Brussels: a strong connection p. 6 II. Walk : in the footsteps of Victor Hugo p. 8 III. Book : In the footsteps of Victor Hugo between Brussels and Paris p. 12 IV. Brusselicious, gastronomic banquet : les Misérables p. 13 V. Events «Les Misérables : 150th anniversary» • Gastronomy p. 15 • Exhibitions p. 15 • Conferences p. 17 • Film p. 19 • Theater p. 20 • Guided tours p. 21 Contacts p. 23 Attachment P. 24 BRUsseLS COMMEMORAtes 150 YEARS Of ‘Les MisÉRABLes’ BY ViCTOR HUGO LES MISÉRABLES IS ONE OF THE GREATEST CLASSICS OF WORLD LITERATURE. THE MASTERPIECE BY VICTOR HUGO ALSO REMAINS VERY POPULAR THANKS TO THE MUSICAL VERSION AND THE MANY MOVIES. Over thirty films have been made of ‘Les Miserables’ and Tom Hooper (The King’s Speech) is currently shooting a new version with a top cast. In March, it is exactly 150 years since ‘Les Misérables’ by Victor Hugo was published. Not in Paris as is often assumed, but in Brussels. The first theatrical performance of ‘Les Misérables’, an adaptation of the book by his son Charles, also took place in Brussels. In addition to these two premieres of ‘Les Misérables’, Brussels played a crucial role in Victor Hugo’s life and his career as a writer and thinker. Closely related to Hugo’s connection with Brussels is also his call for a United States of Europe. -

Ruy Blas. Edited by Harold Arthur Perry
R U Y B I, A S Downloaded from https://www.holybooks.com Fcp. &vo, is. 6d. Hernani. By VICTOR HUGO. Edited with Notes, etc., by H. A. PERRY, M.A., Fellow of King's College, Cambridge. Crown Sz'o, 2s. 6d. Ruy Bias. By VICTOR HUGO. Edited with Notes, by H. A. PERRY, M.A., Fellow of King's College, Cambridge. Crown 8vo } $s. 6d. Les Travailleurs de la Mer. By VICTOR HUGO. Adapted for use in Schools, with Notes, Life, etc., by JAMES BOIELLE, B.A., (Univ. Gall.). LONGMANS, GREEN, AND CO. LONDON, NEW YORK, BOMBAY, AND CALCUTTA Downloaded from https://www.holybooks.com THE WORKS OF VICTOR HUGO Ruy Bias EDITED BY HAROLD ARTHUR PERRY, M.A. FORMERLY FELLOW OF KING'S COLLEGE, CAMBRIDGE EDITOR OF ' HERNANI ' NEW IMPRESSION * \ LONGMANS, GREEN, AND CO. 39 PATERNOSTER ROW, LONDON NEW YORK, BOMBAY, AND CALCUTTA M. ^ 1907 Downloaded from https://www.holybooks.com PQ Re iqcn Downloaded from https://www.holybooks.com PREFACE To my edition of Hernani (published in 1888) \ now add an edition of the sister play. The greater literary value of Ruy Bias, and the numerous his torical facts connected with its action, have called for notes of some length. But I have again endea- voured rather to direct the student's efforts than to render effort unnecessary. H. A. P. Downloaded from https://www.holybooks.com Downloaded from https://www.holybooks.com CONTENTS PAGE I. PREFACE, ..... v II. LIFE OF THE AUTHOR AND HISTORY OF THE PLAY, . ix III. HISTORICAL NOTES i. CHARACTERS OF THE PLAY, . -

Views of 1 If E Str U~Gl Ing for Expression
TYPES OF HEROINES IN THID ~RENCH ROMANTIC DRAMA: A COMPARISON WITH THE H~ROINES OF RACINE AND CORNEILLE • .A Thesis Presented for the Degree of Master of Arts BY Della Roggers Maidox, B. A. -- - . - - ... - - -- --.. - - ....... ·- ~ ;.: ~ ;~;~;-~~~.~-:~ - - - - - - - - -- - - - .. ... .. - THE OHIO-STATE UNIVERSITY -- 19 :20 BIBLIOGRAPHY I. French Sources Histoire da la Langue et ]e la Litterature Fran9aise Vols. IV, V, and VII Petit de Julleville. Drama Ancien, Drame Moderne Emile Faguet. Les 3rands Maitres du XVII~ Siecle, Vol V, IDmile Faguet. Histoire de la Litterature Fran9aise Brunetiere. Le Mouvement Litt~raire ju XIX! Sihcle t'ellissier. Le Rialisme iu Ro~a~ti3me Pellissier. Histoire ie la Litterature Fran9aise Abr Y..1 A11 Uc et Crou z;et Les Epoques iu Theatre Fran9ais• Bruneti~re~ Les Jranis Eorivains 'ran9ais~~Raoine .Justave Larroumet. " II " " Boilea11 Lanson. Histoire iu Romantisme Th6o~hile Gautier. ld(es et Doctrines Litteraires du XrII' Siecle Vial et Denise. n " II II " XIX ' ti Vial et Denise. Histoire de la Litt~rature Fran9aise, Vols.II,III " " " " " Lanson. Portraits Litteraires, Vol I Sainte-Beuve. CauserEes de Lunii Sainte-Beuve. De La Poesie Dramatique, Belles Lettres, Vol. VII Diderot. L'Art Poetique Boi l'eau. Racine et Victor Hugo P. Stapfer. La Poetique de Racine Robert. Les Granis IDcrivains Fran9ais--Alex. Dumas,P~re Parigot. II. English Sources Rousseau and Romanticism Irving Babbitt. Literature of the French Renaissance, Vols. I and II Tilley. Annals of the· French Stage, Vols. II ani III Hawkins. The Romantic Revolt Vaughan. The Romantic Triumph Omond. Studies in Hugo's Dramatic Characters Bruner. Main Currents of Nineteenth Century Literature, Vol.III Brandes~ History of English Romanticism in the Nineteenth Century Beers. -

Works of Victor Hugo Volume 5
// S^i^* ^EUNHARDT declaiming "the battle of HEKNANI" BEFOUE the bust of victor HUGO. • « Ilernani, Frontispiece. ^ DRAMATIC WORKS ,,OF VICTOR^'* HUCau c * TBANSLATED BY FREDERICK L. SLOUS, AND MRS. NEWTON CROSLAND, Author of " llie Diamond Wedding, and other Poems," " Hubert Freeth's Prosperity ^^ ** Stories of the City of London^'' etc. HERNANI. THE KING'S DIVERSION. RUY BLAS. PROFUSELY ILLUSTRATED WITH ELEGANT WOOD ENGRAVINGS, -TTOTSTiJ^hajE: T7-. -1 NEW YORK: P. F. COLLIER, PUBLISHER. .M.... s/-. '-z;- CONTENTS. Hbrnani, translated by Mrs. Newton Crosland 21 The King's Diversion, translated by Fred'k L. Slous . 165 Buy Bias, translated by Mrs. Newton Crosland 267 411580 EDITOR'S PREFACE. S the Translator of "Hernani'' and "Ruy Bias," I may be permitted to offer a few remarks on the three great dramas which are now presented in an English form to the English-speaking public. Each of these works is preceded by the Author's Preface, which perhaps exhausts all that had to be said of the play which follows—from his own original point of view. It is curious to contrast the confident egotism, the frequent self-assertion, and the indignation at repression which mark the prefaces to '' Hernani " and ^' Le Roi s'Amuse " with the calm dignity of the very fine dramatic criticism which intro- duces the reader to "RuyBlas." But when the last-named tragedy was produced, Victor Hugo's fame was established and his literary position secure; he no longer had need to assert himself, for if a few enemies still remained, their voices were but as the buzzing of flies about a giant. -

Bref-Ruy-Blas.Pdf
ANCRAGE POLITIQUE ET GÉOGRAPHIQUE DE LA PIÈCE Après 1600, l’Espagne rentre dans une période de décadence marquée par des rois incompétents, une chute brutale de l’arrivée des métaux précieux d’Amérique et la crise économique qui en résulte, un déclin démographique et un dépeçage territorial. Le Siècle d’Or espagnol prend fin aux alentours de 1640. Au 18e siècle, l’Espagne aura perdu toute son influence tant en Europe que dans le reste du monde. L’Espagne dépeinte dans Ruy Blas par Victor Hugo est celle de Charles II, fin du 17e siècle. Faible, malade, rachitique et fruit de mariages consanguins, il est surnommé « el Hechizado » (l’ensorcelé, le possédé) par ses contemporains. Son physique dis- BREF. gracieux et son intelligence relative l’éloignent des affaires de l’état. Il laisse une place vide au pouvoir, et une place vide dans son lit. Ruy Blas les occupera toutes les deux. Quant au personnage de la Reine, Victor Hugo a prêté à la seconde épouse de Charles II (Marie-Anne de Neubourg) les qualités d’âme et de cœur de la première (Marie-Louise d’Orléans, morte à 27 ans sans lui avoir donné d’héritier). On raconte que Charles II a continué à vouer un culte maladif à cette dernière, dont il conserva et choya le corps longtemps après sa mort. Le roi brille surtout par son absence. Il ne figure pas parmi la liste des person- nages… Premier sujet du royaume, son absence est éloquente et symptomatique : Ruy Blas pas de roi, pas d’état… VICTOR HUGO / YVES BEAUNESNE Anecdote Une reine délaissée, un laquais éperdument amoureux et un noble banni de la cour Dans la pièce, la lettre de Charles II adressée à son épouse, d’une banalité affligeante, qui rêve de vengeance… Il n’en faut pas davantage à Victor Hugo pour imaginer la « Il fait grand vent et j’ai tué six loups », fait référence à un épisode de folie de la vie de trame de son drame romantique. -
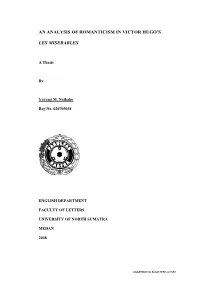
An Analysis of Romanticism in Victor Hugo's Les Miserables
AN ANALYSIS OF ROMANTICISM IN VICTOR HUGO’S LES MISERABLES A Thesis By Yayang M. Naibaho Reg No. 020705038 ENGLISH DEPARTMENT FACULTY OF LETTERS UNIVERSITY OF NORTH SUMATRA MEDAN 2008 UNIVERSITAS SUMATERA UTARA ACKNOWLEDGEMENT Praise, honor, and glory to the Lord who has given me a great opportunity to study in University of North Sumatra and helped me to accomplish this thesis. First of all, I would like to express my gratitude and appreciation to my supervisors, Dra. Martha Pardede, MS, and Dra. Swesana Mardia Lubis, M. Hum, for their constructive critics and suggestions in supervising this thesis. I would also thank all lecturers in the Faculty of literature of University of North Sumatra. I would also like to express my deepest gratitude and love to my family: T. br Sitohang (grandmother), Asiah (mother), G. Naibaho (Uncle), D. Naibaho (Aunt), Martina Samosir (cousin), and my lovely sister Lina Naibaho. Thank you for every support, care, encouragement, advice, and love. I would like to thank my friends in small group “Metanoia-Megumi” (K’Selly, K’Fristianty, Timbul, B’Rudi, Luther, Maringan, K’Anna, K’Astri, K’Mega, and K’Melda). It is a blessing for me to have you in my life! Thank you also for my sisters in small group “Wonderful Grace” (Ane, Asna, Emmy, Pink-Pink, Putri, and Swarni). Thanks for the warm friendship and wonderful time we spend together. Thank you for lots of friends in KMK FS that I cannot mention all here, especially for K’Novi (Thanks for not give up in encouraging me to accomplish this thesis), Ika, Era, Juwita, Lely, Lita, Juleo, Ganda, Hotman, Febri, Shera, Mona, Ivan, and Santa. -

Ruy Blas Couverture.Qxd 4/02/09 18:50 Page 1
Ruy Blas_couverture.qxd 4/02/09 18:50 Page 1 HUGO Ruy Blas HUGO e Dans l’Espagne de la fin du XVII siècle, alors que la BLAS RUY monarchie est en proie au complot, un laquais se voit chargé, en secret, d’usurper l’identité d’un grand Hugo seigneur, et de diriger le pays. Ce laquais, c’est Ruy Blas, amoureux de la reine qui ignore tout de ce travestissement… Ruy Blas Créée en 1838, cette pièce est bien plus qu’une simple Présentation espagnolade. Car, par le drame, Victor Hugo entend par Gérard Gengembre «ressusciter le passé au profit du présent» : de l’Espagne de Charles II à la France de Louis-Philippe, il n’y a qu’un pas. Et, comme dans Lorenzaccio de Musset, la question centrale est ici celle du peuple, incarné par Ruy Blas – «le peuple, orphelin, pauvre, intelligent et fort ; placé très bas, et aspirant très haut » (Préface). Œuvre hybride où Hugo mêle en virtuose sublime et grotesque, tragique et comique, et manie la langue avec une aisance souveraine, Ruy Blas connut un succès sans précédent, et demeure l’une des pièces majeures du drame romantique. Présentation, notes, chronologie et bibliographie par Gérard Gengembre Texte intégral ISBN : 978-2-0812-0718-9 Illustration : Virginie Berthemet © Flammarion editions.flammarion.com Prix France : 2,80 € 1335 Flammarion 07-VIII NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 108 x 178 — 12-07-07 16:34:20 120578AHU - Flammarion - GF - Ruy Blas - Page 3 — Z20578$$$1 — Rev 18.02 VICTOR HUGO RUY BLAS Introduction, notes, dossier, chronologie et bibliographie mise à jour (2007) par Gérard GENGEMBRE GF Flammarion NORD COMPO — 03.20.41.40.01 — 108 x 178 — 12-07-07 16:34:20 120578AHU - Flammarion - GF - Ruy Blas - Page 4 — Z20578$$$1 — Rev 18.02 Du même auteur dans la même collection L’ART D’Eˆ TRE GRAND-PE` RE. -

Victor Hugo (1802-1885)
Victor Hugo (1802-1885) 1 Biographie ictor Hugo est né à Besançon le 26 février 1802. Son enfance s’écoula dans la maison des Feuillantines, qu’il a chantée dans ses vers célèbres, à l’exception de Vl’année 1811 qu’il passa à Madrid où Mme Hugo, avec ses trois enfants, a rejoint son mari promu général en avril 1809. Fin mars 1812 et jusqu’à fin décembre 1813, la vie reprit aux Feuillantines. La vocation du jeune Victor s’affirma vite. En 1816, il note : «Je veux être Chateaubriand ou rien» ; en 1819, il fut couronné par l’Académie des Jeux Floraux et fonda, avec ses frères Adel et Eugène, le Conservateur littéraire qui durera jusqu’en mars 1821. Il a écrit son premier roman Bug-Jargal, publié en 1826, dont le sujet est une révolte des Noirs à Saint- Domingue. En 1820, il reçoit une gratification du roi Louis XVIII pour son Ode sur la mort du duc de Berry - Odes et Ballades. En 1821, il perd sa mère et se remarie peu après. ‘’Victor Hugo : Conscience et combat’’, Nature et poésie, http://www.nature-et-poesie.fr/fr/reperes/articletype/articleview/articleId/49.aspx 120319 Bibliotheca Alexandrina Établi par Alaa Mahmoud 1 1822 marqua son véritable début dans la vie comme dans la carrière des lettres. Le 8 juin, il publia son premier recueil poétique : Odes et poésies diverses - Odes et ballades - et, en octobre, il épousa son amie d’enfance, Adèle Foucher. Viennent ensuite un roman, Han d’Islande (1823), Nouvelles odes (1824), Bug-Jargal (1826), Odes et ballades (1826), recueil complet des premières poésies, le drame de Cromwell (1827). -
La Pièce En Images
LA PIÈCE EN IMAGES Chanson douce de Leïla Slimani, mise en scène Pauline Bayle, avec Sébastien Pouderoux, Florence Viala et Anna Cervinka © Brigitte Enguérand, coll. Comédie-Française PETITE HISTOIRE DE LA SERVITUDE ET DE L’INFANTICIDE SUR LES SCÈNES DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE par Florence Thomas, archiviste-documentaliste à la Comédie-Française, mars 2019. Chanson douce de Leïla Slimani mise en scène Pauline Bayle 14 mars > 28 avril 2019 Ce document vous propose un parcours dans les collections iconographiques de la Comédie-Française présentées au sein de la base La Grange, accessible en ligne à l’adresse suivante : https://www.comedie-francaise.fr/ 1 RAPPORTS DE DOMINATION : DES VALETS BOUFFONS... L’ omniprésence des maîtres et des valets au théâtre reflète leur place dans la société. Ils figurent dans de nombreuses distributions, de l’Antiquité à Genet ou à la récente adaptation de La Règle du jeu de Renoir, en passant par Beaumarchais, Feydeau, Courteline, Brecht, Ionesco… Pour un valet, mieux vaut toutefois vivre sous la plume d’un auteur qui lui attribue un rôle comique, par sa maladresse souvent savoureuse, et un ressort dramaturgique nécessaire, grâce à son oreille confidente ! Bénéficiant de l’apport de la comédie espagnole, les domestiques moliéresques sont particulièrement valorisés. Certains prêtent même leur nom au titre de pièces telles que Sganarelle ou le Cocu imaginaire1 et Les Fourberies de Scapin2. Sganarelle ou le Cocu imaginaire de Molière, eau-forte par Edmond Hédouin, entre 1844 et 1888 © Coll. Comédie-Française Les Fourberies de Scapin de Molière, estampe en taille douce reliée dans Les Œuvres de Monsieur de Molière, 1692, tome VI © Coll. -

Les Savoirs Requis Et Références Indispensables
➨ Les savoirs requis et références indispensables Biographie Des routes d’Empire aux grands chemins littéraires ■ « Ce siècle avait deux ans » La naissance de Victor Hugo, le 26 février 1802 à Besançon*1, « vieille ville espagnole » est destinée à devenir le thème poétique d’ouverture des Feuilles d’automne en 1831. Ce début d’autobiographie versifi ée, contemporaine d’Hernani, s’ouvre en mettant en contraste deux destins : celui conquérant de Napoléon et celui, pour commencer précaire, de Victor Hugo. L’un est déjà en 1802 un empereur en puissance, l’autre survit après une naissance diffi cile. Cette fragilité première du troisième fi ls de Léopold (1773-1828) et Sophie Hugo (1772-1821) va se dépasser dans une enfance très stimulante. ■ Les mouvances familiales Les diverses affectations d’un père, commandant, puis colonel et général dans les armées impériales, mais aussi une crise conjugale grave entre Léopold et Sophie Hugo ont apporté à Victor et ses frères, Abel (né en 1798) et Eugène (né en 1800), des itinéraires de jeunesse aux horizons variés mais très éloignés des sérénités familiales. L’union houleuse de leurs parents leur a fait suivre tantôt les routes des places militaires de leur père, tantôt celles, toutes parisiennes, de leur mère. De là des lieux de vie où l’on voit se succéder la Corse (1803), l’île d’Elbe (1803), Paris (1804-1807), l’Italie (1807), Paris (1809-1811), l’Espagne (1811-12), Paris (1812-1814). Les démêlés judiciaires entre le Général Hugo et son épouse autour de leur séparation ont, à deux reprises, provoqué des confl its pour la garde des deux plus jeunes fi ls. -

The Sources of Victor Hugo's Drama
W. H. 5t°rer The. Sources of [fichor Hucjgs Drama THE SOURCES OF VICTOR HUGO'S DRAMA BY WALTER HENRY STORER A. B. University of Illinois, 1919 THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS IN ROMANCE LANGUAGES IN THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF ILLINOIS 1920 4 ftamto UNIVERSITY OF ILLINOIS THE GRADUATE SCHOOL 2( ^tCa~y ]q £x) I HEREBY RECOMMEND THAT THE THESIS PREPARED UNDER MY SUPERVISION RY /Y^^-^y *&t*y^e-^- Art!., f ENTITLED. BE ACCEPTED AS FULFILLING THIS PART OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF_ Heacrbf Department Recommendation concurred in* .Etc- Committee on Final Examination* *Required for doctor's degree but not for master's ^^oO'VV'i'' \°tzo TABLE OF CONTENTS Page Introduction 1 "Amy Robsart" 2 Theory of Antithesis 3 Hugo* s Use of History 6 "Cromwell" 7 "Hernani" 15 "Marion de Lorme" 22 "Le Roi s' amuse" 25 "Lucrece Borgia" 2? "Marie Tudor" 30 "Angelo" 33 "La Esmeralda" 35 "Ruy Bias" 36 "Les Jumeaux" , 51 "Les Burgraves" 52 "Torquemada" 58 Conclusion 61 Bibliography t * UiOC THE SOURCES OF VICTOR HUGO'S DRAMA Victor Hugo's dramas have been subjected to much critic- ism, both just and unjust, ever since they appeared. Some critics have maintained that they were written merely to set forth the ideas of the romantic school, of which their author was the chief, and that for this reason, if for no other, they must be rather poor literature. Some assert that Hugo's talents, not intended for the writing of dramas, were overtaxed to produce them.