Recherches Sur La Réalité Physique Michel Paty
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stage 2 Physics Sample Examination Questions
Stage 2 Physics Sample Examination Questions © SACE Board of South Australia 2020 Stage 2 Physics Sample Examination Questions Objective reference: A1013258 1. The photograph below shows a mobile phone connected to a charger. The charger contains a step-down transformer. charger mobile phone The transformer decreases the voltage from 220 V to 5.0 V. The primary coil of the transformer has 3520 turns. Determine the number of turns in the secondary coil of the transformer. ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ (2 marks) © SACE Board of South Australia 2020 Stage 2 Physics Sample Examination Questions Objective reference: A1013258 2. Two experiments were conducted to determine the wavelength of light from a monochromatic light source. -

JANNEY CYLINDER COMPANY Subsidiary of Pittsburgh Forgings Co
People and things Michael Crowley-Milling of CERN, winner J. Pniewski of this year's Glazebrook Prize from the UK Institute of Physics. (Photo K Kilian) On People Eric Burhop, well-known high energy physicist from University College London, died on 22 January. He was particularly associated with the nuclear emulsion technique both in its heyday of cosmic ray research and early accelerator experiments and in its revived role in hybrid sys tems for the observation of charmed particle tracks, where he played a pioneering role. The Swedish physicist Erik Rudberg died on 2 January. He was Presi dent of the European Physical So ciety from 1970 to 1972 and in that office wrote for CERN COU RIER (February issue 1971 ) a mes sage of welcome on the decision to build the SPS. Gale Pewitt has been named Deputy Director for Operations at the Ar tation in music and recently com the National Medal of Science, one gonne Laboratory. In the 1960s he posed a song to celebrate CERN's of the highest US awards, to 20 em led the design and construction of 25th Anniversary (see November, inent researchers. Among those the 12 foot hydrogen bubble cham 1979 issue, page 369). who received the award this year <^ ber with its pioneering use of a were Richard Feynman and Victor large superconducting magnet. He Weisskopf. subsequently became Director of Among the award winners of the the High Energy Facilities Division. UK Institute of Physics for 1980 were Michael Crowley-Milling of PETRA and DORIS CERN (Glazebrook Medal and Prize) The Polish physicist J. -

Appeal from the Nuclear Age Peace Foundation to End the Nuclear Weapons Threat to Humanity (2003)………………………………………..……...26
Relevant Appeals against War and for Nuclear Disarmament from Scientific Networks 1945- 2010 Reiner Braun/ Manuel Müller/ Magdalena Polakowski Russell-Einstein-Manifesto (1955)……………..…..1 The first Pugwash Conferenec (1957)………..……4 The Letter from Bertrand Russell to Joseph Rotblat (1956)………………………………..……...6 „Göttinger 18“ (1957)…………………………..…..8 Hiroshima Appeal (1959)………………………..…9 Linus Pauling (1961)…………………………..…..10 The Call to Halt the Nuclear Arms Race (1980)………………..…..11 The Göttingen Draft Treaty to Ban Space Weapons (1984)…………………………………………….....15 Appeal by American Scientists to Ban Space Weapons (1985)………………………………..…..16 The Hamburg Disarmament Proposals (1986)…………………………………………..…...17 Hans A. Bethe to Mr. President (1997)………..…18 Appeal from Scientists in Japan (1998)……….....20 U.S.Nobel laureates object to preventive attack on Iraq (2003)……………………………………...….25 Appeal from the Nuclear Age Peace Foundation to end the nuclear weapons threat to humanity (2003)………………………………………..……...26 Appeal to support an International Einstein Year (2004)……………………………………………….28 Scientists for a Nuclear Weapons Free World, INES (2009)…………………………..……………31 Milan Document on Nuclear Disarmament (2010)……………………..34 Russell-Einstein-Manifesto (1955) 1 Russell-Einstein-Manifesto (1955) In the tragic situation which confronts humanity, we feel that scientists should assemble in conference to appraise the perils that have arisen as a result of the development of weapons of mass destruction, and to discuss a resolution in the spirit of the appended draft. We are speaking on this occasion, not as members of this or that nation, continent, or creed, but as human beings, members of the species Man, whose continued existence is in doubt. The world is full of conflicts; and, overshadowing all minor conflicts, the titanic struggle between Communism and anti-Communism. -

Science, Scientific Intellectuals and British Culture in the Early Atomic Age, 1945-1956: a Case Study of George Orwell, Jacob Bronowski, J.G
Science, Scientific Intellectuals and British Culture in The Early Atomic Age, 1945-1956: A Case Study of George Orwell, Jacob Bronowski, J.G. Crowther and P.M.S. Blackett Ralph John Desmarais A Dissertation Submitted In Fulfilment Of The Requirements For The Degree Of Doctor Of Philosophy Imperial College London Centre For The History Of Science, Technology And Medicine 2 Abstract This dissertation proposes a revised understanding of the place of science in British literary and political culture during the early atomic era. It builds on recent scholarship that discards the cultural pessimism and alleged ‘two-cultures’ dichotomy which underlay earlier histories. Countering influential narratives centred on a beleaguered radical scientific Left in decline, this account instead recovers an early postwar Britain whose intellectual milieu was politically heterogeneous and culturally vibrant. It argues for different and unrecognised currents of science and society that informed the debates of the atomic age, most of which remain unknown to historians. Following a contextual overview of British scientific intellectuals active in mid-century, this dissertation then considers four individuals and episodes in greater detail. The first shows how science and scientific intellectuals were intimately bound up with George Orwell’s Nineteen Eighty Four (1949). Contrary to interpretations portraying Orwell as hostile to science, Orwell in fact came to side with the views of the scientific rig h t through his active wartime interest in scientists’ doctrinal disputes; this interest, in turn, contributed to his depiction of Ingsoc, the novel’s central fictional ideology. Jacob Bronowski’s remarkable transition from pre-war academic mathematician and Modernist poet to a leading postwar BBC media don is then traced. -
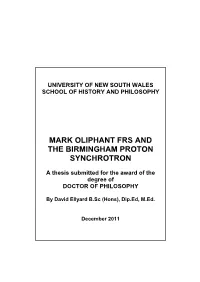
Mark Oliphant Frs and the Birmingham Proton Synchrotron
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES SCHOOL OF HISTORY AND PHILOSOPHY MARK OLIPHANT FRS AND THE BIRMINGHAM PROTON SYNCHROTRON A thesis submitted for the award of the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By David Ellyard B.Sc (Hons), Dip.Ed, M.Ed. December 2011 ORIGINALITY STATEMENT I hereby declare that this submission is my own work and to the best of my knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the award of any other degree or diploma at UNSW or any other educational institution, except where due acknowledgement is made in the thesis. Any contribution made to the research by others, with whom I have worked at UNSW or elsewhere, is explicitly acknowledged in the thesis. I also declare that the intellectual content of this thesis is the product of my own work, except to the extent that assistance from others in the project's design and conception or in style, presentation and linguistic expression is acknowledged. 20 December 2011 2 COPYRIGHT STATEMENT I hereby grant the University of New South Wales or its agents the right to archive and to make available my thesis or dissertation in whole or part in the University libraries in all forms of media, now or here after known, subject to the provisions of the Copyright Act 1968. I retain all proprietary rights, such as patent rights. I also retain the right to use in future works (such as articles or books) all or part of this thesis or dissertation. -

Russell Stannard Interviewed by Paul Merchant: Full Transcript of The
NATIONAL LIFE STORIES Science and Religion: Exploring the Spectrum. Life Story Interviews Russell Stannard Interviewed by Paul Merchant C1672/03 IMPORTANT This interview and transcript is accessible via http://sounds.bl.uk. © The British Library Board. Please refer to the Oral History curators at the British Library prior to any publication or broadcast from this document. Oral History The British Library 96 Euston Road London NW1 2DB United Kingdom +44 (0)20 7412 7404 [email protected] Every effort is made to ensure the accuracy of this transcript, however no transcript is an exact translation of the spoken word, and this document is intended to be a guide to the original recording, not replace it. Should you find any errors please inform the Oral History curators. The British Library National Life Stories Interview Summary Sheet Title Page Ref no: C1672/03 Collection title: ‘Science and Religion: Exploring the Spectrum’ Life Story Interviews Interviewee’s surname: Stannard Title: Professor Interviewee’s Russell Sex: Male forename: Occupation: Professor of Physics Date and place of birth: 24th December 1931, Brixton, London Mother’s occupation: bus conductress Father’s occupation: doorman for London Electricity Board Dates of recording, Compact flash cards used, tracks (from – to): 15/01/2015 (track 1-3), 12/02/2015 (track 4-5), 25/06/2015 (track 6-7), 05/08/15 (track 8-10) Location of interview: British Library, London Name of interviewer: Paul Merchant Type of recorder: Marantz PMD661on compact flash Recording format : audio file 12 WAV 24 bit 48 kHz 2-channel Total no. of tracks 10 Mono or stereo: Stereo Total Duration: 12 hrs. -

Aliens at Harwell
ALIENS AT HARWELL: BRITISH REPRESENTATIONS OF NUCLEAR SCIENCE AND NUCLEAR SCIENTISTS, 1945 - 1961 By Jelena Ćulibrk Submitted to Central European University Department of History In partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts Supervisor: Professor Karl Hall Second Reader: Professor Katalin Straner CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2015. Statement of Copyright Copyright in the text of this thesis rests with the Author. Copies by any process, either in full or part, may be made only in accordance with the instructions given by the Author and lodged in the Central European Library. Details may be obtained from the librarian. This page must form a part of any such copies made. Further copies made in accordance with such instructions may not be made without the written permission of the Author. CEU eTD Collection ii Abstract In this dissertation, I study the representations of nuclear science and nuclear scientists in the early British post-war environment. Temporal framework is from the explosion of Hiroshima and Nagasaki atomic bombs in 1945 to 1961, when the public‘s fascination over nuclear energy decreased. How did nuclear science go from awe and horror of Nagasaki and Hiroshima bombings to the humanizing and peaceful application of nuclear energy? I restrict the study to the production of Harwell‘s space, British ―hub‖ for post-war nuclear research, and John Cockcroft‘s image, Harwell‘s first director. I draw my methodology from current historiography that argues for an equal study of both verbal and visual historical reminiscence. In a comparative study of governmental documents, newspapers, pamphlets, news photography, newsreels and 1950s science fiction cinema, I weave complex representations of the British nuclear project. -

Frédéric Joliot-Curie, the World Federation of Scientific Workers and the Origins of the Pugwash Movement
Geoffrey Roberts Science, Peace and Internationalism: Frédéric Joliot-Curie, the World Federation of Scientific Workers and the Origins of the Pugwash Movement The Pugwash Movement traces its origins to the so-called Russell-Einstein manifesto of July 1955. Launched at a press conference in London the manifesto warned of the dire threat to humanity posed by nuclear weapons of mass destruction: "In view of the fact that in any future world war nuclear weapons will certainly be employed, and that such weapons threaten the continued existence of mankind, we urge the Governments of the world to realize, and to acknowledge publicly, that their purpose cannot be furthered by a world war, and we urge them, consequently, to find peaceful means for the settlement of all matters of dispute between them." 1 Such a statement by the world’s most famous philosopher and the world’s most famous scientist was bound to generate considerable public interest but what grabbed the attention of journalists at the press conference was the political composition of the manifesto’s sponsors. As well as Bertrand Russell and Albert Einstein, the manifesto was signed by nine leading scientists from Britain, Europe, Japan and United States, eight of whom were Nobel laureates. They included Frédéric Joliot-Curie, President of the communist-dominated World Peace Council (WPC), the physicist Leopold Infeld who was a member of the Polish Academy of Sciences and a Vice-President of the WPC, and C.F. Powell, a leading member of the World Federation of Scientific Workers, an organisation over which Joliot-Curie also presided. -

Thesis Front 2
Nuclear New Zealand: New Zealandʼs nuclear and radiation history to 1987 A thesis submitted in fulfilment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in the History and Philosophy of Science in the University of Canterbury by Rebecca Priestley, BSc (hons) University of Canterbury August 2010 Table of contents Abstract 1 Acknowledgements 2 Chapter 1 Nuclear-free New Zealand: Reality or a myth to be debunked? 3 Chapter 2 The radiation age: Rutherford, New Zealand and the new physics 25 Chapter 3 The public are mad on radium! Applications of the new science 45 Chapter 4 Some fool in a laboratory: The atom bomb and the dawn of the nuclear age 80 Chapter 5 Cold War and red hot science: The nuclear age comes to the Pacific 110 Chapter 6 Uranium fever! Uranium prospecting on the West Coast 146 Chapter 7 Thereʼs strontium-90 in my milk: Safety and public exposure to radiation 171 Chapter 8 Atoms for Peace: Nuclear science in New Zealand in the atomic age 200 Chapter 9 Nuclear decision: Plans for nuclear power 231 Chapter 10 Nuclear-free New Zealand: The forging of a new national identity 257 Chapter 11 A nuclear-free New Zealand? The ideal and the reality 292 Bibliography 298 1 Abstract New Zealand has a paradoxical relationship with nuclear science. We are as proud of Ernest Rutherford, known as the father of nuclear science, as of our nuclear-free status. Early enthusiasm for radium and X-rays in the first half of the twentieth century and euphoria in the 1950s about the discovery of uranium in a West Coast road cutting was countered by outrage at French nuclear testing in the Pacific and protests against visits from American nuclear-powered warships. -

CERN PS/SPS Run of Records the CERN PS and SPS Accelerators Ended 1 978 with a Flourish
A 500 GeV pulse as recorded at the CERN SPS on 20 December. This record peak energy was achieved in a machine development run and is not intended to be regularly used in physics runs. (One reason for this is the heavy penalty in electrical power, as can be seen from the shape of the magnet pulse near 500 GeV where field saturation has set in). The SPS will, however, begin regular operating cycles at 450 GeV in the course of 1979. During the 17 GeV runs PETRA reached a peak luminosity of 1.2 x 1 030 per cm2 per s at each intersec tion. This is about a fifth of the value expected at these low' energies. Although beam currents correspond to the design values, the beam cross- sections are wider than expected due to space charge effects. This is being investigated. In February, more high frequency power was installed to enable the machine to move to higher energies. CERN PS/SPS run of records The CERN PS and SPS accelerators ended 1 978 with a flourish. In their last run of the year, new records of beam intensity, number of protons accelerated and beam energy were clocked up at the SPS — all of great significance for the physics pro gramme at the machine. all experimental areas (North, West with the electricity supply were Crucial to the success was the and Neutrino) could be operated cleared. On 20 December, the excellent performance of the PS. The simultaneously. The SPS efficiency 450 GeV cycle was repeated, fol hew linac injector, which came into moved to 88% compared to 80% lowed by 475 GeV. -

David Bohm, the Hot Times of the Cold War, and His Struggle for a New Interpretation O
1 Olival Freire Jr.∗ Science and exile: David Bohm, the hot times of the Cold War, and his struggle for a # new interpretation of quantum mechanics ABSTRACT: In the early 1950s the American physicist David Bohm (1917-1992) lived through a critical moment, when he produced a new interpretation for quantum mechanics and had to flee from the United States as McCarthyism’s victim. At that time he faced vicissitudes related to the Cold War and his move from Princeton to São Paulo. This article focuses on the reception among physicists of his papers on the causal interpretation, which were poorly received at the time. I describe his Brazilian exile and analyze the culture of physics surrounding the foundations of quantum mechanics. This article takes into account the strength of the Copenhagen interpretation of quantum physics among physicists, the way in which issues concerning the foundations of quantum mechanics were present in the training of physicists, the low status of these issues on research agendas, and the kind of results Bohm and collaborators were able to achieve. It also compares the reception of Bohm’s ideas with that of Hugh Everett’s interpretation. This article argues that the obstacles growing from the cultural context of physics at that time had a more significant influence in the reception of Bohm’s ideas than did the vicissitudes related to the McCarthyist climate. WHEN DAVID BOHM and Richard Feynman concluded their physics dissertations, during the first half of the 1940s, they were among the most promising students of their generation in American physics. -
"Taking a Stand: Exploring the Role of the Scientists Prior to the First Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1957"
Article "Taking a Stand: Exploring the Role of the Scientists prior to the First Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1957" Sylvia Nickerson Scientia Canadensis: Canadian Journal of the History of Science, Technology and Medicine / Scientia Canadensis : revue canadienne d'histoire des sciences, des techniques et de la médecine , vol. 36, n° 2, 2013, p. 63-87. Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/1027022ar DOI: 10.7202/1027022ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi sur le droit d'auteur. L'utilisation des services d'Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d'utilisation que vous pouvez consulter à l'URI https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ éruditest un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l'Université de Montréal, l'Université Laval et l'Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.éruditoffre des services d'édition numérique de documents scientifiques depuis 1998. Pour communiquer avec les responsables d'Érudit : [email protected] Document téléchargé le 18 février 2016 04:22 Taking a Stand : Exploring the Role of the Scientists prior to the First Pugwash Conference on Science and World Affairs, 1957∗ Sylvia Nickerson University of Toronto Abstract : In 1957, a small group of world-renown scientists gathered in Pugwash, Nova Scotia to discuss the growing threat of nuclear arms. Funded by industrialist Cyrus Eaton and spearheaded by philosopher Bertrand Russell and physicist Joseph Rotblat, this 1957 meeting founded an organization of scientists that believed they had a duty to speak out against escalating nuclear testing and what they saw as the irresponsible use of science.