Annexe 7 – Fiches Espèces Flore
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Allegato C Al Rapporto Ambientale Studio Di Incidenza
ALLEGATO C AL RAPPORTO AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA FASE DI VAS AI SENSI DELLA LR 32/2012 e s. m. e i. STUDIO DI INCIDENZA Proponente: Dipartimento TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Vicedirezione Generale TERRITORIO Settore TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE PTRAC 1 Rapporto Ambientale VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CAVA Gruppo di lavoro: Settore TUTELA DEL PAESAGGIO, DEMANIO MARITTIMO E ATTIVITÀ ESTRATTIVE LIGURIA RICERCHE S. p. A. Autorità Competente Dipartimento TERRITORIO, AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI TERRITORIO Vicedirezione Generale TERRITORIO Settore PIANIFICAZIONE E VAS PTRAC 2 Rapporto Ambientale Sommario BIODIVERSITÀ IN LIGURIA .................................................................................................................... 6 1.1 Biodiversità inquadramento ed elementi di valutazione di incidenza ............................................ 6 1.2 Biodiversità e Atlante degli habitat ................................................................................................ 6 1.3 Rete Natura 2000 in Liguria ........................................................................................................... 8 1.4 Caratterizzazione dei siti ............................................................................................................. 12 2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA ........................................................................... 18 2.1 Introduzione ............................................................................................................................... -

Valutazione Ambientale Del Piano Di Sviluppo 2011
Valutazione Ambientale del Piano di Sviluppo 2011 Rapporto Ambientale Volume Regione LIGURIA INDICE 1 Introduzione 4 3.3 Paesaggio e beni culturali, architettonici, monumentali e archeologici 13 1.1 Struttura del rapporto regionale 4 3.3.1 Siti UNESCO 13 1.2 Modalità di collaborazione attivate per la VAS 4 4 Contesto Economico 14 1.3 Fonti dati disponibili 4 5 Contesto Tecnico 15 2 Contesto Ambientale 5 5.1 Pianificazione energetica regionale 15 2.1 Caratterizzazione geografica 5 5.2 Stato della rete di trasmissione nazionale nell’area 2.2 Biodiversità ed aree protette 5 del Nord Ovest d’Italia 15 2.2.1 Aree naturali protette 5 6 Interventi 17 2.2.2 Rete Natura 2000 6 2.2.3 Aree Ramsar 9 6.1 Nuove esigenze 17 2.3 Assetto del territorio 9 6.2 Interventi presenti in Piani precedenti già approvati 31 2.4 Pianificazione territoriale 10 6.3 Sintesi degli indicatori regionali 33 3 Contesto Sociale 12 3.1 Demografia 12 3.2 Uso del suolo 12 Indice | 3 1 Introduzione dell’economia regionale, anche in relazione a 1.1 Struttura del rapporto regionale dati nazionali; − Il Rapporto Regionale relativo al Piano di Sviluppo Contesto Tecnico, che descrive lo stato della rete (PdS) 2011 riporta i principali interventi previsti, a livello regionale; suddivisi tra interventi in corso di concertazione, da − Interventi, che sono oggetto della VAS, proposti avviare alla concertazione, privi di potenziali effetti sul territorio regionale. significativi sull’ambiente, al di fuori dell’ambito VAS (in fase autorizzativa, autorizzati, in 1.2 Modalità di collaborazione attivate per la realizzazione, ecc.). -

Scopri Le Alpi Liguri: Estate 2004
SCOPRI LE ALPI LIGURI Escursioni Estate 2017 Vi invitiamo a partecipare al ricco programma di escursioni nello splendido entroterra del Ponente Ligure, ogni gita in una valle diversa, per scoprirne le bellezze naturali, storico-artistiche in una piacevole atmosfera di gruppo. Maggio Domenica 7 Saint Agnes Pic Baudon (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 900 metri Domenica 14 Monte Grammondo da Castellar (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 1000 metri Domenica 21 Monte Ceppo da Ciabaudo (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 900 metri Domenica 28 Monte Carmo di Loano (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 600 metri Giugno Domenica 4 Monte Abellio da Airole (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 900 metri Domenica 11 Monte Ceppo da Bajardo (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 900 metri Domenica 18 Monte Toraggio da Gouta (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 900 metri Domenica 25 Monte Saccarello da Verdeggia per Rododendri (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 8 ore, dislivello 1100 metri Luglio Domenica 2 Monte Monega dal Passo Teglia (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore, dislivello 600 metri Domenica 9 Monte Forquin da Gouta (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 6 ore, dislivello 500 metri Domenica 16 Balconi di Marta da Colle Melosa (M) Difficoltà E, Tempi di Marcia 5 ore, dislivello 600 metri (500 senza scendere nel forte) Domenica 23 Cima delle Saline da Carnino (R) Difficoltà E, Tempi di Marcia 7 ore, dislivello 1200 metri Domenica 30 Rocca -

Sui Sentieri Di Sanremo & Ospedaletti
Marco PUKLI SUI SENTIERI DI SANREMO & OSPEDALETTI GUIDA ESCURSIONISTICA Itinerari scelti Riviera dei Fiori: Alpi Liguri Catena del Saccarello Costiera Ceppo Bignone Copyright © Marco Pukli 2015 - Tutti i diritti e i doveri riservati. Versione 1.3.0 2 Introduzione Questo libretto propone una serie di itinerari escursionistici nell’entroterra di Sanremo e di Ospedaletti. Alcuni di questi percorsi sono molto conosciuti dagli appassionati, altri un po’ meno. Spero che ognuno possa trovarvi uno spunto, un’idea, per organizzare una bella gita, tenendo conto che, oltre a quelli descritti, nella zona sono ancora molti i percorsi da scoprire, e resta tanto spazio libero per la fantasia di ognuno. Lo scopo principale, forse l’unico scopo di questo lavoro, corrisponde a un’illusione: tentare di trasferire sulla carta, di comunicare, qualche emozione nata proprio grazie alle passeggiate nella natura del nostro entroterra. Ovviamente non ci sono riuscito, poiché le emozioni sono una faccenda troppo impalpabile, intima, del tutto personale; ognuno può tentare di farsi capire, ma in fondo ognuno può sentire le proprie emozioni solamente vivendosele direttamente sulla propria pelle. La natura dell’entroterra ligure è un mondo, un ambiente, che vale la pena di conoscere, che per certi versi è necessario conoscere. Perché camminare su questi sentieri, oggi, oltre a consentirci di vivere esperienze sportive nella natura, di svago, di piacere personale, rappresenta un legame con una cultura alla quale apparteniamo, e che ci appartiene. Ma c’è di più. Camminare in montagna a volte offre l’opportunità di vivere esperienze che altrimenti sarebbero inaccessibili. Può capitare di vivere degli strani momenti, per esempio di farsi sorprendere da un odore particolare, da un profumo, che può essere di muschio, o forse di erba bagnata, che risveglia in noi una sensazione indefinibile, un’intuizione di un qualcosa che pensavamo perduto, o di cui forse non eravamo nemmeno mai stati coscienti. -

Elenco Dei SIC-ZSC
AGGIORNAMENTO OTTOBRE 2014 Coordinate geografiche Superficie Lunghezza Regione/Provincia Autonoma CODICE DENOMINAZIONE ZSC Longitudine Latitudine MAPPE FORMULARI STANDARD (Ha) (Km) (Gradi decimali) Piemonte IT1110001 Rocca di Cavour 76 0 7,3780 44,7810 IT1110001_A4-vert.jpg Site_IT1110001.pdf Piemonte IT1110002 Collina di Superga 747 0 7,7706 45,0697 IT1110002_A4-vert.jpg Site_IT1110002.pdf Piemonte IT1110004 Stupinigi 1731 0 7,5920 44,9810 IT1110004_A3-vert.jpg Site_IT1110004.pdf Piemonte IT1110005 Vauda 2654 0 7,6509 45,2503 IT1110005_A3-oriz.jpg Site_IT1110005.pdf Piemonte IT1110006 Orsiera Rocciavré 10956 0 7,1330 45,0617 IT1110006_A4-oriz.jpg Site_IT1110006.pdf Piemonte IT1110007 Laghi di Avigliana 414 0 7,3861 45,0652 IT1110007_A4-vert.jpg Site_IT1110007.pdf Piemonte IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera 62 0 7,4678 45,1778 IT1110008_A4-vert.jpg Site_IT1110008.pdf Piemonte IT1110009 Bosco del Vaj e "Bosc Grand" 1347 0 7,9289 45,1114 IT1110009_A3-vert.jpg Site_IT1110009.pdf Piemonte IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand 3712 0 6,9222 45,0581 IT1110010_A3-vert.jpg Site_IT1110010.pdf Piemonte IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives 145 0 7,7433 45,4158 IT1110013_A4-vert.jpg Site_IT1110013.pdf Piemonte IT1110014 Stura di Lanzo 688 0 7,5647 45,2203 IT1110014_A4-vert.jpg Site_IT1110014.pdf Piemonte IT1110015 Confluenza Po - Pellice 146 0 7,5610 44,8110 IT1110015_A4-vert.jpg Site_IT1110015.pdf Piemonte IT1110016 Confluenza Po - Maira 178 0 7,6460 44,8380 IT1110016_A4-vert.jpg Site_IT1110016.pdf Piemonte IT1110017 Lanca di Santa Marta -

Sintesi Delle Caratteristiche Geologiche E Geomorfologiche Della Provincia Di Imperia
Quadro Fondativo del P.T.C. della Provincia di Imperia – TEMA:GEOLOGIA SINTESI DELLE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 1. - RICOSTRUZIONE PALEOGEOGRAFICA ED INQUADRAMENTO GEOLOGICO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA Di seguito vengono riportati, dopo una breve introduzione finalizzata alla comprensione degli argomenti trattati anche da parte dei “non addetti ai lavori”, estratti bibliografici assai efficaci per la trattazione, in forma sintetica, del tema in oggetto. La citazione degli Autori è riportata nella nota a piè di pagina1. I terreni su cui poggiano i nostri piedi e su cui realizziamo le nostre opere ed attività sono il frutto di fenomeni geologici creativi che si sviluppano in archi temporali di milioni di anni, fenomeni che la scienza specifica ha studiato e continua a studiare, leggendo il passato attraverso ciò che l’attuale geografia degli ambienti terrestri ci mostra. La scoperta delle emissioni vulcaniche della cordigliera sottomarina situata al centro dell’Oceano Atlantico, scoperta che si è resa possibile grazie ai sempre più sofisticati strumenti di cui la Scienza moderna dispone, ha portato alla formulazione della teoria della “Tettonica a zolle”, meccanismo che riesce a descrivere i flussi di energia che fuoriescono dall’interno del nostro globo, che giustifica gli spostamenti reciproci, misurati anche annualmente, tra le masse dei continenti, che spiega il perché dei terremoti. Spiega altresì il perché in cima ai monti troviamo, infisse nelle rocce, le conchiglie marine, cioè spiega i fenomeni di “nascita“ delle montagne, le cosiddette orogenesi: esse avvengono allorquando esiste un movimento di compressione tra le placche continentali, che, detto elementarmente, produce costipazioni e rialzi delle masse rigide crostali, formate appunto da “terreni” o “formazioni” di materiali litoidi. -

SIC IT 1315717 M. Grammondo – T
SIC IT 1315717 M. Grammondo – T. Bevera 1 INDICE RELAZIONE 1. PREMESSA 1.1 IDENTIFICAZIONE ED INQUADRAMENTO DEL SITO 5 1.2 IMPOSTAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE 11 1.3 IL GRUPPO DI LAVORO 12 2. QUADRO CONOSCITIVO 2.1 DESCRIZIONE FISICA 13 2.1.1 Clima, idrografia 13 2.1.2 Geologia, geomorfologia, idrogeologia 15 2.2 DESCRIZIONE BIOLOGICA 19 2.2.1 Vegetazione 19 2.2.2 Habitat 22 2.2.3 Flora 28 2.2.4 Fauna 33 2.2.5 Formulario standard Natura 2000, verifiche per aggiornamento 49 2.3 DESCRIZIONE SOCIO-ECONOMICA 51 2.3.1 Uso del suolo 52 2.3.2 Attività socio-economiche, regime proprietario dei suoli 53 2.4 VALORI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI E CULTURALI 55 2.5 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO 56 2.6 PIANIFICAZIONE URBANISTICA, ALTRI PIANI E PROGRAMMI 58 2.6.1 Il P.U.C. ed altri dispositivi regolamentari di competenza comunale 58 2.6.2 Altri Piani e Programmi: livello regionale 62 2.6.2.1 Piano Territoriale Regionale (PTR) 2.6.2.2 Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) 2.6.2.3 Piano Territoriale delle Cave 2.6.2.4 Piano di Tutela Acque regionale 2.6.2.5 Pianificazione forestale e PRSR 2.6.2.6 Piano Turistico Triennale 2.6.2.7 Piano Energetico Ambientale regionale 2.6.3 Altri Piani e Programmi: livello provinciale 72 2.6.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento provinciale 2.6.3.2 Piano Faunistico Venatorio 2.6.3.3 Carta Ittica provinciale SIC IT 1315717 M. Grammondo – T. -

Progetto CARG Per Il Servizio Geologico- ISPRA: F
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Organo Cartografico dello Stato (legge n° 68 del 2.2.1960) NOTE ILLUSTRATIVE della CARTA GEOLOGICA D’ITALIA alla scala 1:50.000 foglio 257 e 270 DOLCEACQUA - VENTIMIGLIA a cura di: G. Dallagiovanna1, F. Fanucci†2, L. Pellegrini1, S. Seno1 e L. Bonini1, A. Decarlis1, M. Maino1, D. Morelli2, G. Toscani1 Con contributi, per le aree emerse, di: A. Breda3 (depositi pliocenici); P. L. Vercesi1 (substrato meso-cenozoico); D. Zizioli1 (depositi quater- nari); M.PROGETTO Cobianchi1, N. Mancin1, C. A. Papazzoni4 (biostratigrafia nannofossili calcarei e foraminiferi). 1 Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente - Università di Pavia 2 Dipartimento di Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università di Trieste 3 Dipartimento di Geoscienze - Università di Padova 4 Dipartimento di Scienze della Terra - Università di Modena e Reggio Emilia Ente realizzatore Regione Liguria Dipartimento Ambiente - Settore Assetto del CARGTerritorio Direttore del Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia: C. Campobasso Responsabile dei Progetti CARG e RISKNAT per la Regione Liguria: G. Gorziglia Responsabile del Progetto CARG per il Servizio Geologico- ISPRA: F. Galluzzo Gestione Operativa del Progetto CARG per il Servizio Geologico d’Italia – ISPRA: M.T. Lettieri PER IL SERVIZIO GEOLOGICO D’ITALIA Revisione scientifica: E. Chiarini, L. Martarelli, R. M. Pichezzi (aree emerse) S. D’ Angelo, A. Fiorentino (aree sommerse) Allestimento cartografico ed editoriale per la stampa: S. Falcetti Coordinamento cartografico ed editoriale: D. Tacchia Controllo e revisione dell’informatizzazione dei dati geologici: R. Carta Revisione ASC: A. Fiorentino PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA (aree emerse): Coordinatore scientifico: S. -

' N 44°46'5'' Cnt It1110002
SITECODE SITE_NAME AREA LENGTH LONGITUDE LATITUDE BIOGEO IT1110001 Rocca di Cavour 76,00 E 7°23'31'' N 44°46'5'' CNT IT1110002 Collina di Superga 747,00 E 7°46'14'' N 45°4'11'' CNT IT1110004 Stupinigi 1.731,00 E 7°36'40'' N 44°57'32'' CNT IT1110005 Vauda 2.412,00 E 7°41'17'' N 45°13'13'' CNT IT1110006 Orsiera Rocciavré 10.965,00 E 7°8'27'' N 45°3'48'' ALP IT1110007 Laghi di Avigliana 420,00 E 7°23'8'' N 45°4'5'' ALP IT1110008 Madonna della Neve sul Monte Lera 62,00 E 7°28'4'' N 45°10'40'' ALP IT1110009 Bosco del Vaj e "Bosc Grand" 1.347,00 E 7°55'44'' N 45°6'41'' CNT IT1110010 Gran Bosco di Salbertrand 3.712,00 E 6°55'20'' N 45°3'29'' ALP IT1110013 Monti Pelati e Torre Cives 145,00 E 7°44'36'' N 45°24'57'' ALP IT1110014 Stura di Lanzo 688,00 E 7°33'53'' N 45°13'13'' CNT IT1110015 Confluenza Po - Pellice 146,00 E 7°35'22'' N 44°46'55'' CNT IT1110016 Confluenza Po - Maira 178,00 E 7°40'11'' N 44°49'13'' CNT IT1110017 Lanca di Santa Marta (confluenza Po - Banna) 164,00 E 7°41'44'' N 44°57'5'' CNT IT1110018 Confluenza Po - Orco - Malone 312,00 E 7°51'58'' N 45°11'2'' CNT IT1110019 Baraccone (confluenza Po - Dora Baltea) 1.574,00 E 8°2'28'' N 45°10'41'' CNT IT1110020 Lago di Viverone 926,00 E 8°1'52'' N 45°25'4'' CNT IT1110021 Laghi di Ivrea 1.598,00 E 7°53'36'' N 45°29'21'' ALP IT1110022 Stagno di Oulx 84,00 E 6°49'2'' N 45°2'10'' ALP IT1110024 Lanca di San Michele 228,00 E 7°40'42'' N 44°52'3'' CNT IT1110025 Po morto di Carignano 503,00 E 7°41'48'' N 44°53'47'' CNT IT1110026 Champlas - Colle Sestriere 1.050,00 E 6°50'59'' N 44°57'7'' ALP -
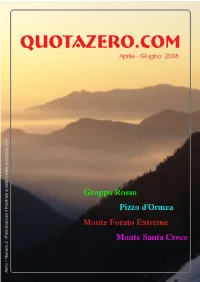
Quotazero 02.Vp
Anno 1 Numero 2 - Pubblicazione trimestrale a cura di www.quotazero.com QUOTAZERO.com Monte F Groppo Rosso orato Extr Monte Santa Aprile -Giugno2008 Pizzo d'Ormea eme Croce Editoriale Dopo tre mesi eccoci di nuovo pronti per essere "scaricati" con 16 pezzi ‘freschi freschi di stagione’. In questo numero è stato dedicato ampio spazio alle varie salite primaverili che hanno visti coinvolti diversi collaboratori della rivista soprattutto nelle Alpi Liguri: verremo "portati" sul Mongioie (per la storica via Biancardi), sul Grammondo (per la divertente cresta sud-est, ad un passo dal mare) e sul "classico" Pizzo d’Ormea che, come vedremo, offre un interessante spunto alpinistico nella sua veste invernale. Non soltanto le alpi Liguri offrono in primavera interessanti salite di alpinismo invernale: leggeremo infatti di una bella salita in Alpi Apuane sul Monte Cavallo. Oltre alle proposte su neve (e roccia!) sopra citate, in questo numero si trovano anche altri articoli dedicati all’arco sud-occidentale delle nostre Alpi e alle Apuane. Inoltre, non mancano idee e informazioni per gli amanti di Mountain Bike oltre che di alpinismo ed escursionismo. Ovviamente non è lasciato in secondo piano l’Appennino Ligure, che come sempre ci offre interessanti spunti (troviamo in questo numero un interessante approfondimento sulle Torri ottocentesche sulle alture di Genova e il racconto di una piacevole escursione alla scoperta della Val Chiaravagna, alle spalle del quartiere genovese di Sestri Ponente) e che fa da ambientazione per diversi eventi nati proprio dai partecipanti al forum di Quotazero: si parlerà infatti dell’incontro "arrampicatorio" svoltosi lo scorso 20 aprile al Castellaro di Alpicella e di quello a Pieve Ligure con salita sul Monte Santa Croce. -

GITE G.E.S. Dal 1965 Al 2016 S/A = Sci / Alpinistica - CIA = Ciaspole N° DESCRIZIONE LOCALITA' DATA N
GITE G.E.S. dal 1965 al 2016 S/A = Sci / Alpinistica - CIA = Ciaspole N° DESCRIZIONE LOCALITA' DATA n. Pers. Tipo G.G. 1 ACQUEDOTTO STORICO di GENOVA 08/02/2015 21 2 ACQUEDOTTO STORICO di GENOVA 1° Parte 25/09/2011 14 3 ACQUEDOTTO STORICO di GENOVA 2° Parte 20/11/2011 29 4 ALASSIO - MADONNA DELLA GUARDIA 04/02/2001 20 5 ALASSIO - MONTE BIGNONE - ALBENGA 30/11/2003 17 6 ALASSIO - POGGIO BREA - ALASSIO 23/01/2005 42 7 ALBENGA - ALASSIO 12/01/2003 28 8 ALBENGA - ALASSIO 17/01/2010 28 9 ALBENGA - ALASSIO (Via Martiri della Libertà) 24/03/1991 12 10 ALBENGA - ALASSIO (Via Martiri della Libertà) 14/01/1996 27 11 ALBISOLA SUPERIORE - BRIC GENOVA (Anello) 10/11/2013 23 12 ALPICELLA - MONTE BEIGUA - MONTE PRIAFIA 30/03/2008 44 13 ALTARE - QUILIANO 19/11/2006 17 14 ALTIPIANO delle MANIE - GROTTA dell'ARMA 21/03/1976 12 15 ALTOPIANO del FINALESE (CALVISIO-San Cipriano-Bric Reseghe) 22/12/1985 24 16 ALTOPIANO DELLE CONCHE (ORCO - SAN LORENZINO) 05/12/1982 35 17 ALTOPIANO DELLE MANIE (Polentata Sociale) 09/11/1983 48 18 ALTURE di BOGLIASCO - NERVI (M.Bado-M.Becco-M.Cardona) 08/04/1984 31 19 AMEGLIA - MONTE MARCELLO - LERICI 26/03/2006 39 20 ANDORA - CAPO MELE BIRDWATCHING 21/03/1999 17 21 ANELLO BARBARESCO (LANGHE) 13/10/2013 28 22 ANELLO DI GIUTTE (MONTE PENNELLO) 14/10/2001 13 23 ANELLO RIO FERRAIA 12/08/2012 10 24 ANELLO SAN PIETRO D'ORBA (Alla ricerca dell'ORO) 30/05/2004 44 25 ANELLO VARIGOTTI 14/04/2013 25 26 ANTICO SENTIERO DEL FIENO SANMARTINO 03/02/2013 37 27 ARENZANO - PASSO DELLA GAVA 13/05/2007 23 28 ARMA STRAPATENTE (ORCO FEGLINO) 02/12/2001 17 29 ARMA STRAPATENTE (ORCO FEGLINO) 25/01/2009 42 30 ARTESINA (Pulman Frabosa S.na) 29/11/1968 33 31 ARTESINA (Pulman) 08/02/1970 30 S/A 32 ARTESINA (Pulman) 22/03/1970 17 S/A 33 ARTESINA-Cima DURAND-Colla BAUSANO-ARTESINA 21/02/2016 13 CIA 34 BADIA DI TIGLIETO 07/11/2004 42 35 BAGNASCO (F.S. -
Programma a Ttivit À Sociale 2018
PROGRAMMA ATTIVITÀ SOCIALE CLUB ALPINO ITALIANO Sezione “Alpi Marittime” 2018 IMPERIA Fondata nel 1922 Piazza Ulisse Calvi, 8 18100 Imperia Telefono e Fax 0183 273509 sito: www.caiimperia.com e-mail: [email protected] Da 25 anni raccontiamo una storia lunga 6 millenni. L’Olivo e le sue storie. Venite a scoprirle tutte. Gli olivi del Museo. I due olivi trapiantati all’esterno del nostro Museo erano giovani all’inizio dell’Alto Medioevo, intorno all’anno 1000 d.C. Gli olivi vivono molte centinaia di anni, fino a diventare più che millenari, mantenendo intatta la capacità di produrre frutti. Museo dell’Olivo - Via Garessio 13 - Imperia www.museodellolivo.com LETTERA DEL PRESIDENTE Cari amici e soci, è l’ultima volta che ho l’onore di scrivere in questa pa- gina del libretto gite. A marzo il mio secondo manda- to da presidente si concluderà e quindi passerò ad altri questa incombenza. Il mio impegno è stato molto ed ho sempre cercato di agire tenendo presente il buon funzio- namento della Sezione. Certamente non sempre ho avu- to l’approvazione totale dei Soci, mentre non sono mai mancati il pieno supporto e la collaborazione del Con- siglio Direttivo e di questo ringrazio tutti i componenti. In questo ultimo anno si è deciso di supportare Soci che hanno dato la propria disponibilità a frequen- tare corsi per ottenere qualifiche necessarie per poter svolgere a loro volta corsi rivolti ai Soci. Infatti tre no- stri Soci hanno frequentato con successo il corso per di- ventare Istruttori regionali di Alpinismo Giovanile ed in questo libretto troverete un programma a sé stante ri- volto appunto ai giovani, linfa essenziale della sezione.