Gilles Perrault, La Longue Traque – Ed. JC Lattès, 1975
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
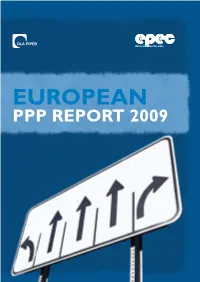
DLA Piper. Details of the Member Entities of DLA Piper Are Available on the Website
EUROPEAN PPP REPORT 2009 ACKNOWLEDGEMENTS This Report has been published with particular thanks to: The EPEC Executive and in particular, Livia Dumitrescu, Goetz von Thadden, Mathieu Nemoz and Laura Potten. Those EPEC Members and EIB staff who commented on the country reports. Each of the contributors of a ‘View from a Country’. Line Markert and Mikkel Fritsch from Horten for assistance with the report on Denmark. Andrei Aganimov from Borenius & Kemppinen for assistance with the report on Finland. Maura Capoulas Santos and Alberto Galhardo Simões from Miranda Correia Amendoeira & Associados for assistance with the report on Portugal. Gustaf Reuterskiöld and Malin Cope from DLA Nordic for assistance with the report on Sweden. Infra-News for assistance generally and in particular with the project lists. All those members of DLA Piper who assisted with the preparation of the country reports and finally, Rosemary Bointon, Editor of the Report. Production of Report and Copyright This European PPP Report 2009 ( “Report”) has been produced and edited by DLA Piper*. DLA Piper acknowledges the contribution of the European PPP Expertise Centre (EPEC)** in the preparation of the Report. DLA Piper retains editorial responsibility for the Report. In contributing to the Report neither the European Investment Bank, EPEC, EPEC’s Members, nor any Contributor*** indicates or implies agreement with, or endorsement of, any part of the Report. This document is the copyright of DLA Piper and the Contributors. This document is confidential and personal to you. It is provided to you on the understanding that it is not to be re-used in any way, duplicated or distributed without the written consent of DLA Piper or the relevant Contributor. -

Télécharger L'inventaire En
Intérieur, Comité d’orientation et de sélection des archives orales des préfets, campagne de recueil d'archives orales (2005) Répertoire (20060251/1-20060251/20) Par Anne-Laure Pierret et François Danhiez, ministère de l'Intérieur 2ème édition électronique Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2006 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_023838 Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Mentions de révision : • 2016: Révisé par Martine Sin Blima-Barru, Archives nationales 3 Archives nationales (France) Sommaire Intérieur, Comité d’orientation et de sélection des archives orales des préfets 5 Jean Brachard 9 Maurice Grimaud 18 Jean Morin 40 Jacques Pelissier 51 Jean-Emile Viè. 61 4 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 20060251/1-20060251/20 Niveau de description sous-fonds Intitulé Intérieur, Comité d’orientation et de sélection des archives orales des préfets Date(s) extrême(s) 2005 Importance matérielle et support • 32h 29min 19s • 20 fichiers WAV, 17 669 408 670 octets • archives audio-visuelles Localisation physique Fontainebleau Conditions d'accès La consultation des enregistrements se fait conformément au code du Patrimoine, articles L.213-1 à L.213-3. Toute collecte d'archives orales repose sur le recueil du consentement des témoins pour la communication, la reproduction et l'exploitation des entretiens. De ce fait, des contrats ont été signés par chacune des parties interviewées permettant de préciser les conditions d'accès. -

Western Europe
Western Europe Great Britain Domestic Affairs X HE YEAR 1973 has been dominated by a feeling that a turning point was reached in national life. Assumptions that supplies of cheap fuel were plentiful, that the steady growth of the economy was continuing, and that social cohesion would keep industrial disputes within limits which did not actually cripple the general community no longer seemed to hold true. This was despite—or perhaps because of—the fact that the government maintained its policy of economic expansion. It hoped thereby to promote industrial investment and break out of the "stop-go cycle." So far as unemployment was concerned, the policy was successful for, until December, the number of unemployed declined by an average of 20,000 per month. The strain of expansion was borne by the foreign trade balance. Thus an early indication of difficulties to come was the announcement in January that the 1972 overseas trade deficit had been £700 million, the worst on record. Another component was the deterioration of the labor situation. It began in a comparatively small way in February with strikes and industrial action by gas workers, civil servants, and nonmedical workers in the National Health Service. April marked the institution of Phase Two of the counterinflation policy, providing for limitations on dividends, profit margins, and wage increases, which was soon followed by a rise in the mortgage rate from 8.0-8.5 to 9.5 per cent, and to 11 per cent by September. In the meantime the Bank of England's minimum lending rate rose to 11.5 per cent in July to buttress spending abroad. -

Clavel, Entre Le Diable Et Le Bon Dieu
uneLÀ. ulugraprileLt---Lt- uu gram perturuateur Clavel, entre le diable et le bon Dieu Treize ans après sa mort, notre «Journaliste transcenckmtal » ressuscite à lctfaveur d'une pieuse biographie. Souvenirs, souvenirs... u'y avait-il donc de commun, dans les plus de vie que d'éventuelle immortalité. A ce parages soixante-huitards, entre un sujet, Clavel se contentait d'avoir rencontré Dieu maoïste et un maurrassien ? Entre à la suite d'une dépression nerveuse. Et la plupart Jeanne d'Arc, Marie-Madeleine et de ceux qui fréquentaient encore les Eglises de Jean Daniel ? Entre hiérarques Marx ou de Freud lui enviaient secrètement ce gaulliens et agitateurs de gauche ? remède à l'ancienne. Entre l'idéal libertin et l'extase selon Le plus étrange, avec lui, c'était cependant son le cardinal de Bérulle ? Rien à l'évidence, sinon aptitude à débusquer, à la moindre occasion, la quelques chimères dont Maurice Clavel était manifestation d'une transcendance. Chrétien, il devenu, par vocation, le - dompteur fantasque. avait ainsi fait du mystère de l'Incarnation le Philosophe, « journaliste transcendantal s, principe unique de toutes ses perceptions et, là où incendiaire officiel, il assuma ainsi, sans faillir, d'autres ne distinguaient qu'un événement, il sa mission d'agent de liaison métaphysique parmi repérait, quant à lui, un sublime avènement. De des êtres irréconciliables et qui, depuis qu'il n'est Gaulle ? Mai-68 ? La publication des « Mots et plus là, n'en finissent pas de s'ignorer. Clavel les choses » ? L'enterrement de Pierre Ovemey ? aimait ce rôle, il le tint avec éclat. -

Maurice Blanchot: Art and Technology
A Thesis Submitted for the Degree of PhD at the University of Warwick Permanent WRAP URL: http://wrap.warwick.ac.uk/101267/ Copyright and reuse: This thesis is made available online and is protected by original copyright. Please scroll down to view the document itself. Please refer to the repository record for this item for information to help you to cite it. Our policy information is available from the repository home page. For more information, please contact the WRAP Team at: [email protected] warwick.ac.uk/lib-publications Maurice Blanchot: Art and Technology Holly Langstaff A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in French Studies University of Warwick, School of Modern Languages and Cultures September 2017 Contents Introduction 1 1. Blanchot and Mallarmé: Le double état de la parole 21 ‘Le double état de la parole’ 23 Literary Autonomy 35 Literary Foundations 44 Literature as Deception 51 ‘Mais quand y a-t-il la littérature?’ 59 2. An Inhuman Interruption 70 The History of Being 72 ‘Wozu Dichter?’ 85 Death: The Impossibility of Possibility 92 A Turning 103 Animals and Automation 110 3. Technology and the Neuter 127 La Technique 131 Writing as techne and Modern Technology 145 The Neuter: Kafka and Le Dernier Homme 166 4. Inorganic Writing 183 Fragmentary Writing and Technology 184 The Cancerous Machine 207 Conclusion 214 Bibliography 223 Declaration I confirm that the material in this thesis represents my own work and has not been submitted for a degree at another university. Abstract Maurice Blanchot (1907-2003), writer of fiction, literary critic, political journalist and thinker, is one of the most influential figures in twentieth-century literature and thought. -

The Commodification of French Intellectual Culture, 1945-1990
From Ideas to Icons: The Commodification of French Intellectual Culture, 1945-1990 By Hunter K. Martin A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) at the UNIVERSITY OF WISCONSIN-MADISON 2012 Date of final oral examination: August 9, 2012 The dissertation is approved by the following members of the Final Oral Committee: Laird Boswell, Professor, History Mary Louise Roberts, Professor, History Suzanne Desan, Professor, History Jennifer Ratner-Rosenhagen, Professor, History Richard Staley, Professor, History of Science © Copyright by Hunter K. Martin 2012 All Rights Reserved i Table of Contents Abbreviations ii Tables and Illustrations iii Introduction Commodification: A New Concept for the History of Intellectual Culture 1 Part I From Inspiration to Implantation: The Origins of Maisons de la Culture 24 Chapter 1 Local Cultural Centers and the “Great Intellectual Struggle of Our Time” 24 Chapter 2 The Commercialization of Maisons de la Culture in Paris and Grenoble 65 Part II Off the Page and onto the Stage: The Making and Marketing of Intellectual Culture at Maisons de la Culture 106 Chapter 3 A Considerable Track Record: Encounters with Intellectual Culture in Paris and Grenoble 106 Chapter 4 Maisons de la Culture and the Creation of Demand 141 Part III Appropriations and Parallel Evolutions 174 Chapter 5 Out with the Old, in with the Pompidou 174 Chapter 6 A Virtuous Cycle: Intellectual Culture on Television and in Journals 207 Conclusion Intellectual “Engagement” -

UNSTITCHING the 1950S FILM Á COSTUMES: HIDDEN
1 UNSTITCHING THE 1950s FILM Á COSTUMES: HIDDEN DESIGNERS, HIDDEN MEANINGS Volume I of II Submitted by Jennie Cousins, to the University of Exeter as a thesis for the degree of Doctor of Philosophy in Film Studies, October 2008. This thesis is available for library use on the understanding that it is copyright material and that no quotation from the thesis may be published without proper acknowledgement. I certify that all material in this thesis which is not my own work has been identified and that no material has previously been submitted and approved for the award of a degree by this or any other University. …………………………………. 2 Abstract This thesis showcases the work of four costume designers working within the genre of costume drama during the 1950s in France, namely Georges Annenkov, Rosine Delamare, Marcel Escoffier, and Antoine Mayo. In unstitching the cinematic wardrobes of these four designers, the ideological impact of the costumes that underpin this prolific yet undervalued genre are explored. Each designer’s costume is undressed through the identification of and subsequent methodological focus on their signature garment and/or design trademark. Thus the sartorial and cinematic significance of the corset, the crinoline, and accessories, is explored in order to determine an ideological pattern (based in each costumier’s individual design methodology) from which the fabric of this thesis may then be cut. In so doing, the way in which film costume speaks as an independent producer of cinematic meaning may then be uncovered. By viewing costume design as an autonomous ideological system, rather than a part of mise-en- scène subordinate to narrative, this fabric-centric enquiry consolidates Stella Bruzzi’s insightful exploration of film costume in Undressing Cinema, Clothing and Identity in the Movies (1997). -

"Nicole" (Simone SEGOUIN) La Jeune Résistante De Chartres
La jeune résistante armée de Chartres 23 août 1944 Frantz MALASSIS Très souvent reproduite dans de nombreux ouvrages consacrés à la Résistance, la photographie de cette jeune combattante prise à l'occasion de la venue du général de Gaulle à Chartres est devenue un symbole de l'engagement des femmes dans la Résistance(1).Alors même que la participation des femmes à la lutte armée était très minoritaire, la très large diffusion de ce cliché va contribuer à occulter la très grande diversité de leur engagement au sein de la Résistance. Mais l'intention du photographe était peut être différente. Peut être voulait-il présenter ainsi une allégorie vivante de la France au combat ? 1 Le 19 août 1944, Chartres est définitivement libérée (2) alors que débute l'insurrection de Paris. La veille le général de Gaulle avait quitté Alger pour Casablanca et en dépit des entraves américaines, avait atterri à Maupertus, non loin de Cherbourg, le dimanche 20 août, avec la ferme intention d'obtenir d'Eisenhower qu'il donne l'ordre à la 2e DB, encore stationnée à Argentan, de marcher sur Paris (3). L'ordre fut enfin donné le 22 au soir et de Gaulle, qui se trouvait alors à Rennes, partit en direction de Paris le 23 au matin. " Passant entre deux haies de drapeaux claquant au vent et de gens criant : "Vive de Gaulle ! " Je me sentais entraîné par une espèce de fleuve de joie. A La Ferté-Bernard, à Nogent-le-Rotrou, à Chartres, ainsi que dans tous les bourgs et les villages traversés, il me fallait m'arrêter devant le déferlement des hommages populaires et parler au nom de la France retrouvée. -

La Croix Et La Bannière L'écrivain Catholique En Francophonie
EDITE PAR ALAIN DIERKENS, FREDERIC G U G E LOT, FABRICE PREYAT ET CECILE VANDERPELEN-DIAGRE La croix et la bannière L’écrivain catholique en francophonie (xvne-xxie siècles) Illustration de couverture Saint Augustin d'Hippone (détail), auteur inconnu. Saint-Ghislain, Couvent des Sœurs de la Charité de jésus et de Marie, XVIIe siècle. © IRPA-KIK, Bruxelles. Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité (CIERL) Directeur : Jean-Philippe Schreiber Directeurs-adjoints : Anne Morelli et Baudouin Decharneux La croix et la bannière L’écrivain catholique en francophonie (xvne-xxie siècles) Dans la même série 1. Religion et tabou sexuel, éd. Jacques Marx, 1990 2. Apparitions et miracles, éd. Alain Dierkens, 1991 3. Le libéralisme religieux, éd. Alain Dierkens, 1992 4. Les courants antimaçonniques hier et aujourd’hui, éd. Alain Dierkens, 1993 5. Pluralisme religieux et laïcités dans l'Union européenne, éd. Alain Dierkens, 1994 6. Eugène Goblet d’Alviella, historien et franc-maçon, éd. Alain Dierkens, 1995 7. Le penseur, la violence, la religion, éd. Alain Dierkens, 1996 8. L'antimachiavélisme, de la Renaissance aux Lumières, éd. Alain Dierkens, 1997 9. L’intelligentsia européenne en mutation 1850-1875. Darwin, le Syllabuset leurs conséquences, éd. Alain Dierkens, 1998 10. Dimensions du sacré dans les littératures profanes, éd. Alain Dierkens, 1999 11. Le marquis de Gages (1739-1787). La franc-maçonnerie dans les Pays-Bas autrichiens, éd. Alain Dierkens, 2000 12. « Sectes » et « hérésies », de l’Antiquité à nos jours, éd. Alain Dierkens et Anne Morelli, 2002 (épuisé) 13. La sacralisation du pouvoir. Images et mises en scène, éd. Alain Dierkens et Jacques Marx, 2003 14. -
'Brave Little Israel' To
From ‘Brave Little Israel’ to ‘an Elite and Domineering People’: The Image of Israel in France, 1944-1974 by Robert B. Isaacson B.A. in Jewish Studies, May 2011, The Pennsylvania State University M.A. in History, May 2015, The George Washington University A Dissertation submitted to The Faculty of The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy May 21, 2017 Daniel B. Schwartz Associate Professor of History The Columbian College of Arts and Sciences of The George Washington University certifies that Robert Brant Isaacson has passed the Final Examination for the degree of Doctor of Philosophy as of March 2, 2017. This is the final and approved form of the dissertation. From ‘Brave Little Israel’ to ‘an Elite and Domineering People’: The Image of Israel in France, 1944-1974 Robert B. Isaacson Dissertation Research Committee: Daniel B. Schwartz, Associate Professor of History, Dissertation Director Katrin Schultheiss, Associate Professor of History, Committee Member Jeffrey Herf, Distinguished University Professor, The University of Maryland, Committee Member ii © Copyright 2017 by Robert B. Isaacson All rights reserved iii Dedication This work is dedicated to my family, whose unflagging love, patience, and support made this dissertation possible in a myriad ways. iv Acknowledgments I wish to acknowledge the many individuals and organizations that have helped to make this dissertation possible. I wish to extend my gratitude to the American Academy for Jewish Research for providing an AAJR Graduate Student Travel Grant (2015), and to the Society for French Historical Studies for its Marjorie M. -

CHARLES MAURRAS EN MAI 68 › Sébastien Lapaque
Aujourd’hui et toujours CHARLES MAURRAS EN MAI 68 › Sébastien Lapaque harles Maurras a failli avoir 150 ans le 20 avril 2018. Mais finalement, aucun représentant de l’État n’est allé souffler les bougies au milieu des herbes folles de son jardin de Martigues, au bout du chemin de Paradis. L’État, Maurras n’avait pourtant que cela en Ctête. Parfois même un peu trop. « On pourrait, avec toute la prudence qu’un tel jugement requiert, prétendre que les cinq plus belles expres- sions françaises de la religion de l’État ont été fournies par Richelieu, Louix XIV, Napoléon, Charles Maurras et Charles de Gaulle », écri- vait l’un de ses biographes en 1971 (1). N’importe. Rayé des contrôles après la mise au pilon, par le ministère de la Culture, du Livre des commémorations nationales, où il avait été inscrit, l’auteur d’Anthi- néa s’est évaporé de la mémoire nationale. Comme s’il n’avait jamais vécu, jamais écrit de livres, jamais été un maître de la vie de l’esprit pendant de longues décennies, jamais marqué la pensée politique de François Mitterrand ou celle de Jean-Pierre Chevènement. L’auteur de l’Avenir de l’intelligence est né au crépuscule du Second Empire, sous Badinguet, et il n’est pas permis de s’en souvenir dans la France d’Em- 108 MAI 2018 MAI 2018 littérature manuel Macron. Il ne sera cette année l’objet d’aucun débat officiel ni d’aucune rencontre universitaire, comme ce fut le cas en 1968, pour son centenaire, et que se tint à l’Institut d’études politiques d’Aix-en- Provence un colloque intitulé « Charles Maurras et la vie française sous la IIIe République ». -

Vintage Reads Email: [email protected]
Vintage Reads email: [email protected] J'ai Lu et autres Poches Title Author Publisher Price Cur La tuile Alec Medieff Albin Michel 3.95 EUR Theatre Complet Victorien Sardou Albin Michel 33.90 EUR La masturbation chez l'adolescent Andre Alsteens Desclee de Brouwer 29.18 EUR Virgile R. Morisset et G. Thevenot Editions de L'ecole 18.95 EUR Ciceron R. Morisset et G. Thevenot Editions de L'ecole 23.85 EUR Pierre Teilhard de Chardin et la politique Africaine Leopold Sedar Senghor Editions du Seuil 7.00 EUR Sens Humain et Sens Divin Editions du Seuil 24.00 EUR Terre promise Editions du Seuil 24.00 EUR Le colosse anarchique A.E. Van Vogt J'ai lu 8.50 EUR Les Monstres A.E. Van Vogt J'ai lu 8.50 EUR Le Livre de Ptath A.E. Van Vogt J'ai lu 8.50 EUR La Machine Ultime A.E. Van Vogt J'ai lu 8.50 EUR L'Horloge Temporelle A.E. Van Vogt J'ai lu 8.50 EUR La Faune de l'espace A.E. Van Vogt J'ai lu 8.50 EUR Avant L'Eden Arthur C. Clarke J'ai lu 2.80 EUR Campagnons du Nouveau Monde Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR L'autre Ile du Dr. Moreau B.W. Aldiss J'ai lu 3.40 EUR Le cirque de Baraboo Barry B. Longyear J'ai lu 2.90 EUR Le Tonnerre de Dieu Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Victoire au Mans Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Le Silence des Armes Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Malataverne Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Tiennot Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Ecrit sur la neige Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Les fruits de l'hiver Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Le Seigneur du Fleuve Bernard Clavel J'ai lu 6.90 EUR Les seigneurs de l' Hydre C.J.