Audit Des Comptes De L'activité Intercités De SNCF Mobilités Dans
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Télécharger Le Plan D'accès Aux Nouveaux Locaux De L
FEDERATION NATIONALE DES AGENCES D'URBANISME Rue de Clichy Rue de Londres quai 27 Paris Saint-Lazare Charles-de-Gaulle quai 1 Paris Saint-Lazare Gare du Nord Gare Saint-Lazare Rue d’Amsterdam Gare de l’Est Cour Saint-Lazare Cour du Havre Sortie 10 de Rome Saint-Lazare Seine Gare de Lyon Sortie 3, Montparnasse Bercy Passage du Havre Rue Saint-Lazare Austerlitz Saint-Lazare Saint-Lazare de la Victoire Passage du Havre Rue Sortie 1, Sortie Rue de la Chaussée d’Antin Cour de Rome 10h-20h 90 Orly Saint-Lazare Place G. Sortie 2 Berry Rue de l’Isly Rue du Havre 30 98 bis 89 Rue de Rome Place Rue Joubert 16 G. Berry 29 17 DEPUIS Gare de Lyon DEPUIS Passage de Provence LES GARES LES AÉROPORTS Rue de Provence Gare Saint-Lazare Saint-Lazare Paris - Boulevard Haussmann Saint-Lazare Charles de Gaulle Printemps Printemps Galeries Galeries 5 min Lafayette Lafayette Sortie 1 Rue de Mogador Chaussée d’Antin Gare Montparnasse Rue Auber Gare d’Austerlitz Saint-Lazare Rue Charras La Fayette Rue Pasquier Gare du Nord Sortie 1 5 min Rue des Mathurins Asnières - Gennevilliers Havre Caumartin Suivre les panneaux Sortie 1 Saint-Denis - Université Auber « Accès Gare de Lyon » Rue Tronchet Saint-Lazare Saint-Lazare Sortie 2 et traverser la Seine. Sortie 3 Saint-Lazare Bd Haussmann, côté pair Place G. Berry Rue Gluck Gare du Nord Saint-Lazare Paris - Orly Rue Castellane Rue de Caumartin Saint-Lazare Rue de l’Arcade Saint-Lazare Sortie 1 Orlyval PARKING INFORMATIONS Saint-Lazare Antony Opéra Place G. -
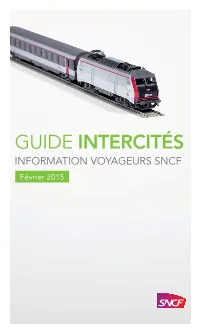
Guide Intercités
GUIDE INTERCITÉS INFORMATION VOYAGEURS SNCF Février 2015 INDEX A M Abonnements 25, 35-36, 39, 57 M-billet 11, 20, 42, 59 Accès Plus 43 Médiation SNCF 80 Accompagnement enfant 54 Militaires 39 Achat de billets 10-12 Animaux, chiens guides d’aveugles 40 O Associations de consommateurs 81 Objets trouvés 17 Auto/train 50 P B Parking 59, 65 Bagages 51-53 Prem’s 25, 28 Billet 18-19 Prix sur 45 relations INTERCITÉS C avec réservation obligatoire 66-69 Calendrier voyageurs 26-27 Prix sur 36 relations INTERCITÉS Cartes de réduction 25, 31-34, 37 sans réservation obligatoire 70-73 Carte de réduction Enfant+ 33 Prix sur 32 relations Carte de réduction Jeune 31 INTERCITÉS de nuit 74-77 Carte de réduction Senior+ 34 Prix sur 20 relations Carte de réduction Week-end 32 Carte des destinations INTERCITÉS Pro 78-79 INTERCITÉS 3-4 Programme de fi délité Carte Enfant Famille 37 Voyageur 64-65 Carte Familles Nombreuses 37 Chariots porte-bagages 53 R Consignes 53 Restauration 10, 44, 63 Convention SNCF 80-85 D S Droits des voyageurs 86-88 Salons SNCF Grand Voyageur 62 Service domicile-train 48-49 E Service Relation Client 80 E-billet 20-21, 30, 42, 61 Service Rendez-vous 42 Élèves, étudiants et apprentis 39 Services à bord 43-46, 55 Envoi billet à domicile 42 Services Pro 62-63 I Services SNCF Porte-à-Porte 47-52 Informations pratiques 17 Informations trafi c 22 T Tarif Congrès 38 J Tarifs Groupes 38 JUNIOR & Cie 54 Taxi 51, 63, 65 L LA GARANTIE VOYAGE 15-16 V Location de voiture 47-48 Vélo 53 Voyageurs professionnels 56-63 CARTE DES DESTINATIONS INTERCITÉS -
Infrastructures De Transport : Des Choix
251 FNAUT infos janvier-fév. 2017 transport - consommation - environnement édition nationale Bulletin de la Fédé ration Nationale des Associations d’Usagers des Transports Infrastructures de transport : des choix Une ambition légitime rationnels sont indispensables Le Commissariat général à l‘environ- nement et au développement durable (CGEDD) a publié récemment des projec- tions de la demande de transport de voya- geurs et de marchandises aux horizons 2030 et 2050. Ces projections confirment la pertinence des propositions ambitieuses de la FNAUT en matière de transport public urbain et ferroviaire. S’agissant de la longue distance (plus de 100 km), le CGEDD prévoit que le trafic voyageurs va croître de 1,2% par an entre 2012 et 2030 puis de 1,1% par an entre 2030 et 2050 en raison de l’augmentation géné- rale de la population et de la progression des salaires. Quai de Seine à Paris Cette hausse du trafic devrait profiter au train qui verrait sa part modale passer de 20,6% en 2012 à 22,4% en 2030 et 25,7% en Les choix en matière de grandes infrastructures de transport sont décisifs 2050, avec une forte croissance du nombre car ils orientent durablement les comportements des usagers, voyageurs de voyageurs-kilomètres (66 milliards en ou chargeurs. Mais ils sont trop souvent faits de manière irrationnelle. Bien 2012 ; 126 en 2050, ou seulement 112 si on conçues, les nouvelles infrastructures peuvent induire des transferts mo- prend en compte le développement du daux bénéfiques à la collectivité ; mal conçues, elles peuvent au contraire covoiturage et de l’offre d’autocars Macron). -

Hostelworld Guide for Paris the Essentials Climate
Hostelworld Guide for Paris The Essentials Climate One of the first things you notice when you walk around Paris is this: the French capital is just as you imagine it. Parisians lounge outside cafés drinking coffee, budding artists sketch whatever passes them Getting There January and February are the coldest months when into their sketch pads, and everywhere you look is another building which causes an immediate reaction the average temperature is 4°C, although it is known to drop below 0°C. In March temperatures to grab for your camera. Some of the world's best museums can be found here, the list of instantly By plane: Paris has three airports - d'Orly, Charles recognisable landmarks is a lengthy one, and the nightlife is electric to say the least. But one of the begin to steadily rise, going from an average of de Gaulle and Beauvais. The best way to the city around 8°C in March to a peak of 22°C in July and French capital's best attributes is that when you want to do nothing but sit back and relax, it's hard to think from d'Orly, Charles de Gaulle is via train. If you fly of a better city in the world to people watch. August. While this is the average temperature, into Beauvais, which is 75km northwest of the city summer days can get far hotter, sometimes centre, you will need to take the shuttle bus. reaching the 30°C mark. By September the days and evenings become cooler, and temperatures By train: Paris has six major train stations where drop each month until December, with an average trains from all over Europe terminate. -

Compte Rendu De L'instance Regionale De Concertation 2018 De Paris Gare
COMPTE RENDU DE L’INSTANCE REGIONALE DE CONCERTATION 2018 DE PARIS GARE DE LYON – PARIS BERCY Paris, le 15 novembre 2018 Participants Membres de droit : - Sylvie Carillon, présidente de l’instance, élue du Conseil Régional d’Ile-de-France, assistée de Caroline Pruvost et d’Astrid Wurster, chargées de mission à la direction des transports, - Valérie Bonnard, directrice des gares de Paris Lyon et Paris Bercy, SNCF Gares & Connexions, assistée de Mikael Lannoy directeur adjoint, de Yann Krysinski, directeur de projet, de Damien Cazauran, adjoint du directeur de projet, de Philippe Chauvin directeur du contrôle de gestion, de Laurence Nicolas contrôle de gestion et de Sophie Dansin, responsable gouvernance gares Paris et région parisienne en charge du secrétariat de l’IRC, - Olivier Milan, responsable pôle prospective gares et grands sites, SNCF Réseau Ile-de- France, accompagné de Denis Carpentier, responsable services gares, d’Adrien Cook, chef de projets grandes gares et pôles CPER et de Sylvain Tissot chargé de mission équilibre économique, - Gilles Fourt, chef de département projet, Ile-de-France Mobilités, accompagné de Sophie Dahan, chargée de projets, - Carine Lecareux, chargée d’études, DRIEA, représentante de l’AO TET et du Préfet, - Amar Chaabi, DET EEV de Paris Lyon et Paris Bercy, SNCF Mobilités, représentant du directeur de la région de Paris-Sud-Est, accompagné par Jamal Khira, responsable financier ESV, - Jean-Michel Chaplotte, chef du service gares, représentant du conseil régional Bourgogne Franche Comté, - Anne-Cécile Delbes, -

Adaptation Des Stations Existantes De La Ligne 2011 Passage De 6 À 8 Voitures Par Train
Décembre Adaptation des stations existantes de la ligne 2011 Passage de 6 à 8 voitures par train Schéma de principe ADAPTATION DES STATIONS EXISTANTES DE LA LIGNE 14 – PASSAGE DE 6 A 8 VOITURES SCHEMA DE PRINCIPE SOMMAIRE RESUME ............................................................................................................................... 3 INTRODUCTION ................................................................................................................... 5 1. Les prolongements prévus de la ligne 14 ............................................................... 7 2. Impacts des prolongements sur la fréquentation et la capacité de la ligne 14 ...13 3. Conséquence : des adaptations nécessaires sur les stations existantes ...........16 4. Etape actuelle : le Schéma de principe ..................................................................18 PREMIERE PARTIE ............................................................................................................19 1. La ligne 14 aujourd’hui ............................................................................................21 2. Les caractéristiques du territoire ...........................................................................26 3. Enjeux d’environnement pour le territoire .............................................................41 4. Les réseaux de transport ........................................................................................52 5. Conclusion : ENJEUX PROPRES AUX STATIONS ................................................58 -

Interruption Des Circulations a Paris Austerlitz Et Rer C Tres Perturbe
SNCF RESEAU ILE-DE-FRANCE PARIS, LE 1ER DECEMBRE 2020 INCIDENT SUR UN CHANTIER URBAIN DE BTP DANS LA ZAC PARIS RIVE GAUCHE : INTERRUPTION DES CIRCULATIONS A PARIS AUSTERLITZ ET RER C TRES PERTURBE Suite à un incident survenu cette nuit sur le chantier urbain de la ZAC Paris Rive Gauche, le trafic est interrompu jusqu’à nouvel avis à l’arrivée et au départ de la gare de Paris Austerlitz et fortement perturbé sur la ligne C du RER. Un coffrage destiné à la réalisation d’une poutre est tombé sur les voies vers 1h30 du matin, endommageant les installations ferroviaires et empêchant la circulation sur les voies. Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. Le chantier, qui consiste à aménager logements, bureaux et équipements publics sur une dalle édifiée au- dessus des voies ferrées, est mené dans le cadre de l’aménagement de la ZAC ATM (Austerlitz-Tolbiac- Masséna). SNCF attend des précisions de la part des entreprises responsables du chantier pour en savoir plus sur la durée d’intervention nécessaire à l’enlèvement du coffrage qui entrave les voies, et espère une reprise des circulations au plus vite dans les prochains jours pour minimiser la gêne causée aux voyageurs. ADAPTATION DES PLANS DE TRANSPORT TER, INTERCITÉS ET RER C POUR LA JOURNEE DU 1ER DECEMBRE • RER C : le trafic est interrompu entre Paris Austerlitz et Massy – Palaiseau et entre Paris Austerlitz et Juvisy jusqu’à nouvel avis. La circulation est également interrompue entre Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers. Le reste de la ligne est fortement ralentie. -

LA RENTRÉE ! Nouvelle Saison Sur La Ligne R
LA RENTRÉE ! Nouvelle saison sur la ligne R NOUVELLE SAISON 2017/2018 DÉJÀ DANS VOS GARES ! Infos utiles, actualités, nouveaux services… Découvrez en avant-première les coulisses de la rentrée 2017 ! À L’AFFICHE ÉPISODE 1 ÉPISODE 2 ÉPISODE 3 ÉPISODE 4 ÉPISODE 5 ÉPISODE 6 ÉPISODE 7 LA RENTRÉE ! Nouvelle saison sur la ligne R 2017/2018 TOUTE L’INFO LES SERVICES LES ACTUS VOTRE AVIS COMPTE P. 4 OÙ ET QUAND P. 6 P. 8 LES TRAVAUX P.10 POUR FACILITER P.14 LES JEUX P.16 LES ÉVÉNEMENTS P.18 DE LA SAISON POUR NOUS VOUS EN AVEZ BESOIN VOTRE QUOTIDIEN VOIR LA SAISON 2017/2018 EN INTÉGRALITÉ 2 3 ÉPISODE 1 LES ACTUS DE LA SAISON Saison après saison, votre ligne Le REGIO 2N est gage de confort et de • des prises électriques, L’arrivée du REGIO 2N, c’est aussi continue à évoluer ! sérénité pour vos trajets quotidiens. • des écrans dynamiques l’occasion de vous accueillir dans La liste des équipements qui vous pour une information en continu, des gares rénovées. attendent à bord de ces nouveaux trains • des espaces vélo, Cela se traduira par exemple, selon les gares, par des quais plus longs, est longue. • un système de chauffage performant LE REGIO 2N ARRIVE SUR En voici quelques-uns : l’installation de nouveaux abris • la climatisation • de larges plateformes pour des montées de quais, de nouvelles assises, VOTRE LIGNE R ! • … et descentes rapides, des toilettes automatiques, une rénovation de l’éclairage ou une mise en peinture… Les nouveaux trains Regio 2N arrivent • des salles éloignées des sources de bruit Une arrivée en 3 temps : Dans certaines gares, ce programme en décembre en Île-de-France et de vibration, • décembre 2017, sur la branche de travaux s’accompagne de nouveaux pour les voyageurs de la ligne R. -

La Libéralisation Du Transport Par Autocar a Été Introduite De Manière 2
252 FNAUT infos mars 2017 transport - consommation - environnement édition nationale Bulletin de la Fédé ration Nationale des Associations d’Usagers des Transports La libéralisation du transport Pics de pollution par autocar : succès et risques et gratuité des transports Présentée par les pouvoirs publics, jusqu’à une date récente, comme une mesure nécessaire d’accompagnement de l’instauration de la circulation alter- née lors des pics de pollution de l’air, la gratuité des transports est aujourd’hui re- mise en cause (Ile-de-France, Strasbourg). La FNAUT a toujours été hostile à cette fausse bonne idée. 1. L’expérience montre que la mesure est peu efficace. L’automobiliste est d’abord sensible à la qualité de service des transports publics, que la gratuité soit une mesure provisoire ou pérenne. La hausse de la fréquentation des transports Gare de Lille-Europe publics est surtout due aux usagers occa- sionnels, qui profitent de l’aubaine pour se déplacer gratuitement. La libéralisation du transport par autocar a été introduite de manière 2. La mesure est coûteuse : 4 millions d’euros par jour en Ile-de-France, soit près improvisée et prématurée, sans étude d’impact sur l’environnement et de 25 millions lors du dernier épisode de l’aménagement du territoire, sans réflexion sur la nécessaire complé- pollution. C’est autant d’argent en moins mentarité entre train et autocar, et sans renforcement préalable du sys- pour les investissements ou le renforce- tème ferroviaire. L’offre routière s’est développée rapidement malgré ment des services. le nombre insuffisant des gares routières. Elle a corrigé l’absence du 3. -

Withers & Rogers LLP 7 Rue Meyerbeer Paris 75009 Tel
From Gare Saint-Lazare (10 minute walk) Walk south on Rue d'Amsterdam towards Place du Havre/Rue Saint-Lazare. Continue onto Rue du Havre. Turn left onto Boulevard Haussmann. At the rounda- bout, take the 3rd exit onto Rue Gluck. Continue onto Rue Meyerbeer. Withers & Rogers LLP 7 rue Meyerbeer From Gare du Nord (12 minutes by Métro) Exit the station and walk south on Boulevard de Paris Denain. Turn left onto Boulevard de Magenta and then 75009 right onto Rue la Fayette. Enter Poissonnière Métro and take Line 7 (Mairie d'Ivry) to Chaussée d'Antin - Tel: +33 (0)1 73 29 07 30 La Fayette Métro. Exit the station and walk south Rue www.withersrogers.com Halévy. Turn left onto Rue Meyerbeer. D7 N1 N2 CLICHY D1 CHAUSSÉECHAUSSÉE D'ANTIND'ANTIN - BOU A14 L EVARDLALA FAYETTEF AYETTE PANTIN N3 HAU LA DÉFENSE SSM R ANN BE UE R U NEUILLY- G E GARE DU NORD L D LE PRÉ-SAINT-GERVAIS UCK SUR-SEINE GARE SAINT-LAZARE E LA D7 GARE DE L'EST UE SCRI R C D1 H E15 AU RU BAGNOLET A3 PALAISPALAIS E S Y M S EYERB GARNIERGARNIER ÉE ÉV MONTREUIL EE D AL PARIS R 'AN RUE AUB H CHARONNE T IN RUE E5 E GARE DE LYON N34 R 7 RUE MEYERBEER GARE MONTPARNASSE GARE D'AUSTERLITZ GARE DE PARIS BERCY BOULOGNE- D BILLANCOURT PLACEPLACE DEDE L'OPÉRAL'OPÉRA CAPUCINES GRAN ES D D1 RD D7 A IS LE OPÉRAOPÉRA U D50 B OULEV A4 E50 LO UE E15 R MONTROUGE A6A D2 A6B IVRY-SUR-SEINE E15 D7 D5 GAREGARE PLACEPLACE DEDE DUDU NORDNORD ROUBAIXROUBAIX S NI MAGENTAMAGENTA E RU TT E E R E A Y U -D R NOTRE T U E E LA F E U B R DE C GAREGARE AIN L -D LIÈGELIÈGE S A AME DUDU NORDNORD N G C L DE E H G -

COMITE DE LIGNE PARIS - MONTARGIS Réunion Du 21 Octobre 2008
COMITE DE LIGNE PARIS - MONTARGIS Réunion du 21 octobre 2008 RD / 23-10-08 Présidé par M. Jean BRAFMAN, Président de la Commission Démocratisation du STIF Etaient présents STIF Mmes BRIEND, GALAND MM. MONNET, GUIMBAUD, SAINT-BLANCARD, ZIBAT, DESORMIERE, PEYRON SNCF MM. KRAKOVITCH et CAREMENTRANT Région Bourgogne M. MOREL CG77 MM. MAILLIET et RONDEL CPTP M. PARMENTIER (représentant de la CRCI) Bois le Roi M. DINTILHAC Dordives Mme GUILLAUME Melun Val de Seine M. FESMEAU Moret sur Loing M. MAROTTE Montigny sur Loing M. MENDY Nemours Mmes CHAMPNIERS et LACROUTE, M. CHAUVET Agglo Montargis M. PEZAIRE Veneux les Sablons MM. BLANT et SOUCHARD AUSTEC M. MERCEY CODUT M. SERVAIS Livry Environnement M. BORDERIEUX GUT77 M. SANTERRE M. Brafman ouvre la séance en remerciant les représentants des collectivités, des associations et de la SNCF de leur présence. Il rappelle que la réunion fait suite à un premier comité de ligne tenu en décembre 2007. 1- Situation générale de la ligne Le STIF présente un premier diaporama sur l’actualité générale de la ligne et les grands chantiers engagés sur le matériel roulant, l’accessibilité, les pôles d’échanges, les parcs relais et l’amélioration du suivi de la régularité par le biais des nouveaux contrats avec les opérateurs. Pour le matériel roulant, les investissements prévus dans le contrat STIF – SNCF (de l’ordre de 1 milliard d’euros), auxquels s’ajoute le Plan Impaqt (environ 200 M€), permettent d’envisager un parc entièrement neuf, récent ou rénové en Ile-de-France à l’horizon 2016. Sur la ligne, cela se traduit par le remplacement complet des matériels « petits gris » Z5300 par du matériel à 2 niveaux Z2N au plus tard fin 2011. -

Getting to Versailles and to the Venue
GETTING TO VERSAILLES AND TO THE VENUE The Venue is located in Versailles (about 35 km west from Paris). To get to the Venue you’ll have to go through Paris. Arriving by plane Paris is served by two main airports: Orly (ORY), and Roissy/Charles de Gaulle (CDG). https://www.parisaeroport.fr/en • From Roissy/Charles de Gaulle (CDG) There are several options https://www.rome2rio.com/s/Paris-CDG-Airport-CDG/Palais-des-Congr%C3%A8s-%C3%8Ele- de-France-France • From Orly airport (ORY) There are several options https://www.rome2rio.com/map/Paris-Orly-Airport-ORY/10-Rue-de-la-Chancellerie-78000- Versailles-France Arriving by train There are seven major train stations in Paris. If you are travelling to or from another city in Europe, consider taking the train. The rail stations in Paris put many destinations in England, Italy, Spain and Germany within your reach. • From Gare du Nord https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-de-Paris-Nord/10-Rue-de-la-Chancellerie-78000- Versailles-France • From Gare de l’Est https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-de-l-Est-m%C3%A9tro-de-Paris/10-Rue-de-la- Chancellerie-78000-Versailles-France • From Gare Montparnasse https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-de-Paris-Montparnasse/10-Rue-de-la- Chancellerie-78000-Versailles-France • From Gare d’Austerlitz https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-d-Austerlitz-85-Quai-d-Austerlitz-75013-Paris- France/10-Rue-de-la-Chancellerie-78000-Versailles-France • Gare de Lyon https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-de-Lyon/10-Rue-de-la-Chancellerie-78000- Versailles-France • From Gare St Lazare https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-Saint-Lazare/10-Rue-de-la-Chancellerie-78000- Versailles-France • Gare de Paris Bercy https://www.rome2rio.com/fr/map/Gare-De-Bercy-France/10-Rue-de-la-Chancellerie- 78000-Versailles-France How to use the metro (subway) anD RER (express train)? The Paris Metro is very easy to use and, given the traffic congestion in Paris, is often much faster than taking a taxi.