Schema Departemental D'amenagment Et De
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Concours Direct Cycle a Option "Diplomatie Arabisant"
N° de Date de Prénom(s) Nom Lieu de naissance table naissance 1 Abdel Kader AGNE 01/03/1989 Diourbel 2 Dieng AIDA 01/01/1991 Pattar 3 Adjaratou Sira AIDARA 02/01/1988 Dakar 4 Alimatou Sadiya AIDARA 06/01/1992 Thiès 5 Marieme AIDARA 06/02/1991 Nioro Du Rip 6 Mouhamadou Moustapha AIDARA 28/09/1991 Touba 7 Ndeye Maguette Laye ANE 10/06/1995 Dakar 8 Sileye ANNE 10/06/1993 Boinadji Roumbe 9 Tafsir Baba ANNE 19/12/1993 Rufisque 10 Gerard Siabito ASSINE 03/10/1991 Samatite 11 Tamba ATHIE 19/08/1988 Colibantan 12 Papa Ousseynou Samba AW 02/11/1992 Thiès Laobe 13 Ababacar BA 02/09/1991 Pikine 14 Abdou Aziz BA 08/02/1992 Rufisque 15 Abdoul BA 02/02/1992 Keur Birane Dia 16 Abdoul Aziz BA 22/11/1994 Ourossogui 17 Abdoul Mamadou BA 30/08/1992 Thiaroye Gare 18 Abdrahmane Baidy BA 10/02/1991 Sinthiou Bamambe 19 Abibatou BA 08/08/1992 Dakar 20 Aboubacry BA 01/01/1995 Dakar 21 Adama Daouda BA 08/04/1995 Matam 22 Ahmet Tidiane BA 22/02/1991 Mbour 23 Aliou Abdoul BA 26/05/1993 Goudoude Ndouetbe 24 Aly BA 20/01/1988 Saint-Louis 25 Amadou BA 01/12/1996 Ngothie 26 Amidou BA 06/12/1991 Pikine 27 Arona BA 02/10/1989 Fandane 28 Asmaou BA 03/10/1991 Dakar 29 Awa BA 01/03/1990 Dakar 30 Babacar BA 01/06/1990 Ngokare Ka 2 31 Cheikh Ahmed Tidiane BA 03/06/1990 Nioro Du Rip 32 Daouda BA 23/08/1990 Kolda 33 Demba Alhousseynou BA 06/12/1990 Thille -Boubacar 34 Dieynaba BA 01/01/1995 Dakar 35 Dior BA 17/07/1995 Dakar 36 El Hadji Salif BA 04/11/1988 Diamaguene 37 Fatimata BA 20/06/1993 Tivaouane 38 Fatma BA 12/01/1988 Dakar 39 Fatou BA 02/02/1996 Guediawaye 40 Fatou Bintou -

Stade : 1 ADAMA NDIAYE 30/03/1989 À Diourbel PRD023603 18/06/2018 2 ADJI MAME B
République du Sénégal Un Peuple Un But Une Foi Ministère de l'Economie des Finances et du Plan DIRECTION GENERALE DES DOUANES Division de la Formation Liste des candidats validés par stade Centre : Dakar Stade : Iba Mar DIOP N° Nom Prénom Date et Lieu Numéro Date naissance inscription épreuve 1 ADAMA NDIAYE 30/03/1989 à diourbel PRD023603 18/06/2018 2 ADJI MAME BINTA 21/09/1997 à guediawaye ACD025382 18/06/2018 3 ADJOVI CLAUDIA HOUÉFA MIREILLE 19/10/1992 à dakar ACD023940 18/06/2018 4 AGBANGLANON SOKHNA FATOU 14/01/1997 à saint louis ACD034753 18/06/2018 5 AGNE HOULEYMATOU 10/12/1993 à camberene 2 ACD001350 18/06/2018 6 AHOUIDI MARTINA DIEUDONNEE 19/01/1995 à thionck-essyl ACD031755 18/06/2018 7 AHOUMOU MARIEME DIOP 01/01/1989 à mboro ACD009218 18/06/2018 8 AIDARA AISSETOU 28/01/1993 à matam COD012013 18/06/2018 9 AIDARA AWA 26/02/1992 à goudomp ACD036511 18/06/2018 10 AIDARA MAIMOUNA 26/09/1993 à koungheul ACD031810 18/06/2018 11 AÏDARA RAMATOULAYE 13/04/1994 à sokone ACD007383 18/06/2018 12 AIDARA ROKHAYA 02/01/1997 à dakar ACD031111 18/06/2018 13 AMAR NDEYE KHADY 08/07/1993 à touba COD002319 18/06/2018 14 AMETEMBA MENDY 14/11/1996 à bignona ACD035058 18/06/2018 15 ANANI ANNE MARIE CATHÉRINE 30/06/1996 à dakar ACD022661 18/06/2018 16 ANNE MAIMOUNA MOUSSA 28/08/1996 à yeumbeul ACD022072 18/06/2018 17 ASSEF NDOUMBE 16/12/1990 à joal fadiouth COD017360 18/06/2018 18 ASSINE ANGELE DJIBASSAO 12/07/1992 à samatite ACD031119 18/06/2018 19 ASSINE MAME SAILE BENEDICTE 06/02/1987 à pikine COD034330 18/06/2018 ROSELINE 20 ASSINE YOLANDE 16/07/1993 -

Les Resultats Aux Examens
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Université Cheikh Anta DIOP de Dakar OFFICE DU BACCALAUREAT B.P. 5005 - Dakar-Fann – Sénégal Tél. : (221) 338593660 - (221) 338249592 - (221) 338246581 - Fax (221) 338646739 Serveur vocal : 886281212 RESULTATS DU BACCALAUREAT SESSION 2017 Janvier 2018 Babou DIAHAM Directeur de l’Office du Baccalauréat 1 REMERCIEMENTS Le baccalauréat constitue un maillon important du système éducatif et un enjeu capital pour les candidats. Il doit faire l’objet d’une réflexion soutenue en vue d’améliorer constamment son organisation. Ainsi, dans le souci de mettre à la disposition du monde de l’Education des outils d’évaluation, l’Office du Baccalauréat a réalisé ce fascicule. Ce fascicule représente le dix-septième du genre. Certaines rubriques sont toujours enrichies avec des statistiques par type de série et par secteur et sous - secteur. De même pour mieux coller à la carte universitaire, les résultats sont présentés en cinq zones. Le fascicule n’est certes pas exhaustif mais les utilisateurs y puiseront sans nul doute des informations utiles à leur recherche. Le Classement des établissements est destiné à satisfaire une demande notamment celle de parents d'élèves. Nous tenons à témoigner notre sincère gratitude aux autorités ministérielles, rectorales, académiques et à l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite de cette session du Baccalauréat. Vos critiques et suggestions sont toujours les bienvenues et nous aident -

Actes De L'atelier ATELIER REGIONAL D'echanges SUR L
ATELIER REGIONAL D’ECHANGES SUR L’AMENAGEMENT DES VALLEES EN CASAMANCE : Ziguinchor, 16 et 17 décembre 2008 Actes de l'atelier Partenaires techniques : Partenaires financiers : ACPP ARD Ziguinchor CRCR Fondaon Lord GRDR Michelham of Hellingly GRDR Ziguinchor - Rue Emile Badiane - BP 813 Ziguinchor - (221) 33 991 27 82 - [email protected] http://www.grdr.org SOMMAIRE PREMIER JOUR : FOIRE D’ECHANGES PAYSANS SUR L’AMENAGEMENT DES VALLEES EN CASAMANCE p. 3 ‐ 6 Cérémonie officielle d’ouverture 3 Echanges de savoirs et d’expériences 4 Lutte contre la mouche blanche des mangues – CARE SENEGAL 4 Techniques de greffage – ANCAR 5 Modèle de gestion des ouvrages – comité vallée Diattock 5 Compagnie Bousana 5 Débats 5 Techniques de lutte biologique par Camara et Diatta 6 DEUXIEME JOUR : ATELIER REGIONAL D’ECHANGES SUR L’AMENAGEMENT DES VALLEES EN CASAMANCE p. 7 – 21 I. LA FILIERE SEMENCE DE RIZ Programme concerté d’appui au développement de la filière"semences certifiées de 7 riz" en Casamance Construction d’une filière semence de riz basée sur les acteurs locaux 8 Débats avec la salle 9 II. PERENISATION DES COMITES VALLEES ET IMPACTS DES AMENAGEMENTS VALLEES Gestion des Comités Vallée 12 Evaluation du système de désalinisation, prospective sur les possibilités de 13 protection et restauration de la mangrove dans la zone d’intervention du GRDR Débats avec la salle 14 III. ATELIERS DE REFLEXION Atelier 1 : filière riz ‐ entre production et certification de semences 17 Atelier 2 : les comites vallées : quelle pérennisation ? 19 Atelier 3 : impact des -
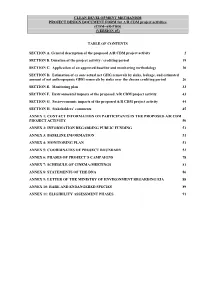
Cdm-Ar-Pdd) (Version 05)
CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM PROJECT DESIGN DOCUMENT FORM for A/R CDM project activities (CDM-AR-PDD) (VERSION 05) TABLE OF CONTENTS SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity 2 SECTION B. Duration of the project activity / crediting period 19 SECTION C. Application of an approved baseline and monitoring methodology 20 SECTION D. Estimation of ex ante actual net GHG removals by sinks, leakage, and estimated amount of net anthropogenic GHG removals by sinks over the chosen crediting period 26 SECTION E. Monitoring plan 33 SECTION F. Environmental impacts of the proposed A/R CDM project activity 43 SECTION G. Socio-economic impacts of the proposed A/R CDM project activity 44 SECTION H. Stakeholders’ comments 45 ANNEX 1: CONTACT INFORMATION ON PARTICIPANTS IN THE PROPOSED A/R CDM PROJECT ACTIVITY 50 ANNEX 2: INFORMATION REGARDING PUBLIC FUNDING 51 ANNEX 3: BASELINE INFORMATION 51 ANNEX 4: MONITORING PLAN 51 ANNEX 5: COORDINATES OF PROJECT BOUNDARY 52 ANNEX 6: PHASES OF PROJECT´S CAMPAIGNS 78 ANNEX 7: SCHEDULE OF CINEMA-MEETINGS 81 ANNEX 8: STATEMENTS OF THE DNA 86 ANNEX 9: LETTER OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT REGARDING EIA 88 ANNEX 10: RARE AND ENDANGERED SPECIES 89 ANNEX 11: ELIGIBILITY ASSESSMENT PHASES 91 SECTION A. General description of the proposed A/R CDM project activity A.1. Title of the proposed A/R CDM project activity: >> Title: Oceanium mangrove restoration project Version of the document: 01 Date of the document: November 10 2010. A.2. Description of the proposed A/R CDM project activity: >> The proposed A/R CDM project activity plans to establish 1700 ha of mangrove plantations on currently degraded wetlands in the Sine Saloum and Casamance deltas, Senegal. -

Alice Joyce Hamer a Dissertation Submitted in Partial Fulfullment of the Requirements for the Degre
TRADITION AND CHANGE: A SOCIAL HISTORY OF DIOLA WOMEN (SOUTHWEST SENEGAL) IN THE TWENTIETH CENTURY by Alice Joyce Hamer A dissertation submitted in partial fulfullment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy (History) in The University of Michigan c'7 1983 Doctoral Committee: Professor Louise A. Tilly, Co-chair Professor Godfrey N. Uzoigwe, Co-Chair -Assistant Professor Hemalata Dandekar Professor Thomas Holt women in Dnv10rnlomt .... f.-0 1-; .- i i+, on . S•, -.----------------- ---------------------- ---- WOMEN'S STUDIES PROGRAM THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 354 LORCH HALL ANN ARB R, MICHIGAN 48109 (313) 763-2047 August 31, 1983 Ms. Debbie Purcell Office of Women in Development Room 3534 New State Agency of International Development Washington, D.C. 20523 Dear Ms. Purcell, Yesterday I mailed a copy of my dissertation to you, and later realized that I neglected changirg the pages where the maps should be located. The copy in which you are hopefully in receipt was run off by a computer, which places a blank page in where maps belong to hold their place. I am enclosing the maps so that you can insert them. My apologies for any inconvenience that this may have caused' you. Sincerely, 1 i(L 11. Alice Hamer To my sister Faye, and to my mother and father who bore her ii ACKNOWLEDGMENTS Numerous people in both Africa and America were instrumental in making this dissertation possible. Among them were those in Senegal who helped to make my experience in Senegal an especially rich one. I cannot emphasize enough my gratitude to Professor Lucie Colvin who honored me by making me a part of her distinguished research team that studied migration in the Senegambia. -
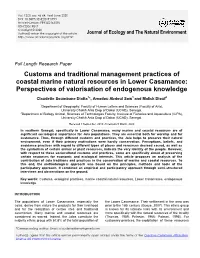
Full-Text (PDF)
Vol. 12(2), pp. 46-64, April-June 2020 DOI: 10.5897/JENE2019.0793 Article Number: FB932D163590 ISSN 2006-9847 Copyright © 2020 Author(s) retain the copyright of this article Journal of Ecology and The Natural Environment http://www.academicjournals.org/JENE Full Length Research Paper Customs and traditional management practices of coastal marine natural resources in Lower Casamance: Perspectives of valorisation of endogenous knowledge Claudette Soumbane Diatta1*, Amadou Abdoul Sow1 and Malick Diouf2 1Department of Geography, Faculty of Human Letters and Sciences (Faculty of Arts), University Cheikh Anta Diop of Dakar (UCAD), Senegal. 2Department of Biology Animal, Sciences of Technologies Faculty, Institute of Fisheries and Aquaculture (IUPA), University Cheikh Anta Diop of Dakar (UCAD), Senegal. Received 1 September, 2019; Accepted 25 March, 2020 In southern Senegal, specifically in Lower Casamance, many marine and coastal resources are of significant sociological importance for Jola populations. They are essential both for worship and for sustenance. Thus, through different customs and practices, the Jola helps to preserve their natural environment, even if their primary motivations were hardly conservation. Perceptions, beliefs, and avoidance practices with regard to different types of places and resources decreed sacred, as well as the symbolism of certain animal or plant resources, indicate the very identity of the people. However, with respect to these sociocultural customs and practices, some are specifically aimed at preserving certain resources for economic and ecological interests. This article proposes an analysis of the contribution of Jola traditions and practices in the conservation of marine and coastal resources. To this end, the methodological approach was based on the principles, methods and tools of the participatory approach. -

Household Survey: Hygiene and Sanitation Behavior As Well As Willingness to Pay in Rural Senegal
Swiss TPH | Hygiene and Sanitation Survey, Senegal – Final report – Final version_15.12.2015 Swiss Center for International Health Water and Sanitation Program, World Bank Household survey: hygiene and sanitation behavior as well as willingness to pay in rural Senegal Support to the Direction de l'Assainissement Final report Swiss TPH ISED Consultants Lise Beck Mayassine Diongue Sylvain Faye Peter Steinmann Cheikh Fall Tidiane Ndoye Ibrahima Sy Adama Faye Alioune Touré Martin Bratschi Anta Tal Dia Kaspar Wyss Basel, 15 December 2015 Page 1 / 125 Swiss TPH | Hygiene and Sanitation Survey, Senegal – Final report – Final version_15.12.2015 Contacts Swiss Tropical and Public Health Institute Institut de Santé et Développement (ISED) Socinstrasse 57 Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) P.O. Box BP 16390 4002 Basel Dakar-Fann Switzerland Senegal Kaspar Wyss Anta Tal Dia Head of Systems Support Unit Director ISED Swiss Center for International Health (SCIH) Tel: +221 33 824 98 78 T: +41 61 284 81 40 Fax: +221 33 825 36 48 F: +41 61 284 81 03 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Website: www.scih.ch / www.swisstph.ch Website: http://www.ised.sn/ Funding This study was undertaken on behalf of the Water and Sanitation Program (WSP), a multi- donor partnership administered by the World Bank Group, which aims to support poor populations in obtaining affordable, safe and sustainable access to water and sanitation services. Disclaimer The views and ideas expressed herein are those of the authors and do not necessarily imply or reflect the opinion of the Institute, WSP or any other institution involved in the study. -
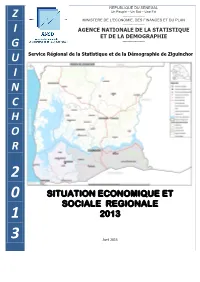
Z I G U I N C H
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi Z ------------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN ------------------ I AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DEMOGRAPHIE G ------------------ Service Régional de la Statistique et de la Démographie de Ziguinchor U I N C H O R 2 0 SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE REGIONALE 1 2013 3 Avril 2015 AVANT PROPOS Dans la réalisation de ses missions de coordination technique des activités du système statistique national et de production et diffusion des données statistiques, l’ANSD réalise régulièrement des publications parmi lesquelles la « Situation Economique et Sociale du Sénégal » et les « Situations Economiques et Sociales » régionales. Les Situations Economiques et Sociales (SES) régionales, élaborées chaque année par les Services Régionaux de la Statistique et de la Démographie (SRSD) pour l’année précédente, figurent en bonne place parmi les produits phares de l’ANSD. Elles constituent d’importants instruments de planification du développement économique et social régional et des outils d’aide à la décision aux niveaux régional et local. L’exercice d’analyse de la conjoncture qu’elles constituent n’a évidemment pas pour ambition l’exhaustivité, mais la présentation de manière synthétique des modes de fonctionnement essentiels de l’économie régionale. Chaque SES régionale essaie d’embrasser la quasi-totalité des secteurs de l’activité économique et sociale. Elle met surtout en relief l’information quantitative et tente, par des analyses sommaires, de décrire la situation de chaque secteur d’activité dans la région concernée. De 2006 à 2013, la publication des SES a été précédée d’une validation régionale au cours de réunions des Comités Régionaux de Développement (CRD). -

Projections Démographiques
REPUBLIQUE DU SENEGAL ------------ MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU PLAN Direction des Statistiques Démographiques et Sociales Division du Recensement et des Statistiques Démographiques Bureau Etat Civil et Projections Démographiques 2013-2063 ANSD-FEVRIER 2016 Projection de la population du Sénégal/MEFP/ANSD-Février 1 2016 INTRODUCTION Les présentes projections démographiques ont été élaborées par l’Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie au cours d’un atelier tenu en mai 2015. Ces projections sont issues d’un large consensus. Elles ont été réalisées avec la participation de techniciens issus d’horizon divers (Ministères de l’Economie des Finances et du Plan, Emploi, Travail, Education, Famille, Agriculture, Elevage, Santé, Jeunes) et UNFPA. Les hypothèses ont été formulées par rapport à une évolution probable des différents facteurs de la dynamique de la population, notamment: La structure de la population, par sexe et par âge ; La structure de la population selon le milieu de résidence (urbaine ou rurale) ; L’Indice synthétique de fécondité comme indicateur de fécondité ; L’espérance de vie ; La structure de la mortalité (à travers l’emploi d’une table‐type de mortalité, celle de Coale & Demeny Nord) ; Le solde migratoire ; Le niveau d’urbanisation. Pour renseigner ces indicateurs, il a fallu recourir à différentes sources de données (RGP 1976 ; RGPH 1988 ; RGPH 2002 et RGPHAE 2013 ; EDS I ; II ; III ; IV et EDS‐MICS 2010‐11) et à des documents de référence en matière de planification sectorielle pour finaliser le travail. Les travaux ont été essentiellement réalisés à l’aide du logiciel SPECTRUM qui est un système de modélisation consolidant différentes composantes dont le modèle DemProj développé par « The Futures Group International ». -

Mémoire De Confirmation
REPUBLIQUE DU SÉNÉGAL MINISTERE DE L’AGRICULTURE INSTITUT SÉNÉGALAIS DE RECHFRCHES AGRICOLES MÉMOIRE DE CONFIRMATION présentépar Dr Cheikh Oumar BA Sociologue sousla Direction du Professeur Abdoulaye Bara DIOP Sur Migrations et organisations paysannes en Basse Casamance. Une première caractérisation à partir de l’exemple du village de Sue1 (Département de Bignona). Juin 1997 SOMMAIRE PAGE DE GARDE . .. .. .. .. .. .. .. SOMMAIRE ............................................................................................................................. 2 L., LISTE DES SIGLES................................................................................................................. 3:t: 5& AVANT-PROPOS.................................................................................................................... s 1. INTRODUCTION ................................................................................................................ S#i f 2. PREMIERE PARTIE : PRESENTATIONDE LA ZONE D’ETUDE ........................... 12 2.1. Organisationsociale Diola . .. .. .. .. .. .. .. ..*.................................. 13 2.2. Suel,un village typiquedu phénomènede mandinguisation.,..... .. .. ,.. ,, . .. .., 16 3. DEUXIEME PARTIE : CADRE THEORIQUE . .. ..*...............*....................................*... 19 3.1. État de la question.. .. ..f........... 19 3.2. Problématique. ..<....................................................*..............................,...,.*...........*....27 3.3. Méthodologie. ..~.............................................................f.................................. -

Liste Lettre Commentaires Incomplete
LISTE LETTRE COMMENTAIRES INCOMPLETE N° NUMERO PRENOM NOM DATE NAISSANCELIEU NAISSANCE OBSERVATION 1 1 LC001009 Chérif Sidaty DIOP 22/05/1993 Dakar INCOMPLET 2 2 LC001024 Malick NIANE 25/06/1994 Gandiaye INCOMPLET 3 3 LC001029 FARMA FALL 16/08/1999 Parcelles Assainies U12 INCOMPLET 4 4 LC001039 Adama NDIAYE 13/04/1997 Saldé INCOMPLET 5 5 LC001060 Amadou DIA 23/10/1994 Thiaroye sur mer INCOMPLET 6 6 LC001070 Mouhamadou BARRY 24/08/1997 Dakar INCOMPLET 7 7 LC001090 Ibrahima KA 03/03/1996 Dahra INCOMPLET 8 8 LC001095 Ousseynou SENE 01/01/2000 Kaolack INCOMPLET 9 9 LC001099 Papa Masow TINE 27/05/2000 Gatte Gallo INCOMPLET 10 10 LC001105 NGAGNE FAYE 20/09/2000 Dakar INCOMPLET 11 11 LC001144 Adama SADIO 07/06/1996 Dakar INCOMPLET 12 12 LC001156 Arfang DIEDHIOU 05/04/1996 MLOMP INCOMPLET 13 13 LC001160 Modoulaye GNING 03/06/1994 Keur matouré e INCOMPLET 14 14 LC001175 Ablaye DABO 17/04/1998 Kaolack INCOMPLET 15 15 LC001176 Ibrahima KA 04/12/1999 Diamaguene Sicap Mbao INCOMPLET 16 16 LC001183 Mansour CISSE 11/03/1994 Rufisque INCOMPLET 17 17 LC001186 Ngouda BOB 14/01/1996 Ngothie INCOMPLET 18 18 LC001193 Abdoukhadre SENE 28/10/1999 Mbour INCOMPLET 19 19 LC001195 Jean paul NDIONE 07/04/1998 fandene ndiour INCOMPLET 20 20 LC001201 Abdou NDOUR 10/10/1996 Niodior INCOMPLET 21 21 LC001202 Yves Guillaume Djibosso DIEDHIOU 19/11/2020 Dakar INCOMPLET 22 22 LC001203 Mamour DRAME 06/10/1995 Guerane Goumack INCOMPLET 23 23 LC001207 Libasse MBAYE 10/07/1998 Dakar INCOMPLET 24 24 LC001211 Modou GUEYE 26/11/1999 Fordiokh INCOMPLET 25 25 LC001224 Bernard