Les Tgv Sur Lignes Classiques Les Tgv Intersecteurs
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
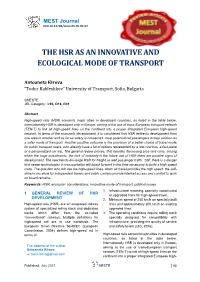
The Hsr As an Innovative and Ecological Mode of Transport
MEST Journal DOI 10.12709/mest.05.05.02.07 THE HSR AS AN INNOVATIVE AND ECOLOGICAL MODE OF TRANSPORT Antoaneta Kirova “Todor Kableshkov” University of Transport, Sofia, Bulgaria ©MESTE JEL Category: L92, O18, R41 Abstract High-speed rails (HSR) connects major cities in developed countries, as listed in the table below. Internationally HSR is developed only in Europe, aiming at the use of trans-European transport network (TEN-T) to link all high-speed lines on the continent into a proper integrated European high-speed network. In terms of the economic development, it is considered that HSR redirects development from one area to another and as far as safety is concerned, most potential rail passengers accept aviation as a safer mode of transport. Another positive outcome is the provision of a better choice of travel mode for public transport users, who already have a lot of options represented by a low-cost bus, a fast plane or a personalized car trip. The general review proves, that besides discussing pros and cons, among which the huge investments, the lack of certainty in the future use of HSR there are positive signs of development. The new trends envisage HSR for freight as well passenger traffic. Still, there is a danger that newer technologies in transportation will boost forward in the time necessary to build a high-speed route. The question who will use the high-speed lines, when air travel provides the high speed, the self- driven cars allow for independent travels and public carriers provide Internet access and comfort to work on board remains. -

Analyse De La Deuxième Phase De La Branche Est De La Ligne À Grande Vitesse (LGV) Rhin-Rhône
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Analyse de la deuxième phase de la branche Est de la ligne à grande vitesse (LGV) Rhin-Rhône Rapport n° 012304-01 établi par Michel ROSTAGNAT P UNovembre B 2018 L I É PUBLIÉ Les auteurs attestent qu'aucun des éléments de leurs activités passées ou présentes n'a affecté leur impartialité dans la rédaction de ce rapport Statut de communication Préparatoire à une décision administrative Non communicable Communicable (données confidentielles occultées) Communicable PUBLIÉ PUBLIÉ Sommaire Résumé.....................................................................................................................4 Liste des recommandations...................................................................................5 Introduction..............................................................................................................6 1. Où en est-on ?.......................................................................................................8 1.1. Bilan de la première phase.........................................................................................8 1.1.1. Modalités d’établissement du bilan LOTI.........................................................9 1.1.2. Evolution du trafic voyageurs...........................................................................9 1.1.3. Bilan financier................................................................................................12 1.2. Le service.................................................................................................................14 -

Download PDF (62.7
Index ability and interoperability 277 Austria 113, 150, 156, 177, 182, 192–4, access, non-discriminatory 43, 46, 201 303–21, 333 authorization process 286–9, 291–2, accounting separation 56, 68, 356–7 293, 294, 299, 300 acquisitions 182–9 autonomy, managerial 90–108 ‘additivity principle’ 326, 332, 338 auto transportation 240, 343, 346 Adelaide–Darwin 262 availability-based concessions 250, Adif 199 253, 255, 260, 268, 269 ageing population 30 avoidable cost principle 350 airport rail links (ARLs) 250, 252, 253, 268, 269 bankruptcies 98 air transport 127–8, 130, 343, 346, Banverket 58 359 Baritaud, M. 325 Alexandersson, G. 2, 59, 103–4, BBG (Federal Railways Act/ 106 Bundesbahngesetz) 192 Allais, Maurice 324, 330, 336 BCG study 102 Alleo 181 BDZ Cargo 154 alliances 179–82, 318 Beacon Rail 224 Alpha Trains 222 Beckers et al. 175 Amtrak 241, 343 Belgium 16, 113, 151, 153, 308 Angel 211, 223, 224 benchmark competition 242, 245 Arenaways 176, 196 Beria et al. 70 Arlanda Express 262, 263, 267 BLS AG 243 Arriva 100–101, 182, 202, 312, 313 BNA (Bundesnetzagentur) 307 Arriva RP 192 bottlenecks, monopolistic 42, 43, 48 Artesia 180 BRC 154 Arup 223 Brisbane Airtrain 262 asset management 227, 229 Britain see UK asset-only PPPs 252 British Rail 59, 61 assets brownfield concessions 270 return 317–18 BTRE 297 value 314–16, 320 Bulgaria 100, 154 ATOC (Association of Train Operating bundled regimes 82–3 Companies) 221, 223, 227 bus access 312–13 Augusta 193 business diversification 350, 360 Australia 222, 234, 261, 262, 297, 342, Butcher, L. -

As of 31St December 2019, SNCF Réseau & SNCF Mobilités
SNCF GROUP INVESTOR PRESENTATION TABLE OF CONTENT 1 SNCF GROUP: AN OVERVIEW OF OUR BUSINESSES 2 SNCF GROUP: CREDIT PROFILE 3 SNCF RÉSEAU: CREDIT PROFILE 4 CSR: COMMITMENTS & GREEN BOND PROGRAMME 5 APPENDICES: BUSINESS PROFILES OTHER CONTACTS 2 SNCF GROUP INVESTOR PRESENTATION AN OVERVIEW OF OUR BUSINESSES SNCF GROUP PRESENTATION A LEADING PASSENGER AND FREIGHT LOGISTICS GROUP IN FRANCE & WORLDWIDE € 33.3 bn € 21.6 bn € 5.1 bn AA- Aa3 A+ Turnover in 2018 € 4.0 bn Net debt pro forma CAPEX financed on its own S&P Moody’s Fitch Group EBITDA in 2018 1/3 outside of France of total debt relief* by SNCF Group Stable Stable Stable * Pro forma of the € 35 bn debt relief, post 2022 Total turnover: breakdown by branches (internal and external) Main activities: rankings & KPIs IN % 24 4 -19 SNCF Réseau KEOLIS automatic subway 100 SNCF Réseau largest network in Europe 18 #2 #1 and tramway operator worldwide 50 SNCF Voyageurs #3 largest ‘high speed’ network in the world SNCF Logistics KEOLIS SNCF Voyageurs #4 operator in Europe GEODIS operator worldwide 15 k trains / day, #8 23 Rail Freight of which 7,000 in the Paris Greater area OUI.SNCF Other* 15 m travelers / day in the world #1 online travel agency in France * Mainly intercompany sales elimination SNCF Réseau SNCF Voyageurs KEOLIS GEODIS Rail Freight Infrastructure and train Train operating company World leader in day Freight and logistics, Rail freight transport station manager in France in France and internationally to day mobility both internal and international, solutions for industries including -

Paris“ Getauft
Presseinformation Zehn Jahre deutsch-französischer Hochgeschwindigkeits- verkehr: ICE auf den Namen „Paris“ getauft Rund 16 Millionen Fahrgäste seit 2007 • Hohe Kundenzufriedenheit von 92 Prozent • WLAN in allen Zügen und auf allen Streckenabschnitten ab Sommer • Jubiläumsangebot: 10.000 Tickets für 29 Euro (Berlin/Paris, 1. Juni 2017) Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des deutsch- französischen Hochgeschwindigkeitsverkehrs wurde heute in Paris ein ICE auf den Namen „Paris“ getauft. Birgit Bohle, Vorstandsvorsitzende DB Fernverkehr AG, Patrick Jeantet, Mitglied des Konzernvorstandes SNCF, Vorsitzender des Vorstands von SNCF Réseau, und Rachel Picard, Vorstandsvorsitzende SNCF Voyages, nahmen die Namensgebung im Beisein zahlreicher Ehrengäste vor. „Gemeinsam mit den rund 16 Millionen Fahrgästen in ICE und TGV haben wir seit 2007 eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte geschrieben“, sagte Birgit Bohle in Paris. „Und sie wird weiter fortgesetzt: Seit Einführung der Hochgeschwindigkeitsverkehre sind die Fahrgastzahlen um über 60 Prozent gestiegen. Ich bin sicher, dass wir mit den kürzeren Reisezeiten, den zusätz- lichen Verbindungen und ab Sommer mit WLAN in allen TGV und ICE auf allen Streckenabschnitten noch mehr Kunden für dieses Angebot begeistern können.“ Kern des Erfolgs bildet Alleo, die gemeinsame, für Marketingleistungen zuständige Tochtergesellschaft von DB und SNCF. Den ICE- und TGV-Zügen von Alleo gelang es, auf der Relation Stuttgart–Paris mit 65 Prozent Marktanteil gegenüber dem Flugzeug die Markführerschaft zu erringen. -

Prévisions De Trafic En Territoire Alsace Mardi 12 Juin 2018
PRÉVISIONS DE TRAFIC EN TERRITOIRE ALSACE MARDI 12 JUIN 2018 TRAFIC TGV TRAFIC RÉGIONAL État du trafic État du trafic Perturbé TER [en moyenne +6% de cars] Perturbé TGV [en moyenne] Prévisions détaillées Prévisions détaillées + Sur l’axe Est : + Strasbourg – Bâle (TER 200) : 5 trains sur 10 + Alsace – Paris : 14 allers – 14 retours (Alleo* compris) + Mulhouse Thann Kruth en tram-train : 9 tram-train sur 10 (fermeture ligne après 21h) + Strasbourg – Roissy Aéroport CDG : 1 aller – 1 retour + Mulhouse Thann Kruth en train : 5 circulations sur 10 (dont 5 cars) + Strasbourg – Nantes : 1 aller – 1 retour + Strasbourg – Offenbourg : service normal + Strasbourg – Bordeaux : 1 aller – 1 retour + Mulhouse – Müllheim : service normal (dont 6 cars) + Strasbourg – Nancy : 2 trains sur 5 + Sur l’axe Sud -Est : + Strasbourg – Sélestat via Molsheim : 4 circulations sur 10 (dont 4 cars) + Mulhouse - Paris Lyon : 4 allers – 4 retours ( Lyria compris) + Strasbourg-Sélestat (Omnibus) : 2 circulations sur 10 (dont 1 car) + Strasbourg – Marseille : 1 aller – retour + Strasbourg – Molsheim : 3 train sur 10 + Francfort – Marseille : 1 aller – retour + Mulhouse – Belfort : 3 trains sur 10 + Strasbourg – Montpellier : 1 aller – retour + Strasbourg – Sarrebruck : 4 trains sur 10 + Colmar – Metzeral : 3 circulations sur 10 (dont 3 cars) TRAFIC INTERNATIONAL + Mulhouse – Bâle (Omnibus) : 3 circulations sur 10 (dont 1 car) + Alléo * (France - Allemagne) + Strasbourg – St-Dié : 3 circulations sur 10 (dont 9 cars) + Mulhouse – Colmar (Omnibus): 3 trains sur 10 + Strasbourg -

PR SNCF Group FY2019 Results 02.28.2020
PRESS RELEASE PRESS RELEASE – LA PLAINE SAINT DENIS, 28 FEBRUARY 2020 SNCF GROUP 2019 ANNUAL RESULTS 2019 MOMENTUM HALTED BY DECEMBER STRIKE • Operating performance linked to continued investment in core programmes targeting saf ety (-21% fall in major safety events), robust rail service (annual on-time arrivals at a historic high of 89%) and passenger information (notice of delays up from 64% to 79%). • Improved customer satisfaction : a historic 85.9% for TER regional rail (+4.2 pts) and 82% for TGV high-speed rail (+3 pts). • Group revenue up 5.1%, driven by steady growth in passenger traffic at Voyageurs. Full - year revenue totalled €35.1bn in 2019 . • The multi-sector strike linked to French pension reforms that began in December saw SNCF go all out to limit consequences for its customers, and led to an operating loss of €614m at year-end 2019. • Buoyant business combined with strict financial discipline generated €560 m in gains in competitiveness that boosted EBITDA despite the strike, and limited its impact on results. • Recur ring net profit was a negative €301m (and would have reached a positive €313m without the strike). • Investments reached a record high of €10bn (all funding sources combined). Of that total, 95% went into the French rail network , benefitting customers, regional development and suppliers. • SNCF recruited 12,600 new employees in France in 2019, with one-third hired for jobs in rail operations. SNCF Group is one of the country’s largest employers. The Board of Directors of SNCF SA met today under the chairmanship of Jean-Pierre Farandou to approve SNCF Group’s consolidated financial statements for financial year 2019. -

California High Speed Train Project
California High-Speed Train Project TECHNICAL MEMORANDUM Terminal and Heavy Maintenance Facility Guidelines TM 5.1 Prepared by: Signed document on file _25 AUG 2009_ James Campbell and Yu Hanakura Date Checked by: Signed document on file _25 AUG 2009_ Paul Mosier, O & M Manager Date Approved by: Signed document on file _25 AUG 2009_ Ken Jong, Engineering Manager Date Released by: Signed document on file _25 AUG 2009_ Tony Daniels, Program Director Date Revision Date Description 0 25 AUG 2009 Initial Release Note: Signatures apply for the latest technical memorandum revision as noted above. Prepared by for the California High-Speed Rail Authority California High-Speed Train Project Terminal and Heavy Maintenance Facility Guidelines, R0 This document has been prepared by Parsons Brinckerhoff for the California High-Speed Rail Authority and for application to the California High-Speed Train Project. Any use of this document for purposes other than this Project, or the specific portion of the Project stated in the document, shall be at the sole risk of the user, and without liability to PB for any losses or injuries arising for such use. CALIFORNIA HIGH-SPEED RAIL AUTHORITY Terminal and Heavy Maintenance Facility Guidelines CONTENTS 1.0 OVERVIEW ................................................................................. 1 2.0 PURPOSE AND OBJECTIVE .......................................................... 1 3.0 MAINTENANCE PROTOCOLS ON EXISTING HST SYSTEMS ........... 2 3.1 FRENCH NATIONAL RAILWAY (SNCF) .................................................. 2 3.1.1 Maintenance Inspection Overview ....................................................4 3.1.2 Heavy Maintenance Policy ...............................................................8 3.1.3 Maintenance and Layup/Storage Facilities .........................................8 3.1.4 Heavy Maintenance Facility Configuration and Capacity .......................12 3.2 JAPAN RAIL GROUP (JR) ................................................................. -

High-Speed Europe, a Sustainable Link Between Citizens
High-speed Europe A SUSTAINABLE LINK BETWEEN CITIZENS This brochure is based largely on ‘European high-speed rail – An easy way to connect’, a study into the development and future prospects of the high-speed trans-European rail network. This study, which was commissioned by the European Commission, was completed in March 2009 by MVV Consulting and Tractebel Engineering. Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed. More information on the European Union is available on the Internet (http://europa.eu). Cataloguing data can be found at the end of this publication. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010 ISBN 978-92-79-13620-7 doi: 10.2768/17821 © European Union, 2010 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged. Cover photo: © Eurostar Group Ltd Photos courtesy of: Adif, Eurostar Group Ltd, Ferrovie dello stato, iStockphoto, Reporters, Shutterstock, European Union Printed in Belgium PRINTED ON WHITE CHLORINE-FREE PAPER PREFACE The European Union is committed to making the transport of goods and the mobility of people more secure, more efficient and more environmentally friendly, with priority given to social and territorial cohesion, as well as to economic dynamism. Looking ahead to the near future, I envisage a transport system that closely meets the needs of its users, that is fast and intelligent but that minimises its environmental impact. The use of high-speed trains shows how this vision for the future can be made a reality today, thanks to the combined efforts of the Member States, partners from the industry and the financial support from the Union. -

Der Deutsch-Französischer Hochgeschwindigkeitsverkehr: Bilanz Und Perspektiven L’ Offre Ferroviaire À Grande Vitesse Franco-Allemande : Bilan Et Perspectives
Der deutsch-französischer Hochgeschwindigkeitsverkehr: Bilanz und Perspektiven L’ offre ferroviaire à grande vitesse franco-allemande : Bilan et perspectives Alleo GmbH auf der Landesmitgliederversammlung Saarbrücken, 7. März 2013 des Verkehrsclub Deutschland e.V. Sarrebruck, 7 mars 2013 1 Mit bis zu 320 km/h verbinden ICE und TGV Deutschland und Frankreich/ jusqu‘à 320km/h TGV et ICE relient l‘Allemagne et la France Hochgeschwindigkeitsverkehr DB – SNCF „alleo“ “ Lignes Grande Vitesse DB – SNCF „alleo n Deutsch-französisches Hochgeschwindigkeitsangebot auf drei Routen: - Täglich bis zu fünf Verbindungen zwischen Frankfurt/M und Paris über Saarbrücken - Bis zu vier Zugpaare zwischen Stuttgart und Paris, davon eine Direktverbindung München – Paris - Neu seit 23. März 2012: eine Direktverbindung Frankfurt/M – Strasbourg – Lyon – Marseille n Une offre franco-allemande de Grande Vitesse sur trois relations : - Jusqu‘à cinq trajets entre Francfort/M et Paris via Fahrzeitentwicklung* 2012 gegenüber 2006 Sarrebruck Evolution de la durée du trajet 2006-2012* - Jusqu‘à quatre trains par jour aller-retour entre Stuttgart et Paris, dont un trajet direct Munich – Paris 6:06 Frankfurt – Paris 3:48 - Nouveau depuis le 23 mars 2012 : un trajet direct Francfort/M – Strasbourg – Lyon - Marseille Saarbrücken– 3:50 Paris 1:46 *jeweils beste Reisezeit ** für internationale Fahrgäste bei einer Reisezeit > eine Stunde auf den Strecken nach Paris; 2 Seit Juni 2007 verbinden wir mit den modernsten Zügen der Welt die Menschen im Herzen Europas Depuis juin 2007, nous relions les hommes au cœur de l’Europe avec les trains les plus modernes du monde 1992 Staatsvertrag von La Rochelle Traité de La Rochelle 1999 Finanzierungsvereinbarung für die neue Infrastruktur in F. -

MEMENTO STATISTIQUES SNCF Mobilités 2016
Les faits marquants et les chiffres clés du groupe SNCF à travers le prisme de l’ÉPIC SNCF Mobilités SNCF MOBILITÉS – DGD PERFORMANCE DIRECTION DES STATISTIQUES, INFORMATIONS ÉCONOMIQUES & GESTION DES DONNÉES Campus Wilson – 9 rue Jean-Philippe Rameau CS 20012 93212 LA PLAINE ST DENIS CEDEX TABLE DES MATIÈRES Le Groupe ................................................................................................................................................................ 2 SNCF Mobilités ........................................................................................................................................................ 9 SNCF Voyages ................................................................................................................................................... 18 SNCF Transilien, Régions et Intercités : ............................................................................................................ 25 Régions ......................................................................................................................................................... 25 Intercités ...................................................................................................................................................... 27 Transilien ...................................................................................................................................................... 30 SNCF Logistics .................................................................................................................................................. -
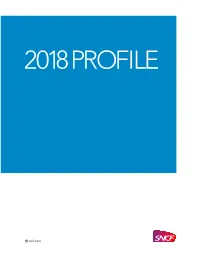
2018 Profile
2018 PROFILE SNCF ÉQUIVALENCE QUADRI SNC_11_0000_Logo2011 16/02/2011 24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE DÉGRADÉ CYAN MAGENTA YELLOW Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87 Web : www.carrenoir.com Ce fichier est un document d’exécution créé sur RÉSERVE BLANCHE Illustrator version CS3. TO OUR READERS SNCF GROUP TODAY SNCF is already a leader in passenger transport and freight logistics—in France and around the world. The rail reform adopted by the French Parliament on 27 June 2018 creates a more unified SNCF, better equipped to compete successfully on an open market. As a champion of mobilities of all types, SNCF Group never stops making things easier for our passengers and freight custo- mers—across France and around the globe. Looking to the future, the reform ensures we’ll have a reliable, high-performance network that is also more eco-friendly. And in doing so, it will allow us to reinvent SNCF’s public service mission and meet competition from a position of strength. €33.5bn €8.8bn 14 revenue in investments million passengers carried daily, (all funding sources combined) in France and around the world over 33% revenue from with 95% 270,000 international markets generated in France employees worldwide 120 countries Key figures at YE 2017 02 2018 PROFILE 2018 PROFILE 03 FINANCIAL PERFORMANCE SNCF GROUP HAS ALREADY INVESTED KEY FIGURES IN 2017 MORE THAN €75BN OVER 10 YEARS WITH MORE THAN 60% FINANCED BY SNCF SNCF GROUP 9.3 SNCF SNCF Total investment, all funding sources in €bn 8.8 €M IN 2017 GROUP 8.6 MOBILITÉS RÉSEAU % financed by SNCF 8.2 8.2 Revenue 33,515 31,831 6,496 7.2 2017 / 2016 Change + 4.2% + 4.7% + 0.9% 6.5 6.5 6.3 6.5 EBITDA 4,578 2,759 1,897 As % of revenue 13.7% 8.7% – Financial profit – 1,476 – 290 – 1,172 Recurring net profitattributable to equity holders of parent co.