Rapport Libourne
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
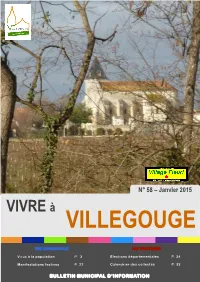
Vivre À Villegouge N° 58 - Janvier 2015
Vivre Villegougeà n° 58 N° 58 – Janvier 2015 VIVRE à - VILLEGOUGEJanvier 2015 VIE MUNICIPALE VIE PRATIQUE Vœux à la population P. 3 Elections départementales P. 24 Manifestations festives P. 22 Calendrier des collectes P. 32 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION VIE MUNICIPALE……….p.03 Vœux à la population Invitation Compte-rendus du Conseil Municipal : Le dimanche 22 février 2015, à partir de 12 heures, - Réunion du 4 novembre dans la salle des fêtes, nos aînés de 60 ans et plus sont conviés au repas offert par la commune. - Réunion du 16 décembre Il y a quelques jours déjà, les personnes concernées CULTURE…….………....p.20 ont dû recevoir une invitation personnelle dans leurs boîtes aux lettres. -Concours de dessin Celles et ceux, âgés de 60 ans et plus qui n’auraient Le P’tit biblio pas reçu d’invitation sont priés de se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie. MANIFESTATIONS FESTIVES.….………..….p.22 Les personnes accompagnantes de moins de 60 ans devront payer la somme de 28 € pour le repas. Gigi the star Cérémonie du 11 novembre Nous vous remercions de nous retourner vos coupons réponses au plus tard le 13 Février à 18 heures. Fête de Noël à l’école Pour notre plus grand plaisir, ce repas sera animé par VIE PRATIQUE ……...…..p.24 Albert et Lorian du Duo « Y’a de la voix », au programme ; magie, chansons, imitations et danses. 2 Elections départementales Nous vous attendons nombreux pour ce moment festif Monoxyde de carbone La commission fêtes et cérémonies. VIE DES ASSOCIATIONS ………. P. 27 Tennis club intercommunal du Fronsadais Les Canailles Le Fusil Villegougeois Le Comité des fêtes Football club Villegougeois Janvier 2015 - S.C.L. -

Sans Titre-1
16 octobre 2015 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde ERRATA L'article 10 est modifié comme suit : Extension du périmètre du syndicat intercommunal du Bassin Versant du Gestas aux communes de Izon, Pompignac, Loupes, Camiac-et-Saint- Denis, Bonnetan, Baron, Saint-Quentin-de-Baron, Nérigean, Tizac-de-Curton, Espiet, Grézillac, Daignac, Dardenac, Blésignac, Saint-Léon, Beychac-et-Caillau, Saint-Loubès, Montussan, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Eulalie, Arveyres, Cadarsac, Moulon, Génissac et Targon. Cf Carte au verso L’article 12 est supprimé, en raison de la procédure de fusion actuellement en cours dans le cadre du droit commun, concernant le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique du bassin de la Dronne et le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne (16), fusion devant prendre effet au 1er janvier 2016. LE VERDON- Blaye SUR-MER Dissolution du SI de défense de la digue des Quenouilles et Reprise SOULAC-SUR-MER par la CC issue de la fusion des CC du canton de Blaye, du canton de Bourg, TALAIS Latitude Nord Gironde, de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers-sur-Gironde et du Cubzaguais SAINT- VIVIEN- GRAYAN- DE-MÉDOC ET-L’HÔPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC Dissolution du SIGBV du Moron et du Blayais VENSAC VALEYRAC et Reprise par la CC issue de la fusion des CC du canton de Blaye, QUEYRAC BÉGADAN du canton de Bourg, Latitude Nord Gironde, SAINT-CHRISTOLY- MÉDOC de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers-sur-Gironde et du Cubzaguais. gestion des bassins versants -

Publication of a Communication of Approval of a Standard
29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -

English Version
What will you find in our practical guide? Practical information Land of wines Saint-Émilion town map List of the wineries open to the public 12 must see monuments Wineries open to the public 2020 main events Shops The Greater Saint-Émilion Area Restaurants Jurisdiction of Saint-Émilion: Accommodation a UNESCO World Heritage Site History & Traditions Leisure activities Gourmet land 3 SAINT-ÉMILION TOURISME TO KNOW OFFICE IS OPEN EVERY DAY Wear comfortable, low-heeled shoes to feel at ease on the narrow OF THE YEAR cobblestone streets, some of which are quite steep. th (except on December, 25 ) As there is a significant difference in temperature between the outdoor city and the wine cellars or the underground monuments (constant temperature OPENING HOURS of 13°C - 55°F), it would be a good idea to take a light sweater with you. (for more information You will find several toilets in Saint-Émilion: visit our website) - in the upper part of the village: free: Espace Villemaurine; paying: • Off season behind the collegiate church, Gendarmerie (police station) parking. (from November to April): - in the lower part of the village: paying: near the old wash houses 10:00 am - 12:30 pm and Place Bouqueyre. 2:00 pm - 5:00 pm • Mid-season (from April to June There is a limited number of parking spaces, but you will be able to park your car on the free parking lot behind the Gendarmerie and paying parking and September to October): (around the collegiate church in the upper town and Place Bouqueyre at the 9:30 am - 12:30 pm lower part of the village). -

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde
Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

Risque Inondation
DDRM DE LA .IRONDE Le risque inondation SOMMAIRE 1. QU’EST-CE QU’UNE INONDATION ?․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․5 2. COMMENT SE MANIFESTE-T-ELLE ?․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6 2.1. Les inondations pa su"#e sion #a ine․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․6 2.2. Les d$"o de#ents de %ou s d’ea!․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․7 2.&. Les inondations pa !isse''e#ent․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․9 2.(. Les inondations pa e#ont$e de 'a nappe p) $ati*!e․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․10 &. LES CONS+QUENCES SUR LES ,ERSONNES ET LES BIENS․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․11 (. LES FACTEURS A..RA/ANTS․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․12 0. LA STRAT+.IE NATIONALE DE .ESTION DU RISQUE INONDATION․․․․․․․․․․13 1. LE RISQUE INONDATION DANS LE D+,ARTEMENT․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․15 1.1. Conte2te )3d o4 ap)i*!e de 'a .i onde․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․15 1.2. Com#ent se #ani5este !ne inondation en .i onde ?․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․16 a. Les inondations par submersion marine․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․16 -

Session on Post-Accident
Your logo here Main results from the French panel of Blayais Post-accident (D9.71) session Mélanie MAÎTRE, Pascal CROÜAIL, Eymeric LAFRANQUE, Thierry SCHNEIDER (CEPN) Sylvie CHARRON, Véronique LEROYER (IRSN) TERRITORIES Final Workshop 12-14 November 2019, Aix-en-Provence This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant agreement No 662287. Quick reminders about WP3 Your logo here ▌ FIRST STEPS Ref. Ares(2018)542785 - 30/01/2018 This project has received funding from the Euratom research and training programme 2014-2018 under grant ► agreement No 662287. Feedback analysis (post-Chernobyl, post-Fukushima) allowing to: EJP-CONCERT • European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Identify uncertainties and local concerns at stake in contaminated Research H2020 – 662287 D 9.65 – Decision processes/pathways TERRITORIES: Synthesis report of CONCERT sub-subtask 9.3.3.1 territories ; Lead Authors: Jérôme Guillevic (IRSN, France), Pascal Croüail, Mélanie Maître, Thierry Schneider (CEPN, France) • Develop a typology of uncertainties (deliverable D.9.65): With contributions from: Stéphane Baudé, Gilles Hériard Dubreuil (Mutadis, France), Tanja Perko, Bieke Abelshausen, Catrinel Turcanu (SCK•CEN, Belgium), Jelena Mrdakovic Popic, Lavrans Skuterud (NRPA, Norway), Danyl Perez, Roser Sala (CIEMAT, Spain), Andrei Goronovski, Rein Koch, Alan Tkaczyk (UT, Estonia) radiological characterization and impact assessment, zoning of affected Reviewer(s): CONCERT coordination team areas, feasibility and effectiveness of the remediation options, health consequences, socio-economic and financial aspects, quality of life in www.concert- the territories, social distrust. h2020.eu/en/Publications ▌ INTERACTIONS WITH STAKEHOLDERS ► Organization of panels, case studies, serious games: collect stakeholders' expectations and concerns to better consider the uncertainties in the management of contaminated territories. -

20 E ÉTAPE LIBOURNE > ST ÉMILION
1 2 J’arrive de Les Billa�, St Denis de Pile, Coutras 4 3 4 5 15 Les Billaux, Galgon, St Denis de Pile, Coutras Av. G. Pompidou Accès Parkings 3, 4, 5 et 15 3 J’arrive de E St André de Cubzac, 5 J’arrive de l’A89, Galgon 17 JUILLET ÉTAPE A10, Paris 6 St André de Cubzac, A10, Paris Av. F. Mitterrand Av. de la Ballastière Av. de la Roudet Accès Parking 6 St André de Cubzac, A10, Paris La Rivière 15 Rue de Logroño CONTRE-LA-MONTRE | 20 D670 Fronsac Accès Parkings 7a, 7b et 7c 2 7a 7b 7c Accès Parking 2 LIBOURNE > ST ÉMILION 6 5 Parcours de la course Du vendredi 16 juillet à 23h au samedi 17 juillet à 21h. Fermeture à la circulation du parcours des coureurs entre : 7a > le Cours des Girondins, > le rond point Jean Moulin, av. de l'Europe Jean Monnet 7b av. du Maréchal Foch > le pont de Bordeaux, > l’avenue Foch, Emplacement 1 > les quais d’Amade, Souchet, des Salinières, > l’avenue Georges Pompidou, spectateurs > le pont de Fronsac, > et les rues adjascentes. réservé PMR 5 1 7c > La rue du Président Wilson, rue de la Marne HÔPITAL ROBERT BOULIN 12 Ligne de départ 8c rue du Président Carnot 8b e 2 3 GARE SNCF de la 20 étape 14 PARKINGS VISITEURS PARKINGS RÉSERVÉS AUX RIVERAINS alliéni . G v Départ de Libourne - Place Joffre a 2 9 route de saint-émilion pont de Pierre 1 Parking Calibus (réservé bus) 8a Parking Arveyres 1 Parking Stade Clémenceau cours Tourny > Caravane : 11h40 cours des Girondins 2 3 Parking Ceva 8b Parking Arveyres Renault 2 Parking Chaperon > Premier coureur : 13h05 quai du Priourat Parking France Agrimer Parking Arveyres Dekra Parking Lycée Jean Monnet > Dernier coureur : 17h19 4 8c 3 a v. -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée « BORDEAUX SUPÉRIEUR »
Publié au BO du MAA le 1er avril 2021 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » homologué par arrêté du 22 mars 2021 publié au JORF du 30 mars 2021 CHAPITRE Ier I. - Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur », initialement reconnue par le décret du 14 octobre 1943, les vins répondant aux conditions particulières fixées ci- après. II. – Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. – Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Bordeaux supérieur » est réservée aux vins tranquilles blancs ou rouges. IV. – Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1°- Aire géographique La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du en date du 26 février 2020 : Abzac, Aillas, Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Anglade, Arbanats, Arcins, Arsac, Artigues-près-Bordeaux, Arveyres, Asques, Aubiac, Auriolles, Auros, Avensan, Ayguemorte-les- Graves, Bagas, Baigneaux, Barie, Baron, Barsac, Bassanne, Bassens, Baurech, Bayas, Bayon-sur- Gironde, Bazas, Beautiran, Bégadan, Bègles, Béguey, Bellebat, Bellefond, Belvès-de-Castillon, Bernos- Beaulac, Berson, Berthez, Beychac-et-Caillau, Bieujac, Birac, Blaignac, Blaignan-Prignac, Blanquefort, Blasimon, Blaye, Blésignac, Bommes, Bonnetan, Bonzac, Bordeaux, Bossugan, Bouliac, Bourdelles, -

Rapport D'activités 2018
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018 www.cdc-fronsadais.com SOMMAIRE EDITO DE MADAME LA PRÉSIDENTE Chères Fronsadaises, Chers Fronsadais, La Communauté de Communes du Au travers de nos réalisations riches Fronsadais existe depuis décembre et diversifiées que sont le pôle en- 2002 et j’ai l’immense honneur de la fance à La Lande de fronsac, l’agran- EDITO DE MADAME LA PRÉSIDENTE ........................................................... 03 présider depuis octobre 2017. dissement de la crèche à Villegouge, le gymnase « Michel Frouin » à Vérac, le Je suis bien consciente que les ci- complexe tennistique à Villegouge, la toyens se sentent plus concernés par LA COMPOSITION DE LA CDC DU FRONSADAIS .............................. ZAC à Lugon et enfin le nouvel « Office 04 l’échelon communal et qu’il y a souvent de Tourisme » à Saint Germain de la une méconnaissance de l’intercom- Rivière, émane notre volonté affichée munalité mais j’espère qu’au travers L’ORGANISATION INSTITUTIONELLE............................................................. de doter notre territoire d’équipements 06 de nos réalisations et de nos projets à de qualité, dans le respect de la bonne venir, nous avons su ou saurons vous utilisation des deniers publics et au convaincre de la pertinence de l’action LES COMPÉTENCES DE LA CDC DU FRONSADAIS ........................... bénéfice de nos administrés. 08 communautaire. Je tiens tout particu- D’autant plus que la loi lièrement à remercier L’ORGANISATION DES SERVICES ...................................................................... 10 NOTRe renforce le rôle J’adhère pleinement le personnel qui œuvre des Intercommunalités chaque jour avec beau- qui se voient désormais aux valeurs de coup de professionna- 2018 EN UN CLIN D’OEIL ................................................................................................. 12 dotées de nombreuses lisme et qui grâce à la Marie-France RÉGIS compétences. -

The Libournais and Fronsadais
108 FRANCE THE LIBOURNAIS AND FRONSADAIS The right bank of the Dordogne River, known as THE GARAGISTE EFFECT the Libournais district, is red-wine country. In 1979, Jacques Thienpont, owner of Pomerol’s classy Vieux Château Certan, unintentionally created what would become the Dominated by the Merlot grape, the vineyards “vin de garagiste” craze, when he purchased a neighboring plot here produce deep-colored, silky- or velvety-rich of land and created a new wine called Le Pin. With a very low yield, 100 percent Merlot, and 100 percent new oak, the wines of classic quality in the St.-Émilion and decadently rich Le Pin directly challenged Pétrus, less than a mile Pomerol regions, in addition to wines of modest away. It was widely known that Thienpont considered Vieux Château Certan to be at least the equal of Pétrus, and he could quality, but excellent value and character, in the certainly claim it to be historically more famous, but Pétrus “satellite” appellations that surround them. regularly got much the higher price, which dented his pride. So Le Pin was born, and although he did not offer his fledgling wine at the same price as Pétrus, it soon trounced it on the auction IN THE MID-1950S, many Libournais wines were harsh, and market. In 1999, a case of 1982 Le Pin was trading at a massive even the best AOCs did not enjoy the reputation they do today. $19,000, while a case of 1982 Château Pétrus could be snapped Most growers believed that they were cultivating too much up for a “mere” $13,000. -

Tirage Du 28 02 2020 Libourne
TIRAGE AU SORT DU VENDREDI 28/02/2020 – ARRONDISSEMENT DE LIBOURNE Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête de liste d'affichage attribué Ensemble continuons à Abzac Jean-Louis d'Anglade 1 moderniser Abzac Demain Abzac : Construisons-le Abzac Jean-Michel PEREZ 2 ensemble Abzac Liste citoyenne Abzac 2020 Lyonel MÜNZER 3 Arveyres Agir ensemble pour Arveyres Marie-Hélène SAGE 2 Arveyres Arveyres à venir Bernard GUILHEM 1 Baron Avec vous, Baron demain ! Emmanuel LE BLOND DU PLOUY 1 Branne Un nouvel air pour Branne Marie-Christine FAURE 2 Branne Branne ensemble Serge MAUGEY 1 Cadillac en Fronsadais Vivre à Cadillac Richard BARBE 1 Nous construisons l'avenir Castillon la bataille Jacques BREILLAT 2 ensemble Castillon la bataille Castillon, notre bataille Patricia COURANJOU 1 Coutras Agir et entreprendre pour Coutras Jérôme COSNARD 3 Coutras Unis participons et réalisons Hervé FAUDRY 2 Coutras Coutras Autrement Mme LACOSTE Michelle 1 Fronsac Ensemble pour Fronsac Marcel DURANT 1 Poursuivre et construire Galgon Jean-Marie BAYARD 1 ensemble Galgon Agir pour Galgon Serge BERGEON 2 Génissac Vivre bien à Génissac Jean-Pierre PALLARO 2 Génissac L'essentiel c'est vous ! Jean-Jacques TALLET 1 Une énergie commune avec Guîtres Philippe BERTEAU 2 Philippe BERTEAU Guîtres Pour Guîtres ! Source d'avenir Hervé ALLOY 1 Guîtres Agir et entreprendre pour Guîtres Marie-Françoise RANCHOU 3 Izon Au coeur d'Izon Frédéric MALVILLE 1 Izon Ensemble vivons Izon Laurent DELAUNAY 2 Numéro du panneau Nom de la commmune Nom de la liste Nom du tête