Risque Inondation
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
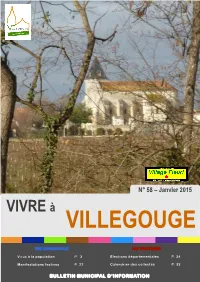
Vivre À Villegouge N° 58 - Janvier 2015
Vivre Villegougeà n° 58 N° 58 – Janvier 2015 VIVRE à - VILLEGOUGEJanvier 2015 VIE MUNICIPALE VIE PRATIQUE Vœux à la population P. 3 Elections départementales P. 24 Manifestations festives P. 22 Calendrier des collectes P. 32 BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION VIE MUNICIPALE……….p.03 Vœux à la population Invitation Compte-rendus du Conseil Municipal : Le dimanche 22 février 2015, à partir de 12 heures, - Réunion du 4 novembre dans la salle des fêtes, nos aînés de 60 ans et plus sont conviés au repas offert par la commune. - Réunion du 16 décembre Il y a quelques jours déjà, les personnes concernées CULTURE…….………....p.20 ont dû recevoir une invitation personnelle dans leurs boîtes aux lettres. -Concours de dessin Celles et ceux, âgés de 60 ans et plus qui n’auraient Le P’tit biblio pas reçu d’invitation sont priés de se faire connaître auprès du secrétariat de la Mairie. MANIFESTATIONS FESTIVES.….………..….p.22 Les personnes accompagnantes de moins de 60 ans devront payer la somme de 28 € pour le repas. Gigi the star Cérémonie du 11 novembre Nous vous remercions de nous retourner vos coupons réponses au plus tard le 13 Février à 18 heures. Fête de Noël à l’école Pour notre plus grand plaisir, ce repas sera animé par VIE PRATIQUE ……...…..p.24 Albert et Lorian du Duo « Y’a de la voix », au programme ; magie, chansons, imitations et danses. 2 Elections départementales Nous vous attendons nombreux pour ce moment festif Monoxyde de carbone La commission fêtes et cérémonies. VIE DES ASSOCIATIONS ………. P. 27 Tennis club intercommunal du Fronsadais Les Canailles Le Fusil Villegougeois Le Comité des fêtes Football club Villegougeois Janvier 2015 - S.C.L. -

Sans Titre-1
16 octobre 2015 Projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale de la Gironde ERRATA L'article 10 est modifié comme suit : Extension du périmètre du syndicat intercommunal du Bassin Versant du Gestas aux communes de Izon, Pompignac, Loupes, Camiac-et-Saint- Denis, Bonnetan, Baron, Saint-Quentin-de-Baron, Nérigean, Tizac-de-Curton, Espiet, Grézillac, Daignac, Dardenac, Blésignac, Saint-Léon, Beychac-et-Caillau, Saint-Loubès, Montussan, Saint-Sulpice-et-Cameyrac, Sainte-Eulalie, Arveyres, Cadarsac, Moulon, Génissac et Targon. Cf Carte au verso L’article 12 est supprimé, en raison de la procédure de fusion actuellement en cours dans le cadre du droit commun, concernant le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique du bassin de la Dronne et le Syndicat intercommunal d’Aménagement Hydraulique du Sud Charente : bassins Tude et Dronne (16), fusion devant prendre effet au 1er janvier 2016. LE VERDON- Blaye SUR-MER Dissolution du SI de défense de la digue des Quenouilles et Reprise SOULAC-SUR-MER par la CC issue de la fusion des CC du canton de Blaye, du canton de Bourg, TALAIS Latitude Nord Gironde, de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers-sur-Gironde et du Cubzaguais SAINT- VIVIEN- GRAYAN- DE-MÉDOC ET-L’HÔPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC Dissolution du SIGBV du Moron et du Blayais VENSAC VALEYRAC et Reprise par la CC issue de la fusion des CC du canton de Blaye, QUEYRAC BÉGADAN du canton de Bourg, Latitude Nord Gironde, SAINT-CHRISTOLY- MÉDOC de l’Estuaire-canton de Saint-Ciers-sur-Gironde et du Cubzaguais. gestion des bassins versants -

Vins D'aquitaine 2015 Liste Des Vins Médaillés
Concours de Bordeaux - Vins d’Aquitaine 2015 Liste des vins médaillés Bordeaux Rouge Médaille : ARGENT SCEA PIVA Tél.: 0556716516 Fax: 0556716182 Château DES SEIGNEURS DE POMMYERS Monsieur PIVA Jean Luc Email : [email protected] 2012 Château des seigneurs de Pomiyers Web : Volume présenté: 313 hl 33540 ST FELIX DE FONCAUDE Médaille : ARGENT SCEA ROCHE Tél.: 0556724128 Fax: 0556720833 Château ROCHEBERT Monsieur ROCHE David Email : [email protected] 2012 11 route de Perriche Web : www.vignoble-roche.com Volume présenté: 500 hl 33750 BEYCHAC ET CAILLAU Médaille : ARGENT SCI DOMAINES CAZEAU & PEREY Tél.: 0556615883 Fax: 0556718770 L'EXCELLENCE DE CHATEAU CAZEAU Madame FONTANIOL Christine Email : [email protected] 2012 BOURRASSAT Web : www.laguyennoise.com CS 70100 Volume présenté : 102 hl 33540 SAUVETERRE DE GUYENNE Médaille : ARGENT SCEA CHÂTEAU SAINTE-BARBE Tél.: 0556774957 Fax: MERLOT DU CHATEAU SAINT BARBE Monsieur JUET Email : [email protected] 2012 Route Du Burck Web : www.chateausaintebarbe.com Volume présenté: 720 hl 33810 AMBES Médaille : ARGENT SCEA CHÂTEAU D' EYRAN Tél.: 0556655159 Fax: 0556654378 Château BASTIAN Réserve Monsieur SAVIGNEUX Stéphane Email : [email protected] 2013 8 chemin du Château Web : www.savigneux.com Volume présenté: 175 hl 33650 ST MEDARD D EYRANS Médaille : ARGENT SA CHEVAL QUANCARD Tél.: 0557778888 Fax: 0557778864 Château DE BORDES-QUANCARD Monsieur CAZE Christian Email : chevalquancard@chevalquancard. 2013 ZI La Mouline Web : com 4 rue du Carbouney www.chevalquancard.com -

Village À Podensac
Page 1 sur 1 Commune de VIRELADE Etat : manque lieu-dit : Castelmoron Précision état : Manque dans la partie supérieure, au époque de construction : 19e siècle Lanterne de procession à Virelade (33) niveau du décor. auteur(s) : maître d'oeuvre inconnu Auteur(s) : auteur inconnu gros-oeuvre : calcaire ; moellon ; enduit partiel Catégorie : Bronze d'art Siècle : 19e siècle couverture (matériau) : tuile creuse Edifice de conservation : église paroissiale;Sainte- Date protection : oeuvre non protégée MH couverture (type) : toit à longs pans ; pignon couvert Marie Statut juridique : propriété de la commune typologie : cabane de vigneron Adresse : Eglise(place de l') Type d'étude : inventaire topographique propriété privée Matériaux : laiton:ajouré;verre(coloré) Nom rédacteur(s) : Zannese Françoise date protection MH : édifice non protégé MH Structure : plan(hexagonal) Copyright : © Inventaire général, 1992 type d'étude : inventaire topographique Description : Verres de diverses couleurs (bleu, rouge, Référence : IM33000438 date d'enquête : 1988 jaune). Dossier consultable : service régional de l'inventaire rédacteur(s) : Maffre Dimensions : 43 h;20 la Aquitaine N° notice : IA00068050 Iconographie : croix;décor d'architecture(trilobe,gâble) 54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex - © Inventaire général, 1988 ;ornementation(perle,palme) 05.57.95.02.02 Dossier consultable : service régional de l'inventaire Précision représentation : Croix au sommet. Décor d' Aquitaine architecture sur les faces. 54, Rue Magendie 33074 BORDEAUX Cedex - Etat : manque 05.57.95.02.02 Précision état : Il manque la hampe et des verres ; Cabanes de Vigneron à Virelade (33) certains sont cassés. Catégorie : Cabanes Auteur(s) : auteur inconnu aire d'étude : Podensac Siècle : 2e moitié 19e siècle collectifs : 7 étudié ; 7 repéré Cabane de Vigneron à Virelade (33) Date protection : oeuvre non protégée MH historique : 40 pour cent des cabanes de vignerons Catégorie : Cabane Statut juridique : propriété de la commune datent du 18e siècle, les autres du 19e siècle. -

Les Délimitations AOC Dans La Partie Méridionale De La Région Des Graves (Gironde) Jean-Claude Hinnewinkel
Les délimitations AOC dans la partie méridionale de la région des Graves (Gironde) Jean-Claude Hinnewinkel To cite this version: Jean-Claude Hinnewinkel. Les délimitations AOC dans la partie méridionale de la région des Graves (Gironde). 2011. halshs-00776788 HAL Id: halshs-00776788 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00776788 Preprint submitted on 22 Jan 2013 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Les délimitations AOC dans la partie méridionale de la région des Graves « Graves » désigne une nature de terrain très répandue sur la rive gauche de l’axe Garonne- Gironde. Ce terme est utilisé le plus souvent pour désigner la région comprise entre Langon et Bordeaux. Avec Graves (mais aussi Cernès), une certaine unité de dénomination caractérise l’ensemble pédologique « graves » au 18ième. Aujourd’hui cet espace assez homogène est scindé en plusieurs entités distinctes, dont bien sûr le Sauternais. Notre propos est ici de rechercher pourquoi au cours du 19ième siècle puis dans la première moitié du 20ème siècle une appellation régionale n’a pas pu émerger sur toute la partie méridionale largement consacrée aux « grands vins blancs » ? Pourquoi l’ancienne Prévoté royale de Barsac n’a pas été convoquée comme territoire viticole, comme ce fut le cas pour la Juridiction de Saint-Emilion ? Il ne s’agit pas de refaire par le menu l’itinéraire de l’appellation Sauternes mais de comprendre comment au sein de ce vaste ensemble régional, cinq communes ont pu ainsi s’isoler des autres. -

D'amécourt Sellier
> NOTRE ÉQUIPE DE CAMPAGNE LES RELAIS CANTONAUX : Jean-Claude DUCHAMPS, LADOS ● Jacques MATIGNON, RIMONS ● Marie-France WIEDENKELLER, SAINTE-FERME ● Baudouin FOURNIER, PINEUILH ● Lisette SAVARIAUD, LA RÉOLE ● Pierre TOMADA, SAUVETERRE DE GUYENNE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN : VICE-PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SOUTIEN Jean-Pierre CHALARD, José BLUTEAU, ancien conseiller général de SAINTE FOY LA GRANDE et Conseiller Général du canton de PELLEGRUE ancien maire de PINEUILH DIRECTEURS DE CAMPAGNE : NOS RÉUNIONS PUBLIQUES, À 20 H 00 : ● 19 Février, salle des fêtes de Coutures sur Drot, en présence d ‘Yves Foulon ,député de la Gironde ● 04 Mars, salle des conférences à La Réole, YVES Dr Anne BARNETT, AILLAS en présence de G. César, sénateur Bruno BELTRAMI, 1er adjoint à SAINTE FOY LA GRANDE ● 05 Mars, à 20h30, à Bazas, réunion départementale de Gironde Positive MANDATAIRES FINANCIERS : en présence d’Alain Juppé, Yves d ‘Amécourt SOPHIE D’AMÉCOURT et l ‘ensemble des candidats de la Gironde aux élections départementales Vu, les candidats - Imprimé sur papier de qualité écologique Ne pas jeter la voie publique. Vu, REMPLAÇANTS ● 11 Mars, salle des fêtes d’Auros, en présence de M-H. des Esgaulx, sénatrice SELLIER ● 12 Mars, salle des fêtes de Pineuilh, Martine et Guy RAMETTE, SIGALENS en présence de G. César, sénateur ● 18 Mars, salle Saint Romain à Sauveterre SUIVEZ NOTRE CAMPAGNE : de Guyenne, en présence de G. César, sellier-damecourt.girondepositive.fr sénateur Aline MARTIN André-Marc BARNETT Tél. 07 83 41 68 13 ● 20 Mars, salle des fêtes de Pellegrue, RÉOLAIS ET BASTIDES [email protected] en présence de G. César, sénateur et d’Alain Juppé www.facebook.com/Sellier-Damecourt Twitter : @yvesdamecourt Nom : Prénom : ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES Adresse : Code Postal : Commune : Téléphone : Mail : 22 ET 29 MARS 2015 Je souhaite faire partie du comité de soutien de Sophie Sellier et Yves d’Amécourt. -

Déchets Ménagers RÉDUIRE,TRIER,ECONOMISER [email protected] Edito
Tarifs 2014 & calendrier des collectes Déchets ménagers RÉDUIRE,TRIER,ECONOMISER [email protected] www.cc-podensac.fr Edito Philippe Meynard Président de la CDC Maire de Barsac, Conseiller Régional d’Aquitaine [email protected] 011, 2012, 2013 : 3 années de fonctionnement de la Redevance Incitative sur notre territoire. Et des résultats particulièrement positifs qui conduisent à une réduction importante de vos fac- 2tures si vous adoptez les gestes éco-citoyens élémentaires. Grâce aux efforts de tous, le coût de la part fixe n’est revalorisé cette année que du «coût de la vie». Il convient par vos efforts d’amoindrir le plus possible la part variable. Continuez à trier, à composter, à porter volontairement à la déchète- rie, dans les colonnes à verre, ou encore vos tissus dans les boxes «Le Relais» répartis sur l’ensemble du territoire. Toutes les informa- tions dans cette édition 2014 des tarifs et du fonctionnement du ser- vice de collecte des déchets ménagers. La réduction des déchets et le coût de leur traitement est l’affaire de chacun de nous. Nous savons pouvoir compter sur vous pour intensifier les efforts engagés. C’est bon pour votre porte-monnaie, c’est bon pour la planète et donc pour les enfants du territoire. Parce que justement le respect de l’Environnement est un long enseigne- ment, la CDC s’associe aux communes dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Des ateliers ludiques sont ainsi organisés. Nous demeurons attentifs à la qualité du service, et à votre parfaite information. -

Publication of a Communication of Approval of a Standard
29.7.2019 EN Official Journal of the European Union C 254/3 V (Announcements) OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Publication of a communication of approval of a standard amendment to the product specification for a name in the wine sector referred to in Article 17(2) and (3) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (2019/C 254/03) This notice is published in accordance with Article 17(5) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 (1). COMMUNICATION OF APPROVAL OF A STANDARD AMENDMENT ‘Haut-Médoc’ Reference number: PDO-FR-A0710-AM03 Date of communication: 10.4.2019 DESCRIPTION OF AND REASONS FOR THE APPROVED AMENDMENT 1. Demarcated parcel area Description and reasons This application includes the applications with reference PDO-FR-A0710-AM01 and PDO-FR-A0710-AM02, submit ted on 7 April 2016 and 12 January 2018, respectively. The following is inserted in chapter I, point IV(2) of the specification after the words ‘16 March 2007’: ‘ 28 September 2011, 11 September 2014, 9 June 2015, 8 June 2016, 23 November 2016 and 15 February 2018, and of its standing committee of 25 March 2014’. The purpose of this amendment is to add the dates on which the competent national authority approved changes to the demarcated parcel area within the geographical area of production. Parcels are demarcated by identifying the parcels within the geographical area of production that are suitable for producing the product covered by the regis tered designation of origin in question. Accordingly, as a r esult of this amendment, a new point (b) has been added -

Compte Rendu Du Conseil Municipal Du 4 Decembre 2019
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 DECEMBRE 2019 PRESENTS : MM. CHALARD, BELTRAMI, Mme GRANDET, Mme LAVOISIER, GOLFIER, Mme BASQUE, BIASOTTO, LAULHAU, LETELLIER, MAS, Mme MIGNON, Mme SELLIER DE BRUGIERE, M. VERTUEL EXCUSES : M. BORT (ayant donné procuration à D. Vertuel), Mme REGUESSE (ayant donné procuration à M. Letellier), M. TOMADA (ayant donné procuration à J Lavoisier) ABSENTS : Mme CHADOURNE, M. COURTADE, Mme WEISS Avant de débuter la séance, M. le Maire fait part au Conseil Municipal du décès de Madame LABORDE, épouse de Monsieur Pierre Laborde, ancien Conseiller Municipal. Il transmettra ses condoléances ainsi que celle du Conseil Municipal à la famille M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal si la lecture du compte rendu de la séance précédente appelle de leur part des observations. M. Mas, Conseiller Municipal s’abstiendra de voter car il était absent lors de cette séance. Toutefois, à la lecture du compte rendu, il a apprécié l’intervention des collègues, membres du Conseil Municipal, qui ont pointé certaines faiblesses de l’ORT. M. le Maire précise que l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) sera signée le 18 décembre 2019. M. le Maire demande aux membres du Conseil Municipal d’approuver le compte rendu de la séance précédente : Vote POUR : 15 Vote CONTRE : 0 ABSTENTION : 1 M. le Maire propose d’élire Madame Lavoisier en tant que secrétaire de séance. VOTE A L’UNANIMITE M. le Maire énonce les membres excusés et les membres absents. M. le Maire souhaite présenter 2 points supplémentaires à l’ordre du jour tel qu’il a été transmis : CONVENTION AVEC GIRONDE NUMERIQUE : M. -

La Liste Des Membres De La Commission Consultative
Membres de la commission consultative C1b Lot 1 : Bordeaux-Agen-Dax, Département SUD GIRONDE et vallée de la Garonne Nom Communes Intercommunalité AILLAS C.D.C DU PAYS D'AUROS ARBANATS C.D.C DU CANTON DE PODENSAC AUROS C.D.C DU PAYS D'AUROS BALIZAC C.D.C DU PAYS PAROUPIAN BARSAC C.D.C DU CANTON DE PODENSAC BAZAS C.D.C DU BAZADAIS BERNOS-BEAULAC C.D.C DU BAZADAIS BIEUJAC C.D.C DU PAYS DE LANGON BRANNENS C.D.C DU PAYS D'AUROS BUDOS C.D.C DU CANTON DE PODENSAC CAPTIEUX C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS CAZALIS C.D.C DU CANTON DE VILLANDRAUT COIMERES C.D.C DU PAYS DE LANGON CUDOS C.D.C DU BAZADAIS ESCAUDES C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS FARGUES C.D.C DU PAYS DE LANGON GISCOS C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS GOUALADE C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS ILLATS C.D.C DU CANTON DE PODENSAC LANDIRAS C.D.C DU CANTON DE PODENSAC LANGON C.D.C DU PAYS DE LANGON LARTIGUE C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS LE NIZAN C.D.C DU BAZADAIS LEOGEATS C.D.C DU PAYS DE LANGON LERM-ET-MUSSET C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS LIGNAN-DE-BAZAS C.D.C DU BAZADAIS LUCMAU C.D.C DU CANTON DE VILLANDRAUT MARIMBAULT C.D.C DU BAZADAIS MARIONS C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS MAZERES C.D.C DU PAYS DE LANGON NOAILLAC C.D.C DU REOLAIS NOAILLAN C.D.C DU CANTON DE VILLANDRAUT PONDAURAT C.D.C DU PAYS D'AUROS PORTETS C.D.C DU CANTON DE PODENSAC PRECHAC C.D.C DU CANTON DE VILLANDRAUT PREIGNAC C.D.C DU CANTON DE PODENSAC PUJOLS-SUR-CIRON C.D.C DU CANTON DE PODENSAC ROAILLAN C.D.C DU PAYS DE LANGON SAINT-LEGER-DE-BALSON C.D.C DU PAYS PAROUPIAN SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU C.D.C DE CAPTIEUX-GRIGNOLS SAINT-MICHEL-DE-RIEUFRET C.D.C DU -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of
L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

USTOM Du Castillonais Et Du Réolais – Rapport Annuel 2014 Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Public De La Gestion Des Déchets 2014
RAPPORT ANNUEL 2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE LA GESTION DES DECHETS USTOM du Castillonais et du Réolais – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets 2014 Le présent rapport, validé en Comité Syndical le 3 Juin 2015, a pour objet de rassembler et présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public de COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS Rapport établi conformément à la loi n° 95-101 du 2 Février 1995, dite loi Barnier et au décret d’application n°2000-404 du 11 Mai 2000 Ce rapport a été transmis à l’ensemble des maires des communes, et des Présidents des Communautés des Communes, membres du Syndicat, qui doivent en faire rapport à leurs conseils municipaux et communautaires. Le contenu de ce rapport doit être tenu à la disposition du public. 2 USTOM du Castillonais et du Réolais – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets 2014 Le mot du Président, Dès les résultats de l'élection entérinés, la nouvelle équipe dirigeante a travaillé sur les sujets principaux suivants : Axe 1 : La mise aux normes des sites de l’USTOM. Un audit technique et environnemental de tous les sites a été confié au Bureau d'Etudes IDE (31) par ordre de service le 28.10.14. Il devra déboucher sur des propositions de travaux et un plan pluriannuel d'investissement. Axe 2 : L’amélioration de la sécurité des sites, des agents et des usagers L'employeur est chargé d'assurer la sécurité de ses agents.