Tome XLI, No. 2
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
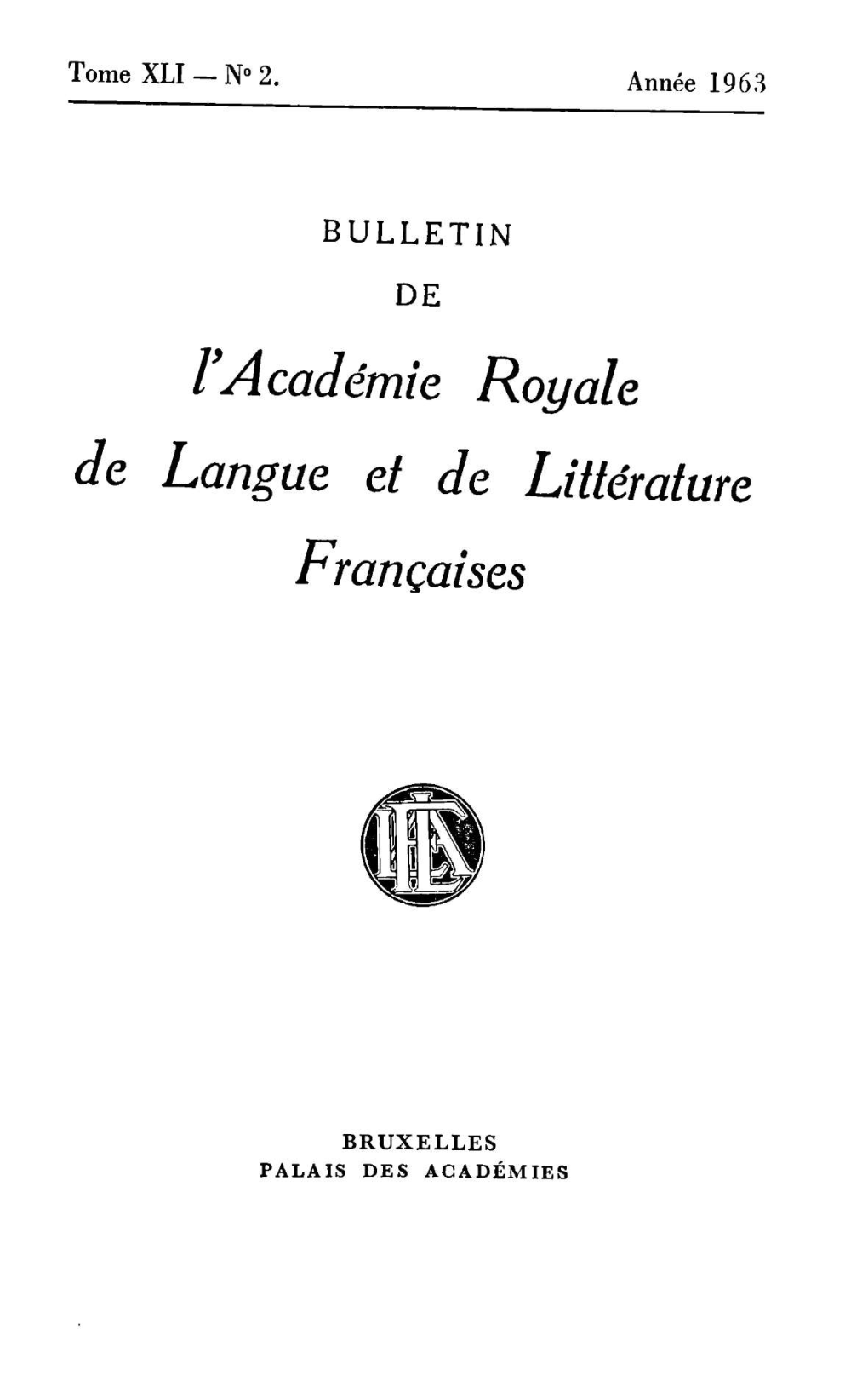
Load more
Recommended publications
-

Book Chapter Reference
Book Chapter The Geneva School: form and signification in motion POT, Olivier Reference POT, Olivier. The Geneva School: form and signification in motion. In: Marina Grishakova, M. & Salupere, S. Theoretical schools and circles in the twenthieth-century humanities. New York : Routledge, 2015. Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:78309 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 9 The Geneva School Time] in 1949. Toward the end of 1949, Raymond and Poulet embarked on a long correspondence reporting on and discussing their respective work. Form and Signification in Motion In 1950, the three names René Wellek (1992) associated with "The Geneva School" were Raymond (1897-1981), Béguin (1901-1957), and Poulet (1902-1991). Olivier Pot Later, two of Raymond's students, Jean Rousset (1910-2002) and Jean translated by Helena Taylor Starobinski (1920) joined this initial circle. Poulet, who from 1952 had taken up a post at Johns Hopkins University in Bàltimore, introduced Starobinski to the circle in 1954, and in the same year he became acquainted with Jean Rousset's thesis (Rousset 1953). Historians sometimes also add Poulet's doctoral student, Jean-Pierre Richard (1922; Richard 2002, 47-48) to this "The Geneva School" was the term used from the 1950s and 1960s to group. The term "Nouvelle critique"' appears for the first time in Poulet's describe a group of literary cri tics who belonged to the movement known in preface to Richard's book, Littérature et sensation published in 1954. In France as the Nouvelle Critique, following the confrontation between Picard 1956, Poulet accepted a chair in literature at Zurich University, probably and Barthes over Sur Racine in 1963. -

Reto Peter Speck, January 2010
Reto Peter Speck, February 2010 PhD (History), Queen Mary University of London The History and Politics of Civilisation: The Debate about Russia in French and German Historical Scholarship from Voltaire to Herder 1 Abstract During the second half of the 18th century, a debate about Russia developed in France and Germany. Spurred on by a preoccupation with Peter I’s project to swiftly civilise his country through Europeanisation, and by the evolving idea of a philosophic history with its concern to explain the historical process of civilisation in general, and Europe’s historical journey out of a state of barbarism in particular, an array of thinkers turned to the example of Russia with a set of interrelated historiographical and political questions: Does Russia share a history with Europe, and if so, how can its particular history be related to generalised accounts of the development of civilisation? What was the role of Peter I in fostering civilisation in Russia, and what political lessons can be learned from his reign? Can the historical process of civilisation be accelerated through willed, top- down reform and through wholesale importation of ideas and models from without as Peter attempted, or are there unsurpassable limits to such a project? The present thesis reconstructs this central Enlightenment debate, which has so far only received scant attention in modern scholarship, by providing an in-depth analysis of the relevant works of its main participants: Voltaire, Denis Diderot, Pierre Charles Levesque, August Ludwig Schlözer and Johann Gottfried Herder. By contextualising their Russian writings in terms of wider Enlightenment discourse on philosophic history and political reform, it seeks to recover the rich and conflicting nature of the debate about Russia. -

Bibliography Primary Sources Abbadie, Jacques
On the Spirit of Rights Dan Edelstein Published by the University of Chicago Press, 2018 Bibliography Primary Sources Abbadie, Jacques. Défense de la nation britannique, ou Les droits de Dieu, de la Nature, & de la Société clairement établis au sujet de la révolution d’Angleterre. The Hague, 1693. ———. Les Droits de Dieu, de la nature et des gens, tirés d’un livre de M. Abbadie intitulé: “Défense de la nation britannique . .” On y a ajouté un discours de M. Noodt sur les droits des souverains (traduit du latin par Barbeyrac). Amsterdam, 1775. ———. Traité de la vérité de la religion chretienne. Rotterdam: R. Leers, 1684. Académie française. Dictionnaire. Paris, 1694. ———. Dictionnaire. Paris, 1762. ———. Dictionnaire. Paris, 1798. Acta Sanctae Sedis. 41 vols. Rome, 1865–1908. http://www.vatican.va/archive/ass/index_en.htm. Adams, John. The Works of John Adams. 10 vols. Edited by Charles Francis Adams. Boston: Little, Brown, 1856. Adams, John, Samuel Adams, and James Warren. Warren-Adams Letters. Boston: Massachusetts Historical Society, 1917. Addison, Joseph. The Evidences of the Christian Religion. London: Tonson, 1733. ———. The Free-holder, Or Political Essays. London: D. Midwinter, 1716. All Canada in the Hands of the English. Boston: B. Mecom, 1760. Almain, Jacques. “A Book Concerning the Authority of the Church.” In Conciliarism and Papalism, edited by J. H. Burns and Thomas M. Izbicki, 134–200. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. Alsop, Vincent. A Reply to the Reverend Dean of St. Pauls’s Reflections on the Rector of Sutton, 1 &c. London, 1681. Annet, Peter. A Discourse on Government and Religion. Boston: Daniel Fowle, 1750. -

Goethe and Rousseau: Resonances of the Mind
University of Kentucky UKnowledge German Literature European Languages and Literatures 1973 Goethe and Rousseau: Resonances of the Mind Carl Hammer Jr. Texas Tech University Click here to let us know how access to this document benefits ou.y Thanks to the University of Kentucky Libraries and the University Press of Kentucky, this book is freely available to current faculty, students, and staff at the University of Kentucky. Find other University of Kentucky Books at uknowledge.uky.edu/upk. For more information, please contact UKnowledge at [email protected]. Recommended Citation Hammer, Carl Jr., "Goethe and Rousseau: Resonances of the Mind" (1973). German Literature. 3. https://uknowledge.uky.edu/upk_german_literature/3 GOETHE AND ROUSSEAU This page intentionally left blank Carl Hammer,Jr. GOETHE AND ROUSSEAU Resonances of the Mind THE UNIVERSITY PRESS OF KENTUCKY To my wife, Mae ISBN 978-0-8131-5260-8 Library of Congress Catalog Card Number: 72--91665 Copyright© 1973 by The University Press of Kentucky A statewide cooperative scholarly publishing agency serving Berea College, Centre College of Kentucky, Eastern Kentucky University, Georgetown College, Kentucky Historical Society, Kentucky State University, Morehead State University, Murray State University, Northern Kentucky State College, Transylvania University, University of Kentucky, University of Louisville, and Western Kentucky University. Editorial and Sales Offices: Lexington, Kentucky 40506 Contents Foreword vn Explanation of Page References vm Introduction 1 I The Cultural Background 10 II Jean-Jacques according to Goethe 32 III Literary Echoes from Four Decades 57 IV Memories and Memoirs 81 V Of Love and Marriage 107 VI Ideals of Culture 122 VII Utopian Visions 137 VIII God, Man, and Cosmos 151 Abbreviations of Titles Used in Notes and Bibliography 171 Notes 173 Selected Bibliography 191 Index 217 This page intentionally left blank Foreword The initial plan of the following study proposed a comparison of Die Wahlverwandtschaften with La Nouveiie Heloise. -

E-Ramuz Biblio
Bibliographie Bibliographies Bringolf Théophile, Bibliographie de l’œuvre de C. F. Ramuz , Lausanne, Mermod, 1942 ; réédition complétée par Jacques Verdan, Neuchâtel, La Baconnière, 1975. « Bibliographie », dans C. F. Ramuz, Romans , t. II, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 2005, p. 1777-1788. Œuvres complètes Œuvres complètes , Genève, Slatkine, à partir de 2005 : I. Journal , t. 1, 1895-1903. II. Journal , t. 2, 1904-1920. III. Journal , t. 3, 1921-1947. IV. Premiers écrits , textes inédits 1896-1903. V. Nouvelles et Morceaux , t. 1, 1904-1908. VI. Nouvelles et Morceaux , t. 2, 1908-1911. VII. Nouvelles et Morceaux , t. 3, 1912-1914. VIII. Nouvelles et Morceaux , t. 4, 1915-1921. IX. Nouvelles et Morceaux , t. 5, 1925-1947. X. Poésie et Théâtre. XI. Articles et Chroniques , t. 1, 1903-1912. XII. Articles et Chroniques , t. 2, 1913-1919. XIII. Articles et Chroniques , t. 3, 1924-1931. XIV. Articles et Chroniques , t. 4, 1932-1947. XV. Essais , t. 1, 1914-1918. XVI. Essais , t. 2, 1927-1935. XVII. Essais , t. 3, 1936-1943. Ouvrages parus du vivant de Ramuz Le Petit Village , Genève, Charles Eggimann, 1903. Aline , Paris, Perrin / Lausanne, Payot, 1905. La Grande Guerre du Sondrebond , Genève, Librairie A. Jullien, 1906. Les Circonstances de la vie , Paris, Perrin / Lausanne, Payot, 1907. Le Village dans la montagne , Lausanne, Payot, 1908. 1 Jean-Luc persécuté et deux autres histoires de la montagne , Paris, Perrin / Lausanne, Payot, 1909. Nouvelles et Morceaux , Lausanne, Payot, 1910. Aimé Pache, peintre vaudois , Paris, Arthème Fayard / Lausanne, Payot, 1911. Vie de Samuel Belet , Paris, Librairie Paul Ollendorff / Lausanne, Payot, 1913. -

Book Chapter Reference
Book Chapter L'Ecole de Genève? JEANNERET, Michel Reference JEANNERET, Michel. L'Ecole de Genève? In: Pichois, C. ; Fumaroli, M. & Menant, S. L'histoire littéraire hier, aujourd'hui et demain, ici et ailleurs. Paris : A. Colin, 1995. p. 54-64 Available at: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:23159 Disclaimer: layout of this document may differ from the published version. 1 / 1 L'ÉCOLE DE GENÈVE ? L'École de Genève est une invention de Georges Poulet. Dans les années trente, De Baudelaire au Surréalisme et L'Âme roman tique et le rêve 1 avaient été pour lui des phares. Il allait plus tard, par des relations personnelles et tout un réseau de correspondance, par des articles et des colloques, réunir, bon gré mal gré, une communauté de critiques autour du principe d'identification. Le critique établit avec l'œuvre une relation de sympathie, qui lui permet d'en dégager les enjeux existentiels : telle devait être, selon Poulet, le programme de l'École de Genève, qui réunirait, outre Marcel Raymond, Pierre Béguin et lui-même, Jean Rousset, Jean Starobinski et Jean-Pierre Richard. Mais Poulet ne voyait pas qu~ son initiative reposait sur un paradoxe. Car si une École suppose une méthode ou une doctrine commune, alors l'École de Genève est une aporie. Comment concilier en effet l'exigence d'engagement personnel, la part, considérable, de la subjectivité dans 1' acte critique et une quelconque allégeance à un système ? Le principe que Poulet plaçait au cœur de son École postule une totale disponibilité de l'esprit, une recherche sans contrainte, donc la liberté. -

Inventaire De L'ensemble De La Correspondance De
FONDS&GILBERT&TROLLIET& Centre&de&Recherches&sur&les&Lettres&Romandes&CRLR& CORRESPONDANCE& & & CORRESPONDANTS Nbre lettres Dates Commentaires (30.11.?) ABEILLE Odette 1 s.d. 1 lettre d’Odette ABEILLE à Gilbert TROLLIET 3 lettres de Gilbert TROLLIET à Raymond ABELLIO 5 lettres de Raymond ABELLIO à Gilbert TROLLIET 1 lettre de Raymond ABELLIO à Gilbert TROLLIET 1 lettre de Gilbert TROLLIET demandant l’adresse de Raymond ABELLIO Raymond 10 1954-1974 ABELLIO ACATOS Sylvio 9 1971-1975 9 lettres de Sylvio ACATOS à Gilbert TROLLIET 3 lettres de Arthur ADAMOV à Gilbert TROLLIET 1 lettre tps de Arthur ADAMOV à Gilbert TROLLIET 10 1 lettre tps de Gilbert TROLLIET à Arthur ADAMOV + 2 tps 5 lettres partiellement datées de Arthur ADAMOV à Gilbert poèmes TROLLIET ADAMOV Arthur d’Adamov 1931-1968 2 tps de poèmes d’ADAMOV ADOUT Jacques (de la SSR) 1 lettre de Jacques ADOUT à Gilbert TROLLIET 2 1971-1973 1 lettre de Jacques ADOUT à Gilbert TROLLIET AEBISCHER-CHAUDET Mme 1 carte de Mme B. AEBISCHER-CHAUDET à Gilbert B. 1 1973 TROLLIET 1 AEBLI Hans H. (Schweizerische avec 1 lettre de Hans H. AEBLI à Gilbert TROLLIET accompagnée Werbestelle für das Buch) documentation 1974 d’une “Dokumentation Schweizer Schriftsteller” AESCHLIMANN A. 1 1973 1 carte de A. AESCHLIMANN à Gilbert TROLLIET AESCHLIMANN C. 1 1965 1 lettre de C. AESCHLIMANN à Gilbert TROLLIET AESCHLIMANN Paul 1 1949 1 lettre de Paul AESCHLIMANN à Gilbert TROLLIET 1 lettre de Jacques W. AESCHLIMANN à Gilbert TROLLIET AESCHLIMANN Jacques W. 1 1973 (1973) AGUET William 3 1945-1954 3 lettres de William AGUET à Gilbert TROLLIET AJURIAGUERRA J. -

Register Mit Einer Einführung: Litera- Turpreise Als Literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand
Diskussionsbeiträge des SFB 619 »Ritualdynamik« der RuprechtRuprecht----KarlsKarlsKarls----UniversitätUniversität Heidelberg Herausgegeben von Dietrich Harth und Axel Michaels Nr. 12 Juni 2005 LITERATURPREISE Register mit einer Einführung: Litera- turpreise als literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand Burckhard Dücker Verena Neumann INHALT Vorwort 2 Burckhard Dücker: Literaturpreisverleihungen. Von der ritualisierten Ehrung zur Literaturgeschichte 1. Zur Aktualität von Literaturpreisverleihungen 4 2. Literatur und Literaturpreise: Zur Perspektive von Autoren 7 3. Zur Klassifikation von Literaturpreisen 9 4. Zur Inszenierung einer Literaturpreisverleihung 11 5. Zur Gedenkfunktion von Literaturpreisverleihungen 12 6. Literaturpreise als literaturgeschichtlicher Forschungsgegenstand 6.1 Literarische Ehrungen als Basis literaturgeschichtlicher Positionierung 13 6.2 Theorie und Methode 15 6.3 Preisverleihung: Konsensproklamation und Gabentausch 17 6.4 Literaturpreisverleihung und Literaturgeschichte 21 6.4.1 Material 24 6.4.2 Präsenz und Präsentation von Literatur 26 Literatur 31 Verena Neumann / Burckhard Dücker: Übersicht der registrierten Preise 35 Register der Preise 40 Register der Preisträger und ihrer Preise 212 1 Vorwort Die vorliegende Veröffentlichung versteht sich als Handreichung und Anregung für weiterführende Studien und wendet sich mit ihrem Infor- mations- und Methodenangebot auch an Gymnasien, Volkshochschulen und andere Einrichtungen im Bereich von Bildung und Weiterbildung. Entstanden ist sie im Rahmen des Heidelberger -

Die Literaturen Der Großregion Saar-Lor-Lux-Elsass in Geschichte Und Gegenwart
bogner_ringvorl_2_cover_breite_final:Layout 1 13.03.2012 15:29 Seite 1 Saarbrücker literaturwissenschaftliche Ringvorlesungen 2 t r a Die Literaturen der Großregion w n e g e Saar-Lor-Lux-Elsass G d n in Geschichte und Gegenwart u e t Die Großregion Saar-Lor-Lux-Elsass ist eine Literaturland - h c i schaft, aus der über die Jahrhunderte hinweg eine Fülle von h c herausragenden literarischen Leistungen hervorgegangen ist. s Herausgegeben von Sie reichen vom ‚Liber Evangeliorum‘ des Otfrid von Weißen - e G burg über Werke Johann Fischarts oder des lothringischen n i Autorenpaars Erckmann-Chatrian bis hin zu Ludwig Harigs s s Ralf Bogner autobiographischen Texten und zur neueren luxemburgischen a s Romandichtung. Alle diese Texte sind aus der Region hervor - l E gegangen und dennoch von der denkbar größten Vielfalt ge - - Manfred Leber x kennzeichnet. u L Die Literatur im Saar-Lor-Lux-Elsass-Raum ist nämlich die - r Literatur einer Region mit zahlreichen Grenzen – politischen, o L sprachlichen, kulturellen, ideologischen –, die sich zudem - r immer wieder stark verschoben haben. Demgemäß eröffnet a a sich hier ein außerordentlich spannungsreiches und inhomo - S genes Forschungsfeld für die Literaturwissenschaft, gerade n o i indem sie ihren Blick auf eine spezifische Region fokussiert. g e r ß o r G r e d n e r u t a r e t i L e i D universaar Universitätsverlag des Saarlandes Saarland University Press Presses Universitaires de la Sarre Saarbrücker literaturwissenschaftliche Ringvorlesungen 2 Ralf Bogner, Manfred Leber (Hg.) Die Literaturen -

La Littérature Romande Et Ses Contextes Monique Moser-Verrey
Document generated on 09/28/2021 1:40 p.m. Études françaises La littérature romande et ses contextes Monique Moser-Verrey Les leçons du manuscrit : questions de génétique textuelle Volume 28, Number 1, automne 1992 URI: https://id.erudit.org/iderudit/035874ar DOI: https://doi.org/10.7202/035874ar See table of contents Publisher(s) Les Presses de l'Université de Montréal ISSN 0014-2085 (print) 1492-1405 (digital) Explore this journal Cite this article Moser-Verrey, M. (1992). La littérature romande et ses contextes. Études françaises, 28(1), 173–188. https://doi.org/10.7202/035874ar Tous droits réservés © Les Presses de l'Université de Montréal, 1992 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ La littérature romande et ses contextes MONIQUE MOSER-VERREY À une époque où les cadres de référence idéologiques s'effondrent, où les aires d'influence économique et cultu- relle des grandes puissances s'estompent et où les frontières des nations vacillent, diverses littératures cherchent aussi à redéfinir leur place dans le monde. Au lendemain du 700e an- niversaire de la Confédération helvétique, il me semble parti- culièrement intéressant d'observer le cas de la littérature romande, car cet anniversaire a servi de prétexte à plusieurs publications qui proposent de nouvelles mises en contexte du corpus. -
![[Electronic Resource]. [Ipswich, MA] : EBSCO Pub](https://docslib.b-cdn.net/cover/4949/electronic-resource-ipswich-ma-ebsco-pub-7914949.webp)
[Electronic Resource]. [Ipswich, MA] : EBSCO Pub
Online database Regional business news [electronic resource]. [Ipswich, MA] : EBSCO Pub. Online database Studies in documentary film [electronic resource]. Bristol, UK : Intellect, c2007- Online Hollenstein, Tom. State Space Grids [electronic resource] : Depicting Dynamics Across Development / by Tom Hollenstein. Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 2013. 003.54 J713 Cover, T. M., 1938-2012. Elements of information theory / Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2006. 005.43 T155 Tanenbaum, Andrew S., 1944- Operating systems : design and implementation / Andrew S. Tanenbaum, Albert S. Woodhull. Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice Hall, c2006. 123. Suarez, Antoine. Is Science Compatible with Free Will? [electronic resource] : Exploring Free Will and Consciousness in the Light of Quantum Physics and Neuroscience /edited by Antoine Suarez, Peter Adams. New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer, 2013. 150.2 Prinstein, Mitchell J., 1970- The Portable Mentor [electronic resource] : Expert Guide to a Successful Career in Psychology / edited by Mitchell J. Prinstein. New York, NY : Springer New York : Imprint: Springer, 2013. 150.28 Benuto, Lorraine T. Guide to Psychological Assessment with Hispanics [electronic resource] / edited by Lorraine T. Benuto. Boston, MA : Springer US : Imprint: Springer, 2013. 150. Encyclopedia of human behavior [electronic resource] / editor-in-chief, V.S. Ramachandran. London ; Burlington, MA : Elsevier/Academic Press, 2012. 152.4 L25 Emotions, imagination, and moral reasoning / editors, Robyn Langdon, Catriona Mackenzie. New York, NY : Psychology Press, 2012. 152.41 B26 Baron-Cohen, Simon. Science of evil : on empathy and the origins of cruelty / Simon Baron- Cohen. New York : Basic Books, 2012, c2011. 15 Encyclopedia of the mind / editor-in-chief Harold Pashler, University of California at San Diego. -

1 Die Fenster Meiner Poesie Sind Weit Geöffnet Zur Strasse 2 Gesang Von
Inhalt 1 Die Fenster meiner Poesie sind weit geöffnet zur Strasse BJaise Cendrars | Robert Walser | Adolf Wölfli | Constance Schwartzlin-Berberat Hermann M. | Louis Soutter \ Walter Vogt \ Gertrud Wilker ] Paul Klee 9 2 Gesang von unserer Rhone Charles-Ferdinand Ramuz \ Maurice Chappaz | Rainer Maria Rilke | Louis Soutter Lorenzo Pestelli | Pierre Imhasly | Adolf Wölfli | Paul Haller | Carl Albert Loosli Beat Sterchi 33 3 Ein Mensch bricht entzwei Otto Nebel | Blaise Cendrars | Hugo Ball | Hans Arp | Adolf Wölfli | Marie von Fischer- von Sinner | Paul Klee | Aloise | Sonja Sekula \ Annemarie Schwarzenbach | Emmy Ball-Hennings | Hermann M. 49 4 Ich bin in dieser Schosshündchenstadt zum wedelnden Hundeli geworden Blaise Cendrars | Charles-Albert Cingria | Robert Walser | Ciaire Coli | Andreas Walser | Hans Morgenthaler | Aloise | Jeanne Natalie Wintsch | Rosa Marbach | Karl M. 71 5 Ich spucke auf die Schönheit Blaise Cendrars | Constance Schwartzlin-Berberat | Claude Aubert \ Hans Morgen thaler | Hermann Hesse | Robert Walser | Adolf Wölfli | Albin Zollinger | Kurt Marti 91 6 Der Wind möge mich verstreuen Georges Haidas | Charles-Albert Cingria \ Gustave Roud | Pierre-Louis Matthey Edmond-Henri Crisinel | Annemarie von Matt 103 7 Papierschlösser in Weiss Hermann Hesse | Louis Soutter | Jörg Steiner | Maurice Chappaz 117 8 Pflanze mich nicht in Dein Herz Werner Renfer | Francis Giauque \ Albin Zollinger | Alfonsina Storni | Meret Oppenheim | Annemarie von Matt 123 9 Der Hügel der finsteren Finsternis Emmy Ball-Hennings | Annemarie Schwarzenbach