Université Du Québec À Montréal
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
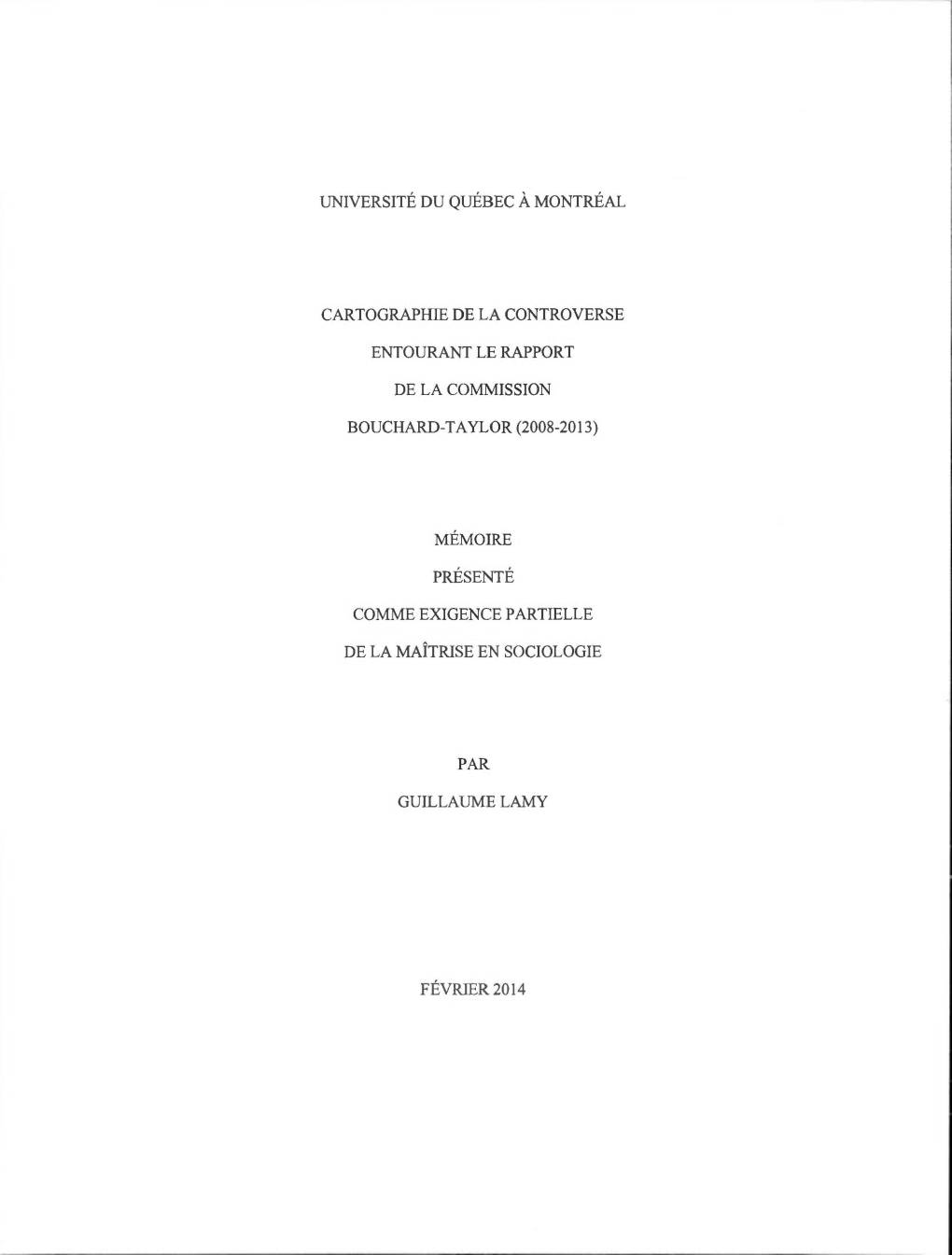
Load more
Recommended publications
-

The Reference on Quebec Secession : a Positive Impact for All
The Reference on Quebec Secession : a Positive Impact for All The Honourable Stéphane Dion 1 In September 2013, I travelled to Armenia, as a member of a parliamentary mission to investigate the situation of refugees fleeing the Syrian crisis. I was brought to Nagorno- Karabakh where the current government presented me with its statement of claim for international recognition of the territory as an independent State – even though it is also being claimed by Azerbaidjan. 2 On page 30 of the document, I found mention of the Reference on Quebec Secession 3 where it is pointed out that, according the Supreme Court of Canada, international law provides no legal foundation to unilateral secession in the context of a democracy but such a right might exist in another context. Based on that argument, and alleging that Azerbaijan is not a democracy, Nagorno-Karabakh calls on the international community to recognize it as a sovereign State. Few people realize how much of an international reference the unanimous August 20, 1998 Supreme Court ruling has become. In a world where almost all countries, including such great democracies as France or the USA, consider themselves as indivisible and where the notion of secession is often abhorred, the Supreme Court opinion seems very daring and liberal. The Court recognized the divisible character of the country. It accepted secession as a possibility but rejected the right to secede on demand. The Court also rejected the use of force or any form of violence. It emphasized clarity, legality, negotiation and justice for all. While the Court's opinion may appear idealistic to many nations, this is precisely because it sought to address, in an ideal manner, situations of breakup which are always complex and sensitive. -

Tuesday, March 23, 1999
CANADA 1st SESSION 36th PARLIAMENT VOLUME 137 NUMBER 123 OFFICIAL REPORT (HANSARD) Tuesday, March 23, 1999 THE HONOURABLE GILDAS L. MOLGAT SPEAKER CONTENTS (Daily index of proceedings appears at back of this issue.) Debates: Chambers Building, Room 943, Tel. 995-5805 Published by the Senate Available from Canada Communication Group — Publishing, Public Works and Government Services Canada, Ottawa K1A 0S9, Also available on the Internet: http://www.parl.gc.ca 2854 THE SENATE Tuesday, March 23, 1999 The Senate met at 2:00 p.m., the Speaker in the Chair. [English] Prayers. CANADIAN INTERCOLLEGIATE ATHLETIC UNION BASKETBALL CHAMPIONSHIPS 1999 VISITORS IN THE GALLERY CONGRATULATIONS TO SAINT MARY’S UNIVERSITY HUSKIES ON WINNING The Hon. the Speaker: Honourable senators, I should like to Hon. Wilfred P. Moore: Honourable senators, I rise today to draw to your attention some distinguished visitors in our gallery. make a statement in recognition of the achievement of the men’s They are the Honourable Joseph Sempe Lejaha, President of the varsity basketball team of Saint Mary’s University of Halifax, Senate of the Kingdom of Lesotho; and Honourable Ms Ntlhoi Nova Scotia. Motsamai, Deputy Speaker of the National Assembly of Lesotho. This past Sunday afternoon, the basketball Huskies, ranked Hon. Senators: Hear, hear! number seven in the nation, won the Canadian Intercollegiate Athletic Union championship in a thrilling 73-69 overtime victory over the number one ranked Alberta Golden Bears in a The Hon. the Speaker: On behalf of all senators, I bid you tournament played before a crowded Metro Centre in Halifax. welcome to the Senate of Canada. -

Bibliografía Y Fuentes De Información
Bibliografía y Fuentes de Información a. Bibliografía y Hemerografía Aldecoa, Francisco y Michael Keating Paradiplomacy in Action, Frank Cass Publishers, London, 1999 Allison, Graham The Essence of Decision, Harper Collins Publishers, Harvard University, 1971 Bakvis, Herman Federalism and the role of the State, University or Toronto Press, Canadá, 1987 Balthazar, Louis, “The other side of Canada-U.S. Relations” en English, John Making a Difference? Canada’s foreign policy in a changing world order, Lester Publishing Limited, Toronto 1992 Balthazar, Louis e Alfred O. Hero Jr. Le Québec dans l’espace américain, Éditions Québec Amérique e Université McGill, Montréal, 1999 Basset, Claude “Regional Governments as International Actors-A Germane Terminology” (borrador/no publicado), Institut Québécois des Hautes Études Internationales, Décembre 2000. Bélanger, Louis “Globalization, Culture and Foreign Policy: The Failure of ‘Third Pillarization’ in Canada”, International Journal of Canadian Studies, No. 22 Fall, 2000, International Council for Canadian Studies, Ottawa Blanchette, Arthur Canadian Foreign Policy 1945-2000 Major Documents and Speeches, The Golden Dog Press, Ottawa, 2000 Bonanate, Luigi "Siete tesis sobre la globalización", Este País, No. 87, junio 1998 Brown, Bernard Comparative Politics, 8th edition, Wadsworth Publishing Co., California 1996 Brown, Craig La historia ilustrada de Canadá, Fondo de Cultura Económica, México 1994 Boeckelman, Keith “Federal Systems in the Globla Economy: Research Issues” en Publius, Winter 1996, Volume 26, Number 1 Burgess, Katrina Nuevos Temas, Nuevos Actores, ITAM,1994 Burgess, Michael “The Federal Spirit as a Moral Basis to Canadian Federalism”, International Journal of Canadian Studies, No. 22 Fall, 2000, International Council for Canadian Studies, Ottawa Cameron, Maxwell y Maureen Appel Molot Democracy and Foreign Policy, Carleton University Press, Ontario 1995 Cameron, David y Richard Simeon “Intergovernmental Relations and Democratic Citizenship”, pre- publication format, CCDM, 1999 Camilleri, J. -

Non-Constitutional Measures As an Alternative to Constitutional Amendment: Post-Meech Lake and Charlottetown
Federalism-e: Volume 9 17 Non-Constitutional Measures as an Alternative to Constitutional Amendment: Post-Meech Lake and Charlottetown Jennifer Chisholm Dalhousie University Abstract The period spanning from the early 1980s to 1992 has been referred to as the era of constitutional federalism in Canada. One of the most significant events in Canadian history occurred on April 17, 1982, the patriation of the Canadian Constitution. Quebec did not sign the Constitution and for the following decade the country was dominated by the “high politics” of constitutional change. The Meech Lake Accord and the Charlottetown Accord respectively attempted to accommodate Quebec’s conditions for signing the document, however both failed. This paper describes the process and content of both Accords and the factors that led to their failure. It argues that Canada is better off due to the failure of these two proposed constitutional amendments. It also argues that subsequent non-constitutional measures introduced in the 1990s and 2000s have addressed many of the mega-constitutional concerns that these two accords attempted to tackle. The paper discusses some of the issues included in both Accords that have since been addressed through non-constitutional means, including: the recognition of Quebec as a distinct society; the federal government’s spending power; Aboriginal self- government; a veto for Quebec on certain constitutional amendments; and Senate reform. April 2008 Federalism-e: Volume 9 18 Introduction The period spanning from the early 1980s to 1992 has been referred to as the era of constitutional federalism in Canada. One of the most significant events in Canadian history occurred on April 17, 1982, the patriation of the Canadian Constitution. -

Government of Lucien Bouchard
QUÉ BEC'S POSITIONS ON CONSTITUTIONAL AND INTERGOVERNMENTAL ISSUES FROM 1936 TO MARCH 2001 GOVERNMENT OF the popular vote each time expressed LUCIEN BOUCHARD and that, each time, our democracy (JANUARY 29, 1996 TO MARCH 8, 2001) has grown in strength, our right to choose become that much stronger. [...] There is nothing more sacred in the democratic life of a people than its capacity to dispose of its own des- tiny. This is the very essence of their liberty.400 379.As a reaction to federal intervention in the Bertrand case, the Québec National Assembly adopted the fol- lowing resolution: “That the National Assembly reaffirm that the people of Daniel Lessard Québec are free to take charge of their own destiny, to define without ••• Status of Québec interference their political status and 377.In North America, Québec is the only to ensure their economic, social and society with a French-Speaking major- cultural development.”401 ity, a well-defined territorial base, and political institutions it controls. The 380.The only judge and jury on the future people of Québec possess all the tra- of Québec happens to be the people of ditional characteristics of a nation. Québec. No judge can stand in the [...] The Québec people subscribe to way of a people’s democratic expres- the democratic concept of a French- sion. The government of Québec will Speaking nation, pluralist in its culture, not go before the Supreme Court of and open to international immigration Canada regarding the federal govern- [...].399 ment’s Reference concerning the future of the Québec people. -
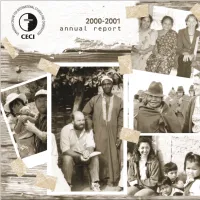
Annual Report
tribute to our volu n t e e r s To mark the invaluable contribution of volunteers to the welfare of humanity, in TABLE OF CONTENTS 1997 the United Nations General Assembly Message from the Chair and the Executive Director 2 decreed that 2001 would be the International Year of Volunteers. Continuity in our commitments 3 Decentralized offices 6 Financial statements 8 Americas Members of the Corporation and donors 12 Michelle Armand - Mathieu Asselin - Catherine Audet - Éric Audet - Marielle Bastien - Danielle Beaudoin - Anick Bernard Sylvie Bertrand - Stéphanie Bolduc - Christiane Bonneau Martin Boudreault - Jean-Guy Bourbonnais - Lise Bourque - André Bouvette - Mireille Brousseau - Franck Cabassu - Ian J.E. Cadieux - Emmanuelle Caron - France Carrière - Maria Cartagena - Patrice César - Marieke Cloutier - Stéphane Cover photos EDITING AND WRITING Cloutier - Gérard Côté - Zoé-Isabelle Côté - Julie Couët - Martin These pictures, all taken from Robert Hazel Couture - Jean Dahm - Catherine D’Anjou - Jean-François CECI’s photo library, show volun- Delorme-Lacasse - Sylvain Déry - Kim Descoteaux - Louise teers in action in developing CONTRIBUTIONS countries. Pierre Bellemare, Jocelyne Dallaire, Doucet - Marc Drouin - Guillaume Dufour - Éric Émond - Pierre Jean Despatie, Michael Gort, Farley - Mélany Faucher - Diane Fortier - Jean Fortin - Claude Roch Harvey and Luc Tremblay Gagné - Majorie Gagnon - Martin Gagnon - Anne Gallant Catherine Gauthier - Geneviève Gauthier - Anne-Marie Gervais TRANSLATION Mathieu Germain - Anne Gillespie - Annick Girard -

Understanding Cultural Difference Management Through Charles Taylor’S Philosophy: Case Studies from the Food Processing Industry
Adm. Sci. 2015, 5, 46–70; doi:10.3390/admsci5020046 OPEN ACCESS administrative sciences ISSN 2076-3387 www.mdpi.com/journal/admsci Article Understanding Cultural Difference Management through Charles Taylor’s Philosophy: Case Studies from the Food Processing Industry Samuel Marleau Ouellet 1,†,*, Joseph Facal 2,† and Louis Hébert 2,† 1 Department of Foreign Affairs, Trade and Development, Government of Canada, 125 Sussex Dr., Ottawa, ON K1A 0G2, Canada 2 Department of Management, HEC Montréal, 3000 Côte Ste-Catherine, Montréal, QC H3T 2A7, Canada; E-Mails: [email protected] (J.F.); [email protected] (L.H.) † Signature indicate personal opinion and do not represent official positions of the department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada or the Government of Canada. * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]. Academic Editor: Joseph Roberts Received: 30 December 2014 / Accepted: 21 April 2015 / Published: 28 April 2015 Abstract: In this paper, we use the work of the philosopher, Charles Taylor, to investigate the role of culture on internationalization decisions. Using parameters related to key constructs such as positive liberty, social ontology, expressivism, civic republicanism and common spaces, we look at how culture influences the decisions regarding corporate international expansion. This framework was applied in a multi-interview design in four firms from the food processing industry from France and Canada. Results showed an obvious sensitivity to cultural difference and that managerial practices surrounding this issue tended to be intuitive and emergent. These practices were not crystallized in the form of a conscious and deliberate organizational strategy for dealing with cultural difference when planning foreign market entry. -

DECEMBER 2004 – JANUARY 2005 Jean-Herman Guay
LE PARTI QUÉBÉCOIS : AU-DELÀ DU CONFLIT DES AMBITIONS Jean-Herman Guay Le Parti québécois est une formation qui nous a habitués aux disputes internes, mais cette fois, note Jean-Herman Guay, les tensions sont plus profondes. Cette situation s’explique par quatre facteurs conjoncturels : un leadership installé à la va-vite en 2001, une défaite électorale cuisante en 2003, la redéfinition de l’aile radicale et l’espoir sensé d’une victoire électorale au prochain scrutin. Mais surtout, écrit-il, elle traduit la difficulté pour ce parti de jongler avec les deux faces de la souveraineté. Celle-ci n’est pas seulement un projet à réaliser, mais également un outil et un symbole. Avant même d’être réalisée, la souveraineté a ainsi généré des changements palpables et continue d’en générer, ce qui peut expliquer les apparents paradoxes d’une opinion publique qui appuie le projet de souveraineté mais ne souhaite pas la tenue d’un nouveau référendum. Pour le PQ, ce qui est en cause présentement, c’est la possibilité de faire cohabiter ces deux visages. Et devant ce défi, tous les protagonistes font face aux mêmes six dilemmes pour lesquels il n’y a pas de solution facile. L’issue du prochain congrès et plus largement l’avenir du Parti québécois reposent sur la façon dont on les résoudra. The Parti Québécois has a history of internal disputes, but this time, notes Jean- Herman Guay, tensions are running deeper. There are four reasons for this: a quickly installed leadership in 2001, a stinging electoral defeat in 2003, the redefinition of the party’s radical wing, and a reasonable hope of winning the next election. -

Assemblée Nationale Du Québec
ASSEMBLÉE NATIONALE DEUXIÈME SESSION TRENTE-SIXIÈME LÉGISLATURE Journal des débats de l'Assemblée Le jeudi 6 décembre 2001 — Vol. 37 N° 67 Président de l'Assemblée nationale: M. Jean-Pierre Charbonneau QUÉBEC Abonnement annuel (TPS et TVQ en sus): Débats de l'Assemblée 145,00 $ Débats des commissions parlementaires 500,00 $ Pour une commission en particulier Commission de l'administration publique 75,00 $ Commission des affaires sociales 75,00 $ Commission de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation 25,00 $ Commission de l'aménagement du territoire 100,00 $ Commission de l'Assemblée nationale 5,00 $ Commission de la culture 25,00 $ Commission de l'économie et du travail 100,00 $ Commission de l'éducation 75,00 $ Commission des finances publiques 75,00 $ Commission des institutions 100,00 $ Commission des transports et de l'environnement 100,00 $ Index (une session. Assemblée et commissions) 15,00 $ Achat à l'unité: prix variable selon le nombre de pages. Règlement par chèque à l'ordre du ministre des Finances et adressé comme suit Assemblée nationale du Québec Distribution des documents parlementaires 880, autoroute Dufferin-Montmorency, bureau 195 Québec, Qc G1R5P3 Téléphone: (418)643-2754 Télécopieur (418) 528-0381 Consultation des travaux parlementaires de l'Assemblée ou des commissions parlementaires sur Internet à l'adresse suivante: www.assnat.qc.ca Société canadienne des postes — Envoi de publications canadiennes Numéro de convention: 0592269 Dépôt légal: Bibliothèque nationale du Québec ISSN 0823-0102 Débats de l'Assemblée nationale Le jeudi 6 décembre 2001 Table des matières Présence du secrétaire de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés des Etats-Unis mexicains, M. -

The Price of Electricity in Québec: Reconciling Conflicting Views1
03-Pineau2_Layout 1 12-08-21 19:53 Page45 THE PRICE OF ELECTRICITY IN QUÉBEC: RECONCILING CONFLICTING VIEWS 1 pierre-olivier pineau HEC Montréal The price of electricity is a subject of controversy. Seldom does a month go by without a political, social or research group (among others) making a public statement for or against a hike in electricity prices. There are less frequent requests for a reduction in the price of electricity, although such an option is feasible based strictly on the cost of generating electricity. More formally, the debate takes place every year when Hydro-Québec files its “Demande relative à l’établissement des tarifs d’électricité” (Request relating to the establishment of electricity rates) with the Régie de l’énergie 2. On this occasion, many stakeholders present their arguments with respect to proposals to revise the rates that have been tabled before this economic 1. The author thanks the two anonymous reviewers for their comments and suggestions, as well as Martin Pâquet and Stéphane Savard for their editorial work. 2. In 2008-2009, 15 stakeholders expressed an opinion about Hydro-Québec’s requested price increase : Association coopérative d’économie familiale de Québec, Association des redistributeurs d’électricité du Québec, Association patronale des entreprises en construction du Québec, Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec, Association québécoise des consommateurs industriels d’élec - tricité et Conseil de l’industrie forestière du Québec, Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John, Énergie Brookfield Marketing Inc., Fédération canadienne de l’entreprise indépendante, Groupe de recherche appliquée en macroécologie, Option consommateurs, Regroupement des organismes environ - nementaux en énergie, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec, Stratégies énergétiques et Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique, Union des consommateurs, Union des municipalités du Québec. -

Issn : 1496-9106
ISSN : 1496-9106 Public Management Reforms, Social Struc- tures and Collective Values : The Unusual Case of Quebec within Canada By : Joseph FACAL, Professeur invité, HEC Montreal Cahier de recherche N°: 06-02 September 2006 ______________________________________________________________________________ Copyright © 2006. HEC Montréal. All rights reserved for all countries. Any translation or alteration in any form whatsoever is prohibited. This document is intended to be used as the framework for an educationnal discussion and does not imply any judgement about the administrative situation presented. Tous droits réservés pour tous pays. Toute traduction ou toute modification sous quelque forme que ce soit est interdite. Les textes publiés dans la série des cahiers du CÉTO n’engagent que la responsabilité des auteurs. CETO, HEC Montréal, 3000 chemin de la Côte- Sainte-Catherine, Montréal (Québec) Canada H3T 2A7 TABLE OF CONTENTS 1. From “reengineering” to “modernization”: The tale of a forced landing............... 3 2. A modernization based on consultation and consensus ............................................ 7 3. What now?............................................................................................................... 16 References......................................................................................................................... 18 ___________________ 1 Copyright © HEC Montréal Public Management Reforms, Social Structures and Collective Values: The Unusual Case of Quebec within Canada PUBLIC MANAGEMENT -

Dans L'intimité Du Pouvoir
DOMINIQUE LEBEL DANS L’INTIMITÉ DU POUVOIR Journal politique 2012-2014 BORÉAL Les Éditions du Boréal 4447, rue Saint-Denis Montréal (Québec) h2j 2l2 www.editionsboreal.qc.ca DANS L’INTIMITÉ DU POUVOIR Dominique Lebel DANS L’INTIMITÉ DU POUVOIR Journal politique 2012-2014 Boréal © Les Éditions du Boréal 2016 Dépôt légal: 2e trimestre 2016 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Diffusion au Canada: Dimedia Diffusion et distribution en Europe: Volumen isbn papier 978-2-7646-2435-7 isbn pdf 978-2-7646-3435-6 isbn epub 978-2-7646-4335-5 Quand on est dans l’action, il n’y a pas d’immense déception. françois Mitterrand, Mémoires interrompus AVANT-PROPOS 9 avant-propos La politique et la vie Pendant presque deux ans, du 4 septembre 2012 à la défaite électorale du 7 avril 2014, j’ai vécu au même rythme que la première ministre du Québec, Pauline Marois. À ses côtés, j’ai connu les joies et les peines d’un gouvernement mino- ritaire déchiré entre sa volonté d’un jour réaliser l’indépen- dance du Québec et sa responsabilité quotidienne de ges- tion de l’État. Pendant presque deux ans, j’ai eu le privilège d’assister à toutes les réunions du Conseil des ministres, d’être un acteur et un témoin de toutes les rencontres stra- tégiques auxquelles a participé la première ministre, en plus de l’accompagner dans toutes les régions du Québec aussi bien qu’à Londres, Davos, Édimbourg et Mexico. Avec elle, j’ai vécu ses premiers moments comme première ministre, partagé le drame de Lac-Mégantic et les derniers jours de son gouvernement au terme d’une campagne électorale qui a marqué la fin de sa carrière politique.