Le Parti Des Communistes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
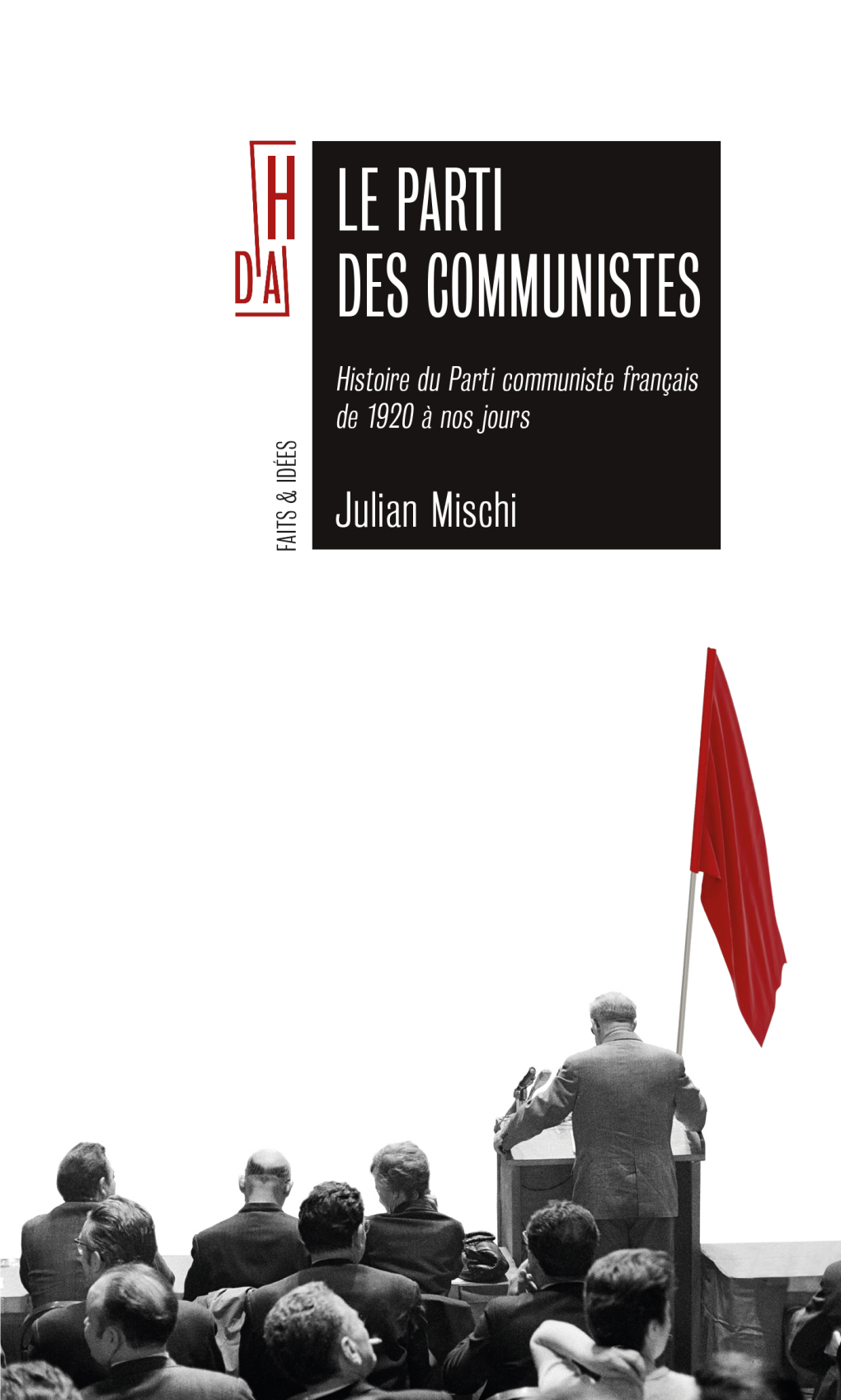
Load more
Recommended publications
-

French Women's Writing 1900-1938
Overlooked and Overshadowed: French Women’s Writing 1900-1938 Margaret Ann Victoria Goldswain Student No: 18550362 Bachelor of Arts (UNISA). Bachelor of Arts (UWA) Diploma in Modern Languages (French) (UWA) This thesis is presented for the degree of Doctor of Philosophy of the University of Western Australia School of Humanities (Discipline-French) 2014 ABSTRACT Overlooked and Overshadowed: French Women’s Writing 1900-1938 This study examines how women in France between 1900 and 1938 (before during and after the Great War) were represented in the writings of four selected women writers - Marcelle Tinayre (1870-1948), Colette Yver (1874-1953), Lucie Delarue-Mardrus (1874-1945) and Marcelle Capy (1891-1962). These authors, fêted in their time have now been largely excluded from contemporary studies on women in early twentieth-century France. The thesis demonstrates how their personal circumstances and the politico-social events of 1900-1938 influenced the way each writer represented women over time, and reveals that women’s writings were not homogenous in theme or in focus. By reading these texts alongside other contemporaneous texts (newspaper articles, reviews and writings by other women), the analyses show that Tinayre, Yver, Delarue-Madrus and Capy challenge and complicate stereotypical perspectives produced mainly by male authors of the same era. Using a longitudinal approach, the study explores each author’s selected texts across three distinct periods - the belle époque, the Great War and the inter-war. Such a reading makes it possible to assess changes in their writing in response to contemporary social and political events in France. By looking at four writers writing across the same era the diversity of women’s lives is also underlined. -

CHRONOLOGIE Mvt Ouvrier
© Association des Amis du Maitron 2002 Les Editions de l'Atelier CHRONOLOGIE INDICATIVE DE L'HISTOIRE DU MOUVEMENT OUVRIER FRANCAIS DE LA REVOLUTION FRANCAISE A LA FIN DES ANNEES 2000 par Stéphane Sirot, complétée par Michel Cordillot, René Lemarquis et Claude Pennetier 1864 - 1870 1871 - 1913 1914 - 1939 1940 - 1968 1969 - 2000 de 1789 à 1863 1791 2 mars . Loi d'Allarde supprimant les corporations et proclamant le principe de la liberté du travail, du commerce et de l'industrie. 22 mai et 14 juin . Lois Le Chapelier interdisant les coalitions de métiers et les grèves. 20 juillet . Interdiction de la concertation sur les salaires et les prix. 1792 20 juin . " Journée révolutionnaire " : les Sans-Culottes envahissent les Tuileries, le roi doit coiffer le bonnet rouge. 10 août . Les Sans-Culottes parisiens forment une commune insurrectionnelle. Le peuple investit les Tuileries et renverse le trône. 11 août . Établissement du suffrage universel. 8-9 septembre . Émeute ouvrière à Tours. Début décembre . Élections à la Commune de Paris : rôle essentiel de Jacques Roux, les " Enragés " apparaissent sur la scène politique. 1793 6 avril . Création du Comité de salut public. 24 mai . Arrestation de l' " Enragé " Jacques Hébert. 31 mai-2 juin . Insurrection parisienne contre les Girondins. 27 juillet . Maximilien Robespierre entre au Comité de salut public. 5 septembre . Jacques Roux, le chef des " Enragés ", est arrêté après une manifestation des Sans-Culottes parisiens. 1794 10 février . Suicide de Jacques Roux dans sa prison. 13 mars . Arrestation de Jacques Hébert et de ses amis. 24 mars . Fin du procès des hébertistes. Exécution des principaux militants Sans-Culottes dont Jacques Hébert et Antoine François Momoro. -

Labour Movements and Strikes, Social Conflict and Control, Protest and Repression (France)
Version 1.0 | Last updated 08 January 2017 Labour Movements and Strikes, Social Conflict and Control, Protest and Repression (France) By Galit Haddad This article examines the institutional shake-up of the French labour movement during WW1. The movement underwent an internal rupture and faced a new reality with the outburst of the total and long conflict. A second aim of this article is to show how the proletarian experience changed under war conditions. Female and male workers suddenly became instrumental in the war effort, encountering harsh living conditions while having their demonstrations violently repressed. Table of Contents 1 Introduction 2 The French Labour Movement Facing the War 2.1 From Acceptance to Refusal 2.2 The Russian Revolution and the Stockholm Conference: New Hope for Peace? 3 The Workers’ Experience: Crises, Strikes, and Repression 3.1 Women in Action: Social Strikes 3.2 The 1918 Pacifist Strikes Notes Selected Bibliography Citation Introduction The sudden outburst of the war in summer 1914 shook up many pre-war social and political Labour Movements and Strikes, Social Conflict and Control, Protest and Repressio - 1914-1918-Online 1/11 structures. One of these was the French labour movement, which was strongly affected by the general mobilisation and the sudden transition to wartime economy. In French historiography, the first studies of the labour movement during the Great War date from the 1960s and were conducted by a generation of historians who looked primarily into the movement’s political dimensions. These historians examined the changes that took place in different branches of the labour movement: socialists, syndicalists, and anarchists. -

Le Pacifisme Des Instituteurs Et Des Institutrices Syndicalistes Pendant La 1Ère Guerre Mondiale
Le pacifisme des instituteurs et des institutrices syndicalistes pendant la 1ère Guerre mondiale Pierre Monatte a pu écrire de la Fédération nationale des syndicats d’instituteurs et d’institutrices (FNSI) qu’elle avait été, au sein de la CGT, la seule fédération « restée fidèle durant la guerre à l’internationalisme ouvrier ». Ce ne fut cependant qu’à sa conférence nationale d’août 1915 que la FNSI adopta une orientation résolument pacifiste et internationaliste, Hélène Brion et Fernand Loriot, les deux seuls membres du bureau fédéral restés à Paris et partisans, dans un premier temps, de la politique de « défense nationale ». Mais certains syndicats de la Fédération demeurèrent « jusqu’auboutistes », et le pacifisme des instituteurs et des institutrices syndiqués n’était pas monolithique. Des divergences apparurent au sein de cette « majorité fédérale », en particulier quand il fallut déterminer si L’Ecole, l’organe de la Fédération, devait publier les articles de ces syndiqués partisans de l’union sacrée. Ces divergences n’empêchèrent pas ces instituteurs et d’institutrices, un peu plus de 100, d’occuper une place déterminante dans la mouvance pacifiste. Les historiens, et en particulier Christophe Prochasson n’ont pas manqué de relever le « rôle nouveau » tenu par ces « petits intellectuels » pendant la guerre. Il n’échappa pas non plus aux gouvernements. Au printemps 1917, les militants de la Fédération devinrent les cibles privilégiées de la répression qui s’en prit aux pacifistes avant même l’avènement du gouvernement Clemenceau. Les sanctions administratives, les révocations et les condamnations se multiplièrent en 1918, l’année qui, par ailleurs, vit se disloquer la minorité de la CGT. -

Communism and Social Democracy Part Ii
COMMUNISM AND SOCIAL DEMOCRACY PART II VOL. IV—2 G A HISTORY OF SOCIALIST THOUGHT: Volume IV, Part II COMMUNISM AND SOCIAL DEMOCRACY 1914-1931 BY G. D. H. COLE LONDON MACMILLAN & CO LTD NEW YORK • ST MARTIN’S PRESS 1961 Copyright © G. D. H. Cole 1958 First Edition 1958 Reprinted 1961 MACMILLAN AND COMPANY LIMITED London Bombay Calcutta Madras Melbourne THE MACMILLAN COMPANY OF CANADA LIMITED Toronto ST MARTIN’S PRESS INC Neiv York PRINTED IN GREAT BRITAIN CONTENTS PART II PAGE T h e P r in c i p a l C h a r a c t e r s v ii CHAP. X III. F r a n c e , 1914-1931 4 5 7 XIV. Belgium and Switzerland 500 XV. Holland, Scandinavia, and Finland 512 X VI. Spain and Portugal 535 X V II. Russia from t h e N e w Economic Policy to t h e F iv e - y e a r P l a n 554 X V III. The Ukraine 605 XIX. P o l a n d , 1914-1931 615 XX. The Weimar Republic, 1922-193 i 630 X X I. Great Britain to the Fall of the Second L a b o u r G o v e r n m e n t , 1 9 2 6 -1 9 3 1 667 XXII. The Battle of the Internationals, 1922-1931 680 XXIII. The United States : Canada 715 XXIV. L a t i n A m e r ic a , 1914-1931 750 XXV. The Rise, Fall, and Renaissance o f C o m munism in China 775 XXVI. -

Connections Between Civilian and Military Dissidence During the French Crisis of 1917 by Cora J
“The Worst Winds of Revolt”: Connections Between Civilian and Military Dissidence During the French Crisis of 1917 by Cora Jackson Bachelor of Arts, University of New Brunswick, 2018 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the Graduate Academic Unit of History Supervisor: Sean Kennedy, PhD, History Examining Board: Sarah-Jane Corke, PhD, History, Chair Lisa M. Todd, PhD, History Matthew Sears, PhD, Classics and Ancient History This thesis is accepted by the Dean of Graduate Studies THE UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK May 2020 ©Cora Jackson, 2020 ABSTRACT This thesis, rooted in the fields of social, cultural, and military history, examines connections and correlations between civilian and military dissidence during the French Crisis of 1917. Previous studies on the Crisis have isolated moments of unrest on the home-front from those occurring on the Western Front, which has in turn created a significant gap in historiography and in popular memory. This research seeks to complicate the narrative of the Crisis by connecting mutinies in the French Army on the Western Front to labour actions at home, arguing that both movements are key to a better understanding of civil-military relations in France during the Great War. This thesis explores their shared motivations and further analyses the ways in which soldiers and civilians shaped, influenced, and legitimized each other’s dissent in an effort to reclaim their political voice from their war-time state. ii DEDICATION To the strikers and mutineers. Vive la Révolution. iii ACKNOWLEDGEMENTS The completion of this thesis is due in large part to all the wonderful people who have supported and encouraged me over the past two years. -

N86 Des "Cahiers Du Mouvement Ouvrier"
Cahiers du mouvement ouvrier NAISSANCE DES SECTIONS FRANÇAISE ET ITALIENNE DE LA TROISIEME INTERNATIONALE DES DOCUMENTS INEDITS OU RARES, EN PARTICULIER Le conflit catalan et les tâches du prolétariat (1934), DE LEON TROTSKY N° 86 – 1er NUMERO EXCLUSIVEMENT EN LIGNE – Février 2021 1 Cahiers du mouvement ouvrier Fondés par Jean-Jacques Marie et Vadim Rogovine. Assistant pour la partie russe et soviétique : Marc Goloviznine, collaborateur scientifique de l’Institut de sociologie de l’Académie des sciences de Russie Directeur de la publication : Jean-Jacques Marie. Comité de rédaction : Nicole Bossut-Perron, Odile Dauphin, Katia Dorey, Marc Golozivine, Colette Hublet, Frank La Brasca, Claudie Lescot, Jean-Jacques Marie, Jacqueline Trinquet. Publié par Le Cercle des Cahiers du mouvement ouvrier c/O Jean-Jacques Marie – Bâtiment Les Charmes 36, rue de Picpus – 75012 Paris. Adresse mail : [email protected] www.cahiersdumouvementouvrier.org 2 SOMMAIRE Présentation p. 5 DOCUMENTS INEDITS … de Lénine p. 6 – Lettre à l’émir d’Afghanistan Amanoulah-Khan’ (novembre 1919). … de Trotsky p. 8 – Lettre de démission du bureau politique (5 juillet 1919) et réponse collective, signée Lénine, Kamenev, Krestinski, Kalinine, Serebriakov, Staline et Stassova. – La contre-révolution agonisante. p. 10 … de Staline p. 12 – La Guépéou n’est pas une boîte postale. Télégramme adressé aux camarades Iagoda et Evdokimov (8 décembre 1929). ——– Lev Zadov, de Makhno au NKVD puis au peloton d’exécution, p. 13 par Jean-Jacques Marie. ——– LE CONFLIT CATALAN ET LES TÂCHES DU PROLETARIAT Présentation p. 16 Le conflit catalan et les tâches du prolétariat (1934), de Léon Trotsky. p. 18 Présentation du document par Pelai Pagès. -

FJJ Les Notes 42
Les Notes de la Fondation Jean-Jaurès Histoire et Mémoire Le premier communisme français (1917-1925) Un homme nouveau pour régénérer le socialisme Par Romain Ducoulombier Préface de Alain Bergounioux N°42 - août 2004 LES NOTES DE LA FONDATION JEAN-JAURÈS - HISTOIRE ET MÉMOIRE - N° 42 - AOÛT 2004 - 1 LE PREMIER COMMUNISME FRANÇAIS (1917-1925) Les membres du Comité de lecture • Alain Bergounioux, historien et président de L’OURS ; Préface • Noëlline Castagnez-Ruggiu, docteur en histoire – Professeur à l'IUFM de Versailles ; • Fabrice d’Almeida, docteur en histoire, maître de conférences à l’Université Paris X-Nanterre ; • Jean-William Dereymez, docteur en science politique, maître de conférences à l’IEP de Grenoble ; • Frank Georgi, docteur en histoire, maître de conférences à l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne, chercheur associé au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (CHS-XXe siècle) ; • Hélène Hatzfeld, Professeur à l'Ecole d'architecture de Lyon ; • Marc Lazar, Professeur des Universités et directeur de l’Ecole doctorale de l’IEP de Paris, enseignant-chercheur au Centre d’études et de recherches internationales (CERI) ; • Gilles Morin, docteur en histoire, chercheur associé au CHS- ourquoi avoir attribué le Prix d’his- XXe siècle et à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP). toire 2003 de la Fondation Jean- Jaurès à un mémoire qui traite de “ l’ascétisme révolutionnaire ” et de “ la figure de l’homme nouveau pro- létarien dans le premier commu- nisme français ”P ? Les finalités de ce prix, en effet, sont plutôt de cou- Cette Note constitue la version remaniée de notre travail de DEA, ronner des travaux jetant une lumière nouvelle sur le socialisme fran- soutenu en 2002. -

Lev Trotsky a Parigi Durante La Prima Guerra Mondiale1
Alfred Rosmer LEV TROTSKY A PARIGI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE1 (11 luglio 1950) 1 Questi ricordi di Alfred Griot detto A. Rosmer (1877-1964) sul soggiorno parigino di Lev Trotsky ‒ che durò poco meno di due anni, dal novembre 1914 al settembre 1916 ‒ furono originariamente scritti, in vista del decimo anniversario dell’assassinio del fondatore dell’Armata Rossa, per la rivista teorica dell’organizzazione statunitense capeggiata da Max Shachtman: «Trotsky in Paris During World War I. Recollections of a Comrade and Co-Worker», The New International. An organ of revolutionary Marxism, vol. XVI, n. 5 (143), settembre- ottobre 1950, pp 263-278, dove il testo è privo dei titoletti intermedi e reca la data: Parigi, 11 luglio 1950. La sua versione originale in lingua francese, con i titoletti ma priva della data, venne pubblicata di lì a poco sulle pagine de La Révolution Prolétarienne. Revue syndicaliste révolutionnaire, a. XIX, n. 344 (Nuova serie, n. 43), ottobre 1950, pp. 1-8. La presente traduzione italiana, curata da Paolo Casciola, si basa sul testo francese. A proposito dell’attività di Trotsky durante il conflitto, fondamentale è il lavoro di Ian Dennis Thatcher, Leon Trotsky and World War One. August 1914-February 1917, Macmillan, Basingstoke 2000. Per un inquadramento storico-politico più generale del periodo si rinvia soprattutto ad Alfred Rosmer, Il movimento operaio alle porte della Prima guerra mondiale. Dall’unione sacra a Zimmerwald, Jaca Book, Milano 1979 [N.d.r.]. 1 Alfred Rosmer LEV TROTSKY A PARIGI DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE Fu all’inizio della Prima guerra mondiale, e nel corso di quel conflitto, che noi entrammo in contatto con diversi socialisti russi, e in particolare con Trotsky. -

From Lenin to Stalin •
Victor Serge • FROM LENIN TO STALIN • Tramlated from the French By RALPH MANHEIM PIONEER PUBLISHERS NEW YORK Copyright 1937 PIONEER PUBLISHERS 100 Fifth Avenue New York, N. Y. ~8S PRINTED IN THE UNITED STATES OF AMERICA FROM LENIN TO STALIN A Note About The Author Victor Serge (Victor Lvovich Kibalchich) was born in Brussels on December 30, 1890, of parents who were Russian revolutionary emigres. His father had been an officer and later a physician, and was a sympathizer of the Narodnaya Volya (People's Will) party. One of his relatives, a chemist belonging to this party, was hanged in 1881 after the assassination of Tsar Alexander II. Serge's childhood was spent in Belgium and England. One of his younger brothers died of want. At fifteen he was apprenticed to a photographer in Brussels. Later he became successively a photog rapher, a draughtsman, an office worker, a linotype operator-after he had learned the trade in anarchist print shops-a journalist and a translator .... At fifteen, he became a member of the socialist Jeune Garde in Ixelles; then a militant member of the Groupe Revolution naire in Brussels. He contributed to the Temps Nouveaux, Liber taire and Gz;erre Sociale. He took part in demonstrations and trials. He spent some time in company villages in the north of France and took part in militant activity in Paris. Editor of l'Anarchie in 1910, during the period of illegality, he was arrested and called on to denounce the members of the underground group, of whom several killed themselves and others died on the guillotine. -
Aux Origines Du Parti Communiste En Anjou
Aux origines du Parti communiste en Anjou 2 - 1919-1920 Deux années de luttes revendicatives et politiques et de débats sur l’adhésion à l’Internationale communiste Frédéric DABOUIS Les Cahiers du CESA / Cercle d’Etudes Sociales Angevin - n° 11 - Novembre 2018 LEXIQUE / INDEX DES SIGLES Certains mots ou certaines expressions pouvant être ambigües, j’ai préféré les expliciter ci- dessous, aux côtés de la liste des sigles les plus courants utilisés dans ce cahier. ADML : Archives départementales de Maine-et-Loire. ARAC : Association Républicaine des Anciens Combattants (fondée en 1917). Bolchéviques (ou bolchéviks) : tendance du Parti Ouvrier Social-Démocrate de Russie animée par Lénine. Bourse du Travail : siège des syndicats, souvent dans un local municipal. La Bourse du Travail de Cholet date de 1891, celle d’Angers de 1892. CAP : Commission administrative permanente (organe exécutif du Parti socialiste SFIO). CCN : Comité Confédéral National (parlement de la CGT, composé des représentants des Fédérations professionnelles et des Unions départementales). CGT : Confédération Générale du Travail (fondée en 1895). Chômer : faire grève. Classe ouvrière : ensemble des travailleurs salariés, comprenant les ouvriers proprement dits, mais aussi les employés, techniciens, ingénieurs, etc., qui participent au processus de production. CRRI : Comité pour la Reprise des Relations Internationales (entre syndicats et partis socialistes des pays en guerre), fondé en novembre 1915. FNSI : Fédération Nationale des Syndicats d’Instituteurs (fondée en 1905). FSMEL (ou FMEL) : Fédération des Syndicats des Membres de l’Enseignement Laïque (nouveau nom de la FNSI à partir de 1919, suite à l’élargissement de la FNSI à tous les degrés de l’enseignement). FSI : Fédération Syndicale Internationale dont le siège est à Amsterdam. -

Gender Equality Zita Gurmai
N°02 / 2010 THE NEXT WAVE OF EMANCIPATION Magazine by FEPS - Foundation for European Progressive Studies www.feps-europe.eu/queries 1 About Queries Isaac Newton’s famous book Opticks concludes with a set of “Queries”. These Queries are not questions in the ordinary sense, but rather rhetorical questions intended to stimulate thinking. This was Newton’s mode of explaining “by query”. N°02 / 2010 GENDER SENSITIVE, PROGRESSIVE EUROPE Inside 8 Putting equality in the heart of the next Europe’s agenda Ernst Stetter 10 The next wave of emancipation Judit Tánczos 14 Social democracy and gender equality Zita Gurmai A COMMITMENT THAT ARISES FROM A CENTURY STRUGGLE 34 European social democracy and women Ghislaine Toutain 53 Gender and the British Labour Party Pat Thane 65 Gender and social democracy in Germany Christa Randzio-Plath 4 STRONGER FROM THE PAST, ENCOURAGING EXPERIENCES “Queries” is the scientific magazine of the Foundation for European 80 Gender equality policies Progressive Studies. in Spain The Foundation for European Progressive Studies is a European progressive political foundation, close to the Party of European Soledad Ruiz-Seguín and Marta Plaza Socialists (PES). As a platform for ideas, FEPS works in a close collaboration with social democratic organizations, and in particular 101 An ongoing challenge for Sweden - national foundations and think tanks, to tackle the challenges that one of the most equal countries Europe faces today. Publisher: FEPS – Foundation for European Progressive Studies Ylva Johansson First published in Belgium 2010 Publishing supervisor: Dr. Ernst Stetter (Secretary General – FEPS) Managing Editor of Queries: Dr. Ania Skrzypek (Policy Advisor – FEPS) THE NEXT AGENDA FOR A CHANGING With the financial support of the European Parliament.