Resumen Abstract
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Annual Report and Accounts 2018
ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS 2018 1 TABLE OF CONTENTS Message from the Chairman .................................................................................................... 4 Nature of the Report ................................................................................................................ 7 i. Metropolitano de Lisboa Group ........................................................................................ 8 1. Organization’s profile ...................................................................................................................... 8 2. Mission, Vision and Values ............................................................................................................ 10 3. Corporate Bodies ........................................................................................................................... 12 4. Management Policies and Mechanisms ........................................................................................ 14 ii. The Metropolitano de Lisboa’s Activity ........................................................................... 17 1. Macroeconomic Framework ......................................................................................................... 17 2. Passenger Transport Service ......................................................................................................... 27 3. Other activities .............................................................................................................................. 33 4. ML’s -

Universidade De Lisboa Faculdade De Belas-Artes
UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE BELAS-ARTES DA CIDADE AO MUSEU E DO MUSEU À CIDADE: UMA PROPOSTA DE ITINERÁRIO PELA AZULEJARIA DE AUTOR NA LISBOA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX ANA CLÁUDIA VESPEIRA DE ALMEIDA MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA 2009 UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE BELAS-ARTES DA CIDADE AO MUSEU E DO MUSEU À CIDADE: UMA PROPOSTA DE ITINERÁRIO PELA AZULEJARIA DE AUTOR NA LISBOA DA SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX ANA CLÁUDIA VESPEIRA DE ALMEIDA MESTRADO EM MUSEOLOGIA E MUSEOGRAFIA DISSERTAÇÃO ORIENTADA PELA PROFª. DOUTORA LUÍSA CAPUCHO ARRUDA 2009 RESUMO Esta dissertação - Da Cidade ao Museu e do Museu à Cidade - consiste num projecto de exposição temporária a realizar no Museu Nacional do Azulejo, tendo como base a identificação prévia de núcleos azulejares da segunda metade do século XX inscritos na cidade de Lisboa. Esta exposição encontra-se organizada em quatro núcleos: o Núcleo I corresponde às obras em azulejo incluídas no espaço da Avenida Infante Santo; o Núcleo II abarca algumas intervenções de menção existentes nas estações do Metropolitano de Lisboa; o Núcleo III respeita às obras em suporte cerâmico do Parque das Nações e o Núcleo IV concerne a outras Obras de Referência que marcaram a cidade mas que não apresentam uma relação geográfica de proximidade. Todas as obras cerâmicas que integram os núcleos, como elementos de Arte Pública, encontram-se acessíveis a todos os cidadãos com uma marca autoral forte e constituem obras de referência no campo da azulejaria dos principais artistas portugueses. O principal objectivo da exposição é causar um efeito de proximidade no visitante para assim o manter sempre consciente do lugar de contexto dos revestimentos cerâmicos evocados e promover a sua observação in situ, ou seja remetê-lo de novo para o espaço da cidade. -

Bilhete Turístico De Lisboa | CP
ESCOLHA O SEU TÍTULO DE TRANSPORTE / CHOOSE YOUR TICKET BILHETE TRAIN & BUS CASCAIS E SINTRA / BILHETE FAMÍLIA & AMIGOS / BILHETE TURÍSTICO / TOURIST TRAVELCARD TRAIN & BUS TRAVELCARD CASCAIS E SINTRA FAMILY & FRIENDS TICKET Válido para 1 ou 3 dias (24 ou 72 horas consecutivas), para Válido entre Rossio / Sintra, Cais do Sodré / Cascais, Para viagens conjuntas de 3 a 9 pessoas, aos fins de semana um número ilimitado de viagens nos comboios das Linhas Alcântara - Terra / Oriente e nos autocarros da Scotturb, e feriados nacionais. de Sintra/Azambuja, Cascais e Sado, após validação. exceto BusCas e Giro. For 3-to-9-person trips, on weekends and national holiday. Valid for 1 day or 3 days in a row (24 or 72 hours) Valid between Rossio / Sintra, Cais do Sodré / Cascais, for unlimited travel on the Sintra/Azambuja, Cascais Alcântara - Terra / Oriente and Scotturb buses, except BusCas and Sado line trains. and Giro. All tickets must be validated before they can be used. ZAPPING BILHETE 10 VIAGENS / 10 TRIPS TICKET O carregamento de outros títulos de transporte no cartão do Bilhete Turístico, não é possível enquanto este Carregamentos em dinheiro para viajar de Comboio (CP), Metro, Preço mais económico, num determinado percurso escolhido. estiver válido. Autocarro (Carris) e Barco, sendo descontado o custo da viagem em cada utilização. A more economical price in a specific chosen route. You cannot load other tickets onto the Travelcard while it is still valid. Cash loading to travel by Train (CP), Subway, Bus (Carris) and Boat will be deducted when the card is validated in the different transport Válido apenas para o comboio. -

IN ASSOCIATION with CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA out There out There Beginner’S Survival Guide
IN ASSOCIATION WITH CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA Out there Out there Beginner’s survival guide Greet people with two kisses, forget the high heels, dodge the queues and bypass restaurants with food pictures by the front door. Here are our best tips to avoid tourist traps. You’re welcome. We speak the metro network, Don’t take just a creation is tricky terrain, have we been English whether you want risks: book to lure tourists with the city’s duped? As a rule of (and a bit to take a train or a table in. Creative, famous seven thumb, if the menu of everything an elevator – you’ll The recent boom but a deception hills and slippery is actually good, it else) avoid long queues. of trendy spaces nonetheless, so be Portuguese doesn’t need to be Portuguese people and experiences, aware, especially in pavement making paraded so much. are known for Expect kisses particularly in the the city centre, the the walking Keep this in mind their linguistic The Portuguese restaurant scene, most fertile ground experience (ideal when walking abilities, not to love kissing, and has made Lisbon’s for these traps. for discovering around Baixa, mention their cheek-kissing is gastronomy even every nook and Belém and other hospitality. You’re very much alive more appealing. Choose your cranny) into a tourist hotspots. very likely to find in Lisbon. So be With a caveat: if fado house real challenge. people who speak prepared to greet you’re not quick carefully Your breathing Don’t pay English better than (and be greeted by) enough, you’ll risk Fado is Portugal’s capacity may be ridiculous average, and maybe strangers with a not getting a table traditional music – tested to the max amounts even some French kiss on each cheek in the majority of nothing new here but, on the bright of money (especially the (or just on one, in popular venues – and it suddenly side, the city is for pressed older generations), posher settings). -

Tarifário Site Jan 2020 UK
Títulos ocasionais normal (amounts in euros) Carris/Metro single ticket* 1.50 1 day ticket (24h) Carris/Metro** 6.40 Carris/Metro/Transtejo (Cacilhas)** 9.55 Fares Carris/Metro/CP** 10.60 * Valid for one journey in the Carris/Metro whole network, during 1 hour after the first validation. 2020) ** Valid for a 24h period, after the first validation. , st, 1 Zapping The following amounts may be stored in the viva viagem/7 colinas January and Lisboa viva cards: 3€, 5€, 10€, 15€, 20€, 25€, 30€, 35€ e 40€. Viagem no Metro 1.34 Valid in the whole network Bank card Metro journey applicable since ( Valid in the whole network Caixa VIVA 1.34 Viva Go 1.50 4_18, Cartões normal sub23 viva viagem/7 colinas 0.50 Lisboa viva* 7.00 3.50 Lisboa viva express delivery** 12.00 6.00 * Metro staions: Jardim Zoológico, Colégio Militar/Luz, Marquês de Pombal, Campo Grande, Rossio, Baixa Chiado, Cais do Sodré, Oriente and Aeroporto. ** Lisboa viva express delivery: Metro staions - Marquês de Pombal and Campo Grande, on weekdays. Social +, 4_18 4_18 spatial time and sub23 Social + and sub23 Passes validity validity normal Echelon B Echelon A Echelon A Navegante Navegante Metropolitano AML monthly 40.00 30.00 20.00 16.00 Navegante Municipality Lisboa or Amadora monthly 30.00 22.50 15.00 12.00 or Odivelas Navegante 12 (kids) AML free Navegante +65* AML monthly 20.00 Navegante urbano senior/ret./pens.** Lisbon's municipality 30 days 15.00 Navegante família Metropolitano AML monthly 80.00 Navegante família Municipal Lisboa or Amadora monthly 60.00 or Odivelas * Valid for senior citizens and retirees/pensioners. -

Doing Business in (Insert Country Name Here)
Doing Business in Portugal: 2014 Country Commercial Guide for U.S. Companies INTERNATIONAL COPYRIGHT, U.S. & FOREIGN COMMERCIAL SERVICE AND U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2010. ALL RIGHTS RESERVED OUTSIDE OF THE UNITED STATES. Chapter 1: Doing Business in Portugal Chapter 2: Political and Economic Environment Chapter 3: Selling U.S. Products and Services Chapter 4: Leading Sectors for U.S. Export and Investment Chapter 5: Trade Regulations, Customs and Standards Chapter 6: Investment Climate Chapter 7: Trade and Project Financing Chapter 8: Business Travel Chapter 9: Contacts, Market Research and Trade Events Chapter 10: Guide to Our Services Return to table of contents Chapter 1: Doing Business in Portugal Market Overview Market Challenges Market Opportunities Market Entry Strategy Market Overview Return to top Mainland Portugal, along with the autonomous island regions of the Azores and Madeira, offers American exporters a market of approximately 10.6 million people in a country roughly the size of the State of Indiana. As a member of the European Union (EU) and the euro zone, it is fully integrated with the EU, uses the euro currency, and follows directives from the European Commission in Brussels. As with all EU countries, Portugal’s borders and ports are completely open to the free flow of trade with other EU member countries. Portugal has a politically stable environment with a democratically elected parliamentary government and is welcoming of foreign business and investment. The government remains committed to attracting FDI, expanding trade with South America, Africa, and Asia, and focusing on niche sectors of the economy such as tourism, renewable energy, high quality industrial components, technology services, and value-added agricultural products. -
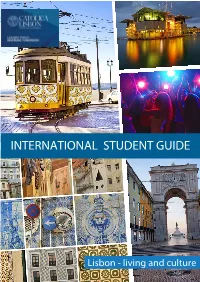
Guide Lisbon 2
INTERNATIONAL STUDENT GUIDE Lisbon - living and culture INTERNATIONAL STUDENT GUIDE Index Culture and Lifestyle 4 Portuguese history and architecture 4 Climate 5 Food and drink 5 Pastries 7 Fado 7 Sightseeing and museums 8 Monuments 8 Belém Tower 8 Jerónimos Monastery 9 Avenida da Liberdade 10 Praça da Comércio 10 Sé 11 Castelo de São Jorge 12 Parque das Nações 12 Museums 13 Museu Nacional de Arte Antiga 13 Museu do Azulejo 14 Fundação Gulbenkian 15 Colecção Berardo 15 Nighlife 16 Dining 16 Precautions 17 Bureaucratic issues 18 Embassies 18 Outside Europe 18 Europe 25 Hospitals 36 Public institutions 36 Santa Maria Hospital 36 Pulido Valente Hospital 37 São José Hospital 37 Private Institutions Luz Hospital 38 Lusíadas Hospital 38 CUF Descobertas Hospital 38 39 2 INTERNATIONAL STUDENT GUIDE Index Shopping 40 Hypermarkets 40 Electronics 40 Furniture 40 Clothing and footwear 40 Telecommunications 41 Department stores 41 Shopping malls 42 Colombo Shopping Centre 42 Amoreiras Shopping Centre 42 Vasco da Gama Shopping Centre 43 Specialized stores 44 IKEA 44 Decathlon 44 El Corte Inglés 45 Gymnasiums 48 Safety and law enforcement services 47 Safety and law enforcement services 48 48 Chelas Martim Moniz area 48 Contacts 48 Police Stations in Lisbon 48 Overview of Lisbon safety 48 Transportation in Lisbon Mass transportation within Lisbon 50 Bus 50 Tram 51 Metro 52 Mass transportation outside Lisbon 52 Train 52 Monthly Passes 53 Taxi services 54 Sightseeing in Portugal 55 Where to go? 55 Continental Cities and Places 55 How to travel around? 55 How to get there? 55 3 INTERNATIONAL STUDENT GUIDE Culture and Lifestyle Lisbon is a diverse and multicultural city, with a rich history, which is reected in the cuisine, architecture and overall habits of Lisboetas. -

Martim Moniz)
Survival Guide for Mobility and International Students Hi everyone! We are the Student Support Unit of TÉCNICO (NAPE) and we welcome you all to our University! We are students just like you and our mission is to ensure that you expe- rience a smooth transition to the University and city as well as provide guidance and support whilst you are here. For that reason, we have created this survival guide to help you plan your mobility period and survive when you arrive to Portugal. We look forward to meet you in the upcoming weeks and to help you adjust to your new life here in Lisbon. We all hope you have a pleasant experience and we encourage you to come and visit us if you have any issues or concerns that you wish to seek as- sistance with. You can find us daily at TÉCNICO’s Main Building reception from 9am to 5pm or contact us at [email protected]. NAPE Team Get Connected! Join us! Why wait until you arrive at TÉCNICO Lisboa to start making new friends? You can start connecting right now with other new TÉCNICO students through our social media sites. Facebook Faculty App In our Facebook group you can check The TÉCNICO Lisboa app will help you the latest updates about our events and get settle in and find your way around campus, connected with all the new TÉCNICO mobility since TÉCNICO Lisboa is one of the first students. portuguese intitutions with Google Maps You can also follow our official Indoors. The app is free and it is available for Facebook page – facebook.com/napeist – download on the Google Play Store. -

Student Guide Fall 2010-2011
CATHOLIC UNIVERSITY OF PORTUGAL THE SCHOOL OF ECONOMICS AND MANAGEMENT STUDENT GUIDE 10/11 International Office Contents Welcome Note 4 Meet the Staff 5 Contacts and Opening Hours 5 The University 7 Getting to Lisbon center from the Airport 8 Getting to the University 8 Catholic University Campus 10 FCEE-Católica Building 11 Computer Facilities 14 Main Campus Facilities Facilities 14 Textbooks 16 FCEE-Católica and Social Networks 16 Academic Calendar 18 Student Card 20 Portuguese Language Course 20 Welcome Week 21 Social Calendar 21 Important documents 2 Lisbon 24 Accommodation 25 Temporary Accomodation 25 Permanent Accomodation 25 Transportation 26 Within Lisbon 27 Within Portugal 29 Parking 31 Parking in the Catholic University 31 Mobile Phones 32 Climate 32 Nightlife 33 Finances 34 What to carry in your wallet 36 Medication 36 Sending Packages from Portugal 36 Wheelchair Access in Portugal 37 Government 37 Sports 38 Outdoor Activities 39 Indoor Activities 40 Culture 41 Portuguese Food 42 Examples of Portuguese Dishes 43 Portuguese Coffee Culture 44 Fado 45 Sightseeing in Portugal 46 Appendix 48 Map of Portugal 49 Emergency Numbers 50 Embassies 50 Hospitals 51 Taxi 51 Farnacies 51 Libraries 52 Tourism Offices 52 Erasmus Associations 53 Cinemas 53 Theaters 54 Museums 55 Restaurants 57 Cafés 58 National Holidays 59 3 Traditional Festivals 59 Welcome Note Welcome to FCEE-Católica, Portugal’s first business school. We are the School of Economics and Business Administration (FCEE) from Universidade Católica Portuguesa and one of the leading departments of its kind. We have a long tradition of welcoming exchange students, provide an excellent academic environment and an unforgettable exchange experience. -

VERDE Metro - Horários 12 Paragens Cais Do Sodré - Horário Da Rota: VER HORÁRIO DA LINHA Segunda-Feira 00:03 - 23:57
Horários e mapa de metro da linha VERDE Telheiras - Cais do Sodré Ver No Modo Website A linha VERDE (metro) - Telheiras - Cais do Sodré tem 2 rotas. Nos dias de semana, os horários em que está operacional são: (1) Cais Do Sodré: 00:06 - 23:57 (2) Telheiras: 00:06 - 23:57 Utilize a aplicação Moovit para encontrar a estação de metro ( VERDE) perto de si e descubra quando é que vai chegar o próximo metro de VERDE. Direção: Cais Do Sodré VERDE metro - Horários 12 paragens Cais Do Sodré - Horário da rota: VER HORÁRIO DA LINHA Segunda-feira 00:03 - 23:57 Terça-feira 00:06 - 23:57 Telheiras Quarta-feira 00:06 - 23:57 Campo Grande 9 Rua Actor António Silva, Lisboa Quinta-feira 00:06 - 23:57 Alvalade Sexta-feira 00:06 - 23:57 Praça de Alvalade, Lisboa Sábado 00:06 - 23:53 Roma Domingo 00:03 - 23:53 58 Avenida de Roma, Lisboa Areeiro 7 Praça Francisco Sá Carneiro, Lisboa VERDE metro - Informações Alameda Direção: Cais Do Sodré Avenida Almirante Reis, Lisboa Paragens: 12 Duração da viagem: 18 min Anjos Resumo da linha: Telheiras, Campo Grande, 58A Avenida Almirante Reis, Lisboa Alvalade, Roma, Areeiro, Alameda, Anjos, Intendente, Martim Moniz, Rossio, Baixa / Chiado, Cais Do Sodré Intendente 27B Avenida Almirante Reis, Lisboa Martim Moniz Rua da Senhora da Saúde, Lisboa Rossio 4 Praça da Figueira, Lisboa Baixa / Chiado 120/122 Rua Garrett, Lisboa Cais Do Sodré Direção: Telheiras VERDE metro - Horários 12 paragens Telheiras - Horário da rota: VER HORÁRIO DA LINHA Segunda-feira 00:03 - 23:57 Terça-feira 00:06 - 23:57 Cais Do Sodré Quarta-feira 00:06 -

The Neogene of Portugal
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by New University of Lisbon's Repository Proceedings of the 1" R.C.A.N.S. Congress, Lisboa, October 1992 pp.7-22 Ciencias cia Terra(UNL) Lisboa NP12 1993 ( 7 figs. J The Neogene of Portugal M. Telles Antunes & Joao Pais Centro de Estratigrafia e Paleobiologia da UNL, Faculdade de Ciencias e Tecnologia, Quinta da Torre, P-2825 Monte de Caparica, Portugal. ABSTRACT Key words: Neogene; Portugal. Aftera briefhistorical introduction, this paper deals with the main concerned geotectonic units: the Lower Tagus and Alvalade basins, the Western and Southern borders, and their infillings. Most of the Neogene events and record concern areas South of the Iberian Central Chain, a nearly inverse situation as that of Paleogene times. In the most important of these units, the Lower Tagus basin, there are quite thick detrital series, mostly marine in its distal part near Lisboa (albeit with several continental intercalations), and mainly continental in its inner part. Sedimentological record is almost complete since Lowermost to Upper Miocene. The richness ofdata (paleontology, isotope chronology, paleoclimate, etc.) it gives and the possibility of direct marine-continental correlations render this basin one of the more interesting ones in Western Europe. Alvalade basin is separated from the previous one by a barrier ofPaleozoic rocks. Two transgressions events (UpperTortonian and Messinian in age) are recorded. Active sedimentation may be correlated to Late Miocene tectonics events. In Algarve, chiefly marine units from Lower to Upper Miocene are well developped. The Lower unit (Lagos-Portimao Formation) is best exposed in Western Algarve, but desappears eastwards. -

A Work Project, Presented As Part of the Requirements for the Award of a Master In
A Work Project, presented as part of the requirements for the Award of a Master in Management from the NOVA – School of Business and Economics. Municipal Markets of Lisbon: a Strategic Group Analysis JOANA LEE FIGUEIREDO VIDAL TAM - 31738 MIGUEL CASTRO ADREGO - 29916 PATRÍCIA NUNES DE VASCONCELOS MALAFAIA BAPTISTA - 30430 A Project carried out on the Master in Management Program, under the supervision of: Professor Emanuel Gomes January 2019 Abstract Municipal markets have lost their importance over the last decades, however a newfound interest has recently brought them back to the spotlight. This study intends to analyse the current state of Lisbon’s 25 municipal markets, by performing a strategic group analysis and shed light on how, in particular, three of these markets can be improved, so that they can reach their full potential and serve new customers’ demands. The markets were aggregated into eight strategic groups, revealing that markets have very distinct characteristics. Mercado de Arroios, Alvalade Norte and 31 de Janeiro are analyzed more deeply and specific recommendations are provided. Keywords: Municipal Markets; Rehabilitation; Strategic Group Analysis; Key Success Factors. 2 Index Abstract 2 Introduction 3 Part 1 – Collective Contribution 6 1. Literature Review 6 1.1. Strategic Group Analysis 6 1.2. Key Success Factors 8 1.3. Context 9 1.3.1. Historical Evolution of Municipal Markets 10 1.3.2. Municipal Markets Concept 12 1.3.3. Municipal Markets in Portugal 14 1.3.4. Municipal Markets in Lisbon 15 1.3.5. Examples and Best Practices of Successfully Rehabilitated Municipal Markets 17 2. Methodology 23 2.1.