DIDR, Somalie : La Piraterie Somalienne, Ofpra, 04/08/2014
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Justice and Corrections
Quarterly Report: 01 January to 31 March 2015 Project: Rule of Law – Justice and Corrections Reporting Period 1 January- 31 March, 2015 Government Counterpart Ministry of Justice, Judiciary, Attorney General’s Office, Corrections, Legal Aid Providers, Universities’ Faculty of Law, and Bar Association. PSG PSG 3 (Justice): Establish independent and accountable justice institutions capable of addressing the justice needs of the people of Somalia by delivering justice for all. PSG priorities 1. Key priority laws in the legal framework are aligned with the Constitution and international standards 2. Justice institutions start to address the key grievances and injustices of Somalis 3. More Somalis have access to fair and affordable justice Focus Locations: In South Central: Mogadishu; In Somaliland: Hargeisa, Burao & Borama; In Puntland: Garowe, Bosaso & Gardo. AWP Budget USD 4,993,463 Available Funds for year USD 2,824,288 Expenditure to date USD 778,738.00 CONTRIBUTING DONORS: ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AWP Annual Work Plan CSO Civil Society Organization DFID Department for International Development EU European Union FGS Federal Government of Somalia GROL Governance and Rule of Law Programme HJC High Judicial Council ISF Integrated Strategic Framework JISU Joint Implementation Support Unit JP Joint Programme JSC Judicial Services Commission MIA Mogadishu International Airport MCG Micro-Capital Grant MOJ Ministry of Justice UNMPTF UN Multi Partner Trust Fund NGO Non-Governmental Organization PLAC Puntland Legal Aid Center PLDU Policy and -
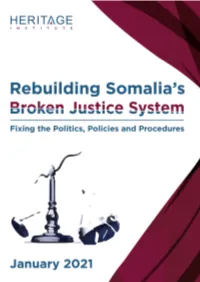
Justice-Report-Jan-6-.Pdf
1 Heritage Institute Contents 2 Heritage Institute Acronyms 1. A2J Access to Justice 2. ADR Alternative dispute resolution 3. BRA Benadir Regional Administration 4. CCILS Consultative Committee for Integration of Legal 5. CFI Systems Court of First Instance 6. DPC District peace committees 7. FGS Federal Government of Somalia 8. FMS Federal Member States 9. GBV Gender-Based Violence 10. JSC Judicial Services Commission 11. HJC Higher Judicial Council 12. HRC Human Rights Commission 13. IDLO International Development Law Organization 14. MOJ Ministry of Justice 15. NGO Non-governmental organization 16. NSC National Security Court 17. OAG Office of the Attorney General 18. PCoS Provisional Constitution of Somalia 19. CCoS Constitutional Court of Somalia 20. SCoS Supreme Court of Somalia 21. PM Prime minister 22. SBA Somali Bar Association 23. SLC Somali Legal Society 24. SRC Supreme Revolutionary Council 25. SSC State Supreme Court 26. TFC Transition Federal Charter 27. TNG Transitional National Government 28. TFG Transitional Federal Government 3 Heritage Institute 1. Executive summary Despite recent reforms, the formal justice system in Somalia is broken at the core, depriving More than 10 years equitable access to justice for millions of citizens. More than 10 years with no judicial system (1990- with no judicial 2000) followed by 20 years of weak statutory courts (2000-2020) have had a profoundly deleterious system (1990- impact on the nation’s deeply decentralized judicial branch. As a result, a buffet of justice systems 2000) followed and alternative dispute mechanisms have flourished across the country, leading citizens to shop for by 20 years of the most favorable outcomes. -

Bk-Somali-Conflict-Part6-010194-En.Pdf
POSTSCRIPT Several significant developments have taken place since Mark Bradbury submitted his report in October 1993. 1 On 3-4 October several US servicemen and numerous Somalis were killed in the Bakhara Market in Mogadishu, when US special forces attempted to capture the leaders of General Aideed's Somali National Alliance. As a result, the USA and UN took the decision to wind down their military operations in Somalia. In Mogadishu itself, UN and US forces have been largely confined to barracks, and only minimal protection has been offered to humanitarian agencies. 2 US policy is motivated by the attempt to withdraw completely from Somalia with some measure of honour. A temporary build-up of the use of military hardware was accompanied by an announcement that all US forces would be withdrawn by 31 March 1994. At the same time, greater diplomatic emphasis was put on scaling down the conflict with Aideed and the SNA. Much of this work was carried out by ex-Ambassador Oakley. It led ultimately to the withdrawal of the warrant for Aideed's arrest, and the release in January 1994 of all detainees held by the UN, among them several of Aideed's key aides. 3 The US decision to withdraw by the end of March 1994 was quickly followed by similar decisions by the Belgians, Germans, Swedes, and Italians — indeed, by all the European forces under the UN umbrella. As a result of these unilateral decisions, the UN has been forced to scale down its whole peace-enforcement operation in Somalia, with a target of approximately 18,000 troops on the ground after March 1994. -

Somalia Decent Work Programme 2012-2015Pdf
1 DECENT WORK PROGRAMME Southern Somalia and Puntland 2011-2015 5 1.0 Introduction 9 2.0 Country Context 11 2.1 Political Context 13 2.2 Socio-Economic Context 13 3.0 Challenges Facing Southern Somalia and Puntland in the Context of Decent Work 15 3.1 Employment 16 3.2 International Rights 16 Contents 3.3 Labour Standards 17 3.4 Social Protection 18 3.5 Social Dialogue, Tripartism 18 3.6 Summary of Challenges 20 3.7 ILO Technical Cooperation 20 4.0 Towards a Decent Work Country Programme for Southern Somalia and Puntland 23 4.1 International Frameworks 24 4.2 ILO Policies and Programmes 26 4.3 Government Policies and Programmes 29 4.4 Milestones to the Decent Work Programme 30 5.0 Decent Work Programme priorities for Southern Somalia and Puntland 33 Table: Overview of priorities and outcomes 5.1 Priority 1: Increased Employment Creation for Poverty Alleviation 34 a) Introduction 36 b) Strategy 37 c) Outcomes, Outputs and Indicators 39 5.2 Priority 2: Strengthened Capacities for Tripartite Labour Governance and Administration 42 a) Introduction 43 b) Strategy 44 c) Outcomes, Outputs and Indicators 45 5.3 Priority Three: Reducing Vulnerability through designing a Social Protection Floor by Building on Existing Practices 47 a) Introduction 49 b) Strategy 50 c) Outcomes, Outputs and Indicators 50 6.0 Decent Work Programme in Partnership - Implementation and Management 51 6.1 Management and Implementation Framework 52 6.2 Monitoring and Evaluation (M&E) 52 6.3 Resource Requirements 53 7.0 Annex: 55 Conventions Ratified by Somalia 56 Work Cited -

Puntland Post Monthly
01/03/2020 Volume 3 Issue 6 Puntland Post Monthly INSIDE THIS ISSUE WHITHER PUNTLAND? In February Puntland President Said Abdullahi Deni called for a consultative conference for Puntland stakeholders. The conference to take place mid March 1. WHITHER PUNTLAND? will have almost all the characteristics of the 2. BERBERA URBAN PROJECT 1998 conference out of which an autonomous 3. THE LOOMING administration emerged. The founding President of CONSTITUIONAL CRISIS IN Puntland Abdullahi Yusuf Ahmed envisioned a Puntland SOMALIA that would pioneer federalism for a Somalia that was still 4. AGAINST THE POLITICAL a country with no government. Twenty one years after ISOLATION OF DJIBOUTI that conference Somalia has a Federal Government but its 5. PUNTLAND TO LOSE writ does not run throughout Somalia. It is dependent on African peacekeepers. FEDERAL REPRESENTATION OF Who should take the blame for apparent DISPUTED TERRITORIES failure federalism in Somalia? Should one equate 6. US SUPPORT FOR SOMALI this political failure with possible relapse to state failure? ARMY SUSTAINS POLITICAL INSTABILITY President Deni made the right call to hold a 7. MUDUG GOVERNOR consultative conference. Puntland has been staunch supporter of federal institutions since the end of WARNS THE FEDERAL GOVERNMENT AGAINST the transition. Puntland political class deluded themselves into thinking that ending the transition is a DEPLOYMENT OF TROOPS sure way to institutionalise federalism. The absurdity of 8. BLOOD MONEY AND this line of thinking is better reflected by how the PUNTLAND JUSTICE Federal Governments under President Mohamed SYSTEM Abdullahi Mohamed turned out to be a 9. THE ILLEGALITY OF more destabilising entity than its predecessor. -

31 August 2019
CHILD PROTECTION ASSESSEMENT IN SOMALIA FINAL REPORT UNICEF/SOMALI-CHILD PROTECTION AREA OF RESPONSIBILITY 31 AUGUST 2019 i TABLE OF CONTENT TABLE OF CONTENT .................................................................................................................. ii LIST OF TABLES ......................................................................................................................... ix LIST OF FIGURES ....................................................................................................................... ix LIST OF ACRONYMS ................................................................................................................ xii DEFINITIONS OF TERMS ........................................................................................................ xiv ACKNOWLEDGEMENTS .......................................................................................................... xv EXECUTIVE SUMMARY ......................................................................................................... xvi CHAPTER ONE ........................................................................................................................... 1 INTRODUCTION......................................................................................................................... 1 1.1 Background and Context........................................................................................................... 1 1.2 Introduction .............................................................................................................................. -

Puntland President Praises Jubaland Election, Condemns ‘False’ Federal Constitution
Puntland State of Somalia Somalia: Puntland President Praises Jubaland Election, Condemns ‘False’ Federal Constitution PRESS RELEASE May 27, 2013 The President of Puntland State of Somalia H.E. Abdirahman Mohamed Mohamud (Farole) held a Public Symposium to address important issues and engage in Question and Answer session with the Puntland public. The two-hour event, held at Puntland Development and Research Center (PDRC) in Garowe, was attended by over 100 people representing different sectors of Puntland society, including elders, religious scholars, women and youth, businesspeople, Diaspora, students and academics. President Farole gave a 40-minute speech, touching on key topics of security, economy, democratization process, and federal affairs. The President was joined by Interior Minister H.E. Abdullahi Ahmed Jama (Ilkajir), Education Minister H.E. Abdi Farah Saeed (Juha), State Minister for Good Governance H.E. Mohamed Farah Issa (Gashan), and Deputy Livestock Minister H.E. Abdiweli Hersi Nur. Sheikh Mohamud Haji Yusuf, an Islamic scholar with the East Africa University in Puntland, opened the event with an Islamic sermon. Security President Farole said the entire world is struggling with security issues and Puntland has made remarkable achievements in strengthening its own security, by reforming the security forces, providing training initiatives, waging war against Al Shabaab terrorists in Golis Mountains and in urban centers, fighting piracy criminals on land and in the high seas. “Terrorist groups want to create endless conflict. They do not want any place of peace. They kill people even inside the mosques. Terrorism is the worst kind of evil and I call upon the Puntland people to unite and to work with the Government to fight the terrorists,” said the President. -

Pillars of Peace
International Peacebuilding Alliance Garowe, Puntland Alliance internationale pour la consolidation de la paix Phone: (+252 5) 84 4480 • Thuraya: +88 216 4333 8170 Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz Galkayo Satellite Office Interpeace Regional Office for Eastern and Central Africa Phone: (+252 5) 85 4200 • Thuraya: +88 216 43341184 T +254(0) 20 3862 840/ 2 • F +254(0) 20 3862 845 P.O.Box 14520 – Nairobi, Kenya 00800 [email protected] www.interpeace.org www.pdrcsomalia.org PILLARS OF PEACE SOMALI PROGRAMME In partnership with the United Nations Puntland Note: Mapping the Foundations of Peace Puntland Note: This publication was made possible through the generous contributions and support from: Puntland Note: Mapping the Foundations of Peace Challenges to Security and Rule of Law, Democratisation Process and Devolution of Power to Local Authorities Denmark Schweizerische Eidgenossenschaft Confederation suisse Confédérazione Svizzera Confederaziun svizra Swiss Confederation European Commission Garowe, November 2010 P ILLARS OF P EACE Somali Programme Puntland Note: Mapping the Foundations of Peace Challenges to Security and Rule of Law, Democratisation Process and Devolution of Power to Local Authorities Garowe, November 2010 i Pillars of Peace - Somali Programme Puntland Note: Mapping the Foundations of Peace Pillars of Peace - Somali Programme ii Acknowledgements This research document was made possible by the joint effort and partnership of the Puntland Development Research Center (PDRC) and the International Peacebuilding Alliance (Interpeace). PDRC would like to thank the Puntland stakeholders who actively participated and substantially contributed to the discussions, interviews, community consultations and analysis of the research output. Special thanks also go to the peer reviewers who, looking at the document from the outside, constructively and attentively reviewed the content and form of this document. -
The Evolution of Somali Piracy by Demonstrating How Multiple Factors Work Together to Facilitate the Evolution of Somali Piracy
DYNAMICS OF GLOBAL AND REGIONAL PIRACY 1996 to 2013 : THE EVOLUTION OF SOMALI PIRACY by Keunsoo Jeong B.A. in Sociology, Sungkyunkwan University, 1993. M.A. in Sociology, New School for Social Research, 1997. Master of Public and International Affairs. University of Pittsburgh, 2008. Submitted to the Graduate Faculty of Public and International Affairs in partial fulfillment of the requirements for the degree of PhD in Foreign and Security Policy University of Pittsburgh 2017 UNIVERSITY OF PITTSBURGH PUBLIC AND INTERNATIONAL AFFAIRS This dissertation was presented by Keunsoo Jeong It was defended on March 17, 2017 and approved by Phil Williams, PhD, Professor William N. Dunn, PhD, Professor Michael Kenney, PhD, Associate Professor Charles S. Gochman, PhD, Associate Professor Dissertation Advisor: Phil Williams, PhD, Professor ii Copyright © by Keunsoo Jeong 2017 iii DYNAMICS OF GLOBAL AND REGIONAL PIRACY 1996 to 2013 : THE EVOLUTION OF SOMALI PIRACY Keunsoo Jeong, PhD University of Pittsburgh, 2017 In an attempt to provide a comprehensive explanation of Somali piracy, this study investigates not only a wide range of piracy issues from both historical and regional perspectives, but also the deeper context of Somali piracy as a particular regional phenomenon. This study adopts a multimethod research. It uses a quantitative approach as a nested framework for a comprehensive qualitative analysis. A process-tracing method based on classification and congruence techniques was then applied to construct a causal mechanism model, which helped to discover how the relevant factors worked together to produce Somali piracy. This study identifies and traces five evolutionary stages of Somali piracy from its genesis to its demise. -
Somalia Risk Assessment 2014 INSCT MIDDLE EAST and NORTH AFRICA INITIATIVE
INSCT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA INITIATIVE INSTITUTE FOR NATIONAL SECURITY AND COUNTERTERRORISM Somalia Risk Assessment 2014 INSCT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA INITIATIVE EXECUTIVE SUMMARY This report, developed from open-source information including congressional and federal reports, academic articles, news media accounts, and NGO papers— concerns one of the most developmentally deficient and war-torn countries in the world. The name “Somalia” and the phrase “failed state” unfortunately have become synonymous. Since the 1991 overthrow of dictator Said Barre and the resulting civil war, successive incarnations of a Somali government have time and again attempted to rise above the seemingly perpetual instability and begin exerting state control. Since 2012, when an internationally supported government was installed in Mogadishu (the US recognized the government in January 2013), Somalia has taken baby steps toward restoring stability and security in parts of the country. The presence of forces from neighboring counties, such as Kenya and Ethiopia (as part of an African Union Mission in Somalia (AMISOM)), has brought a measure of stability to regions in the country’s south that were until recently controlled by non-state militias, FIGURE 1: Map of Somalia and Region (University of Texas). mainly the militant Islamic organization and Al-Qaeda affiliate Al-Shabaab. But despite recent AMISOM battlefield gains and encouraging signs of increasing government capacity, the central government still controls only a portion of Mogadishu and almost no other territory in the rest of the country. And even these gains are precarious. This report will examine four topics that provide a cross-section of national security issues in Somalia: ! Defense Capabilities—Including Somalia’s attempts to re-build its national military, partnerships with friendly and donor nations, and the US military posture in East Africa. -

Justice and Corrections
Quarterly Report: 01 January to 31 March 2015 Project: Rule of Law – Justice and Corrections Reporting Period 1 January- 31 March, 2015 Government Counterpart Ministry of Justice, Judiciary, Attorney General’s Office, Corrections, Legal Aid Providers, Universities’ Faculty of Law, and Bar Association. PSG PSG 3 (Justice): Establish independent and accountable justice institutions capable of addressing the justice needs of the people of Somalia by delivering justice for all. PSG priorities 1. Key priority laws in the legal framework are aligned with the Constitution and international standards 2. Justice institutions start to address the key grievances and injustices of Somalis 3. More Somalis have access to fair and affordable justice Focus Locations: In South Central: Mogadishu; In Somaliland: Hargeisa, Burao & Borama; In Puntland: Garowe, Bosaso & Gardo. AWP Budget USD 4,993,463 Available Funds for year USD 2,824,288 Expenditure to date USD 778,738.00 CONTRIBUTING DONORS: ABBREVIATIONS AND ACRONYMS AWP Annual Work Plan CSO Civil Society Organization DFID Department for International Development EU European Union FGS Federal Government of Somalia GROL Governance and Rule of Law Programme HJC High Judicial Council ISF Integrated Strategic Framework JISU Joint Implementation Support Unit JP Joint Programme JSC Judicial Services Commission MIA Mogadishu International Airport MCG Micro-Capital Grant MOJ Ministry of Justice UNMPTF UN Multi Partner Trust Fund NGO Non-Governmental Organization PLAC Puntland Legal Aid Center PLDU Policy and -

Report of the Monitoring Group on Somalia
United Nations S/2010/91 Security Council Distr.: General 10 March 2010 Original: English Letter dated 10 March 2010 from the Chairman of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea addressed to the President of the Security Council On behalf of the Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning Somalia and Eritrea, and in accordance with paragraph 3 (j) of Security Council resolution 1853 (2008), I have the honour to transmit herewith the report of the Monitoring Group on Somalia. In this connection, the Committee would appreciate it if the present letter, together with its enclosure, were brought to the attention of the members of the Security Council and issued as a document of the Council. (Signed) Claude Heller Chairman Security Council Committee pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 concerning Somalia and Eritrea 10-24689 (E) 110310 *1024689* S/2010/91 Letter dated 26 February 2010 from the members of the Monitoring Group on Somalia addressed to the Chairman of the Security Council Committee established pursuant to resolution 751 (1992) We have the honour to transmit herewith the report of the Monitoring Group on Somalia in accordance with paragraph 3 (j) of Security Council resolution 1853 (2008). (Signed) Matt Bryden Coordinator Monitoring Group on Somalia (Signed) Arnaud Laloum (Signed) Jörg Roofthooft 2 10-24689 S/2010/91 Report of the Monitoring Group on Somalia pursuant to Security Council resolution 1853 (2008) Contents Page Abbreviations.................................................................. 5 Summary ..................................................................... 6 I. Introduction ................................................................... 8 A. Mandate .................................................................. 8 B. Methodology .............................................................