Introduction
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thèse Lavitra Final Version.Pdf
Caractérisation, contrôle et optimalisation des processus impliqués dans le développement postmétamorphique de l’holothurie comestible Holothuria scabra (Jaeger, 1833) (Holothuroidea : Echinodermata). Item Type Thesis/Dissertation Authors Thierry, Lavitra Publisher Université de Mons-Hainaut et Université de Toliara Download date 28/09/2021 08:57:47 Link to Item http://hdl.handle.net/1834/9541 Université de Mons-Hainaut Faculté des Sciences Laboratoire de Biologie Marine Caractérisation, contrôle et optimalisation des processus impliqués dans le développement postmétamorphique de l’holothurie comestible Holothuria scabra (Jaeger, 1833) (Holothuroidea : Echinodermata) Thèse présentée en vue de l’obtention du grade de Docteur en Sciences Septembre 2008 Présentée par Thierry LAVITRA Promoteur : Prof. Igor EECKHAUT M U H bio mar Membres du Jury : Prof. Chantal CONAND Université de la Réunion, France Prof. Richard RASOLOFONIRINA Université de Tuléar, Madagascar Dr. Patrick FLAMMANG Université de Mons-Hainaut, Belgique Prof. Philippe GROSJEAN Université de Mons-Hainaut, Belgique Prof. Igor EECKHAUT Université de Mons-Hainaut, Belgique Remerciements REMERCIEMENTS Ce travail de thèse n’aurait pas pu voir le jour sans le soutien financier de la Commission Universitaire pour le Développement (CUD) de la Communauté française de Belgique et du Gouvernement Malgache. Il a été effectué au sein de l’Aqua-Lab/IH.SM-Madagascar (Institut Halieutique et des Sciences Marines, dirigé par le Dr. Man Wai Rabenevanana) et des laboratoires de Biologie Marine de l’Université de Mons-Hainaut et de l’Université Libre de Bruxelles-Belgique (dirigé par le Professeur Michel Jangoux). En tout premier lieu, j’exprime ma vive gratitude au Professeur Michel Jangoux de m’avoir accueilli au sein de son laboratoire. -

Ilfxrietwanjuseum
ilfXrietwanJuseum PUBLISHED BY THE AMERICAN MUSEUM OF NATURAL HISTORY CENTRAL PARK WEST AT 79TH STREET, NEW YORK 24, N.Y. NUMBER 1821 MARCH 29, 1957 The Littoral Holothurians of the Bahama Islands BY ELISABETH DEICHMANN Very little is known about the echinoderms of the Bahama Islands, and in particular the holothurians have been almost completely forgotten. In Ives's paper (1891) on the echinoderms of the Bahamas not one holo- thurian is included, and in the survey of the littoral echinoderms of the West Indies, H. L. Clark (1919) lists only one. In 1933 Clark notes under the individual species merely whether or not it has been reported from that area, but gives no list. Evidently he overlooked Edwards' ac- count (1909) of the early stages of "Holothuria floridana," based on ma- terial from Green Turtle Key in the Bahamas, and here tentatively referred to H. mexicana, which apparently is the most common species in that region. As the Bahamas form the northern outpost of the West Indies, with rather extreme ecological conditions, and as they probably serve as a stepping stone for the migration of a number of species to the Bermudas, it would be of great interest to know more about their littoral fauna and to compare it with that of other areas-as for example, that of Biscayne Bay on the eastern coast of Florida. The chance to give a preliminary account of the holothurian fauna of the shallow water of the Bahamas came in the summer of 1952 when I received a small collection made by Libbie Hyman during her six weeks' visit to the Lerner Marine Labora- tory on Bimini Island. -

Regional Studies in Marine Science 9 (2017) 35–42
Regional Studies in Marine Science 9 (2017) 35–42 Contents lists available at ScienceDirect Regional Studies in Marine Science journal homepage: www.elsevier.com/locate/rsma The potential for propagation of the commercial sea cucumber Isostichopus fuscus (Ludwig, 1875) by induced transverse fission Jorge I. Sonnenholzner a,*, Ricardo Searcy-Bernal b, María Panchana-Orralaa a Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas. 30.5, Vía Perimetral, Guayaquil, Ecuador b Instituto de Investigaciones Oceanológicas, Universidad Autónoma de Baja California, Km. 107 Carretera Tijuana-Ensenada, Ensenada, Mexico h i g h l i g h t s • Isostichopus fuscus asexual reproduction was induced by fission and body parts regenerated in 90 days. • A high protein diet with brown macroalgae powder produced a rapid growth of posterior body parts. • This technique might be used for restoring wild populations of sea cucumbers. article info a b s t r a c t Article history: This study evaluated the potential to propagate asexually the brown sea cucumber Isostichopus fuscus by Received 18 March 2016 induction of transverse fission, and its ability to survive, grow and regenerate body parts into a whole Received in revised form 3 October 2016 animal. Two independent experiments were performed. Experiment 1: sixty-two adult animals (18.8 ± Accepted 14 October 2016 0.2 cm and 368.1 ± 7.2 g) were cut six centimeters from the rear, and during this process they eviscerated. Available online 18 October 2016 Survival of body-parts (anterior and posterior) of animals and regeneration times were evaluated, until Keywords: all individuals showed complete regeneration in terms of its morphology (lasted 13-wk). -

August 2004 INFORMATION BULLETIN
ISSN 1025-4943 Secretariat of the Pacific Community BECHE-DE-MER Number 20 — August 2004 INFORMATION BULLETIN Editor and group coordinator: Chantal Conand, Université de La Réunion, Laboratoire de biologie marine, 97715 Saint-Denis Cedex, La Réunion, France. [Fax: +262 938166; Email: [email protected]]. Production: Information Section, Marine Resources Division, SPC, BP D5, 98848 Noumea Cedex, New Caledonia. [Fax: +687 263818; Email: [email protected]; Website: http://www.spc.int/coastfish]. Produced with financial assistance from the European Union. Editorial It is a great pleasure to present the 20th issue of the SPC Beche-de- Mer Information Bulletin. Inside this issue In recent months, several important CITES (Convention on the Convention on International Trade International Trade in Endangered Species) activities related to in Endangered Species of Wild Fauna sea cucumber management have occurred. Following the CITES and Flora (CITES): Conservation and Technical Workshop in Malaysia, in March 2004, the CITES trade in sea cucumbers Animals Committee met in South Africa, in April 2004, and C. Conand p. 3 adopted several recommendations. The 13th meeting of the Conference of the Parties will be held in Thailand, in October Field observations of juvenile sea 2004. Further details can be found in this issue (page 3). cucumbers G. Shiell p. 6 During the workshop on Advances in Sea Cucumber Aquaculture and Management (ASCAM) organised by the Fisheries Department Sandfish (Holothuria scabra) of the Food and Agriculture Organization (FAO), recommendations with shrimp (Penaeus monodon) were formulated and will be used in future collaborations. The pro- co-culture tanks trials ceedings of the ASCAM workshop are published by FAO (see page R. -

Asexual Reproduction by Fission in Holothuria Atra
OCEANOLOGICA ACTA- VOL 19- W 3-4 ~ -----~- Asexual reproduction Asexual reproduction by fission Regeneration Holothurian Strate gy in Holothuria atra : variability Indo-Pacific Reproduction asexuée of sorne parameters in populations Régénération Holothurie Stratégie from the tropical ln do-Pacifie 1ndo-Pacifique Chantal CONAND Laboratoire d'Écologie Marine, Université de La Réunion, 97715 Saint-Denis Messag Cedex, France. Received 17/01/95, in revised forrn 19/12/95, accepted 21/12/95. ABSTRACT Holothuria atra is the most common aspidochirotid holothurian on tropical Indo Pacific reefs. Asexual reproduction by transverse fission, followed by regenera tion, has been studied at Reunion Island (Indian Ocean) and compared with dif ferent populations of the Indo-Pacific zone, thus perrnitting a better identification of the most significant parameters and a better understanding of this reproductive strate gy. At Reunion Island, the species is studied at two stations on the same fringing reef: 1) on the back-reef where the fission rate is high (20 % of the population), the individuals small (generally weighting Jess than 150 g) and the population density high (41m2); and 2) on the reef front, where fission is extre mely rare, the mean size of the individuals larger (up to 300 g) and the density low (O.Ol!m2). Different categories of individuals, fissioning (F), after fission, anterior and posterior parts (A and P), and regenerating (Ap and Pa) have been identified from externat observations. Dissection has demonstrated the unequal allocation of organs during fission and the variability of the regenerative states, mostly in the anterior part. Conceming fission, the position of the split in an indi vidual is in the anterior half (at 44 % of the totallength). -

SPC Beche-De-Mer Information Bulletin #29 – June 2009 X
Secretariat of the Pacific Community ISSN 1025-4943 Issue 29 – June 2009 BECHE-DE-MER information bulletin Inside this issue Editorial Changes in weight and length of sea cucumbers during conversion to This issue principally includes seven original papers, the list of processed beche-de-mer: Filling gaps publications on sea cucumbers by Dr D.B. James and the abstracts for some exploited tropical species th S.W. Purcell et al. p. 3 about holothuroids presented during the 9 International Echino- The correlation of attributes of egg derm Conference held in Hobart (Tasmania) in January. source with growth, shape, survival and development in larvae of the temperate sea cucumber The first paper is from S.W. Purcell et al. (p. 3). They complete Australostichopus mollis the published results of Conand, Skewes and other authors in A.D. Morgan p. 7 estimating the change in length and weight, during processing Shifting the natural fission plane of stages, of several tropical commercial species for which data Holothuria atra (Aspidochirotida, Holothuroidea, Echinodermata) were lacking. P. Purwati et al. p. 16 Problems related to the farming A.D. Morgan reports that survival of larvae of Australostichopus of Holothuria scabra (Jaeger, 1833) mollis relies on the characteristics of the females laying the eggs T. Lavitra et al. p. 20 and particularly on the number and size of the eggs that the Stock assessment of holothuroid populations in the Red Sea waters females are able to lay (p. 7). of Saudi Arabia M.H. Hasan p. 31 P. Purwati et al. show that for Holothuria atra, the natural fission From hatchery to community – Madagascar’s first village-based plane may no longer be important in fission inducement and that holothurian mariculture programme it could be manipulated. -
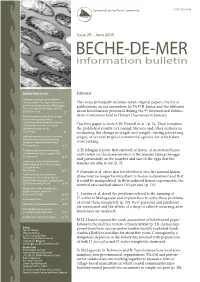
SPC Beche-De-Mer Information Bulletin #29 – June 2009 X
Secretariat of the Pacific Community ISSN 1025-4943 Issue 29 – June 2009 BECHE-DE-MER information bulletin Inside this issue Editorial Changes in weight and length of sea cucumbers during conversion to This issue principally includes seven original papers, the list of processed beche-de-mer: Filling gaps publications on sea cucumbers by Dr D.B. James and the abstracts for some exploited tropical species th S.W. Purcell et al. p. 3 about holothuroids presented during the 9 International Echino- The correlation of attributes of egg derm Conference held in Hobart (Tasmania) in January. source with growth, shape, survival and development in larvae of the temperate sea cucumber The first paper is from S.W. Purcell et al. (p. 3). They complete Australostichopus mollis the published results of Conand, Skewes and other authors in A.D. Morgan p. 7 estimating the change in length and weight, during processing Shifting the natural fission plane of stages, of several tropical commercial species for which data Holothuria atra (Aspidochirotida, Holothuroidea, Echinodermata) were lacking. P. Purwati et al. p. 16 Problems related to the farming A.D. Morgan reports that survival of larvae of Australostichopus of Holothuria scabra (Jaeger, 1833) mollis relies on the characteristics of the females laying the eggs T. Lavitra et al. p. 20 and particularly on the number and size of the eggs that the Stock assessment of holothuroid populations in the Red Sea waters females are able to lay (p. 7). of Saudi Arabia M.H. Hasan p. 31 P. Purwati et al. show that for Holothuria atra, the natural fission From hatchery to community – Madagascar’s first village-based plane may no longer be important in fission inducement and that holothurian mariculture programme it could be manipulated. -

Observations of Asexual Reproduction of <Em>Holothuria (Platyperona) Parvula </Em>(Selenka, 1867) in the Caribbean S
SPC Beche-de-mer Information Bulletin #40 – March 2020 49 Observations of asexual reproduction of Holothuria (Platyperona) parvula (Selenka, 1867) in the Caribbean Sea Giomar H. Borrero-Pérez1* Holothuria (Platyperona) parvula is one of the nine species Notes: Specimens were observed adhered to the underside of of sea cucumbers belonging to the family Holothuriidae small- to medium-size rocks, no more than 50 cm diameter. reported by Dolmatov (2014) as being capable of asexual They were in pairs, with two to six on the same rock, includ- reproduction. The fission process in this species was first ing posterior fission halves (which were obviously regener- recorded by Crozier (1917, as H. captiva) in Bermuda. Later, ating new anterior ends) and anterior fission halves. Some Kille (1942) studied the development of the reproductive apparently whole specimens were also observed. Two speci- system after fission using specimens from the Dry Tortugas mens of H. (P.) parvula were collected previously from Bahia and, for comparison, some from Bermuda, the only location Chengue (11 October 2016), also located at the Parque for which this information was available for H. (P.) parvula Nacional Natural Tayrona, although no evidence of asexual (Dolmatov 2014). Emson and Mladenov (1987), also based reproduction in those specimens was observed. on specimens from Bermuda, described the fission process and its frequency throughout the year (from August 1984 to September 1985). These authors concluded that during fis- Location: Isla cayo Serranilla, SeaFlower Biosphere Reserve, Colombia (Caribbean Sea) at 15° 47’ 53.2638” N 79° 50’ sion, Holothuria parvula split into roughly equal parts across the middle of the body, and that there was little difference in 56.076” W survival between the oral and anal ends. -

Asexual Reproduction in Holothurians
Hindawi Publishing Corporation e Scientific World Journal Volume 2014, Article ID 527234, 13 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/527234 Review Article Asexual Reproduction in Holothurians Igor Yu. Dolmatov1,2 1 A. V. Zhirmunsky Institute of Marine Biology, FEB RAS, Palchevsky 17, Vladivostok 690041, Russia 2 School of Natural Sciences, Far Eastern Federal University, Suhanova 8, Vladivostok 690950, Russia Correspondence should be addressed to Igor Yu. Dolmatov; [email protected] Received 29 July 2014; Accepted 23 September 2014; Published 21 October 2014 Academic Editor: Runcang Sun Copyright © 2014 Igor Yu. Dolmatov. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Aspects of asexual reproduction in holothurians are discussed. Holothurians are significant as fishery and aquaculture items and have high commercial value. The last review on holothurian asexual reproduction was published 18 years ago and included only 8 species. An analysis of the available literature shows that asexual reproduction has now been confirmed in 16 holothurian species. Five additional species are also most likely capable of fission. The recent discovery of new fissiparous holothurian species indicates that this reproduction mode is more widespread in Holothuroidea than previously believed. New data about the history of the discovery of asexual reproduction in holothurians, features of fission, and regeneration of anterior and posterior fragments are described here. Asexual reproduction is obviously controlled by the integrated systems of the organism, primarily the nervous system. Special molecular mechanisms appear to determine the location where fission occurs along the anterior-posterior axis of the body. -

SPC Beche-De-Mer Information Bulletin #23 – February 2006
ISSN 1025-4943 Secretariat of the Pacific Community BECHE-DE-MER Number 23 — February 2006 INFORMATION BULLETIN Editor and group coordinator: Chantal Conand, Université de La Réunion, Laboratoire de biologie marine, 97715 Saint- Denis Cedex, La Réunion, France. [Fax: +262 938166; Email: [email protected]]. Production: Information Section, Marine Resources Division, SPC, BP D5, 98848 Noumea Cedex, New Caledonia. [Fax: +687 263818; Email: [email protected]; Website: http://www.spc.int/coastfish]. Produced with financial assistance from the European Union. Editorial This is the 23rd issue of a nearly 16-year-old publication, and I be- lieve the bulletin has now reached its cruising speed with two is- Inside this issue sues published every year for the last five years. I must thank here the many regular and occasional contributors who helped me make this happen, as well as the dedicated SPC Fisheries Informa- Recent developments with tion and Publication Sections‘ staff who work hard behind the the sea cucumber fishery in scenes to maintain the quality of this publication. The important Solomon Islands correspondence included in this issue proves that the bulletin W. Nash and C. Ramofafia p. 3 serves well its goal of linking scientists, technicians, fisheries man- agers and all others with an interest in sea cucumbers, worldwide. Population patterns and seasonal observations on density and I draw, once again, your attention to the new database of all articles distribution of Holothuria grisea and abstracts published in the bulletin to date. This was put together (Holothuroidea:Aspidochirotida) by SPC’s Fisheries Information Section, and is available on SPC’s on the Santa Catarina Coast, Brazil website at: http://www.spc.int/coastfish/news/search_bdm.asp. -

SAV) Y En Lo Específi Co De La Isla De Sacrifi Cios, La Cual Está Siendo Tomada Como Sitio Particular De Estudio Por El UIEP
A la memoria de Mario Lara Pérez Soto (1960-2003) Estudioso del Sistema Arrecifal Veracruzano…. Impulsor del buceo como una actividad necesaria en el estudio de los ecosistemas arrecifales… un académico… un profesional…un amigo. Agradecemos al Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y a las autoridades de la Universidad Veracruzana el apoyo brindado para realizar el proyecto “Fortalecimiento Disciplinario para el Desarrollo y Consolidación del Cuerpo Académico Manejo y Conservación de Recursos Acuáticos”. Asimismo, se agradece al Acuario de Veracruz, A.C. el apoyo para llevar a cabo, en sus ins- talaciones, varias jornadas académicas que enmarcaron este proyecto, así también agradecemos el apoyo logístico y de gestión que dieron para el trabajo en campo el Acuario de Veracruz, la 3a Zona Naval Militar de la Secretaria de Marina, y el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. Investigaciones Científi cas en el Sistema Arrecifal Veracruzano A. Granados Barba, L. G. Abarca Arenas y J. M. Vargas Hernández Editores 2007 Investigaciones Científi cas en el Sistema Arrecifal Veracruzano Granados Barba, A., L.G. Abarca Arenas, y J.M. Vargas Hernández (Eds.), 2007. Investigaciones Científi cas en el Sistema Arrecifal Veracruzano. Universidad Autónoma de Campeche. ISBN 968- 5722-53-6. 304 p. @ Universidad Autónoma de Campeche, 2007 Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México ISBN 968-5722-53-6 Centro de Ecología, Pesquerías y Oceanografía del Golfo de México Av. Agustín Melgar s/n. Col. Buenavista San Francisco de Campeche 24020. Campeche, México Tel: (981) 81 19800 ext 62300 Fax: (981) 81 19899 ext 62399 www.uacam.mx/epomex/epomex.html Contenido PRESENTACIÓN I PROLOGO III SEMBLANZAS CURRICULARES V 1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN EL SISTEMA ARRECIFAL VERACRUZANO 1 M.A. -

Taxonomía De Los Pepinos De Mar (Echinodermata: Holothuroidea) De La Península De
El Colegio de la Frontera Sur Taxonomía de los pepinos de mar (Echinodermata: Holothuroidea) de la Península de Yucatán y algunos de la University of Miami Deep Sea Expeditions. TESIS presentada como requisito parcial para optar al grado de Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural Por Stephanie Rosario Amador Carrillo 2017 i El Colegio de la Frontera Sur ____Jueves____, _26__ de _Octubre_ del 2017. Las personas abajo firmantes, miembros del jurado examinador de: Stephanie Rosario Amador Carrillo__________________________________________ hacemos constar que hemos revisado y aprobado la tesis titulada: Taxonomía de los pepinos de mar (Echinodermata: Holothuroidea) de la Península de Yucatán y algunos de la University of Miami Deep Sea Expeditions. para obtener el grado de Maestra en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. Nombre Firma Director _Dr. Sergio I. Salazar-Vallejo__________________________ Co-Director _Dr. Francisco A. Solís-Marín_________________________ Asesora _M. en C. Arely Martínez-Arce_________________________ Sinodal adicional _Dr. David González Solís____________________________ Sinodal adicional _ Dr. Miguel Ángel Ruiz Zárate__________________________ Sinodal suplente _ Dra. Rebeca Adriana Gasca Serrano____________________ ii En memoria del mi Padre Joaquín. a la salud de mi Madre Silvia, sobreviviente del cáncer; a la mejora emocional y física de mis hermanos Ingrid y Gabriel. Siempre unidos, los amo. iii AGRADECIMIENTOS A El Colegio de la Frontera Sur, Unidad Chetumal, por abrirme las puertas en su programa de Maestría en Ciencias en Recursos Naturales y Desarrollo Rural. A la beca nacional de CONACYT, por cubrir colegiaturas, manutención y servicios médicos durante estos estudios. Agradezco el apoyo de mi asesora M. en C. Arely Martínez- Arce y al Dr.