Refonte Du Reseau De Surface Atoubus Elements D’Analyse Lyon En Lignes.Org
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Systèmes De Transport Collectif Structurants
la CeMathèque d oossier s s i e r tthématique h é m a t i q u e > Les systèmes de transpotransportr t collectif strstructurantsucturants > Définition, rôle et impact d’un sysystèmestème de trtransportansport ccollectifollectif structurstructurantant > CaracCaractéristiquestéristiques d’un sysystèmestème de trtransportansport colleccollectiftif strucstructurantturant > LeLess réponses possibles : différents types de matériel roulant enenvisageablesvisageables > LeLess infrinfrastructuresastructures de déplacdéplacementement > Coût des différents sysystèmes.stèmes. Eléments comparcomparatifsatifs > Domaine de perpertinencetinence de chaque sysystèmestème La CeMathèque_n°26n°26 décembre 2008 > Préambule Divers systèmes de transport collectif, plus ou moins innovants selon les cas, permettent la mise en place d’une desserte très efficiente dans des contextes précis. Ils dynamisent le trans- port en commun, le rendent plus attractif et favorisent un accroissement de sa clientèle, dans des conditions qui le rendent également plus concurrentiel avec la voiture individuelle. Ces systèmes ont la caractéristique d’être structurants, c’est-à-dire qu’ils constituent l’ossature d’un réseau et offrent, à ce titre, une desserte qui rencontre un ensemble d’exigences préci- ses, au moins en termes de régularité, de fréquence et de rapidité. Ils proposent également un niveau de service élevé. Ils structurent aussi l’environnement dans lequel ils s’inscrivent : en termes d’attractivité et de développement des lieux d’activités, d’habitat, … Différentes solutions existent et connaissent un succès croissant. Elles témoignent d’une diver- sification importante des alternatives possibles, qui peuvent être adoptées au sein d’une 8 même ville. Chacune dispose de son domaine de pertinence. Ce qui indique clairement 200 qu’à chaque situation correspond une solution, pas nécessairement parfaite, mais la mieux adaptée parmi ces différentes solutions. -

French Light Rail
NEW FRENCH LIGHT RAIL SYSTEMS IN THE TWENTYFIRST CENTURY (Twentyone tramways, five tram-trains, five rubber-tyred tramways and one metro) -------------- by Graham Jellett Light Rail Transit Association Website: www.lrta.org Email: graham at jellett.plus.com Mobile: 07758087389 NEW TRAMWAYS, TRAM-TRAINS and METRO IN FRANCE from 2000 to 2017 Inner Urban Opening Inner Urban Opening Conurbation Population Year Conurbation Population Year STEEL WHEEL TRAMWAYS TRAM-TRAINS 1. Montpellier 264,538 2000 1. Paris T4 2,243,833 2006 2. Orléans 114,185 2000 2. Lyon 491,268 2010 3. Lyon 491,268 2000 3. Mulhouse 110,351 2010 4. Bordeaux 239,399 2003 4. Nantes 287,845 2011 5. Mulhouse 110,351 2006 5. Paris T11 2,243,833 2017 6. Valenciennes 43,471 2006 RUBBER-TYRED “TRAMWAYS” 7. Paris T3 2,243,833 2006 8. Marseille 850,636 2007 1. Nancy * 105,382 2001 9. Le Mans 143,240 2007 2. Caen * 108,793 2002 10. Nice 344,064 2007 3. Clermont- 140,597 2006 11. Toulouse 447,340 2010 Ferrand 12. Reims 180,752 2011 4. Paris T5 2,243,833 2013 13. Angers 148,803 2011 5. Paris T6 2,243,833 2014 14. Brest 140,547 2012 METRO 15. Dijon 151,504 2012 1. Rennes 208,033 2002 16. Le Havre 174,156 2012 (driverless) 17. Tours 134,633 2013 18. Paris T7 2,243,833 2013 Tramways, tram-trains and metros 19. Besançon 115,879 2014 are all electrically powered 20. Aubagne 45,800 2014 * Nancy and Caen trams also have 21. -

Pour Ou Contre Le Tramway Lyonnais ?
Cafés Géographiques de Lyon Christian Montès, Yann Calbérac 7 octobre 2003 Lyon, Le Tango de la rue, 7 octobre 2003 Pour ou contre le tramway lyonnais ? La rentrée des cafés géo lyonnais s'est faite ce soir sous le signe du changement : nos rencontres auront désormais lieu le deuxième mercredi de chaque mois (et non plus le jeudi), au Tango de la rue, à la Croix-Rousse (et non plus Place des Terreaux). C'est donc dans un autre cadre qu'anciens et nouveaux des cafés géo lyonnais se sont réunis mercredi soir autour de Christian Montès, maître de conférences à l'Université Lumière Lyon II, directeur du département de géographie, auteur d'une thèse sur les transports publics à Lyon, venu nous parler du tramway lyonnais. En l'absence du contradicteur qui devait co-animer le débat, Christian Montès fait les questions et les réponses. Les premières sont posées par le président de l'AUFT (Association des Usagers Fatigués du Tramway), et les secondes apportées par le trésorier de l'Association Lyon-Tramway. Même si l'AUFT n'existe pas (à la différence de Lyon-Tramway dont Christian Montès est effectivement responsable), et au-delà du simple exercice schizophrénique, parler du tramway sous forme de débat ne relève pas d'une simple mise en scène : cela fait écho aux discussions souvent houleuses que la mise en place d'un tramway dans une ville a toujours engendrées. Christian Montès au Tango de la rue Photo : Emmanuelle Delahaye 1) N'y a-t-il pas un paradoxe dans la décision des autorités lyonnaises, qui veulent faire de Lyon une métropole internationale, de développer un mode de transport aussi archaïque que le tramway au détriment du métro ? Le lien entre tramway et archaïsme est une idée fausse qui relève des représentations. -

Vers Le Succès D'implantation D'une Navette Aéroportuaire Pour Montréal Dans Une Perspective De Développement Durable
VERS LE SUCCÈS D'IMPLANTATION D'UNE NAVETTE AÉROPORTUAIRE POUR MONTRÉAL DANS UNE PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE Par Thomas Rozsnaki-Sasseville Essai présenté au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable en vue de l'obtention du grade de maître en environnement (M. Env.) Sous la direction de Monsieur Jean-Marie Bergeron MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE Mai 2014 SOMMAIRE Mots clés : développement durable, transports durables, transports ferroviaires, accessibilité, aéroport de Montréal L'objectif de cet essai est d'évaluer l'importance, mais aussi les conditions nécessaires pour assurer le succès d'implantation d'un futur système de transport rapide reliant le centre-ville de Montréal à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau, le tout dans une perspective de développement durable. Dans le contexte montréalais, l'aéroport Montréal-Trudeau est une infrastructure essentielle, notamment pour appuyer le développement économique et le tourisme et représente aussi un pôle d'emploi important. Pourtant, son accessibilité actuellement limitée avec le centre- ville restreint sa compétitivité par rapport à d'autres villes similaires qui possèdent une telle voie rapide entre deux pôles. Pour répondre à une telle problématique, plusieurs efforts ont été apportés pour mettre en œuvre une liaison ferroviaire entre l'aéroport et le centre-ville, mais encore aujourd'hui on ne dénote aucun résultat concret. Quatre projets comparables à la situation de Montréal sont ainsi analysés pour faire ressortir les principaux éléments qui ont su assurer le succès d'une telle implantation. Ceux-ci se résument aux moyens de financement utilisés, l'accessibilité aux usagers que de tels projets procurent, le type d'exploitation choisi, le service offert aux usagers, le matériel roulant utilisé et la possibilité de revaloriser des infrastructures déjà en place. -

French Light Rail Systems in the Twentyfirst Century
NEW FRENCH LIGHT RAIL SYSTEMS IN THE TWENTYFIRST CENTURY (Twentythree tramways, five tram-trains, four rubber-tyred tramways and one metro) -------------- by Graham Jellett Light Rail Transit Association Website: www.lrta.org Email: graham at jellett.plus.com Mobile: 07758087389 Inner Urban Opening NEW TRAMWAYS, TRAM-TRAINS Conurbation Population Year and METRO IN FRANCE STEEL WHEEL TRAMWAYS 2000 to 2019 1. Montpellier 264,538 2000 2. Orléans 114,185 2000 Inner Urban Opening 3. Lyon 491,268 2000 Conurbation Population Year 4. Bordeaux 239,399 2003 TRAM-TRAINS 5. Mulhouse 110,351 2006 1. Paris T4 2,243,833 2006 6. Valenciennes 43,471 2006 2. Lyon 491,268 2010 7. Paris T3 2,243,833 2006 3. Mulhouse 110,351 2010 8. Marseille 850,636 2007 4. Nantes 287,845 2011 9. Le Mans 143,240 2007 5. Paris T11 2,243,833 2017 10. Nice 344,064 2007 RUBBER-TYRED “TRAMWAYS” 11. Toulouse 447,340 2010 1. Nancy (see below) 105,382 2001 12. Reims 180,752 2011 2. Clermont- Ferrand 140,597 2006 13. Angers 148,803 2011 3. Paris T5 2,243,833 2013 14. Brest 140,547 2012 4. Paris T6 2,243,833 2014 15. Dijon 151,504 2012 16. Le Havre 174,156 2012 METRO 17. Tours 134,633 2013 1. Rennes (driverless) 208,033 2002 18. Paris T7 2,243,833 2013 Tramways, tram-trains and metros are all 19. Besançon 115,879 2014 electrically powered. Nancy trams also 20. Aubagne 45,800 2014 have diesel engines but are 21. Paris T8 2,243,833 2014 unidirectional. -

Romania's Long Road Back from Austerity
THE INTERNATIONAL LIGHT RAIL MAGAZINE www.lrta.org www.tautonline.com MAY 2016 NO. 941 ROMANIA’S LONG ROAD BACK FROM AUSTERITY Systems Factfile: Trams’ dominant role in Lyon’s growth Glasgow awards driverless contract Brussels recoils from Metro attack China secures huge Chicago order ISSN 1460-8324 £4.25 Isle of Wight Medellín 05 Is LRT conversion Innovative solutions the right solution? and social betterment 9 771460 832043 AWARD SPONSORS London, 5 October 2016 ENTRIES OPEN NOW Best Customer Initiative; Best Environmental and Sustainability Initiative Employee/Team of the Year Manufacturer of the Year Most Improved System Operator of the Year Outstanding Engineering Achievement Award Project of the Year <EUR50m Project of the Year >EUR50m Significant Safety Initiative Supplier of the Year <EUR10m Supplier of the Year >EUR10m Technical Innovation of the Year (Rolling Stock) Technical Innovation of the Year (Infrastructure) Judges’ Special Award Vision of the Year For advanced booking and sponsorship details contact: Geoff Butler – t: +44 (0)1733 367610 – @ [email protected] Alison Sinclair – t: +44 (0)1733 367603 – @ [email protected] www.lightrailawards.com 169 CONTENTS The official journal of the Light Rail Transit Association MAY 2016 Vol. 79 No. 941 www.tautonline.com EDITORIAL 184 EDITOR Simon Johnston Tel: +44 (0)1733 367601 E-mail: [email protected] 13 Orton Enterprise Centre, Bakewell Road, Peterborough PE2 6XU, UK ASSOCIATE EDITOR Tony Streeter E-mail: [email protected] WORLDWIDE EDITOR Michael Taplin 172 Flat 1, 10 Hope Road, Shanklin, Isle of Wight PO37 6EA, UK. E-mail: [email protected] NEWS EDITOR John Symons 17 Whitmore Avenue, Werrington, Stoke-on-Trent, Staffs ST9 0LW, UK. -

Revue Géographique De L'est, Vol. 52 / 1-2 | 2012 Entre Desserte (Péri)Urbaine Et Desserte Aéroportuaire, Les Tramways De L’Est
Revue Géographique de l'Est vol. 52 / 1-2 | 2012 Territoires et transports en commun en site propre Entre desserte (péri)urbaine et desserte aéroportuaire, les tramways de l’Est lyonnais The hard development of the public transport service to the airport and to the urban area. The case of the East Lyon tramway Jean Varlet Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/rge/3598 DOI : 10.4000/rge.3598 ISSN : 2108-6478 Éditeur Association des géographes de l’Est Édition imprimée Date de publication : 15 juin 2012 ISSN : 0035-3213 Référence électronique Jean Varlet, « Entre desserte (péri)urbaine et desserte aéroportuaire, les tramways de l’Est lyonnais », Revue Géographique de l'Est [En ligne], vol. 52 / 1-2 | 2012, mis en ligne le 18 octobre 2012, consulté le 08 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/rge/3598 ; DOI : https://doi.org/10.4000/ rge.3598 Ce document a été généré automatiquement le 8 septembre 2020. Tous droits réservés Entre desserte (péri)urbaine et desserte aéroportuaire, les tramways de l’Est... 1 Entre desserte (péri)urbaine et desserte aéroportuaire, les tramways de l’Est lyonnais The hard development of the public transport service to the airport and to the urban area. The case of the East Lyon tramway Jean Varlet 1 Dans la période récente d’expansion de nouveaux réseaux de transports urbains lourds, les territoires concernés se trouvent évidemment aux premières loges, lorsqu'ils tentent de traiter en partie les problèmes de congestion automobile, de stationnement, de pollution et de financement des transports en commun afin de faciliter les déplacements des citadins, des banlieusards et des habitants du périurbain. -

Le Renouveau Du Tramway En France
Le renouveau du tramway en France Dunkerque Belfort Colmar Arras Niort Béziers Thionville Amiens Belfort Maubeuge d Colmar r Arras Charleville Mézières Cherbourg Octeville Béthune Niort Béziers Boulogne sur Mer Lorient Limoges Cherbourg Brive-la-Gaillarde Saint-Malo Nevers Thionville Amiens Mâcon Brest Le Mans Roubaix Chartres Poitiers Agen Rennes Nancy Tarbes NantesBriey Metz Brest Marseille Clermont Ferran Antibes Saint-Étienne Orléans Toulouse Montpellie Bordeaux Roanne ParisCaen Bourg en Bresse Avignon Pau Évreux Annemasse Fort de France Grasse Annecy g Nancy oyes LilleNice Orléans Grenoble s Nîmes Tr Montbéliard La Rochelle ours illeurbanne Besançon Cannes Laval T V oulon Lenss Le Havre T Valence Douai ourcoing Cognac Calais Quimper s Mulhouse T Anger Dijon lenciennes Strasbour Albi Bayonne Beauvais Orléans Hagondange Va Auxerre Angoulême Reim Dunkerque g Aix-en-Provence Roanne Tours Bourg-en-Bresse Compiègne Saint-Quentin Rouen Lyon La Roche-sur-Yon Châteauroux s Saint-Deni Épinal Montbéliard Caen Nîmes Chalon sur Saône Valence Douai Carcassonne Périgueux Alençon Quimper illeurbanne Bordeaux V Saint-NazaireFort-de-France Calais Strasbour Rouen Dax Anger Dax Biscarosse Pau Beauvais Auxerre Nice oulouse Angoulême Hendaye Biarritz T Vichy Marseille lenciennes Perpignan Dunkerque Compiègne Va Saint-Quentin Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement www.developpement-durable.gouv.fr Dunkerque Belfort Colmar Arras Niort Béziers Thionville Amiens Belfort Maubeuge d Colmar r Arras Charleville Mézières -
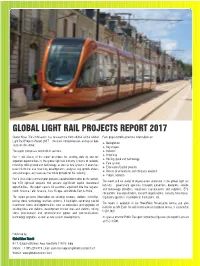
GMT Global Report Global Light Rail Report 2017 F1.Qxp
GLOBAL LIGHT RAIL PROJECTS REPORT 2017 Global Mass Transit Research has released the third edition of the Global Each project profile provides information on: Light Rail Projects Report 2017 – the most comprehensive and up-to-date Background study on the sector. Key players The report comprises two distinct sections. Network Ridership Part 1 (42 slides) of the report describes the existing state of, and the Rolling stock and technology expected opportunities in, the global light rail industry in terms of network, Fare system ridership, rolling stock and technology, as well as fare systems. It examines Extensions/Capital projects recent technical and financing developments; analyses key growth drivers Recent developments and contracts awarded and challenges; and assesses the future outlook for the industry. Project contacts Part 2 (555 slides) of the report provides updated information on the world's The report will be useful to organisations interested in the global light rail top 109 light-rail projects that present significant capital investment industry – government agencies, transport authorities, operators, service opportunities. The report covers 43 countries organised into five regions: and technology providers, equipment manufacturers and suppliers, EPC North America, Latin America, Asia, Europe, and Middle East & Africa. contractors, investors/lenders, research organisations, industry consultants, The report presents information on existing network, stations, ridership, regulatory agencies, development institutions, etc. rolling stock, technology and fare systems. It highlights upcoming capital The report is available in the PowerPoint Presentation format and also investment needs and opportunities such as extensions and upgrades of includes an MS Excel file with information in database format. It is priced at existing lines and stations; development of new lines and stations; rolling USD4,000. -

Anneau Des Sciences Expertise Complémentaire
Rapport final Anneau des Sciences Expertise complémentaire Karlsruhe, version du 25 mars 2013 Numéro de projet TTK: 132 081 Rapport final Anneau des Sciences Expertise complémentaire Maître d’ouvrage : CNDP 20, avenue de Ségur - 75007 Paris Contact : Dominique de Lauzières Tel /Fax : 01.42.19.20.26 Email : [email protected] Mandataire : TransportTechnologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) Siège Gerwigstraße 53 Agence de Lyon D-76131 Karlsruhe 47 rue Maurice Flandin Contact : Marc PEREZ F-69003 Lyon Tel. : + 49 (0) 721 62503-15 Tel : +33 (0) 4 37 91 65 60 Fax. : +49 (0) 721 62503-33 Email : [email protected] www.ttk.de Equipe d’étude : Marc Perez, Jan große Beilage, Privat Juillard Table des matières Table des matières 1 Introduction : cadrage de la mission par la CNDP ................................... 11 2 Analyse d’hypothèses alternatives possibles et réalistes en termes de trafics aux horizons d’étude ................................................................. 12 2.1 Des hypothèses de mobilité 2030 à retravailler ............................... 12 2.2 Des hypothèses dimensionnantes sur le volume et l’organisation des flux routiers à compléter ..................................... 15 2.2.1 Des hypothèses relatives à un éventuel péage urbain à intégrer 15 2.2.2 Des hypothèses relatives au grand contournement autoroutier nord-sud à préciser 16 2.2.3 Des hypothèses relatives à A45 à différencier 19 2.2.4 Des hypothèses de capacités de l’A6-A7 requalifiée à nuancer : des possibilités sans attendre le TOP 21 2.3 Les interactions entre les transports et l’urbanisme à intégrer dans les études de modélisation ..................................................... 24 2.3.1 Rappel sur les interactions transports / urbanisation 24 2.3.2 Une modélisation à reprendre en prenant en compte les interactions transport / urbanisme 31 3 Analyse des trois hypothèses TC sans infrastructure routière majeure ...................................................................................................... -

16.13 Light Rail to Airports
IARO report 16.13 Light rail to airports LRreport 1 Status:first edition, March 2013 IARO Report 16.13: Light rail to airports Editor: Andrew Sharp Published by International Air Rail Organisation Suite 3, Charter House, 26 Claremont Road, Surbiton KT6 4QZ Great Britain Telephone +44 (0)20 8390 0000 Fax +44 (0)870 762 0434 website www.iaro.com, www.airportrailwaysoftheworld.com email [email protected] ISBN 1 903108 19 5 © International Air Rail Organisation 2013 £250 to non-members Our mission is to spread world class best practice and good practical ideas among airport rail links world-wide. LRreport 2 Status:first edition, March 2013 Contents Introduction ---------------------------------------------------------------------- 5 Abbreviations and acronyms -------------------------------------------------- 6 What is light rail, and where does it serve airports? ------------------- 10 Issues around planning, construction and implementation --------- 12 Rolling stock design ----------------------------------------------------------- 18 Usage and characteristics ---------------------------------------------------- 20 Lessons from systems in operation ---------------------------------------- 25 Airport integration ------------------------------------------------------------- 30 Future plans --------------------------------------------------------------------- 31 Conclusions---------------------------------------------------------------------- 32 Annex: where light rail serves airports ------------------------------------ 33 Baltimore-Washington -

Concertation Sytral T3 Rhonexpress
CEDRUL le 3 juin 2010 Concertations préalables Concertation du Sytral sur l’aménagement de capacité de T3 et sur la desserte du grand stade au Montout sur la commune de Décines. Observations proposées par la CEDRUL A Monsieur le président du Sytral Sommaire Rappels p 2 1ère observation : le fond et la forme de la concertation p 2 2ème observation : sur l’aménagement de T3 / Rhônepress p 4 3ème observation : Sur l’extension de la ligne T3 pour la desserte du grand stade p 6 conclusions p 9 Annexes : p 12 Carte du PDU (de 1997 confirmé en 2005) p 12 Carte du réseau des transports en commun (doc DOG 2009) p 13 Liste des associations de la CEDRUL p 14 Contribution CEDRUL 3 juin 2010 Observations de la CEDRUL Observations de la CEDRUL dans le cadre des deux concertations publiques diligentées par le Sytral sur les aménagements de la ligne de tram T3 en vue du projet de grand stade sur le site du Montout à Décines. Rappels : Les concertations sur les aménagements de T3 ont été votées par le Sytral dans sa séance du 22 avril 2010 sous la forme de deux délibérations : - la délibération 10.051 qui concerne « l’extension de la ligne de tramway T3 pour la desserte du Grand Stade » - Et la délibération 10.052 qui porterait, selon une sémantique trompeuse, sur « les aménagements de la ligne de tram T3 pour faciliter l’exploitation commune de LEA/LESLYS » On notera : a) que ces délibérations s’inscrivent dans la démarche engagée par le Sytral depuis l’adoption du plan de la nouvelle mandature (2008 – 2014) alors que les projets inscrits au PDU de 1997 révisé en 2005 n’ont pas été réalisés ! b) Que le Sytral avait adopté auparavant, ce même 22 avril 2010, deux délibérations portant sur « l’extension de la ligne de tramway T2 à Eurexpo » : - la délibération 10.047 approuvant l’avant projet de cette extension (Celle-ci précise au bas de la page 1 que « l’ensemble de cette extension sera réalisé en voies doubles pour faciliter un prolongement ultérieur vers le nord d’Eurexpo, le Grand Stade et T3…»).