Rives Méditerranéennes, 11 | 2002
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
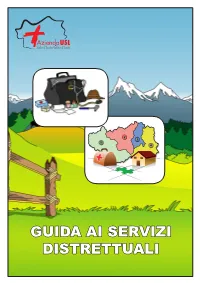
Guida Ai Servizi Distrettuali
GUIDA AI SERVIZI DISTRETTUALI 1. INTRODUZIONE I Distretti sono gli ambiti organizzativi territoriali per l’effettuazione di attività e l’erogazione di prestazioni di assisten- za sanitaria, di tutela e di promozione della salute, di prestazioni socio sanita- rie, di erogazioni dei servizi e delle prestazioni socio as- sistenziali, di integrazione tra servizi sanitari e servizi socio assistenziali. IL DISTRETTO È COSTITUITO AL FINE DI GARANTIRE: • l’assistenza primaria, ivi compresa la continuità assistenzia- le mediante il necessario coordinamento tra medici di medi- cina generale, pediatri di libera scelta, servizi di continuità assistenziale notturna e festiva, medici specialistici ambula- toriali • Il coordinamento dei medici di medicina generale e dei pe- diatri di libera scelta con le strutture operative a gestione diretta, nonchè con i servizi specialistici ambulatoriali ed i presidi ospedalieri ed extra ospedalieri accreditati • l’erogazione delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, connotate da specifica ed elevata integrazione • l’assistenza specialistica ambulatoriale • l’attività per la prevenzione e la cura delle tossicodipendenze • l’attività consulenziale per la tutela della salute dell’infan- zia, della donna e della famiglia • l’attività ed i servizi rivolti ai disabili e agli anziani 3 • l’attività ed i servizi di assistenza domiciliare integrata • l’attività ed i servizi per le patologie da HIV e per le patolo- gie terminali Al fine di garantire le attività ed i servizi sopradescritti i Distretti fanno capo ad un Direttore coadiuvato dai coordina- tori dei seguenti profili professiona- li: amministrativi, infermieri, direttore fisioterapisti, logopedisti, assistenti sanitari, oste- triche. L’integrazione fra le attività svolte dagli operatori afferenti al Distretto con gli al- tri servizi sanitari e sociali, caratterizza l’attività distrettuale. -

The Great Balcony of the Matterhorn (Trail 107)
The Great Balcony of the Matterhorn (Trail 107) This fascinating itinerary winds through Valtournenche taking the Matterhorn as point of reference, the majestic bulk of which will accompany and guide the traveller along the entire route. The Great Balcony, trail 107, is a journey through the culture and traditions of the Aosta Valley, providing direct contact with the mountain flora and fauna, merging the magic of the mountain with recreational and educational moments. It is a walk which keeps the person continuously immersed in breathtaking panoramas of light and shade, weak and vibrant colours. The Trekking trail travels the ancient paths which connect the places of Valtournenche since the dawn of time: the hamlet of Antey-Saint-André, with its 15th century Bell Tower, the town of La Magdeleine, with its ancient mills, the town of Chamois, pearl of the Alps, totally devoid of motorcars, the village of Cheneil, where important pages of mountaineering history have been written, the village of Breuil-Cervinia with its thousand contradictions, resting in an enchanting basin at the foot of the Gran Becca, the town of Torgnon with a great history of rural life and its immense pastures. The Great Balcony is not a particularly difficult trail, it is suffice to know the basic mountain safety rules and be in possession of the suitable equipment; it is actually an itinerary suited to all hiking enthusiasts. The trekking trail has twelve access points from which it is possible to embark on the route in one of the two directions of travel to discover the more striking areas of the Matterhorn Valley; it is recommended from June to September. -

09-Cyclotour-Fietsroutes.Pdf
PONT-SAINT-MARTIN , CICLOTOUR 01 Pont-Saint-Martin – Gressoney-La-Trinité Recommended Period: 1st May - 31 October Departure: Pont-Saint-Martin (Piazza IV Novembre) Arrival: Gressoney-La-Trinité (End of road - Staffal) Difference in level: 1473 m Length 38,2 Km Duration going there: 2h10 The Val de Gressoney is the first you meet as you enter Val d’Aosta if you are coming from the Po Valley. The Valley starts at Pont-Saint-Martin and is wedged into a narrow corridor which then opens out in the sight of Monte Rosa, a spectacular mountain with 28 peaks above 4,000 metres and which is the natural boundary with Switzerland. Places you go through on the route: - Pont-Saint-Martin (345 m) - Lillianes 6.1 km (650 m) - Fontainemore 9.1 km (785 m) - Issime 12 km (950 m) - Gaby 17.4 (1,045 m) - Gressoney-Saint-Jean 25.2 km (1,420 m) - Gressoney-La-Trinité 33.3 km (1,640 m) - Stafal 38.2 km (1,800 m) Route included in a stage of the Giro d'Italia in 1995 (Briançon/Gressoney). Stage won by Ouchakov (UCR) VERRÈS , CICLOTOUR 02 Verrès – Saint-Jacques (Ayas) Recommended Period: 1st May - 31 October Departure: Verrès (Roundabout on the SS26 road) Arrival: Saint-Jaques (Ayas, end of road) Difference in level: 1301 m Length 31,6 Km Duration going there: 2h08 From Verrès you make your way upwards along the wide, sunny Valle d'Ayas which climbs 32 km alongside the mountain river of Evançon. The first town you come to is Challand-Saint-Victor where you can visit the remains of Villa Castle from the 10th century. -

Procedura Per L'assistenza Delle Persone Poste In
PROCEDURA PER L’ASSISTENZA DELLE PERSONE POSTE IN QUARANTENA AL DOMICILIO A SEGUITO DI ORDINANZA PER COVID-19 VERSIONE 14/03/2020 LM 1/6 1 OBBIETTIVI In riferimento all’emanazione del documento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – CDPC prot. N. COVID/0010656 del 03/03/2020 “Misure operative di protezione civile per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19”, si ritiene utile dare indicazioni ai Comuni che attiveranno i Centri Operativi Comunali e organizzeranno servizi di assistenza a domicilio per le persone in quarantena domiciliare (per es. generi di prima necessità, farmaci, pasti preconfezionati…), eventualmente svolti da personale di organizzazioni regionali di volontariato di Protezione Civile. Gli obbiettivi sono riassumibili • Garantire la consegna di derrate alimentari, farmaci e altri generi di necessità alle persone poste in isolamento • Evitare il contatto diretto tra gli utenti e il personale incaricato del servizio; • Garantire lo smaltimento dei rifiuti. 2 INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE Il punto f) Livello Comunale (Comuni – COC) della direttiva in oggetto recita “volontariato, opportunamente formato e dotato di DPI” per lo svolgimento delle attività di assistenza domiciliare. Si ritiene che il volontariato impiegato non debba avere contatti con le persone in quarantena domiciliare. 3 ENTI COINVOLTI • L’amministrazione Comunale raccoglie le esigenze del territorio; • La struttura regionale raccoglie le esigenze dei comuni e le smista per competenza; • La Croce Rossa Italiana si occupa dell’assistenza -

Chamois Testo Ingl
THE HIGHEST COMMUNE IN THE AO S TA VALLEY (1815-2470M IT CAN ONLY BE R E ACHED BY CABLE CAR OR ON FOOT ALONG AN OLD MULE T R AC K ENCHANTING CHAMOIS C h a m o i s , situated on a plateau and surrounded by green pasture s , ove rlooks the narrow Va l t o u rnenche that runs from Monte Cervino down to Chatillon Saint Vi n c e n t . he town of Chamois, in the Valle d’Aosta, is situated in a panoramic place among the mountains of Grand Dent, Bec de Nana, Bec de Trecare, Falinère and Fontana Fredda. These mountains, gentle in shape, rise at the north side Tand shelter Chamois from the cold winds, granting it a dry and steady climate. Because of the favo u r a ble ex p o s i- tion of the whole hollow to the south, this natural amphitheatre is wa rm and quite sunny also in winter-time. It is like ly that the first fa rmers settled in these lands during the first centuries of the Low Middle Ages, when the gr owth of the population brought about the settlement of people in areas till then uninhabited or just seasonally occupied for transhu- mance. In the 14th century Chamois was a chief town of the Challant-Montjovets and in 1681 a Parish Seat under the auspices of S. Pantaleone. Chamois continued its development till the second half of the 19th century and the beg i n n i n g of the 20th century; then, after the economic crisis that affected the Valle d’Aosta and caused a big migration, its popu- lation decreased from 300 to less than a hundred inhabitants. -

Fiel Per Fascioni Enogastro
Padiglione Enogastronomico 2015 N. IMPRESA / ASSOCIAZIONE SEDE 1 AGLIOLIOPEPERONCINO s.s. SAINT-PIERRE 2 AGRIVAL s.s.a. GRESSAN 3 ALPE S.r.l. HONE 4 ALPENZU s.n.c. di Brunero Luciano e Thedy Laura ARNAD 5 AMBIENTE-GRUMEI di GIOVANNONI S. VERRAYES 6 ARNAD LE VIEUX S.r.l. ARNAD 7 AZIENDA AGRICOLA ANNA di De Santis Anna AOSTA 8 AZIENDA AGRICOLA ARPISSON s.s.a. COGNE 9 AZIENDA AGRICOLA "DA EMY" VALSAVARENCHE 10 AZIENDA AGRICOLA "Betemps Leo" BIONAZ 11 AZIENDA AGRICOLA "LA TZA" di Fiorini Eliana BIONAZ 12 AZIENDA AGRICOLA ROSSET s.s. QUART 13 Azienda Vitivinicola Lo Saint Julien di Pieiller Corrado FENIS 14 BIRRIFICIO '63 S.r.l. AOSTA 15 BISSON FABRIZIO GRESSAN 16 BONNE VALLEE di Chappoz Ezio & C. s.n.c. DONNAS 17 CASEIFICIO ARTIGIANO VARINEY s.n.c. GIGNOD 18 CASTAGNA Ezio GRESSAN 19 CENTRALE LAITIERE VALLEE D'AOSTE S.r.l. GRESSAN 20 CIOCCOLATERIA ROBBIANO di Dapino Ferruccio VALGRISENCHE 21 COFRUITS Soc. Coop. SAINT-PIERRE 22 CONIUGI GLAVINAZ s.n.c. di Chatrian Carlotta SAINT-VINCENT 23 COOPERATIVE DE L'ENFER Soc. Coop. ARVIER 24 Cooperativa Produttori Latte e Fontina Soc. Coop. a r.l. SAINT-CHRISTOPHE 25 "DA ILDA" di Gerard Edi e c. s.n.c. COGNE 26 BIRRIFICIO AOSTA - D.F.M. S.r.l. SAINT-CHRISTOPHE 27 DE BOSSES S.r.l. SAINT-RHEMY-EN-BOSSES 28 DINUS DONAVIT di Peaquin Marilena & C. s.n.c. ARNAD DISTILLERIA CORTESE degli eredi di Cortese G. & 29 SAINT-VINCENT C. s.n.c. Padiglione Enogastronomico 2015 N. IMPRESA / ASSOCIAZIONE SEDE 30 DOLCEVALLE Rossi Cinzia AOSTA 31 DONNET Emilio LA SALLE 32 DOUCE VALLEE di Vittaz Paola LA MAGDELEINE 33 FRAGNO Michel POLLEIN 34 FRASSY Ettore ARVIER 35 GECA Ortofrutta s.s. -

Aosta Di Telemark 7 Musica 8 Cinema E Teatro
gennaio 01 2017 INSERTO 1017 e SPECIALE FOIRE DE SAINT TRADIZIONE seghesiogrivon.it E FOLKLORE OURSAOSTE 30 - 31 2 JANVIER 2017 ANIMAZIONE E SPETTACOLI 2 SPORT 4 LABORATORI E CORSI 4 ATTIVITÀ, GITE E VISITE GUIDATE 5 www.regione.vda.it/artigianato pagine centrali CULTURA 6 EPIFANIA COPPA DEL MONDO M0STRE IN VALLE D’AOSTA DI TELEMARK 7 MUSICA 8 CINEMA E TEATRO pag. 4 9 Foto: Armani SAGRE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI EDIZIONE SPECIALE Tanti appuntamenti dedicati alla scoperta 10 della Valle d’Aosta e del suo territorio. ARTIGIANATO Scoprili tutti sull’edizione speciale: FIERE E MERCATINI • Passeggiate guidate pag. 3 con racchette da neve 10 Foto di Enrico Romanzi Venerdì 6 Sabato 14 Domenica 1 Torgnon Valpelline La Magdeleine Partenza telecabina { 18:00 Carnevale storico Arena { 14:00 - 16:00 Fiaccolata dei bambini della Coumba Freida Gara pupazzi di neve Una fiaccolata speciale e i protagonisti La tradizione lega la nascita del sono i bambini. carnevale al passaggio di Napoleone PARTECIPAZIONE LIBERA attraverso il Colle del Gran San Info Ufficio Turistico di Torgnon +39.0166.540433 Bernardo, nel maggio del 1800, durante www.torgnon.org la campagna d’Italia. I costumi TRADIZIONE sarebbero dunque la trasposizione Verrès allegorica delle uniformi dei soldati E FOLKLORE Collegiata di Saint Gilles { 10:00 francesi. Ritroviamo inoltre l’orso che Santa Messa dell’Epifania rappresenta l’avvicendarsi della Nella Collegiata di Saint Gilles, con la primavera; le code dei muli, che Martedì 3 partecipazione consueta del Coro di rappresentano i venti e servono per Verrès, sarà celebrata la Santa Messa allontanare le correnti d’aria nefaste; Champorcher dedicata all’Epifania. -

Étroubles Altitude: 1280 M – Inhabitants: 491
Santa Maria Assunta Parish Titular Saint: Our Lady of the Assumption, celebrated on 15th August ÉTROUBLES Altitude: 1280 m – Inhabitants: 491 troubles, already inhabited in Roman times, is located on tory parish priests appointed in the 16th century, the Great Saint the Resurrection from the Holy Sepulchre to the left. The the road to the Great Saint Bernard Pass, which has been Bernard Canon Regulars remained in charge of the Étroubles church’s interior decoration was made in 1847-1848 by a Éa way across the Alps since ancient times. The impor- parish until 1752 when Pope Benedict XIV decreed the appro- painter from Valsesia, Paolo Gianoli, but was mostly remade, tance of the trail in the Middle Ages, because of it being part priation by the Order of Saints Maurice and Lazarus of all the as it presents itself today, in the ‘60s by painter Ermanno of the Via Francigena, lead to the development of the small vil- Great Saint Bernard’s properties south of the Alps, including Politi and by decorator Dante Fredda. lage where a hospice for pilgrims and wayfarers existed back the right of patronage over parish churches. Since 1929 the The high altar made by stucco decorators Giuseppe and in 1317. At that time, on the eastern tip of the village next to parish has been in the free collation of the bishop. Domenico Pagani from Como, dates 1816. The wooden the parish church stood the ancient tower of the local noble chandeliers placed on the altar steps were made in 1865 family named De La Tour of Étroubles, who also bore the title The Church by Giovanni Comoletti from Valsesia; a few years later he of Lords of Bosses. -

Nuovo Albo Iscritti
ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI NOMINATIVO SEDE DI ENTE LOCALE DI INCARICO O C/O ENTI IN MOBILITA' TEMPORANEA SEGRETARI A TEMPO INDETERMINATO E CON ACCESSO PER CONCORSO PUBBLICO COMUNE DI FONTAINEMORE 1 ARMANI Fabrizio ARTAZ Roberto ANTEY-SAINT-ANDRE' E LA MAGDELEINE- CONVENZIONE 2 BARBARO Giuseppina COMUNE DI VILLENEUVE 3 BARONE Giorgio VERRES/CHAMPDEPRAZ-CONVENZIONE 4 BATTISTI Angela Maria QUART/NUS-CONVENZIONE 5 BOSCHINI Claudio ETROUBLES/EMRESE-CONVENZIONE 6 CANTELE Corrado incarico dirigenziale c/o ARPA 7 CENA Mirella incarico dirig. c/o CHAMBRE 8 CERISEY Ubaldo Alessio SAINT-RHEMY-EN-BOSSES/SAINT-OYEN-CONVENZIONE 9 CHABOD Osvaldo COMUNE DI SARRE 10 CHANOINE Elisa COMUNITA' MONTANA VALDIGNE MONT BLANC 11 CHIARELLA Antonio COMUNE DI LA THUILE 12 CONSOL Elvina ISSIME E COMUNITA' MONTANA WALSER-ALTA VALLE DEL LYS-CONVENZIONE 13 D'ANNA Eloisa Donatella COMUNE DI LA SALLE 14 DAVID Laura COMUNE DI GRESSONEY-LA-TRINITE' 15 DE SIMONE Aldo COMUNE DI CHATILLON 16 DEL COL Adriano incarico Segr.gen. c/o CHAMBRE 17 ALBO REGIONALE DEI SEGRETARI DEMARIE Ernesto COMUNITA' MONTANA MONTE CERVINO 18 DUPONT Vittorio COMUNE di SAINT-PIERRE 19 FAVRE Nelly COMUNE DI FENIS-reggenza SAINT-MARCEL 20 FEA Gianluca incarico dirigente c/o R.A.V.A. 21 GAIDO Dario HONE , BARD E PONTBOSET-CONVENZIONE 22 GIOVANARDI Gianluca COMUNE DI GRESSAN 23 GROSJACQUES Jeannette Pia incarico dirig.. c/o R.A.V.A. 24 HENCHOZ Raimondo COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE 25 JORRIOZ Piera COMUNITA' MONTANA MONT EMILIUS 26 LANESE Giuseppe AYMAVILLES/JOVENCAN-CONVENZIONE 27 LONGIS Anna COMUNE DI -

Place Jariot, 37 11020 Ayas COMUNE SEDE DEL CONSORZIO PRESI
Foglio1 DENOMINAZIONE DEL COMUNE SEDE DEL COMUNE PRESIDENTE INDIRIZZO PRESIDENTE C.A.P. CONSORZIO CONSORZIO RESIDENZA 1 MONT-SARON ALLEIN NEX Rosildo c/o Municipio - loc. Capoluogo, 1 11010 Allein 2 ANTEY-SAINT-ANDRÉ ANTEY-SAINT-ANDRÉ HOSQUET Livio fr. Cerian, 41 11020 Antey-Saint-André 3 ARPILLES SOPRA AOSTA VETTICOZ Daniela Emerica fraz. Signayes-Ossan, 127 11100 Aosta 4 CANALE DELLA COLLINA AOSTA CUAZ Giorgio Ugo Carlo via Giorgio Elter, 6 11100 Aosta 5 GIOANNET AOSTA PERRIER Ovidio fraz. Signayes-Preille, 92 11100 Aosta 6 LIN AOSTA CHARBONNIER Ennio fraz. Arpuilles-Capoluogo, 14 11100 Aosta 7 MÈRE DES RIVES AOSTA CASTIGLION Luciana via Voison, 14 11100 Aosta 8 POROSSAN AOSTA GALASSI Erika Margareta fr. Porossan-Roppoz, 15/A 11100 Aosta 9 ARNAD ARNAD ROLLAND Renzo fr. Clos-de-Barme, 35 11020 Arnad 10 ÉCHALLOD ARNAD SEZIAM Luciano fr. Échallod-Dessus, 3 11020 Arnad BAISE PIERRE, LO LAIR, PLAN- 11 ARVIER ALLEYSON Luigi via Saint Antoine, 61 11011 Arvier RAFORT c/o Comunità Montana Grand Paradis - 12 BORÈGNE-PILEO-LEYTIN ARVIER CLUSAZ Andrea 11018 Villeneuve piazza Chanoux, 8 13 EAUX SOURDES ARVIER PERRIER Roberto via Lostan, 94 11011 Arvier 14 ENFER ARVIER VALLET Mauro via Lostan, 39 11011 Arvier 15 L'ADRET D'AVISE AVISE DENARIER Marino fr. Cérellaz, 87 11010 Avise 16 RUNAZ AVISE MILLIÉRY Claudio fr. Praximond, 10 11010 Saint-Pierre c/o Comunità Montana Grand Paradis - 17 VEDUN-COL DE BARD AVISE VALLET Franco 11018 Villeneuve piazza Chanoux, 8 18 ANTAGNOD AYAS BOUGEAT Alexandre loc. Vagère s.n.c. 11020 Ayas VERCELLIN NOURRISSAT 19 MASCOGNAZ-CREST AYAS loc. -
![Éducation Et Sociétés Plurilingues, 43 | 2017 [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Août 2018, Consulté Le 24 Septembre 2020](https://docslib.b-cdn.net/cover/1340/%C3%A9ducation-et-soci%C3%A9t%C3%A9s-plurilingues-43-2017-en-ligne-mis-en-ligne-le-01-ao%C3%BBt-2018-consult%C3%A9-le-24-septembre-2020-3001340.webp)
Éducation Et Sociétés Plurilingues, 43 | 2017 [En Ligne], Mis En Ligne Le 01 Août 2018, Consulté Le 24 Septembre 2020
Éducation et sociétés plurilingues 43 | 2017 Varia Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/esp/1188 DOI : 10.4000/esp.1188 ISSN : 2532-0319 Éditeur Centre d'Information sur l'Éducation Bilingue et Plurilingue Édition imprimée Date de publication : 1 décembre 2017 ISSN : 1127-266X Référence électronique Éducation et sociétés plurilingues, 43 | 2017 [En ligne], mis en ligne le 01 août 2018, consulté le 24 septembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/esp/1188 ; DOI : https://doi.org/10.4000/esp. 1188 Ce document a été généré automatiquement le 24 septembre 2020. © CIEBP 1 SOMMAIRE Éditorial Diversité linguistique, une réalité aujourd’hui ! Andrée Tabouret-Keller Editoriale Diversità linguistica, oggi una realtà! Andrée Tabouret-Keller Hommage à Marie-Thérèse Weber Hommage à Marie-Thérèse Weber Comité de lecture d’ESP Pour Marie-Thérèse Weber Françoise Morvant Un exemple de plurilinguisme vécu au quotidien Marie-Thérèse Weber Histoire et société Accogliere uomini, accogliere parole. Lampedusa: una storia esemplare di ieri e di oggi. Giovanni Ruffino Val d’Aoste Les Sacs d’histoires : mode d’emploi Gabriella Vernetto Situation actuelle du français en Val d’Aoste Enquête et résultats Tristan Hauff Didactique & enseignement bi/plurilingue Come rompere la routine e lavorare le competenze orali in classe di FLE raccontando una bella storia Luigi Zammartino Éducation et sociétés plurilingues, 43 | 2017 2 Expériences & Recherches Comment travailler sur les attentats terroristes en classe de langue ? Gérald Schlemminger Deutsch lernen nach (und trotz) der Bildungsreform in Frankreich - eine Zwischenbilanz Laure Gautherot Témoignage De la magie des sons à la magie du monde Christiane Dunoyer Débat Langues et démocratie : un lien imprescriptible Gilbert Dalgalian Compte rendu d’ouvrage Dario Elia TOSI, Diritto alla lingua in Europa Giappichelli Editore, Torino, 2017, 416 p Luisa Revelli Résumé d’HDR Diffusion d’un classement académique en France : analyse des logiques sociales et des discours de presse sur le classement dit « de Shanghai ». -
AREAS ACTIVITY in the Andpaths Aosta Valley Osta Valley Is a Land of Matchless Beauty, with a Wealth of Natural Resources
PICNIC AREAS ACTIVITY in the andPATHS Aosta Valley osta Valley is a land of matchless beauty, with a wealth of natural resources. One easy, convenient Away to enjoy these superb natural surroundings is undoubtedly a day spent relaxing in the open air in one of the numerous areas equipped for the purpose that visitors can find throughout the region. For some time now, our Department, in collaboration with the various local administrations, has been devoting particular attention to the creation and upkeep of these delightful, inviting areas. As you flick through these pages, you can easily appreciate the amount of hard work and dedication that has gone into offering visitors such appealing, genuine, peaceful spots where they can breathe in the scent of the forest, admire breathtaking scenery or lie down and relax by the banks of lakes and rivers – and all of this in the comfort and convenience offered by the facilities available. There are now a total of 34 specially equipped areas throughout the region, located at various altitudes, from the 350 metres of the Cignas area in Donnas village up to the 2020 m a.s.l. of the Lake Lod area in Chamois village. All of them are well equipped for visitors, offering tables, benches, water fountains, barbecues and toilets, as well as easy access for visitors with disabilities. Each of the files presented here also contains interesting basic information on the type of plant life present, the surrounding scenery and the walking trips to be enjoyed nearby. There is also information on the eleven equipped routes in the region, and a few simple yet important rules on how to make the most of the facilities available while respecting both nature and your fellow visitors.