Extrait Offert
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Lettre De La Conformité
LA LETTRE DE LA CONFORMITÉ CHAPITRE FRANCE DE L’ACAMS – LETTRE D’INFORMATION #2 2018 NOTE DE LA RÉDACTION PARLONS Le 15 mai 2018, la conférence du Chapitre France de CONFORMITÉ l’ACAMS a tendu le micro à Stéphanie GIBAUD, qui se Avec l’ACAMS retrouve, bien malgré elle, sur le devant de la scène, depuis maintenant dix ans. Sa dénonciation de faits jugés L’ACAMS a lancé trois certificats de contraires à l’éthique ne lui laisse pratiquement aucun spécialisation, durant le premier répit. Stéphanie est venue témoigner de sa condition de semestre 2018, à destination des lanceuse d’alerte ; si jamais la forme féminine de ce détenteurs du CAMS (cours en anglais) : concept devait exister. Vous pouvez lire la retranscription de son intervention dans sa quasi-totalité sur le site de AML for FinTechs (s’adresse aux professionnels en l’ACAMS (https://www.acams.org/fr/chapitre- poste dans une société fintech européenne ou à toute france/#activites) ou bien vous référer à l’article publié en personne aspirant à le devenir). page 2 de ce bulletin, pour une vue d’ensemble sur le sujet. FinTech as Your Customers (à destination des Cette initiative personnelle est cher payée et met à jour un professionnels comptant des fintechs parmi leurs clients) paradoxe : les entreprises sont surveillées tout en étant mises à contribution lorsqu’il s’agit de lutter contre le crime. GDPR and 4AMLD (pour être à la page en matière de Nous avons choisi un article paru dans la dernière protection des données, le Règlement Général sur la publication d’AcamsToday sur le trafic d’organes pour Protection des Données étant entré en vigueur le 25 mai cette deuxième newsletter. -
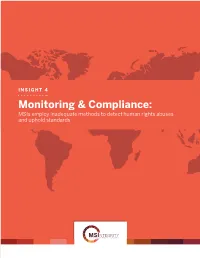
Monitoring & Compliance
I N S I G H T 4 Monitoring & Compliance: MSIs employ inadequate methods to detect human rights abuses and uphold standards The Institute for Multi-Stakeholder Initiative Integrity (MSI Integrity) aims to reduce the harms and human rights abuses caused or exacerbated by the private sector. For the past decade, MSI Integrity has investigated whether, when and how multi-stakeholder initiatives protect and promote human rights. The culmination of this research is now available in our report, Not Fit-for-Purpose: The Grand Experiment of Multi-Stakeholder Initiatives in Corporate Accountability, Human Rights and Global Governance. The full report contains six insights from experience with, and research into, international standard-setting multi-stakeholder initiatives. It also contains key conclusions from these insights, and perspectives on a way forward for improving the protection of human rights against corporate-related abuses. This is an excerpt of the full report, focusing on Insight 4. The six insights are: Insight 1: Influence — MSIs have been influential as human rights tools, but that influence, along with their credibility, is waning. Insight 2: Stakeholder Participation — MSIs entrench corporate power by failing to include rights holders and by preventing civil society from acting as an agent of change. Insight 3: Standards & Scope — Many MSIs adopt narrow or weak standards that overlook the root causes of abuses or risk creating a misperception that they are being effectively addressed. Insight 4: Monitoring & Compliance — MSIs employ inadequate methods to detect human rights abuses and uphold standards. Insight 5: Remedy — MSIs are not designed to provide rights holders with access to effective remedy. -

The Press Review 16-30 April 2016 Prepared by Transparency International Luxembourg
APPT asbl 11 C, Boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg Téléphone : (+352) 26.38.99.29 www.transparency.lu [email protected] The press review 16-30 April 2016 Prepared by Transparency International Luxembourg Disclaimer Cette revue de presse est compilée par Transparency International Luxembourg. Les idées et opinions exprimées dans les articles cités sont fournies à titre d’information uniquement et ne représentent pas les idées et opinions de Transparency International Luxembourg, qui s’en distance formellement. La véracité et l'exactitude des documents repris ou cités dans cette revue de presse n'a pas été confirmée par Transparency International Luxembourg. Pour toutes questions concernant ce service, nous vous prions de bien vouloir contacter notre bureau au numéro de téléphone 26 38 99 29 ou par e-mail au [email protected]. Information importante « hotline anti-corruption » Nous vous rappelons que nous avons mis en place une « hotline » qui permet d’obtenir aide et assistance gratuite pour les particuliers pour tout fait constitutif de corruption au sens large ou de trafic d’influence (en tant que victime ou de témoin). Vous pouvez nous joindre à cet effet par téléphone au numéro 26 38 99 29, par email [email protected] ou alors directement en nos bureaux situés au 11C, Bd. Joseph II, Luxembourg. Association pour la Promotion de la Transparence a.s.b.l. – R.C.S. Luxembourg F 7974 McD Europe Franchising McDonald's France fined €300 million for channelling profits through Luxembourg McDonald's in Luxembourg City centre on Place d'Armes Photo: LW Archive Published on Thursday, 21 April, 2016 at 11:09 (ADW) McDonald's France now has to pay 300 million euros in taxes in France for channelling profits through Luxembourg and other countries with lower tax rates, and therefore paid lower tax in France. -

Democratic Information in an Age of Corporate Power
14 09/2016 N°14 Democratic Information in an Age of Corporate Power Democratic Information in an Age of Corporate Power The Passerelle Collection The Passerelle Collection, realised in the framework of the Coredem initiative (Communauté des sites de ressources documentaires pour une démocratie mondiale– Community of Sites of Documentary Resources for a Global Democracy), aims at presenting current topics through analyses, propos- als and experiences based both on field work and research. Each issue is an attempt to weave together various contribu- tions on a specific issue by civil society organisations, media, trade unions, social movements, citizens, academics, etc. The publication of new issues of Passerelle is often associated to public conferences, «Coredem’s Wednesdays» which pursue a similar objective: creating space for dialogue, sharing and build- ing common ground between the promoters of social change. All issues are available online at: www.coredem.info Coredem, a Collective Initiative Coredem (Community of Sites of Documentary Resources for a Global Democracy) is a space for exchanging knowl- edge and practices by and for actors of social change. More than 30 activist organisations and networks share informa- tion and analysis online by pooling it thanks to the search engine Scrutari. Coredem is open to any organisation, net- work, social movement or media which consider that the experiences, proposals and analysis they set forth are building blocks for fairer, more sustainable and more responsible societies. Ritimo, the Publisher The organisation Ritimo is in charge of Coredem and of publishing the Passerelle Collection. Ritimo is a network for information and documentation on international solidarity and sustainable development. -

Version Djihadiste Ou Lamisme Intégriste N’Est Droite Y Vont De Leur Surenchère Dans Ce Qui Est En Ment Pour Ne Pas Se Laisser Terroriste
Prolétaires de tous les pays, unissons-nous ! Hebdomadaire Paraît le vendredi ISSN 0024-7650 N° 2741 1,20 12 février 2021 F: 1,20 € • DOM : 1,80 € - 2741 Le journal L 15290 d’Arlette Laguiller UNION COMMUNISTE (trotskyste) Plus menaçant que le Covid ! Le profit tueur d’emplois LO Pandémie Logement Algérie Communication Cherté, pénurie, La crise sociale à haute dose expulsions... s’approfondit Page 3 Page 5 Page 8 Au sommaire ÉDITORIAL Bulletins d’entreprise du 8 février LEUR SOCIÉTÉ La concurrence capitaliste : LuxLeaks : les secrets bien gardés de la bourgeoisie 4 un virus plus menaçant que le Covid ! Total : suppression des emplois, pas des dividendes 4 Offi ce Dépôt : pillage légal 4 Le capitalisme, la concurrence, la pro- expliquent que l’appât du gain et la concur- Logement : une crise priété privée ont l’art de gâcher les plus belles rence ont accéléré les découvertes de vaccins. permanente, qui s’aggrave 5découvertes, et c’est encore ce qui se passe Ils confondent tout. Les profi ts promis par la Non aux expulsions ! 5aujourd’hui avec la vaccination. vaccination anti-Covid ont donné à la recherche Livret A : pour le logement Les scientifi ques ont fait leur travail. En l’allure d’une ruée vers l’or, mais ce n’est pas ce ou pour la fi nance ? 5trouvant des vaccins effi caces, en dix mois, ils qui a motivé les chercheurs à travailler nuit et Éducati on : les mensonges ont réalisé un exploit que beaucoup estimaient jour. des dotati ons scolaires 6 impossible. L’enjeu est maintenant de fabri- Si les épidémiologistes, les biologistes ou Lycée Dorian – Paris 6e : postes supprimés, élèves sacrifi és 6quer vite et en masse, pour sauver des vies et les généticiens passent leur vie à étudier, sans Le Pré Saint-Gervais : pour ne pas être rattrapé par des variants qui garantie que leurs travaux aboutiront un jour, non aux fermetures de classes 6 échapperaient aux vaccins. -

The False Promise of Certi Cation
The false promise of certication How certication is hindering sustainability in the textiles, palm oil and sheries industries The false promise of certification Contents List of figures, tables and boxes 5 Executive summary and key findings 1. Executive summary 7 2. Key findings 8 2.1. Fisheries 8 2.2. Palm oil 9 2.3. Textiles 11 3. The way forward for certification 12 Chapter 1. About standards 15 1.1. Introduction 15 1.2. What are sustainability standards? 17 1.3. The history of voluntary standards and certification 19 Chapter 2. Case study: Palm oil 27 2.1. Palm oil: the world’s favourite vegetable oil 27 2.2. The problem with palm oil production 27 2.3. The rise of palm oil production standards and certification agreements 28 2.4. The largest palm oil certification scheme: Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) 30 www.changingmarkets.org The purpose of this report is to shed light on industry-specific 2.4.1. Introduction 30 issues related to environmental impacts of certification 2.4.2. Coverage 30 This report was published in May 2018 by the schemes and voluntary initiatives in fisheries, palm oil and 2.4.3. Criticism 30 Changing Markets Foundation. textiles sectors. The information in this document has been 2.5. Other schemes 33 obtained from sources believed reliable and in good faith Contributors to this report (in alphabetical but any potential interpretation of this report as making an 2.5.1. Rainforest Alliance (RA) / Sustainable Agriculture Network (SAN) 33 order): Alina Brad, Alice Delemare, allegation against a specific company or companies named 2.5.2. -

Five Years of Inaction Why Regulation of the Commodity Trade in Switzerland Is Long Overdue
A Public Eye Report – November 2018 Five years of inaction Why regulation of the commodity trade in Switzerland is long overdue Five years of inaction 1 INTRODUCTION 3 The progress made falls short of the scope of the problems 3 2 CORRUPTION: A CENTRAL ISSUE 5 Dangerous strategies 5 The risks are recognised at the international level 6 The OECD highlights Switzerland’s shortcomings 7 3 PROBLEMS IGNORED AND DATA LACKING IN SWITZERLAND 9 The myth that banks provide indirect oversight of the trade 9 Five years later there are still no reliable data 10 Human rights: “data” provided by a reticent industry 10 4 REGULATION TO MITIGATE SPECIFIC RISKS 13 A In favour of a supervisory authority 13 B Due diligence requirements on business partners 13 C Transparency of payments to governments 14 D Transparency of contracts 15 E Transparency of beneficial ownership of companies 16 F Due diligence requirements in relation to supply chains (human rights and the environment) 17 5 CONCLUSION: PAVING THE WAY OR ACTING UNDER PRESSURE 19 6 ANNEX: CASES FROM 2013–2018 21 ENDNOTES 26 IMPRINT Five years of inaction. Why regulation of the commodity trade in Switzerland is long overdue, November 2018, 28 pages | Authors Agathe Duparc, Marc Guéniat, Andreas Missbach, Urs Rybi and Géraldine Viret | Translation Kim Park | English Edition Simon Parker | Acknowledgments Camille Chappuis | Publisher Raphaël de Riedmatten | Layout Karin Hutter, karinhutter.com | Cover picture © Taylor Weidman – Getty Images The original French language version is also available at www.publiceye.ch. Cinq années d’inaction, novembre 2018, 28 pages. In the event of discrepancies between the English and French versions, the French version shall prevail. -

Reinventing Plastics
THE VEOLIA INSTITUTE REVIEW FACTS REPORTS 2019 REINVENTING PLASTICS In partnership with THE VEOLIA INSTITUTE REVIEW - FACTS REPORTS THINKING TOGETHER TO ILLUMINATE THE FUTURE THE VEOLIA INSTITUTE Designed as a platform for discussion and collective thinking, the Veolia Institute has been exploring the future at the crossroads between society and the environment since it was set up in 2001. Its mission is to think together to illuminate the future. Working with the global academic community, it facilitates multi-stakeholder analysis to explore emerging trends, particularly the environmental and societal challenges of the coming decades. It focuses on a wide range of issues related to the future of urban living as well as sustainable production and consumption (cities, urban services, environment, energy, health, agriculture, etc.). Over the years, the Veolia Institute has built up a high-level international network of academic and scientifi c experts, universities and research bodies, policymakers, NGOs, and international organizations. The Institute pursues its mission through high-level publications and conferences, and foresight working groups. Internationally recognized as a legitimate platform for exploring global issues, the Veolia Institute has official NGO observer status under the terms of the United Nations Framework Convention on climate change. THE FORESIGHT COMMITTEE Drawing on the expertise and international reputation of its members, the Foresight Committee guides the work of the Veolia Institute and steers its development. -

Les Secrets Inavouables De Nos Téléphones Portables" (1:18)
Nom : ............................................. Prénom : ........................................... Classe : ...... LLeess sseeccrreettss iinnaavvoouuaabblleess ddee nnooss ttéélléépphhoonneess ppoorrttaabblleess 9e | SHS Géographie | cycle 3 COE | 17.03.15 1 PARTIE 1 : PRODUCTEURS A. Introduction Fin 2013, on estime le nombre d'abonnements de téléphones portables à environ 7 milliards. Ce nombre ne prend pas en considération les téléphones sans abonnement (cartes prépayés, téléphones jetables). Sachant que la population mondiale est légèrement au- dessus de 8 milliards, on peut vite faire la moyenne mondiale : chaque habitant possède un portable ! Dans cette partie, nous allons nous intéresser à la fabrication de ces petits bijoux de technologie et révéler des vérités que beaucoup essaient de garder enfouies. Un documentaire diffusé sur France2 le 4 novembre 2014 va servir de support principal pour cette partie. (http://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/cash-investigation/cash- investigation-du-mardi-4-novembre-2014_730935.html) B. Fabricants 1. Retrouve la marque du téléphone selon le logo de l'entreprise. Samsung Apple Huawei Nokia Blackberry ZTE 2. Pour chaque marque, place sur la carte ci-dessous en vert le pays où se situe le siège social de l'entreprise et en rouge le pays où les téléphones sont assemblés. Blackberry : Nokia (Microsoft) : Waterloo (On, Redmond(WA, USA) CAN) Apple : Cupertino Samsung : Séoul (CA, USA) (Corée du Sud) Huawei + ZTE : Shenzhen (Chine) 9e | SHS Géographie | cycle 3 COE | 17.03.15 2 3. Quelles constatations peux-tu faire ? Selon réponses des élèves : pas de grandes marques en Europe ; production en Chine alors que sièges sociaux aux USA… 4. Pour quelles raisons, selon toi, les grandes marques de téléphonie décident-elles de faire fabriquer leurs produits en Chine. -

What Are the Impacts of Mobile Phones on Society?
What are the impacts of mobile phones on society? A study on the environmental, social and health impacts of mobile phones along their entire life cycle, from materials sourcing to end-of-life and recycling. Student work by Yaroslav Kroutchinin and Louise-Anne Baudrier (Sciences Po Paris, Clinique du droit, 2019). Translated from French into English by Gerard Bennet. Summary Context and development Raw material production Structure Environmental impacts Social impacts Health impacts Processing/manufacturing Structure Social impacts Environmental impacts Health impacts Usage and end-of-life Structure Environmental impacts Social impacts Health impacts Regulatory framework National regulatory framework in France EU regulatory framework International regulatory framework Alternatives At the national level At the multinational level Recommendations Recommendation regarding mobile phone production Recommendation regarding mobile phone use Recommendation regarding e-waste Context and evolution 1. Design takes place mostly in the United States 2. Mining and processing of raw materials takes place in SE Asia, Australia, central Africa and South America 3. Main components are manufactured in Asia, United States and Europe 4. Assembly is carried out in SE Asia Distribution to the rest of the world mostly by plane 2 In brief, a mobile phone consists of the following main parts (and related minerals): • A shell (plastic composition) • A screen (europium, yttrium, terbium, gallium etc.) • A battery (lithium, cobalt, gold and fluorinated electrolyte) • A circuit board (precious metals, rare earth metals, plastic and fiberglass) Sales of mobile phones have increased constantly since 2007. In addition to the ever-increasing number of units sold, manufacturers have tended to constantly increase the size of screens, the quality and precision of the camera, and the number of phone’s functions. -
NEUCHÂTEL Service Des Contributions Mieux Perçu Par Les Patrons PAGE 3 MARDI 5 AVRIL 2016 | | N0 77 | CHF 2.70 | J.A
" - 4ZTUÏNFJOOPWBOUQPVSQSPUÐHFSMFTTUPSFTEFMBHSÑMF1"(&4 CANTON DE NEUCHÂTEL Service des contributions mieux perçu par les patrons PAGE 3 MARDI 5 AVRIL 2016 | www.arcinfo.ch | N0 77 | CHF 2.70 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL Les ramifications suisses du tsunami Panama Papers IMPACT PLANÉTAIRE Au lendemain de la SUISSE ÉCLABOUSSÉE De nombreuses SPORTS Les noms de plusieurs sportifs révélation d’un vaste système d’évasion fiscale célébrités ayant eu recours à des sociétés de renom, en activité ou à la retraite, sont cités, par le Consortium international des journalistes offshore l’ont fait par le biais d’intermédiaires comme Lionel Messi, Michel Platini d’investigation, le choc est immense. – banques, avocats – actifs sur sol suisse. ou encore l’ex-golfeur Nick Faldo. PAGES 15 ET 21 Le Passage succombe L’ÉDITO SOPHIE WINTELER [email protected] à la tentation du diable LUCAS VUITEL PONTS-DE-MARTEL Un marché A nos lecteurs JËX^iXe[`i\kjËle`igfliki\\eZfi\gcljg\iZl$ au bétail de plus kXek\kmfljf]]i`i#Z_ i\c\Zki`Z\\kZ_\ic\Zk\li# en plus couru [\d\`cc\li\jZc\]j[\Zfdgi_\ej`fegfli[Zf$ PAGE 7 [\icËXZklXc`kjl`jj\#`ek\ieXk`feXc\\kZfefd`$ hl\%Mf`c~c\[]`hl\efljmfljXeefeZ`fejc\)/ fZkfYi\gXjjXm\ZcXj`^eXkli\gXi<J?D\[`Xj# LITTORAL gifgi`kX`i\[\½CË<ogi\jj¾#½CË@dgXik`Xc¾#[l ½Eflm\cc`jk\¾ ~ J`fe# [\ ½CX :k\¾ ~ Epfe# Il revendait [Ële\ZfccXYfiXk`feXm\Zc\^iflg\]i`Yfli^\f`j JX`ek$GXlc#[`k\li[\½CXC`Y\ik¾% des ordinateurs G\e[Xek Z`eh Xej# c\j hlfk`[`\ej [l ^iflg\ volés à l’Etat <J?D[`XjfekkiXmX`cc\ej\dYc\~E\lZ_k\c PAGE 5 Xlj\`e[\cË\ek`k8IGi\jj\gflicXiXc`jXk`fe[\ Z`ehgX^\jZfddle\jjlic\jjla\kjjlgiXi^`f$ -

Tax Havens Against World Democracy Jacques Fontanel
Tax Havens against World democracy Jacques Fontanel To cite this version: Jacques Fontanel. Tax Havens against World democracy. Economie de la Sécurité internationale, Nov 2016, Paris, France. hal-02545502 HAL Id: hal-02545502 https://hal.univ-grenoble-alpes.fr/hal-02545502 Submitted on 17 Apr 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Tax Havens against World democracy Jacques Fontanel Seminar, UNECON (State University of Economy of Saint-Petersbourg), Russia, April 2016. Seminar, Institut Libre d’Etudes de Recherche Internationale (ILERI), Paris November 2016 CESICE, Grenoble, 2016 Summary: Globalization has enabled some unscrupulous countries to market their sovereignty. These states pursue a policy of the “beggar-thy-neighbour” type, which allows them to receive a number of multinational firms registered offices after particularly attractive financial tax negotiations with governments in place. What are their methods, the guilty States, the multinational firms concerned, the cost for public service, the violence of inequality, the new insecurity for international health and protection of citizen? Tax havens threat democracy. Résumé : La mondialisation a permis à certains pays peu scrupuleux de commercialiser leur souveraineté. Ces États mènent une politique du type "beggar-thy-neighbour", qui leur permet d'accueillir un certain nombre de sièges sociaux de multinationales après des négociations fiscales particulièrement intéressantes avec les gouvernements en place.