Rapport Du Jury
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Géraldine Crahay a Thesis Submitted in Fulfilments of the Requirements For
‘ON AURAIT PENSÉ QUE LA NATURE S’ÉTAIT TROMPÉE EN LEUR DONNANT LEURS SEXES’: MASCULINE MALAISE, GENDER INDETERMINACY AND SEXUAL AMBIGUITY IN JULY MONARCHY NARRATIVES Géraldine Crahay A thesis submitted in fulfilments of the requirements for the degree of Doctor in Philosophy in French Studies Bangor University, School of Modern Languages and Cultures June 2015 i TABLE OF CONTENTS Abstract .................................................................................................................................... vii Acknowledgements ................................................................................................................... ix Declaration and Consent ........................................................................................................... xi Introduction: Masculine Ambiguities during the July Monarchy (1830‒48) ............................ 1 Introduction ..................................................................................................................................... 1 Theoretical Framework: Masculinities Studies and the ‘Crisis’ of Masculinity ............................. 4 Literature Overview: Masculinity in the Nineteenth Century ......................................................... 9 Differences between Masculinité and Virilité ............................................................................... 13 Masculinity during the July Monarchy ......................................................................................... 16 A Model of Masculinity: -

Pretty Tgirls Magazine Is a Production of the Pretty Tgirls Group and Is Intended As a Free Resource for the Transgendered Community
PrettyPretty TGirlsTGirls MagazineMagazine Featuring An Interview with Melissa Honey December 2008 Issue Pretty TGirls Magazine is a production of the Pretty TGirls Group and is intended as a free resource for the Transgendered community. Articles and advertisements may be submitted for consideration to the editor, Rachel Williston, at [email protected] . It is our hope that our magazine will increase the understanding of the TG world and better acceptance of TGirls in our society. To that end, any articles are appreciated and welcomed for review ! Pretty TGirls Magazine – December 2008 page 1 PrettyPretty TGirlsTGirls MagazineMagazine December 2008 Welcome to the December 2008 issue … Take pride and joy with being a TGirl ! Table of contents: Our Miss 2008 Cover Girls ! Our Miss December 2008 Cover Girls Cover Girl Feature – Melissa Honey Editor’s Corner – Rachel Williston Ask Sarah – Sarah Cocktails With Nicole – Nicole Morgin Dear Abby L – Abby Lauren TG Crossword – Rachel Williston In The Company Of Others – Candice O. Minky TGirl Tips – Melissa Lynn Traveling As A TGirl – Mary Jane My “Non Traditional” Makeover – Barbara M. Davidson Transgender Tunes To Try – Melissa Lynn Then and Now Photo’s Recipes by Mollie – Mollie Bell Transmission: Identity vs. Identification – Nikki S. Candidly Transgender – Brianna Austin TG Conferences and Getaways Advertisements and newsy items Our 2008 Calendar! Magazine courtesy of the Pretty TGirls Group at http://groups.yahoo.com/group/prettytgirls Pretty TGirls Magazine – December 2008 page 2 Our Miss December 2008 Cover Girls ! How about joining us? We’re a tasteful, fun group of girls and we love new friends! Just go to … http://groups.yahoo.com/group/prettytgirls Pretty TGirls Magazine – December 2008 page 3 An Interview With Melissa Honey Question: When did you first start crossdressing? Melissa: Early teens, I found a pair of nylons and thought what the heck lets try them on! I was always interested in looking at women's legs and loved the look of nylons. -

Ananda Devi's Narrative Strategies and Subversions. Ritu Tyagi Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2009 Ananda Devi's Narrative Strategies and Subversions. Ritu Tyagi Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the French and Francophone Language and Literature Commons Recommended Citation Tyagi, Ritu, "Ananda Devi's Narrative Strategies and Subversions." (2009). LSU Doctoral Dissertations. 3561. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3561 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. ANANDA DEVI’S NARRATIVE STRATEGIES AND SUBVERSIONS A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of French Studies by Ritu Tyagi B.A., Jawaharlal Nehru University, 1999 M.A., University of California Irvine, 2003 May 2009 ©Copyright 2009 Ritu Tyagi All rights reserved ii ACKNOWLEDGEMENTS The completion of this dissertation and doctoral degree would not have been possible without the help and support of many individuals. I would like to express my profound gratitude to my dissertation director, Dr. Jack Yeager, for his stimulating suggestions and encouragement. His pleasant smile, optimism, and positivity helped me sail through the most frustrating and depressing moments. My thanks also go to the members of my committee for their support: Dr. -

The Dramaturgy of Marivaux: Three Elements of Technique
72-4653 SPINELLI, Donald Carmen, 1942- THE DRAMATURGY OF MARIVAUX: THREE ELEMENTS OF TECHNIQUE. The Ohio State University, Ph.D., 1971 Language and Literature, modern University Microfilms,A XE R O X Company, Ann Arbor, Michigan © 1 9 7 1 Donald Carmen Spinelli ALL RIGHTS RESERVED THE DRAMATURGY OF MARIVAUX* THREE ELEMENTS OF TECHNIQUE DISSERTATION Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The Ohio State University By Donald C. Spinelli, B.A., M.A. ****** The Ohio State University 1971 Approved by Adviser nt of Romance Languages PLEASE NOTE: Some Pages have Indistinct print. Filmed as received. UNIVERSITY MICROFILMS TO MY MOTHER AND FATHER ACKNOWLEDGMENTS I would like to take this opportunity to express my gratitude to some of the people who have made this work possible. Professors Pierre Aubery and V. Frederick Koenig took a personal interest in my academic progress while I was at the University of Buffalo and both en couraged me to continue my studies in French, At Ohio State University I am grateful to my ad visor* Professor Hugh M. Davidson* whose seminar first interested me in Marivaux. Professor Davidson*s sound advice* helpful comments* clarifying suggestions and tactful criticism while discussing the manuscript gave direction to this study and were invaluable in bringing it to its fruition. 1 must thank Emily Cronau who often gave of her own time to type and to help edit this dissertation! but most of all I am grateful for her just being there when she was needed during the past few years. -

Beyond the Check-Boxes: Exploring Genderqueer Identity
Beyond the Check-Boxes: Exploring Genderqueer Identity My rules for using labels: Some labels I use in self-identification: ● rule 1: labels work best when we determine ● Genderqueer describes my gender identity them for ourselves ● Butch describes my appearance ● rule 2: labels are only good as long as they ● Queer describes my sexuality, not limited by work for you gender ● rule 3: labels can be used alone or in combination; combinations add complexity and depth Remember: different people interpret different Remember: labels are words, words are labels differently: to communicate better, go beyond approximations we use to communicate complex the shorthand concepts, they are short-hand and don’t tell the whole story Why use Labels? In some very basic ways, we use labels to help us identify who is a friend/enemy, who might be attracted to us and who we might be attracted to. We also seek out people we think are like us, to form alliances and find common-ground, people who will support and understand us. Even though words are just approximations, we rely on words to communicate with others. For many of us, words also form the backbone of our thought processes, our inner dialogue, as we seek to explore and define ourselves. Unfortunately, labels can also be used against us, to limit us, box us in and as the basis for discrimination and bigotry. Goals for the session: Each participant will leave with a better understanding of the terms used to describe gender identities which are outside of, between, or some combination of the genders. -

Challenging Common Representations of Bareback Sex and HIV Through Ethnography
MOVING BEYOND RESISTANCE AND MEDICALIZATION: Challenging Common Representations of Bareback Sex and HIV through Ethnography Julien Brisson A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in partial fulfillment of the requirements for the MA degree in anthropology School of Sociological and Anthropological Studies Faculty of Social Sciences University of Ottawa © Julien Brisson, Ottawa, Canada, 2015 ABSTRACT Condomless sex between gay men, also known as bareback sex, has been a popular object of research since the beginning of the AIDS epidemic. One of the most common perspectives on studying bareback sex has been through a medicalization approach, as it may be observed notably with public health and psychology. In other instances, the abandonment of condom use is framed as an intentional act of resistance to public health. Through the methodological approach of ethnography, I studied how young gay men in their twenties from Toronto understand bareback sex in relations to popular discourses of the sexual practice. While my informants initially had a certain way of talking of bareback sex, their narratives on the sexual practice changed with time and challenged the common representations of bareback sex as either a site of resistance or medicalization, which I argue was possible because of the methodological approach of ethnography. During fieldwork, other themes also emerged in regards to shaping understandings of bareback sex and HIV as it relates to young gay men, such as the traumatic memories of an older generation who witnessed the earlier days of the AIDS epidemic. From this anthropological research, I seek to invite the opportunity to rethink the relationship between sex, biomedical science and HIV. -

REPRESENTATIONS of MARIE- ANTOINETTE in 19Th
L’AUGUSTE AUTRICHIENNE: REPRESENTATIONS OF MARIE- ANTOINETTE IN 19th CENTURY FRENCH LITERATURE AND HISTORY --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- by KALYN ROCHELLE BALDRIDGE Dr. Carol Lazzaro-Weis, Dissertation Superviser MAY 2016 APPROVAL PAGE The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled L’AUGUSTE AUTRICHIENNE: REPRESENTATIONS OF MARIE-ANTOINETTE IN 19th CENTURY FRENCH LITERATURE AND HISTORY presented by Kalyn Rochelle Baldridge, a candidate for the degree of doctor of philosophy, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. Professor Carol Lazzaro-Weis Professor Ilyana Karthas Professor Valerie Kaussen Professor Megan Moore Professor Daniel Sipe ACKNOWLEDGEMENTS I would first of all like to acknowledge the Department of Romance Languages at the University of Missouri for having supported me throughout my dissertation writing process, allowing me to spend time in France, and welcoming me back to the campus for my final year of study. Secondly, I would like to thank the members of my committee, Dr. Valerie Kaussen, Dr. Megan Moore and Dr. Daniel Sipe, for taking the time to read my research and offer their welcome suggestions and insight. I would especially like to thank Dr. Ilyana Karthas, from the Department of History, for having spent many hours reading earlier drafts of my chapters and providing me with valuable feedback which spurred me on to new discoveries. I am most grateful to my dissertation superviser, Dr. Carol Lazzaro-Weis. -

Drag Et Performance Luca Greco, Stéphanie Kunert
Drag et performance Luca Greco, Stéphanie Kunert To cite this version: Luca Greco, Stéphanie Kunert. Drag et performance. Encyclopédie critique du genre. Corps, sexual- ité, rapports sociaux, 2016. hal-01612233 HAL Id: hal-01612233 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01612233 Submitted on 6 Oct 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. « Drag et performance » Greco Luca, Kunert Stéphanie, In Encyclopédie critique du genre. Corps, sexualité, rapports sociaux. Paris, La Découverte, « Hors collection Sciences Humaines », 2016, p. 222-231. URL : https://www.cairn.info/encyclopedie-critique-du-genre--9782707190482-page- 222.htm Résumé : Dans cette contribution, après avoir retracé l’émergence historique de la catégorie « drag » et circonscrit les contours sémantiques dessinés par cette notion, notamment par rapport à d’autres catégories proches comme « travestissement » et « camp », nous mettrons en évidence ses apports pour une vision performative des pratiques de transformation corporelle genrées. Dans ce cadre, nous présentons les enjeux politiques et épistémologiques de la distinction entre performance et performativité, de l’approche intersectionnelle des pratiques Drag et d’une lecture chorégraphique inspirée par les dance studies. En conclusion, nous montrons quelques pistes de recherche qui permettent de dépasser une vision dichotomique des pratiques Drag (« Drag Queen » versus « Drag King ») pour proposer une vision fluide et plurielle des genres. -

Virtues for the People Aspects of Plutarchan Ethics PLUTARCHEA HYPOMNEMATA
virtues for the people aspects of plutarchan ethics PLUTARCHEA HYPOMNEMATA Editorial Board Jan Opsomer (K.U.Leuven) Geert Roskam (K.U.Leuven) Frances Titchener (Utah State University, Logan) Luc Van der Stockt (K.U.Leuven) Advisory Board F. Alesse (ILIESI-CNR, Roma) M. Beck (University of South Carolina, Columbia) J. Beneker (University of Wisconsin, Madison) H.-G. Ingenkamp (Universität Bonn) A.G. Nikolaidis (University of Crete, Rethymno) Chr. Pelling (Christ Church, Oxford) A. Pérez Jiménez (Universidad de Málaga) Th. Schmidt (Université de Fribourg) P.A. Stadter (University of North Carolina, Chapel Hill) VIRTUES FOR THE PEOPLE ASPECTS OF PLUTARCHAN ETHICS Edited by GEERT ROSKAM and LUC VAN DER STOCKT Leuven University Press © 2011 Leuven University Press / Presses Universitaires de Louvain / Universitaire Pers Leuven. Minderbroedersstraat 4, B-3000 Leuven (Belgium) All rights reserved. Except in those cases expressly determined by law, no part of this publication may be multiplied, saved in an automated datafile or made public in any way whatsoever without the express prior written consent of the publishers. ISBN 978 90 5867 858 4 D/2011/1869/3 NUR: 735-732 Design cover: Joke Klaassen Contents Efficiency and Effectiveness of Plutarch’s Broadcasting Ethics 7 G. Roskam – L. Van der Stockt 1. Virtues for the people Semper duo, numquam tres? Plutarch’s Popularphilosophie on Friendship and Virtue in On having many friends 19 L. Van der Stockt What is Popular about Plutarch’s ‘Popular Philosophy’? 41 Chr. Pelling Plutarch’s Lives and the Critical Reader 59 T.E. Duff Greek Poleis and the Roman Empire: Nature and Features of Political Virtues in an Autocratic System 83 P. -
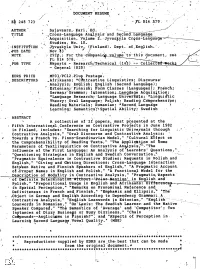
Reports - Researcii/Technical (10) -- Collec O -General (020)
, " DOCUMENT RESUME Et) 248 723 0-14. 579 , / ,AUTHOR Sajavaaral Kari, Ed. TITLE Cross-Language.Analysisand Secimd Language Acquisition. Vc4ume 2.:JyvasicYla CrQss-Language----:-.------------- Studies, No. 10 . Jimaskyla Univ, (inland). Dept. of,Eng,lish.'. ,,PUB DATE Nov 13" . , NOTE 292p.; For -the volu e to-thisdocument,see / FL 014 578. :. PUE TYPE Reports - Researcii/Technical (10) -- Collec o -General (020) EDRS PRICE MF01/PC12,Plup Postage. DESCRIPTORS Afrikaans; *Cantrastive Linguistics; Discourse' Analysis; Effglish; gnglish (Second Languige); Estonian ,/Finnish; Form Classes (Language0; French; Germa , Grammat; Iatonation4r_Langdage Acquisition; *L uage Research; Language *Linguigtic Theory; Oral Language; Polish; Reading Cdmprehensqm; Reading Materials; Rumanian; *Second. Language Learning; Semantics-;NSpatial Ability; Swedish . ABSTRACT A collection of'21 papers mostperesented at the Fifth Internationi1,Conference onContrastive Projects in June 1982 in Finland, includes: "Searching for Linguistic Universals through I,- Contrastive Analysis," "Oral- Discourse and Gon.trastive Analysis: f .Towards a French 1p. Finno-Scandinavian Model," "Cultural Effect on the Comprehensibility. of Reading Texts.," "The AppliOetion of some Parameters of Textlinguistics on ContrastiveAnql,lysis'","The Influence of the-First Language: An Analysis of Learners' Questions," "Questioning Strategies in Eiglish and Swedish Conversation," "Pragmatic Equivalence in Contrastive Studies: Requests in Polish and English," "Giving and Getting Directions: Cross-Language Interaction Bet#een Native and Finnish Speakers of English," "A Pragmatic Account ot-Proper Names in English and Polish," "A Functional Model for the Description_of Modality in Contrastive Analysis," "Pragmatici 'Aspects of Definite. iferiiiiirriatiblviittzt-hotrt,.-Lp.r404.41enti.u. ' in English and Polish," "Prepositional Usage in English andAfrikaiiiii-riTterenceis----, in Spatial Perception," "Remarks on Pronominal Reference and Definiteness in French an Finnish," "Emphatis and Ellipsis,'" "The. -
À La Croisée Des Genres : Trajectoires Et Identités « Trans » Au Québec
Université de Montréal À LA CROISÉE DES GENRES : TRAJECTOIRES ET IDENTITÉS « TRANS » AU QUÉBEC Par Isabelle Chiasson-Levesque Département de sociologie Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté à la Faculté des arts et des sciences en vue de l’obtention du grade de maître ès sciences (M. Sc.) en sociologie Mai 2018 © Isabelle Chiasson-Levesque 2018 Résumé Ce mémoire porte sur les trajectoires et les identités trans au Québec. Il s’appuie sur les récits de vie de 11 personnes s’identifiant trans au Québec, afin de mieux comprendre l’influence des normes sociales de genre sur leur parcours de vie et la façon dont elles se manifestent dans le cadre des interactions sociales quotidiennes. Fondée à la fois sur des récits de vie d’hommes et de femmes trans, cette recherche a ainsi pour but de mesurer l’impact d’un système de normes basé sur la binarité des genres. Cette lecture croisée des genres permet de mettre en lumière les principales convergences et divergences entre les expériences des hommes trans et celles des femmes trans. Dans un premier temps, la recherche montre que la trajectoire identitaire de genre prend place, pour tous et toutes, dès l’enfance, période où cette question du genre serait présente, mais en « sommeil ». La période de l’adolescence équivaut ensuite à une période d’éveil aux stigmates qui les aurait mené-es à intérioriser leur différence. L’âge adulte -le présent- est le moment d’extériorisation identitaire qui s’inscrit dans une série d’expériences de transition. Dans un deuxième temps, cette étude fera état des inégalités sociales de genre et des inégalités transidentitaires, et de la façon dont ces deux formes d’inégalités s’articulent, notamment dans le cadre des espaces publics et des interactions sociales. -
« Ni Hommes Ni Femmes, Le Binarisme Nous Rend Malades !»
Université catholique de Louvain Faculté des sciences économiques, sociales et politiques Département des sciences politiques et sociales « Ni hommes ni femmes, le binarisme nous rend malades !» Enquête ethnographique auprès de personnes transgenres à Bruxelles. par Céline LORGE Promoteur : Prof. Anne-Marie Vuillemenot Mémoire présenté dans le cadre du Rapporteur : Prof. Jacinthe Mazzocchetti Master 120 en Anthropologie, Finalité approfondie Session de septembre 2010 1 2 Code de déontologie « Je déclare sur l’honneur que ce mémoire a été écrit de ma plume, sans avoir sollicité d’aide extérieure illicite, qu’il n’est pas la reprise d’un travail présenté dans une autre institution pour évaluation, et qu’il n’a jamais été publié, en tout ou en partie. Toutes les informations (idées, phrases, graphes, cartes, tableaux, …) empruntées ou faisant référence à des sources primaires ou secondaires sont référencées adéquatement selon la méthode universitaire en vigueur. » « Je déclare avoir pris connaissance et adhérer au Code de déontologie pour les étudiants en matière d'emprunts, de citations et d'exploitation de sources diverses et savoir que le plagiat constitue une faute grave. » 3 Remerciements Je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes de Genres Pluriels qui m'ont ouvert les portes de leur association, qui m'ont fait partager cette aventure intime, m'ont accordé leur confiance et leur amitié. Je les remercie pour tous les échanges enrichissants qu'il y a pu y avoir …ainsi que pour les nombreux rires échangés. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont accompagnées de près ou de loin dans cette aventure fluide, qui ont apporté de l'intérêt à ce terrain, qui m'ont conseillée et soutenue tout au long de ce travail.