Chronique Trimestrielle 33 Septembre-Novembre 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Full Text (PDF)
Document generated on 10/01/2021 5:33 a.m. L'Inconvénient La nymphette divinisée David Dorais L’Amérique et nous Number 63, Winter 2016 URI: https://id.erudit.org/iderudit/80611ac See table of contents Publisher(s) L'Inconvénient ISSN 1492-1197 (print) 2369-2359 (digital) Explore this journal Cite this review Dorais, D. (2016). Review of [La nymphette divinisée]. L'Inconvénient, (63), 46–47. Tous droits réservés © L’inconvénient, 2016 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Ces livres dont on dit du bien LA NYMPHETTE DIVINISÉE David Dorais n roman qui manque de ne pas une Nana en jarretelles noires, gantelets platonicien, l’éros s’attache d’abord à être publié à cause d’une pour- en dentelle et collier de perles. Sa phy- la beauté charnelle (la nymphette des Usuite judiciaire, cela attire l’atten- sionomie marmoréenne était flanquée photos admirées par l’adolescent de tion. Sans aucun doute, ce livre contient du titre, en lettrage rose : « Les Lolitas cinq ans son aîné), puis à l’art (plongée un trésor sulfureux, des phrases si en vente ». de Simon Liberati dans la littérature), dangereuses ou si incriminantes qu’on En fin de compte, la poursuite a été avant de se transmuer en un amour dé- ne peut pas les laisser circuler dans le déboutée. -

Martin Suter, Patrice Leconte, Bernard Werber, Pascale Kramer, Valérie Trierweiler, Douglas Kennedy, Metin Arditi, Simon Liberati, Bernard Minier, Nombreuses
Le livre sur les quais 2017 l’ Éditorial Le Livre sur Les Quais change pour rester le même — Du 1er au 3 septembre, les vedettes seront au prestigieux rendez-vous morgien des auteurs. Les tentes ou- vertes sur le Léman, les croisières, les rencontres, tout est maintenu. Ce qui change, c’est la mise en scène. Nou- velles tentes, occupation diversifiée des lieux, aménagement plus spacieux. Et un «pass» pour assister aux rencontres. Amélie Nothomb, Jean-Christophe Rufin, Anne Nivat, Eric-Emmanuel Schmitt, Martin Suter, Patrice Leconte, Bernard Werber, Pascale Kramer, Valérie Trierweiler, Douglas Kennedy, Metin Arditi, Simon Liberati, Bernard Minier, nombreuses. Jean-Louis Servan-Schreiber… et 265 autres au- Sans oublier le teurs ont confirmé leur participation. cinéma, en salle et en open air, ni les nombreux événements imaginés pour les familles. Ceux-ci Victime de son succès croissant au fil des sept seront gratuits, comme l’accès aux auteurs sous les éditions précédentes, Le livre sur les quais a décidé tentes où ils dédicaceront leurs livres. de donner davantage d’espace aux lecteurs comme aux écrivains, en leur offrant des lieux de dédi- Grâce à la réservation en ligne et à la billetterie caces différenciés pour les romans, les essais et la ouverte sur les quais dès le vendredi 1er septembre, littérature jeunesse, ainsi qu’une nouvelle tente on pourra acheter facilement sa place aux croi- pour les grands débats et un site pour la littéra- sières et aux grands débats. Nouveauté 2017: un ture gastronomique et culinaire (voir pages 62-63). pass journalier donne accès à la programmation dans les salles pour les rencontres plus intimes Partenaire Rencontres littéraires, croisières enchante- (voir page 64). -

« Horizons Multiples »
Le Printemps du Livre Association Loi 1901 Maison de l’Europe et de la vie Associative 4 rue Séverin Icard BP 7 13714 Cassis Cedex Tél : 06 09 73 24 50 DOSSIER DE PRESSE « Horizons Multiples » La XXVe édition du Printemps du Livre de Cassis Du 27 Avril au 5 Mai 2013 Le Printemps du Livre de Cassis vous invite à participer à sa XXV° édition intitulée « Horizons Multiples». Cette version sera marquée, pour la dixième année consécutive, par l’attribution du Prix du Printemps du livre de Cassis, placé sous la présidence de Jean Paul Kauffmann et la présidence d’honneur de Patrick Poivre d’Arvor. Le programme nous offre de très nombreux auteurs, témoins du siècle, qui font l’actualité littéraire depuis plusieurs années pour raconter le monde avec leurs mots et pour nous inviter sur le thème « Horizons Multiples ». La grande qualité de la programmation, la pertinence du duo, Serge Koster et Antoine Spire, les animateurs des débats et les interventions d’un public toujours extrêmement motivé font de ces rencontres un moment d’exception. Comme l’explique Danièle Milon, Maire de Cassis et Présidente d’honneur de l’Association extrêmement exigeante sur la qualité et la spécificité de la manifestation : « Les écrivains passent environ deux heures avec leurs lecteurs. Ceux-ci ne cessent de poser toutes sortes de questions. Le dialogue s’installe. Ils se dévoilent, expliquent leurs motivations, leurs techniques d’écriture. Ils parlent ainsi de façon très intime. Les lecteurs aussi se dévoilent et partagent ». Expositions photos, concerts, cinéma… le Printemps du Livre de Cassis est une manifestation originale et pluridisciplinaire qui se déroule dans le cadre exceptionnel de la Fondation Camargo (un amphithéâtre Grec face au Cap Canaille) ; des salles voutées de l’Hôtel de Ville et de l’Oustau Calendal ; dans les salons panoramiques de l’Hôtel des Roches Blanches. -
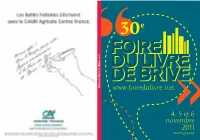
Guide-FL-2011.Pdf
Foire du livre de Brive 2011 Edito La Foire du livre a trente ans. Qui aurait pu prédire une telle longévité au modeste rassemblement d’auteurs qui s’est tenu sous la halle Brassens il y maintenant trois décennies à l’initiative de quelques amis partageant un même amour de la littérature ? L’idée a pris, tant à Brive, que dans le monde des Lettres qui a progressivement choisi d’intégrer La Foire du livre dans Brive dans ses grands rendez-vous de rentrée ce qui 1 Foire du livre, halle Georges Brassens allait devenir la plus improbable des escapades 2 Théâtre littéraires en province. 3 Médiathèque Cette longévité, la Foire du livre de Brive la doit 4 Chapelle Saint-Libéral d’abord à une volonté municipale jamais affaiblie. 5 Musée Labenche Elle la doit aussi à l’aide, la mobilisation d’innom- © Brive Mag brables énergies : bénévoles, libraires, enseignants, associations, partenaires de l’événement publics Cette année est symbolique pour lui aussi. Cent ans et privés, hôteliers, restaurateurs, commerçants d’activités pour la Maison Gallimard, voilà un anni- de la ville, agents de tous les services de la versaire remarquable ! C’est une fierté aussi pour collectivité… Une liste longue, et ici incomplète, notre ville que de participer à cette célébration mais qui traduit bien l’engouement de tout qui a connu de nombreuses déclinaisons, cette année, un bassin de population pour un événement dans l’actualité nationale de l’action culturelle. qui contribue à porter en lui-même une parcelle Cette 30e édition ne déroge pas à la tradition : de notre identité locale. -

Consulter/Télécharger
Sommaire | novembre 2015 Éditorial 5 | La faute à Robespierre ? › Valérie Toranian Grand entretien 8 | Umberto Eco. « La France a subi un choc qu’elle n’a pas encore digéré » › Franz-Olivier Giesbert et Valérie Toranian Dossier | L’héritage Robespierre 26 | La France et l’esprit révolutionnaire › Ran Halévi 37 | Jean-Luc Mélenchon. « Le Parti de gauche est l’héritier de Robespierre » › Valérie Toranian et Sophie Bernoville 47 | Robespierre n’a pas eu lieu. Anatomie d’un cerveau reptilien › Michel Onfray 54 | « La faute à Rousseau » ? › Robert Kopp 71 | Robespierre et l’Être suprême, ou de l’usage du religieux en révolution › Lucien Jaume 78 | Robespierre face à la Terreur › Thomas Branthôme 87 | Psychologie de l’Incorruptible › Hippolyte Taine 92 | La Terreur, une passion française › Frédéric Mitterrand 95 | Un déjeuner de travail › Marin de Viry Études, reportages, réflexions 100 | Quand le dragon s’essouffle, il plie mais ne rompt pas › Marc Ladreit de Lacharrière 106 | Russie, Chine et Amérique : un triangle dangereusement déséquilibré › Renaud Girard 113 | Mme Vigée Le Brun, grande peintre parmi les grands › Eryck de Rubercy 2 NOVEMBRE 2015 119 | Les hommes intéressants épousent souvent des femmes étranges › Marin de Viry 124 | La COP 21 sera-t-elle à la hauteur de l’urgence climatique ? › Annick Steta 131 | Jacques Abeille : un dédale littéraire › Laurent Gayard 136 | Littérature romande et identité nationale › Robert Kopp 144 | Les 70 ans de la « Série noire » › Olivier Cariguel 153 | Journal › Richard Millet Critiques 158 | Livres -
FINAL FICTION SPRING19 Ruukr-Print
Fall 08 LESTER LITERARY AGENCY & ASSOCIATES FICTION Spring 2019 Russia Ukraine Belarus HIGHLIGHTS HIGHLIGHTS 3 LITERARY FICTION 14 (RE)DISCOVERED WRITERS 19 CONTEMPORARY UP-MARKET 23 DEBUT NOVEL / NEW VOICES 30 COMMERCIAL FICTION 36 FEEL GOOD 44 BIO & HISTORICAL 47 ARTISTIC DESTINIES 53 THRILLER / CRIME / NOIR 56 GRAPHIC NOVELS 61 ITALIAN WRITERS 62 FRENCH CANADIAN WRITERS 63 BESTSELLERS & BACKLIST 64 2 HIGHLIGHTS Dai Sijie Atiq Rahimi L’ÉVANGILE SELON YONG SHENG LES PORTEURS D’EAU (The Gospel According to Yong Sheng) (The Water Carriers) Gallimard, February 2019, 440 pages POL, January 2019, 288 pages ◊ Under option in: Russia. ◊ 10,000 copies sold. ◊ The surprising tale of one of the first 20th-century ◊ Rights sold in: Brazil (Estaçao Liberdade), Italy Chinese Christian preachers, at a time when (Einaudi), Lebanon (Dar Al-Saqi), Turkey (Can religion had been banned and religious leaders Yayinlari). were being hounded by the Red Guards ◊ Longlisted for the Prix des Romancières 2019. ◊ A poetic and mischievous style, which grants the Combining fairy tales and ancient wisdom with the tale of a life pounded by history all the lyricism of ◊ cruel history of our age. a puckish legend. ◊ Two parallel, powerfully tragic lives – characters ◊ A rogue’s gallery of characters. whose paths never cross, but who deliver a ◊ Free of the constraints imposed by the truth, the magnificent, poignant, polyphonic story of exile, author does not hesitate to add elements of a fairy memory, love and liberty. tale, blending the description of a historical period full of violence and cruelty with amazing, Atiq Rahimi’s new novel takes place over a single day: whimsical, or comic aspects. -
P. 3 À 6 : Prix Littéraires 2011 P. 7 À 17 : Rentrée Littéraire 2011 P
1 Sommaire P. 3 à 6 : Prix littéraires 2011 P. 7 à 17 : Rentrée littéraire 2011 P. 18 à 19 : autres nouveautés dans les médiathèques Disponibilités dans les médiathèques municipales de Montereau indiquées par les abréviations : MAP, pour Médiathèque Alain Peyrefitte (Ville Haute) MGF, pour Médiathèque Gustave Flaubert (Ville Basse) Les livres sont classés par liste alphabétique d’auteurs 2 Prix littéraires 2011 Prix Femina 2011 Jayne Mansfiield 1967 / Simon Liberati MAP Ed. Grasset, 2011. Au programme : perruques pouf, LSD , satanisme, chihuahuas, amants cogneurs, vie désaxée, mort à la James Dean, cinq enfants orphelins et saut de l'ange dans l'underground. Une oraison funèbre et morbide chic dans la droite ligne de Truman Capote et Kenneth Anger. « Aux basses heures de la nuit, le 29 juin 1967 sur un tronçon de la route US 90 qui relie la ville de Biloxi à la Nouvelle Orléans, une Buick Electra 225 bleu métallisé, modèle 66, se trouva engagée dans une collision mortelle. Dans cette Buick broyée se trouvait une femme, une "Hollywood movie star" de trente-quatre ans, danseuse nue à Las Vegas, célébrissime sex-symbol des années 50. Simon Liberati ressuscite Jayne Mansfield… Prix Goncourt 2011 L'art français de la guerre / Alexis Jenni MAP Ed. Gallimard, 2011. Un premier roman que le Goncourt salue : enfin la littérature française s’engage dans la relation de la guerre d’Algérie ! « J'allais mal; tout va mal; j'attendais la fin. Quand j'ai rencontré Victorien Salagnon, il ne pouvait être pire, il l'avait faite la guerre de vingt ans qui nous obsède, qui n'arrive pas à finir… Il m'apprit à peindre, et en échange je lui écrivis son histoire. -
Delavega Creation
Printemps du livre 3 1 0 Cassis 2 du 27 avril au 5 mai avec la participation de nombreux écrivains : Elaine Sciolino Steven Sampson Paul Nizon Cécile Guilbert Olivier Rolin Boualem Sansal Marcel Rufo Carlo Ginzburg Mona Ozouf Marcus Malte Antoine Compagnon Tobie Nathan Pierre Assouline « Car nous vivons dans plusieurs mondes… » Avec Claude Lévi - Strauss Serge Koster Antoine Spire Autour du thème : Horizons Multiples 2 Samedi 27 Avril à 11h30 Cour d’Honneur de la Mairie de Cassis Inauguration en présence de Madame le Maire de Cassis, des écrivains invités et de nombreuses personnalités Concert de Jazz avec «Trio Tenderly» Remise du Prix du Printemps du Livre de Cassis sous la présidence de Jean-Paul Kauffmann et de la présidence d’honneur de Patrick Poivre d’Arvor Exposition de photographies aux Salles Voutées de la Mairie Valérie PERRIN du 27 Avril au 5 Mai 2013 3 Printemps du livre 3 1 0 Cassis 2 du 27 avril au 5 mai Le Printemps du Livre de Cassis créé en 1986 par Danielle Milon, conjugue, littérature, musique, arts plastiques, photographie, et cinéma. Cette véritable fête de l’écriture se décline toujours sur deux week-ends dans le cadre magique de l’amphi - théâtre de la Fondation Camargo où les écrivains sont peu à peu amenés à dévoiler leur processus littéraire, à se révéler à leurs lecteurs, à dialoguer avec eux. 4 Prix du Printemps du Livre de Cassis Créé à l’initiative de Danielle Milon et de Pascal Chaix , ce prix placé sous la présidence de Jean-Paul Kauffmann et la présidence d’honneur de Patrick Poivre d’Arvor, récompensera pour la neuvième année consécutive un essai littéraire, politique ou historique et sera remis au lauréat lors de l’inauguration du Printemps du Printemps du Livre. -

Table of Contents
ANASTASIA LESTER LESTER LITERARY AGENCY PRESENTS : FALL 2015 FICTION TABLE OF CONTENTS FICTION .............................................................................................. 3 BEST-SELLERS 2015 ..................................................................................... 3 HIGHLIGHT FALL 2015 ............................................................................... 8 DISCOVERED WRITER ............................................................................. 17 LITERARY FICTION .................................................................................. 20 NON-FRANCOPHONE AUTHORS ........................................................... 28 DEBUT NOVEL ............................................................................................ 29 WOMEN WRITING ..................................................................................... 35 CONTEMPORARY UP-MARKET COMMERCIAL TRENDS ............. 39 BIOGRAPHICAL & HISTORICAL NOVEL ........................................... 48 COMMERCIAL FICTION .......................................................................... 52 CRIME & SUSPENSE NOVELS ................................................................. 57 THRILLERS .................................................................................................. 62 SCIENCE-FICTION & FANTASY ............................................................. 67 YOUNG ADULT & CROSS OVER ............................................................ 69 ALL TITLES ..................................................................................... -

Page 1 Lieux Bibliothèques Idéales Page 2 Calendrier
e bibliothèques idéales page 1 jeu 7 sept 10h ligne A station Cours de l’Illiade Lectures en stations 10h ligne C station Gare centrale Lectures en stations 16h ligne G station Rieth Lectures en stations 16h lignes B/C/E/F station République Lectures en stations 16h30 Opéra Michel Serres 17h30 Opéra Erik Orsenna — Ouverture 19h Opéra Régis Debray / Jean-Claude Guillebaud / Delphine Horvilleur 19h Médiathèque Sud Clara Beaudoux ven 8 sept 17h Opéra Sorj Chalandon/ Jakuta Alikavazovic / Saphia Azzeddine 18h Opéra Régis Debray 20h Opéra Leonor de Recondo / Emily Loizeau sam 9 sept 13h45 Opéra Roland Gori / Camille Laurens / Elsa Godart / Claude Schauder 15h Opéra François Jullien 16h Opéra Claude Hagège 17h Opéra Christian Bobin 18h30 Opéra Nancy Huston / Guy Oberson / Michel Godard 20h30 Opéra Eric Naulleau / Graham Parker dim 10 sept 13h Opéra Abd Al Malik / Clotilde Courau / Lionel Suarez — Autour d’Albert Camus 14h Opéra Laure Adler / Alain Veinstein / Jean-Luc Nancy – Hommage à Jacques Derrida 15h Opéra Olivier Besancenot / Eric Hazan / Christian Salmon 16h30 Opéra Kamel Daoud 17h30 Opéra Léopoldine HH / Kéthévane Davrichewy / Vincent Dedienne / Gregory Ott / Matthieu Zirn – Hommage à Barbara 19h Opéra Olivier Guez / Philippe Sands / Françoise Sironi / Christian Ingrao 20h30 Opéra Catherine Dargent / Armel Amiot – Récital Jeanne Moreau lun 11 sept 17h30 Aubette Aldo Naouri / Timothée de Fombelle / Marion Vernoux / Jean-Baptiste Andréa mar 12 sept 17h Fnac Frédéric Denhez / Erwann Menthéour / OphélieVeron 17h Aubette Marc Dugain /Janine -

11 NOV. 17 DEC. 2015 Lettres
11 NOV. 17 DEC. 2015 CHRISTINE ANGOT CLAIRE DITERZI DELPHINE DE VIGAN GRAND BLANC LLUIS LLACH ANNA MOUGLALIS SIMON LIBERATI & PILOOSKI MAYLIS DE KERANGAL LINO (ÄRSENIK) FESTIVAL VIRGINIE DESPENTES Parisen toutes MEDHI & BADROU (LES KIDS) Lettres SONIA WIEDER-ATHERTON 11-22 Novembre & ANDRÉ MARKOWICZ ... Passage Molière www.maisondelapoesieparis.com 157, rue Saint-Martin 75 003 Paris 01 44 54 53 00 EDITO Le festival Paris En Toutes Lettres est fondé sur les hybridations entre les genres littéraires et les formes artistiques ainsi que sur les résonances entre la géographie parisienne et sa vie littéraire. À la Maison de la Poésie et Hors-les-Murs, il se déploie dans une quinzaine de lieux, du 11 au 22 novembre. Revisitant l’actualité littéraire (Christine Angot, Olivier Rolin, Delphine de Vigan, Simon Liberati, Maylis de Kerangal, Nicole Lapierre, Christophe Boltanski, Tobie Nathan, Mehdi & Badrou, Lluis Llach, William Cliff…), le festival fait la part belle aux créations mêlant littérature et musique avec notamment Claire Diterzi, Rodolphe Burger, Grand Blanc, Lino, X-Men, Albin de la Simone, Sonia Wieder-Atherton, les siestes de Bastien Lallemant… Parmi plus de cinquante concerts littéraires, rencontres et lectures (Romain Gary par Camélia Jordana, Hélène Bessette par Anna Mouglalis et Claudine Hunault, Alice au pays des merveilles par Véronique Ovaldé, La Soit-disant Utopie Beaubourg par Jacques Bonnaffé & André Minvielle…), on trouve également d’insolites conférences, de Une maison poétique et vivante, curieuses performances et le désormais célèbre Bal littéraire. À travers ce curieuse et foisonnante, foisonnement de lieux et de propositions, d’une ouverture saluant Roland Barthes à une clôture dédiée à la bande dessinée, c’est à un Paris vivant dont le programme se renouvelle et traversé de littérature que le festival donne voix. -

Saison Des Prix Littéraires
SAISON DES PRIX LITTÉRAIRES Chaque année depuis plus d'un siècle, des prix littéraires sont décernés dans les derniers mois de l'année à des auteurs de tout poil… VOUS AVEZ MANQUÉ LES LAURÉATS DE CES DIX DERNIÈRES ANNÉES? Voici le palmarès des principaux prix… Prix Nobel de Littérature Le prix Nobel de littérature ( Nobelpriset i litteratur en suédois) récompense annuellement, depuis 1901, un écrivain ayant rendu de grands services à l'humanité grâce à une œuvre littéraire qui, selon le testament du chimiste suédois Alfred Nobel, « a fait la preuve d'un puissant idéal ». L'attribution des prix se fait au début octobre. 2012 : Mo Yan 2011 : Tomas Tranströmer 2010 : Mario Vargas Llosa 2009 : Herta Müller 2008 : Jean-Marie Gustave Le Clézio 2007 : Doris Lessing 2006 : Orhan Pamuk 2005 : Harold Pinter 2004 : Elfriede Jelinek 2003 : J.M. Coetzee 2002 : Imre Kertész Prix Goncourt Le Prix Goncourt, l'un des plus prestigieux prix littéraires, est remis chaque année fin novembre, au terme d'un déjeuner chez Drouant réunissant les membres de son académie. Il récompense les auteurs qui ont marqué la littérature française. 2012 : Le Sermon sur la chute de Rome , Jérôme Ferrari 2011 : L’art français de la guerre , Alexis Jenni 2010 : La carte et le territoire , Michel Houellebecq 2009 : Trois femmes puissantes , Marie NDiaye 2008 : Syngue Sabour , Atiq Rahimi 2007 : Alabama Song , Gilles Leroy 2006 : Les Bienveillantes , Jonathan Littell 2005 : Trois jours chez ma mère , François Weyergans 2004 : Le soleil des Scorta , Laurent Gaudé 2003 : La maîtresse de Brecht , Jacques-Pierre Amette 2002 : Les Ombres errantes , Pascal Quignard 2001 : Rouge Brésil , Jean-Christophe Rufin Prix Renaudot Originellement décerné le même jour que le prix Goncourt et créé en 1925, le prix littéraire Théophraste-Renaudot récompense un ouvrage en prose combinant talent et originalité.