Téléchargez Le Document Au Format PDF Format
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

La Télévision Au Pilori De La Caricature, 1950-2000
AC_92368_p127p140_BL 26/04/07 13:41 Page 129 dossier médiamorphoses 129 La télévision au pilori Hélène Duccini de la caricature, 1950-2000 La télévision au pilori de la caricature, 1950-2000 Hélène Duccini, université de Paris 10, Nanterre La télévision est très vite devenue le moyen d’information privilégié des Français, loin devant le livre évidemment, le journal ou même la radio. À ce titre elle est très présente dans les mises en scène des caricaturistes, soit qu’elle suscite la critique, soit qu’elle figure la nouvelle agora démocratique des citoyens et des consommateurs. n règle générale, les caricaturistes ne peuvent Au milieu des années quatre-vingts, une révolution fonda- commencer leurs attaques que lorsque le public mentale s’opère dans les médias. Le monopole public est E de leurs journaux est apte à rire ou sourire de abandonné et l’on voit apparaître d’autres chaînes hert- leurs traits, apte à saisir les allusions, comprendre les réfé- ziennes : Canal+ (1984), la Cinq (1985), M6 (1986), la rences et les référents. Il y a donc tout naturellement un naissance d’ARTE attendant 1992. La révolution du câble décalage entre l’apparition d’un nouveau média, en l’oc- augmente elle aussi l’éventail des chaînes ouvrant l’écran currence la télévision, et sa mise au pilori par la caricature. à Eurosport, Paris Première, TV5, Planète, Ciné Cinéma, En fait, dans l’immédiat après-guerre, la télévision reste le Ciné Cinéfil pour n’en citer que quelques-unes. L’apparition privilège de quelques-uns. Un vrai coup d’envoi est donné de la télécommande, outil indispensable du choix par le dans le public en 1953 par la retransmission en direct du téléspectateur, facilite désormais le « zapping ». -

AVRIL 2015 13E ÉDITION CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL Direction Des Études Et De La Prospective Direction Des Programmes Tour Mirabeau
GUIDE DES CHAÎNES NUMÉRIQUES AVRIL 2015 13e ÉDITION CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL Direction des études et de la prospective Direction des programmes Tour Mirabeau. 39-43 quai André Citroën 75 739 Paris Cedex 15 Tél : 01 40 58 38 00 www.csa.fr CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L’IMAGE ANIMÉE Direction de l’audiovisuel et de la création numérique Direction des études, des statistiques et de la prospective 12, rue de Lübeck - 75 784 Paris Cedex 16 Tél : 01 44 34 38 26 Email : [email protected] www.cnc.fr DIRECTION GÉNÉRALE DES MÉDIAS ET DES INDUSTRIES CULTURELLES Ministère de la Culture et de la Communication 182, rue Saint Honoré - 75 033 Paris Cedex 01 Tél : 01 40 15 80 00 www.culturecommunication.gouv.fr ASSOCIATION DES CHAÎNES CONVENTIONNÉES ÉDITRICES DE SERVICES 17, rue de l’Amiral Hamelin - 75 116 Paris Tél : 01 47 04 24 09 www.acces.tv SYNDICAT NATIONAL DE LA PUBLICITÉ TÉLÉVISÉE 1, quai du Point du Jour 92 656 Boulogne Cedex Tél : 01 41 41 43 21 / Fax : 01 41 41 43 30 Email : [email protected] www.snptv.org Guide réalisé par : Agence Clair de Lune. 20, avenue Gabriel Péri. 92 350 Le Plessis Robinson Tél : 01 55 52 07 18 - Email : [email protected] www.clairdelunepresse.fr SOMMAIRE SYNTHÈSE ........................................................4 CHAPITRE 6 RESSOURCES DOCUMENTAIRES .....................6 LA PRODUCTION AUDIOVISUELLE ET CINÉMATOGRAPHIQUE CHAPITRE 1 L’OFFRE DE CHAÎNES NUMÉRIQUES Partie I : la production audiovisuelle et cinématographique à partir des données du CSA 1. Les chaînes de la TNT ................................................................... 8 1. Contribution réelle à la production audiovisuelle . -

LA CHAÎNE D'information INTERNATIONALE POUR LA FRANCE Gerald ARBOIT (*) Quatre Longues Années Après Le Vœu Du Président J
LA CHAÎNE D’INFORMATION INTERNATIONALE POUR LA FRANCE FRANCE 24 A L’EPREUVE DE LA RÉALITÉ… par Gerald ARBOIT (*) Quatre longues années après le vœu du président Jacques Chirac, pro- noncé devant le Haut Conseil de la francophonie le 12 février 2002, la «CNN à la française» a vu le jour! Elle est opérationnelle depuis le 6 décem- bre 2006, 20h30. Une jolie blonde en tailleur blanc, une charmante brune en tailleur noir… Si ce n’était les versions française et anglaise, en l’absence de Christian Morin comme maître de cérémonie, on se serait cru au lance- ment de feue La Cinq berlusconienne : la même fragilité budgétaire, le même mélange secteur privé/secteur public, la même origine politique et la même ambition de renouveler le «broadcast», selon le mot des dirigeants de France 24 (1). Il s’en est fallu de peu que le «top» d’Alain de Pouzilhac, président du directoire de France 24, ne débouchât sur aucune image (2). Depuis que cette «Arlésienne», comme se sont plu à l’appeler des députés comme Alain Mathus (2004) et Christian Kert (2005) – que le gouvernement ne semblait pas avoir écoutés en confiant la réalisation de la chaîne française d’infor- mation internationale à France Télévisions/TF1 –, était apparue dans le paysage médiatique, une sourde résistance franco-française s’était mise en place. Dans Les Nouveaux Dossiers de l’Audiovisuel de janvier-février 2006, Isabelle Repiton, journaliste à La Tribune, posait trois questions/objections (*)Chercheur au Centre d’études et de recherches interdisciplinaires sur les médias en Europe (CERIME) de l’Université Robert Schuman (Strasbourg, France). -

Guillaume Durand : Canal Plus D'info
LeMonde Job: WMR2397--0002-0 WAS TMR2397-2 Op.: XX Rev.: 06-06-97 T.: 19:13 S.: 75,06-Cmp.:07,08, Base : LMQPAG 31Fap:99 No:0046 Lcp: 196 CMYK ENTRETIEN Guillaume Durand : Canal Plus d’info Porté au pinacle puis « jeté aux loups », ressourcé par trois années passées à LCI, le futur remplaçant de Philippe Gildas à « Nulle Part Ailleurs » parle de sa conception de l’information, de TF 1, du service public et de la télévision en général quarante-cinq ans, sibles, confronté à des exigences Guillaume Durand d’audience qu’il devait résoudre, comme touche, dit-il, à la ça, du jour au lendemain. C’était dingue. sérénité. Après On critique souvent Mougeotte pour sa Europe 1 de Jean- dureté. Mais quiconque est nommé patron Luc Lagardère et de TF 1 se transforme inévitablement en ce feue La Cinq du duo Mougeotte-là, du jour au lendemain, ou Hersant-Berlusconi, alors il laisse sa place. Moi, je connais les après TF 1 et LCI de deux Mougeotte, celui qui est caricaturé Francis Bouygues, le voilà qui arrive par les Guignols, mais l’autre aussi, celui aujourd’huiA à Canal Plus pour remplacer qui fut mon premier « patron de presse » à Philippe Gildas à la tête de l’équipe de Europe 1, qui a plein de qualités humaines « Nulle part ailleurs », la vitrine (en clair) et que j’aime beaucoup. C’est moins le de la chaîne cryptée. Première apparition à procès de l’homme qu’il faut faire que la rentrée. celui du monde contemporain, tel que Journaliste-vedette des années-pail- Viviane Forrester le dénonce dans son livre lettes, porté aux nues puis « jeté aux SCHWARTZ/CANAL+ P. -

Inatheque.Fr
heures de documents d’heures enregistrées chaînes de radio et de télévision sites web 5 000 000 radio et télévision 1 000 000 chaque année 120 captées 24h/24 au titre du dépôt légal 9 000 média ICI, CONSULTEZ UN FONDS UNIQUE HISTOIRE / POLITIQUE JEUNESSE CINÉMA La Chaîne parlementaire Histoire >2003 Télétoon >2003 GÉNÉRALISTE (LCP, Public Sénat) >2003 TPS Star >2006 Toute l’Histoire >2003 Canal J > 2002 Canal + cinéma >2008 TF1 >1995 (complet) 1e chaîne >1947 (partiel) Mangas >2003 France 2 >1995 (complet) 2e chaîne, Antenne 2 >1963 (partiel) Gulli >2005 France 3 >1995 (complet) 3e chaîne, FR3 >1972 (partiel) MUSIQUE Disney Channel > 2007 France 5 >1995 (complet) La Cinquième >1994 (partiel) Disney XD >2009 MCM >2002 MEZZO >2003 GÉNÉRALISTE PUBLIQUE Jetix >2007-2009 Arte >1995 Canal + >1995 RTL9 >2002 RFM TV >2003 FUN TV >2003 Canal + family >2008 RDF /RTF/ ORTF (stations nationales et régionales) >1944 (partiel) TMC >2002 Téva >2003 Direct 8 >2005 Europe 2 TV >2005-2008 ZIK >2007 France Bleu >2000 France Info >1995 Radio bleue M6 >1995 La Cinq 1986-1992 (partiel) Virgin 17 >2008-2010 NRJ 12 >2005 >1980 (partiel) France Inter >1999 (complet) Direct Star >2010 >1963 (partiel) >1994 (complet) France Culture France Musique VIE QUOTIDIENNE >1963 (partiel) >1963 (partiel) >1994 (complet) >1994 (complet) RFI >1977 (partiel) EMPLOI / ÉCONOMIE CULTURE >1999 (complet) Demain ! >2003 France 4 >2005 Festival >2003-2005 BFM Business >2010 Paris Première >2002 RADIO CRIME / INVESTIGATION MÉTÉO GÉNÉRALISTE PRIVÉE ème 13 Rue >2003 La chaine Météo >2003 Europe 1 >1980 (partiel) >2001 (complet) SEXUALITÉ DIVERTISSEMENT XXL >2007 RMC >1980 (partiel) >2001 (complet) W9 >2005 HUMOUR TV RTL >1980 (partiel) >2001 (complet) Comédie ! >2007 DÉCOUVERTE Plus de 9 000 sites : sites des chaînes, contenus édités par les diffuseurs, THÉMATIQUE web TV, web radio, sites d’émissions, Planète >2002 de fans, de séries…). -

American Primacy and the Global Media
City Research Online City, University of London Institutional Repository Citation: Chalaby, J. (2009). Broadcasting in a Post-National Environment: The Rise of Transnational TV Groups. Critical Studies in Television, 4(1), pp. 39-64. doi: 10.7227/CST.4.1.5 This is the accepted version of the paper. This version of the publication may differ from the final published version. Permanent repository link: https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/4508/ Link to published version: http://dx.doi.org/10.7227/CST.4.1.5 Copyright: City Research Online aims to make research outputs of City, University of London available to a wider audience. Copyright and Moral Rights remain with the author(s) and/or copyright holders. URLs from City Research Online may be freely distributed and linked to. Reuse: Copies of full items can be used for personal research or study, educational, or not-for-profit purposes without prior permission or charge. Provided that the authors, title and full bibliographic details are credited, a hyperlink and/or URL is given for the original metadata page and the content is not changed in any way. City Research Online: http://openaccess.city.ac.uk/ [email protected] Broadcasting in a post-national environment: The rise of transnational TV groups Author: Dr Jean K. Chalaby Department of Sociology City University Northampton Square London EC1V 0HB Tel: 020 7040 0151 Fax: 020 7040 8558 Email: [email protected] Jean K. Chalaby is Reader in the Department of Sociology, City University in London. He is the author of The Invention of Journalism (1998), The de Gaulle Presidency and the Media (2002) and Transnational Television in Europe: Reconfiguring Global Communications Networks (2009). -

Market Structure and Innovation Policies in France Matthieu Lardeau
Market Structure and Innovation Policies in France Matthieu Lardeau To cite this version: Matthieu Lardeau. Market Structure and Innovation Policies in France. Hans van Kranenburg. Innovation Policies in the European News Media Industry: A Comparative Study, pp.193 - 83, 2017, 9786. 10.1007/978-3-319-45204-3_6. hal-01508746 HAL Id: hal-01508746 https://hal.uca.fr/hal-01508746 Submitted on 18 Apr 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Market Structure and Innovation Policies in France Matthieu Lardeau 1 Market Structure and Media Ownership The news media industry in France has a long tradition. Le Mercure Franc¸ois is known as the first news review. It started to appear in 1611. In 1631, The´ophraste Renaudot launched the first periodical paper, La Gazette. The first daily newspaper appeared in 1777: Le Journal de Paris. In 1830s, France became known as one of the three pioneers of the modern daily press in Europe. At that time, the newspaper industry was very innovative. For instance, the French penny press based on a new business model was introduced by journalist entrepreneurs Emile de Girardin and Armand Dutacq. -

Ce Document Est Le Fruit D'un Long Travail Approuvé Par Le Jury De Soutenance Et Mis À Disposition De L'ensemble De La Communauté Universitaire Élargie
AVERTISSEMENT Ce document est le fruit d'un long travail approuvé par le jury de soutenance et mis à disposition de l'ensemble de la communauté universitaire élargie. Il est soumis à la propriété intellectuelle de l'auteur. Ceci implique une obligation de citation et de référencement lors de l’utilisation de ce document. D'autre part, toute contrefaçon, plagiat, reproduction illicite encourt une poursuite pénale. Contact : [email protected] LIENS Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 122. 4 Code de la Propriété Intellectuelle. articles L 335.2- L 335.10 http://www.cfcopies.com/V2/leg/leg_droi.php http://www.culture.gouv.fr/culture/infos-pratiques/droits/protection.htm UNIVERSITE DE METZ Faculté des Lettres et SciencesHumaines Département Communication et Arts du Spectacle TELEVISION ET SERIALITE Eléments pour une typologie des genres fictionnels télévisuels Thèse pour un Doctorat Présentéeet soutenuepar StéphaneBENASSI BIBLIOTHEOUEUNIVERSITAIRE DE METZ lltil ililtIililtililllil llilIilil tffi tilil llil lililll 031 1515404 Directeur de thèse : Monsieur Noël NEL Professeuren Sciencesde I'Information et de la Communication à I'Université de Metz Ss$oo_eL 1998 ]anvier t/Mz sSfz f1g'vri'n' UNIVERSITE DE M.ETZ Faculté des Lettres et SciencesHumaines Département Communication et Arts du Spectacle TELEVISION ET SERIALITE Eléments pour une typologie des genres fictionnels télévisuels Thèse pour un Doctorat Présentéeet soutenuepar StéphaneBENASSI Directeur de thèse : Monsieur Noël NEL Professeuren Sciencesde I'Information et de la Communication à I'Université de Metz Janvier 1998 REMERCIEMENTS ]e tiens tout particulièrement à exprimer ma profonde reconnaissanceà Monsieur le ProfesseurNoël NEL, et à le remercierpour la qualité de ses conseils,pour Sesencouragements et sa très grande disponibilité. -

1 Digital Terrestrial Television in France
Digital Terrestrial Television in France: an attempt to enhance competition in an oligopolistic market# Marc Bourreau ENST, Département EGSH, and CREST-LEI Only 17 per cent of French households received digital television in 2002.1 Hence, for public authorities, digital terrestrial television (DTTV) is mainly a means to stimulate the development of digital television. However, cable and satellite operators (TF1, M6 and Canal Plus), which have been designated as leaders of the DTTV process, are reluctant, as they view DTTV as a competitor to their existing platforms. TERRESTRIAL DIGITAL TELEVISION In France, DTTV has been urged by public authorities. Its main goal is to increase the number of channels received by French households and to provide digital television to all. Indeed, in 2002, 52 per cent of French households received only the five unscrambled free-to-air channels (TF1, France 2, France 3, ARTE/La Cinq, M6). 20 per cent received an additional terrestrial pay television channel, Canal Plus. Only 28 per cent received an extended choice of channels, through either cable (14 per cent) or satellite (14 per cent).2 Finally, only 17 per cent received digital television. For the Jospin government, the second goal of DTTV was to stimulate the development of public television (for instance, see Le Guen, 2001). Since the change of government, the role of public television on DTTV has been unclear, as we will see. # This paper is a chapter of a forthcoming book, Digital in Europe. I thank Jérôme Perani and John Wisdom for useful remarks and suggestions. 1 Source: AFORM, TF1, Canal Plus, INSEE. -
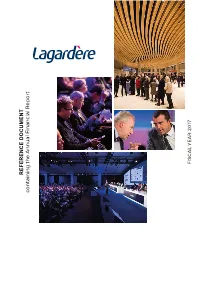
REFERENCE DOCUMENT Containing the Annual Financial Report
REFERENCE DOCUMENT containing the Annual Financial Report FISCAL YEAR 2017 PROFILE The Lagardère group is a global leader in content publishing, production, broadcasting and distribution, whose powerful brands leverage its virtual and physical networks to attract and enjoy qualifi ed audiences. The Group’s business model relies on creating a lasting and exclusive relationship between the content it offers and its customers. It is structured around four business divisions: • Books and e-Books: Lagardère Publishing • Travel Essentials, Duty Free & Fashion, and Foodservice: Lagardère Travel Retail • Press, Audiovisual (Radio, Television, Audiovisual Production), Digital and Advertising Sales Brokerage: Lagardère Active • Sponsorship, Content, Consulting, Events, Athletes, Stadiums, Shows, Venues and Artists: Lagardère Sports and Entertainment 1945: at the end of World 1986: Hachette regains 26 March 2003: War II, Marcel Chassagny founds control of Europe 1. Arnaud Lagardère is Matra (Mécanique Aviation appointed Managing Partner TRAction), a company focused 10 February 1988: of Lagardère SCA. on the defence industry. Matra is privatised. 2004: the Group acquires 1963: Jean-Luc Lagardère 30 December 1992: a portion of Vivendi Universal becomes Chief Executive Publishing’s French and following the failure of French Offi cer of Matra, which Spanish assets. television channel La Cinq, has diversifi ed into aerospace Hachette is merged into Matra and automobiles. to form Matra-Hachette, and 2007: the Group reorganises Lagardère Groupe, a French around four major institutional 1974: Sylvain Floirat asks partnership limited by shares, brands: Lagardère Publishing, Jean-Luc Lagardère to head is created as the umbrella Lagardère Services (which the Europe 1 radio network. company for the entire became Lagardère Travel Retail ensemble. -

Pasado Y Futuro Del Anime En España. Mazinger Z, El Fenómeno Dragon Ball Y Otras Dinámicas De Consumo Contemporáneas
Unidad Sociológica I Número 11, Año 3 I Octubre 2017-Enero 2018 I Buenos Aires Pasado y futuro del anime en España. Mazinger Z, el fenómeno Dragon Ball y otras dinámicas de consumo contemporáneas José Andrés Santiago Iglesias* Desde la primera emisión de Mazinger Z (1978) en la televisión pública española, ha cambiado notablemente la industria del anime, tanto las prácticas de consumo de anime por parte de los espectadores, como la dinámica y jerarquías que se establecen entre ambos. En los últimos cuarenta años, el anime ha vivido tres grandes transformaciones. Las dos primeras son especialmente notables, ejemplificadas por sendas series de anime: el binomio formado por Heidi y Mazinger Z a finales de la década de 1970; y el fenómeno Dragon Ball a comienzos de la década de 1990; llegando a una nueva madurez del mercado a comienzos del Siglo XXI y a las nuevas plataformas de distribución en streaming, simulcast y otras prácticas contemporáneas para el consumo de anime. Por todo ello, en este artículo intentaré mostrar las diferencias en dinámicas de distribución y consumo de anime en España a través de estos ejemplos. PALABRAS CLAVE: Dragon Ball - Dinámicas de consumo - Domesticación - Extranjerización Since Mazinger Z first broadcasted on the Spanish national television (1978), the anime industry has largely changed, in regards to the consumption of anime (as a medium) by viewers, and the dynamics and hierarchies established between them. In the last four decades, anime in Spain has undergone three major transformations. The first two are particularly noteworthy, exemplified by the following anime series: the binomial formed by Heidi and Mazinger Z in the late 1970s; and the Dragon Ball phenomenon in the early 1990s; leading to the market’s full maturity in the early 21st Century, and new distribution platforms such as streaming, simulcast and other contemporary anime consumption mechanics. -

La Médiatisation De La Cuisine À La Télévision
La médiatisation de la cuisine à la télévision LICENCE PROFESSIONNELLE HÔTELLERIE RESTAURATION PROJET TUTORÉ La médiatisation de la cuisine à la télévision Présenté par : Elisa CEBRIAN Célia DANGREMONT Clémentine GOUSSARD Martin ORDRENNEAU Thomas THINUS Année universitaire : 2015 – 2016 Sous la direction de : Frédéric ZANCANARO La médiatisation de la cuisine à la télévision La médiatisation de la cuisine à la télévision La médiatisation de la cuisine à la télévision La médiatisation de la cuisine à la télévision L’ISTHIA de l’Université Toulouse - Jean Jaurès n’entend donner aucune approbation, ni improbation dans les projets tutorés et mémoires de recherche. Les opinions qui y sont développées doivent être considérées comme propres à leur auteur(e). La médiatisation de la cuisine à la télévision « Et, de fil en aiguille, la télévision qui prétend être un instrument d’enregistrement, devient un instrument de création de réalité » - Pierre BOURDIEU “La télévision ouvre bien des portes, notamment celles des réfrigérateurs” - Jean-Loup CHIFLET La médiatisation de la cuisine à la télévision Remerciements our débuter ce projet, nous souhaitions en premier lieu remercier les différentes personnes qui nous ont accompagnées tout le long de cette année dans la mise en P place du dossier. Tout d’abord, nous tenions à remercier tout particulièrement Monsieur Frédéric ZANCANARO pour l’intérêt qu’il a porté à notre sujet. Son écoute très attentive, son implication et ses précieux conseils nous ont été d’une grande aide. Nous remercions, Monsieur Paul-Emmanuel PICHON tout comme Monsieur Pierre ROUILLON pour leurs conseils sur le fond de notre projet durant leurs différentes interventions.