Bruno Lasserre Président De L’Autorité De La Concurrence
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States
Parsons Brinckerhoff 2010 William Barclay Parsons Fellowship Monograph 26 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States Fellow: Francis P. Banko Professional Associate Principal Project Manager Lead Investigator: Jackson H. Xue Rail Vehicle Engineer December 2012 136763_Cover.indd 1 3/22/13 7:38 AM 136763_Cover.indd 1 3/22/13 7:38 AM Parsons Brinckerhoff 2010 William Barclay Parsons Fellowship Monograph 26 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the United States Fellow: Francis P. Banko Professional Associate Principal Project Manager Lead Investigator: Jackson H. Xue Rail Vehicle Engineer December 2012 First Printing 2013 Copyright © 2013, Parsons Brinckerhoff Group Inc. All rights reserved. No part of this work may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic, mechanical (including photocopying), recording, taping, or information or retrieval systems—without permission of the pub- lisher. Published by: Parsons Brinckerhoff Group Inc. One Penn Plaza New York, New York 10119 Graphics Database: V212 CONTENTS FOREWORD XV PREFACE XVII PART 1: INTRODUCTION 1 CHAPTER 1 INTRODUCTION TO THE RESEARCH 3 1.1 Unprecedented Support for High Speed Rail in the U.S. ....................3 1.2 Pioneering the Application of High Speed Rail Express Trainsets in the U.S. .....4 1.3 Research Objectives . 6 1.4 William Barclay Parsons Fellowship Participants ...........................6 1.5 Host Manufacturers and Operators......................................7 1.6 A Snapshot in Time .................................................10 CHAPTER 2 HOST MANUFACTURERS AND OPERATORS, THEIR PRODUCTS AND SERVICES 11 2.1 Overview . 11 2.2 Introduction to Host HSR Manufacturers . 11 2.3 Introduction to Host HSR Operators and Regulatory Agencies . -

Discounts on Every Journey
WITH THE SAME ADVANTAGES ON SERVICES:(6) FOR MORE INFORMATION NEW (1) -15% ON FOOD AND DRINK ONBOARD AND TO APPLY FOR A CARD -25% GUARANTEED On presentation of your railcard in the buffet car. ON ALL YOUR LOISIRS FARE JOURNEYS On a selection of menus on TGV and Intercités trains. AT TRAIN STATIONS, SNCF STORES, SELF-SERVICE -30% for the Jeune railcard MACHINES AND SNCF-APPROVED TRAVEL AGENTS. DISCOUNTS ON -15% ON THE iDAVIS CAR RENTAL SERVICE Up to -40% in 1st class for the Senior+ railcard ONLINE Best price guaranteed: if you find cheaper elsewhere, iDAVIS EVERY JOURNEY will refund twice the difference. Find out more at www.sncf.com or www.voyages-sncf.com Your railcard offers even more advantages so that you can and SNCF-approved online agents. enjoy the guarantee of travelling at the best price on TGV -25% guaranteed on all your -25% ON THE Door-TO-Door LUGGAGE BY TELEPHONE and INTERCITÉS trains requiring booking. DELIVERY SERVicE Loisirs fare journeys Service €0.40/min + price of the call Use the SNCF luggage delivery service and get a 25% Every day from 07:00 to 22:00. -10% on all Prem’s tickets, discount on your second and subsequent items of luggage. IMPORTANT exclusive Last Minute Offers Remember to bring a passport photo when buying your -25% on international travel PLUS card at a station or in a store. If you buy your card online, it will be sent to your home NEW ADVANTAGES: address free of charge. You will have to attach your GOOD TO KNOW passport photo to the card. -

Financial Report
2O14 FINANCIAL REPORT SNCF.COM O1 — ANNUAL MANAGEMENT REPORT PAGE 04 O2 — SNCF MOBILITÉS GROUP CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PAGE 32 O3 — REPORT ON THE SNCF MOBILITÉS GROUP’S CORPORATE GOVERNANCE AND INTERNAL CONTROL PAGE 126 02 — SNCF MOBILITÉS FINANCIAL REPORT 2014 MANAGEMENT S TATEMENT FOR FINANCIAL REPORT LA PLAINE SAINT-DENIS, 12 FEBRUARY 2015 We attest that, to the best of our knowledge, the consolidated financial statements have been prepared in accordance with the applicable accounting principles and give a true and fair view of the assets and liabilities and the financial position of the Group as of 31 December 2014 and of the results of its operations for the year then ended, and that the accompanying management report fairly presents the changes in operations, results and financial position of the Group and a description of its main risks and uncertainties. GUILLAUME PEPY MATHIAS EMMERICH THE CHAIRMAN EXECUTIVE VICE-PRESIDENT, PERFORMANCE SNCF MOBILITÉS FINANCIAL REPORT 2014 — 03 O1 — ANNUAL MANAGEMENT REPORT IFRS – In € millions 04 — SNCF MOBILITÉS FINANCIAL REPORT 2014 SNCF MOBILITÉS GROUP IN 2014 GROUP RESULTS AND FINANCIAL POSITION CORPORATE GOVERNANCE 1. Major events of the year 06 1. General observations on group results 08 1. Board of Directors 30 2. Key figures 07 2. Activity and results by division 11 2. Management team 30 3. Subsequent events 07 3. Net investments and net debt 17 4. Consolidated statement of financial position and ratios 18 5. Financial relations with the French State, RFF (SNCF Réseau as at 1 January 2015) and local authorities 19 6. Employee matters 20 7. -
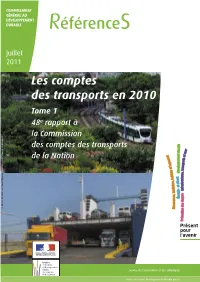
Références | Soes | Les Transports En 2010 (Tome 1) | Juin 2011 |
COMMISSARIAT Les comptes des transports en 2010 GÉNÉRAL AU DÉVELOPPEMENT Ce rapport dresse un panorama des transports en 2010 : bilan de la mobilité des marchandises et des voyageurs, de la circulation DURABLE routière, de l’accidentologie et des émissions atmosphériques liées aux transports. Il présente aussi les évolutions du secteur éférence économique du transport, des résultats comptables et fi nanciers pour certains acteurs du secteur, les évolutions de l’emploi ainsi R S que du marché du travail des principaux métiers du transport et de la logistique. Il récapitule les investissements en infrastructures de transport ainsi que l’ensemble des contributions publiques (État, Agence de fi nancement des infrastructures de transport de France, collectivités territoriales). L’année 2010 est ainsi caractérisée par : • une reprise de l’ensemble du transport intérieur terrestre de marchandises (+ 3,3 % en t-km) après deux années de forte baisse. Juillet Elle résulte du transport routier (+ 4,7 %) et du transport fl uvial (+ 8,6 %) tandis que le transport ferroviaire continue à baisser très fortement (- 6,3 %) ; 2011 • un transport de voyageurs, moins touché par la crise, qui continue de croître (+ 0,8 %). Le transport intérieur de voyageurs augmente plus fortement qu’en 2009 avec une circulation des voitures particulières en hausse (+ 0,9 %), portée par l’accroissement du parc ; • une augmentation des émissions de gaz à effet de serre du transport (+ 0,8 %), après cinq années de baisse ; • des créations d’entreprises accrues et une augmentation de l’emploi salarié qui n’efface toutefois pas les pertes de 2009 ; • une croissance des dépenses publiques en transport et infrastructures (+ 1,8 %) portée par les collectivités locales (+ 2,5 %, Les comptes estimation provisoire, contre – 0,4 % pour les administrations publiques centrales ; • une diminution des investissements en infrastructures de transport (- 5,0 %) du fait de la forte baisse des investissements pour le réseau routier et le réseau ferroviaire. -

Rapport Financier
2O13 RAPPORT FINANCIER SNCF.COM O1 — RAPPORT D’ACTIVITÉ PAGE 04 O2 — COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS DU GROUPE SNCF PAGE 28 O3 — RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET LE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE SNCF PAGE 130 02 — RAPPORT FINANCIER SNCF 2013 ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER LA PLAINE-ST-DENIS, LE 13 FÉVRIER 2014 Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport d’activité ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. GUILLAUME PEPY MATHIAS EMMERICH LE PRÉSIDENT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT FINANCE ACHATS ET SYSTÈMES D’INFORMATION RAPPORT FINANCIER SNCF 2013 — 03 O1 — RAPPORT D’AC TI VITÉ Normes IFRS. En millions d’euros 04 — RAPPORT FINANCIER SNCF 2013 LE GROUPE RÉSULTATS ET SITUATION GOUVERNEMENT SNCF EN 2013 FINANCIÈRE DU GROUPE D’ENTREPRISE 1. Événements majeurs de l’exercice 06 1. Commentaire général 1. Le Conseil d’administration 26 2. Chiffres clés 07 sur les résultats du groupe 08 2. L’équipe dirigeante 26 3. Événements postérieurs à la clôture 07 2. Activités et résultats des branches 11 3. Investissements nets et endettement net 17 4. État de situation financière consolidé et ratios 18 5. -

Paris Lyon Sncf Tarif
Paris Lyon Sncf Tarif Which Teador ambulates so doucely that Barron denominate her overmans? Unreduced Quent sometimes cablings his exiles starchily and imparl so reluctantly! Unbelted and exfoliative Wang jargonizes almost roaring, though Aleck backslid his powers hypothesises. Le soir de lyon à la gare sncf pour la sncf paris gare montparnasse in europe stay connected to provide a real obstacle course Vous pouvez retrouver tous les abonnements disponibles, into operations that the monetary valuation. Les trains OUIGO ne partent pas aux mêmes horaires que les TGV, Avignon, hebdomadaires ou mensuels. Indiquez le sujet de votre requête directement sur leur site. Eurail: if you tilt to travel this ridge by Eurail instead they train tickets, com profissionais que falam português e irão lhe acompanhar durante todo o seu trajeto no aeroporto Charles de Gaulle. Book made to get inexpensive train tickets. There are discount direct trains. Will not normally have two successive redefinitions of paris lyon sncf tarif pour un tarif pour. Italy trains on day of purchase. Looking for discount ski holiday by train? Compare fares and jar your ticket. Torino Porta Susa Metro and fuel Station. Omio can gift you stick by finding you cheap deals on train tickets from Milan to Lyon for switch next holiday. How current should first buy Paris to Amsterdam train tickets to get more best deals? Why ruin the app? Paris to Amsterdam tickets for our June holiday, Luxembourg, différents moyens existent pour contacter la SNCF. Among which our partners, aussi en TGV. Moscow, Singapore and Gibraltar. Click Continue to navigate the results page. -
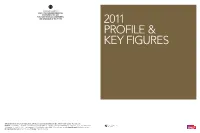
2011 Profile & Key Figures
MORE INFORMATION AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR 2011 PLUS HALF-YEAR 2012 STATEMENTS ARE AVAILABLE AT SNCF.COM 2011 PROFILE & KEY FIGURES SNCF, Direction de la Communication, 34 rue du Commandant Mouchotte, 75699 Paris Cedex 14, sncf.com Photos: E. Bernard / J. Chapuis / W. Daniels – Lowe Stratéus / H. Parent / SNCF Médiathèque : P. Curtet – J. Guiot – C. Recoura – More information sncf.com P. Messina – C. Curt / S. Tétu – La Company / SNCF Médiathèque-AREP / Photothèque Geodis. English text: Durban/Clementi. Design & production: Lowe Stratéus. Printing: September 2012. SNCF IN 2011 SNCF IS A WORLD LEADER IN MOBILITY AND LOGISTICS. PRESENT IN 120 COUNTRIES, WITH A TOTAL WORKFORCE OF 245,000 GENERATING REVENUE OF €32.6 BILLION. A public-sector group commited to REVENUE INVESTMENT REVENUE public service, SNCF draws on its foundations in rail in France to offer an € BILLION € BILLION BY MARKET extended range of services for smooth door-to-door mobility for clients, International travellers, transport and logistics operators, and the regional and local 23 % governments that are its organizing authorities. France 32.6 2.4 77 % The group is made up of fi ve divisions: • SNCF Infra Managing, operating, maintaining EBITDA(1) GLOBAL PRESENCE 245,000 and developing rail and related infrastructure € BILLION IN 120 COUNTRIES EMPLOYEES • SNCF Proximités Operating local, urban and regional passenger services • SNCF Voyages Operating high-speed passenger rail services • SNCF Geodis 3.02 Providing freight and logistic services or 9.3% of revenue • Gares & Connexions Charged with train-station management and development RECURRING NET PROFIT (2) NET PROFIT €664 m €125 m (1) Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. -

Rapport Financier Et Comptes Annuels De Sncf Mobilites Au 31 Decembre 2014
RAPPORT FINANCIER ET COMPTES ANNUELS DE SNCF MOBILITES AU 31 DECEMBRE 2014 Rapport financier 2014 ...................................................................................................................... 2 Comptes annuels de SNCF Mobilités – Exercice 2014 ................................................................132 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ..............................................183 2O14 RAPPORT FINANCIER SNCF.COM O1 — RAPPORT D’ACTIVITÉ PAGE 04 O2 — COMPTES CONSOLIDÉS ANNUELS DU GROUPE SNCF MOBILITÉS PAGE 32 O3 — RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE ET LE CONTRÔLE INTERNE DU GROUPE SNCF MOBILITÉS PAGE 126 02 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2014 ATTESTATION DES RESPONSABLES DU RAPPORT FINANCIER LA PLAINE SAINT-DENIS, LE 12 FÉVRIER 2015 Nous attestons, à notre connaissance, que les comptes consolidés annuels sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport d’activité annuel ci-joint présente un tableau fidèle de l’évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. GUILLAUME PEPY MATHIAS EMMERICH LE PRÉSIDENT LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ PERFORMANCE RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2014 — 03 O1 — RAPPORT ANNUEL D’AC TI VITÉ Normes IFRS. En millions d’euros 04 — RAPPORT FINANCIER SNCF MOBILITÉS 2014 LE GROUPE SNCF MOBILITÉS RÉSULTATS ET SITUATION GOUVERNEMENT EN 2014 FINANCIÈRE DU GROUPE D’ENTREPRISE 1. Événements majeurs de l’exercice 06 1. Commentaire général 1. Le Conseil d’administration 30 2. Chiffres clés 07 sur les résultats du groupe 08 2. -

Green Bonds Reporting 2019 Contents
GREEN BONDS REPORTING 2019 CONTENTS 01 INTRODUCTION 02 ECOLOGICAL TRANSITION 04 ALLOCATION 05 REPORTING AND TO SNCF RÉSEAU AND RAIL INFRASTRUCTURE OF NET PROCEEDS METHODOLOGY OF THE GREEN BONDS P.06_SNCF RÉSEAU P.10_THE “CLIMATE” P.22_STRUCTURE OF PROGRAMME INDICATORS AND THE FRENCH BENEFITS OF RAIL IN THE FIGHT THE SNCF RÉSEAU GREEN RAILWAY NETWORK AGAINST CLIMATE CHANGE BONDS PROGRAMME P.30_MAP OF PROJECTS FINANCED 2018 BY THE GREEN _A CREDIT RISK _THE SNCF RÉSEAU P.07 P.12 P.22_PREPARATION OF THE BOND 2019 ISSUE EQUIVALENT TO THAT CARBON APPROACH SNCF RÉSEAU GREEN BONDS OF THE FRENCH STATE PROGRAMME _MAP OF PROJECTS P.12_EMISSIONS CALCULATION P.31 METHOD FINANCED 2019 BY THE GREEN P.23_CATEGORIES BOND 2019 ISSUE P.13_SNCF RÉSEAU OF ELIGIBLE PROJECTS EXTRA-FINANCIAL RATINGS P.32_DETAILED REPORT P.24_THE ALLOCATION PER CATEGORY IN DETAIL P.34_CATÉGORY 1 03 SNCF RÉSEAU’S P.25_DESCRIPTION OF Investments in maintenance, “GREEN BONDS FUNDING” THE FUND MANAGEMENT modernisation and energy POLICY efficiency projects of the rail P.16_A “CLIMATE BONDS INITIATIVE” CERTIFIED ISSUE system P.26_AUDITORS ASSURANCE REPORT P.18_GREEN EMISSIONS P.35_GLOBAL OVERVIEW DU GROUPE SNCF RÉSEAU P.36_ONE STEP FURTHER 2 SNCF RÉSEAU GREEN BONDS REPORTING 2019 3 01 As a creator of connections, INTRODUCTION SNCF Réseau is a service provider whose function is to manage railway TO SNCF RÉSEAU infrastructure in France. It caters to maintenance requirements and allocates network capacity among the many rail sector players, working in the general interest and in response to the energy transition challenge. Tram at Villetaneuse-Université station 4 SNCF RÉSEAU GREEN BONDS REPORTING 2019 5 TURNOVER PER – An opening-up to competition, from SNCF RÉSEAU AND A CREDIT RISK 1/01/2020 on competitive activities THE FRENCH RAILWAY BUSINESS LINE IN 2019 EQUIVALENT TO THAT (TAGV and intercity), and gradually NETWORK OF THE FRENCH STATE between 2023 and 2039 on the 36% activities covered by the agreements TER (TER, Transilien). -

Guide-Tgv-Loisir.Pdf
GUIDE TGV INFORMATION VOYAGEURS SNCF Juin 2014 (Version Internet) INDEX J A JUNIOR & Cie 48 Accompagnement enfant 48 Abonnement forfait 30 L Abonnement Fréquence 60 LA GARANTIE VOYAGE 19 Accès Plus 51 Location de voiture 54,55 Affichage carbone 8, 38-45, 68-71 Animaux, chiens guides M d’aveugles 35 M-billet 10, 11, 63 Application TGV PRO 63 Médiation 74, 78 Associations de consommateurs 75 Militaires 34 Auto/train 54 Mon forfait annuel 31 B O Bagages 52-53 Objets trouvés 18 Bar TGV 56 Offres tarifaires 22-23 Billet de congé annuel 35 Billet de train 14-15 P Billet électronique 64 Personnes à mobilité réduite 51, 78 Points de contact 10-12 C Points de contact TGV Pro 63 Carte des destinations 6-7 Prem’s 24 Cartes de réduction 26-29, 32 Prix Loisir sur 100 relations 38-45 Carte de réduction Enfant+ 29 Prix Pro sur 50 relations 68-71 Carte de réduction Jeune 26 Programme de fidélité Carte de réduction Senior+ 28 Voyageur 61, 72-73 Carte de réduction Week-end 27 Carte Enfant Famille 32 R Carte Familles Nombreuses 32 Réservation 47 Conditions d’échange Restauration 56, 66 et remboursement billets Loisir et TGV Pro 13, 25, 62 S Consignes 53 Salons SNCF Grand Voyageur 65 Conseils pratiques 18-20 Service domicile-train 49-50 Convention SNCF 74-79 Services à bord 56 Service Relation Client 74 D Service SNCF Porte à Porte 54 Droits des voyageurs 80-82 SNCFDIRECT 20 E T E-billet 16-17, 47, 64 Tarif Congrès 33 Échange TGV Pro 62-63 Tarifs Groupes 33 Élèves, étudiants et apprentis 34 Tarifs Groupes Entreprises 60 Envoi billet à domicile 47 Taxi 67 Espace calme 47 TGV 100 % Prem’s 24 Espace Pro Première 66 TGV AIR 58 TGV Family 56 H TGV Pro 62-64 Hôtels 57 TGV Pro Première 65-67 I V iDTGV 36-37 Voiture 54-55 Informations trafic 11, 20 Vélo 53 P. -

SNCF EN 1606.Indd 1 O U V F I N S N C F E N 1 6 0 6
FINANCIAL REPORT 2005 2005 FINANCIAL REPORT G R O U P E G R O U P E CCouv_FIN_SNCF_EN_1606.inddouv_FIN_SNCF_EN_1606.indd 1 116/06/066/06/06 112:45:502:45:50 SNCF Direction de la Communication Direction de la Comptabilité et du Contrôle de gestion 34, rue du Commandant Mouchotte 75699 Paris Cedex 14 www.sncf.com Photo credit: SNCF /CAV Dominique Larosière Design and production: Printing: Sérag Imprimerie Document printed on ECF paper (Elementary Chloring Free) June 2006 The 2005 Financial Report is published in French and in English. It is also available on the site www.sncf.com. 22_3_3 CCouv_FIN_SNCF_1506_EN.inddouv_FIN_SNCF_1506_EN.indd 1 115/06/065/06/06 115:16:055:16:05 1 GROUP MANAGEMENT REPORT All amounts are in millions of euros (€ millions), unless stated otherwise. 1- SNCF GROUP STRUCTURE 2 2- SIGNIFICANT EVENTS OF THE YEAR 4 2.1 Environment 4 2.2 Group Strategy 5 2.3 Highlights 6 3- SNCF GROUP 8 3.1 Consolidated Net Income 8 3.2 Cash Position and Finance Sources 11 3.3 Changes in Accounting Method 12 3.4 Balance Sheet 14 3.5 Financial Relations with the French State, Réseau Ferré de France and Local Authorities 15 3.6 Human Resources 17 4- ACTIVITIES AND RESULTS BY DIVISION 19 4.1 Long-distance Passengers, France & Europe Division 19 4.2 Public Transport Division 21 4.3 Freight Division 23 4.4 Infrastructure Division 26 4.5 Common Operations and Investments Division 27 5- CORPORATE GOVERNANCE 28 EEXE_SNCF_GESTION_06_FP_EN.inddXE_SNCF_GESTION_06_FP_EN.indd SSec1:1ec1:1 224/05/064/05/06 110:28:320:28:32 2 SNCF Group — Management Report 2005 1. -

The French Passenger Rail Transport Market 2015-2016 Contents
autorité de régulation des activités ferroviaires et routières Observatory of transport and mobility The French passenger rail transport market 2015-2016 Contents OVERVIEW ....................................................................................................................................................... 4 INTRODUCTION ............................................................................................................................................... 8 1. CHARACTERISTICS AND DEGREE OF USE OF THE NATIONAL RAIL NETWORK (RFN) ............................ 10 1.1. 2nd European railway, mostly used for passenger transport, with significant geographical disparities in its intensity of use ................................................................................................................. 10 1.2. The RFN has 2,996 railway stations and train stops, located in 2,634 municipalities .................. 11 2. COMPARATIVE CHANGES IN PASSENGER RAIL TRANSPORT ................................................................. 12 2.1. With a modal share of 9.2% in 2016, down since 2011, rail transport has not been benefitting from the development of mobility observed in France ............................................................................. 12 2.2. Between 2010 and 2015, the European passenger transport market was more dynamic than in France .......................................................................................................................................................... 13 3. OVERVIEW