CHIWAKI SHINODA, JAPONIA the Cult of Trees Summary
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Through the Case of Izumo Taishakyo Mission of Hawaii
The Japanese and Okinawan American Communities and Shintoism in Hawaii: Through the Case of Izumo Taishakyo Mission of Hawaii A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAIʽI AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN AMERICAN STUDIES MAY 2012 By Sawako Kinjo Thesis Committee: Dennis M. Ogawa, Chairperson Katsunori Yamazato Akemi Kikumura Yano Keywords: Japanese American Community, Shintoism in Hawaii, Izumo Taishayo Mission of Hawaii To My Parents, Sonoe and Yoshihiro Kinjo, and My Family in Okinawa and in Hawaii Acknowledgement First and foremost, I would like to express my deep and sincere gratitude to my committee chair, Professor Dennis M. Ogawa, whose guidance, patience, motivation, enthusiasm, and immense knowledge have provided a good basis for the present thesis. I also attribute the completion of my master’s thesis to his encouragement and understanding and without his thoughtful support, this thesis would not have been accomplished or written. I also wish to express my warm and cordial thanks to my committee members, Professor Katsunori Yamazato, an affiliate faculty from the University of the Ryukyus, and Dr. Akemi Kikumura Yano, an affiliate faculty and President and Chief Executive Officer (CEO) of the Japanese American National Museum, for their encouragement, helpful reference, and insightful comments and questions. My sincere thanks also goes to the interviewees, Richard T. Miyao, Robert Nakasone, Vince A. Morikawa, Daniel Chinen, Joseph Peters, and Jikai Yamazato, for kindly offering me opportunities to interview with them. It is a pleasure to thank those who made this thesis possible. -

80Th Anniversary Celebration Konko Mission of Wahiawa
80th Anniversary Celebration Konko Mission of Wahiawa Konko Mission of Wahiawa 207 Muliwai Avenue Wahiawa, HI. 96786 Phone & Fax: (808) 621-6667 E-mail: [email protected] “Thank you for the blessings till today” Sunday, March 15, 2020 Konko Mission of Wahiawa 80th Anniversary 60 Konko Mission of Wahiawa 80th Anniversary 1 49) Mansho, Rene 108) Yasutake, Rev. Tetsuro (Waipahu Kyokai) 50) Masaki, Chelsea 109) Yasutake, Rev. Mitsuko (Waipahu Kyokai) 51) Masaki, Hunter 110) Yasutake, Rev. Akinobu (Waipahu Kyokai) 52) Masaki, Judy 111) Yasutake, Rev. Miyoko (Waipahu Kyokai) 53) Masaki, Sean 112) Yasutake, Judy 54) Matsunaga, Tsugumi 113) Yasutake, Rev. Hisayo (Wailuku Kyokai) 55) Matsuoka, Rev. Edna (Wahiawa Kyokai) 114) Yasutake, Rev. Kanae (Wailuku Kyokai) 56) Matsuoka, Clayton 115) Yasutake, Aimee Guests 57) Miyahara, Nolan 116) Yasutake, Rev. Michiyoshi (Amagi Kyokai) 58) Miyasaka, Janet 117) Yasutake, Rev. Sachiko (Amagi Kyokai) 1) Adkison, Bryce 59) Miyashiro, Leong-Courtney 118) Yee, Jeremy 60) Montes, Rie 119) Yip, Fong 2) Adkison, Jason 3) Adkison, Jayden 61) Motosue, Reiko 120) Yip, Paley 62) Newell, Yuka 121) Zhao, Lyndon 4) Adkison, Trisha 5) Arakaki, Terry Jean 63) Nguyen, Chris 122) Zhao, Susan 64) Noguchi, Hugh 6) Esteban, Joyce 65) Oda, Glenn 7) Fukagawa, Rev. Shoryu (Ryusenji Soto Mission) 66) Oda, Claire 8) Fukushima, Dennis 9) Furusho, Alex 67) Ohata, Nancy 68) Ogino, Kiyoteru 10) Furusho, Masumi 11) Furusho, Nicholas 69) Okuno, Loren 70) Okuno, Rev. Setsuko (Hanapepe Kyokai) 12) Furusho, Randy 13) Grange, Evan 71) -

The Making of an American Shinto Community
THE MAKING OF AN AMERICAN SHINTO COMMUNITY By SARAH SPAID ISHIDA A THESIS PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS UNIVERSITY OF FLORIDA 2008 1 © 2007 Sarah Spaid Ishida 2 To my brother, Travis 3 ACKNOWLEDGMENTS Many people assisted in the production of this project. I would like to express my thanks to the many wonderful professors who I have learned from both at Wittenberg University and at the University of Florida, specifically the members of my thesis committee, Dr. Mario Poceski and Dr. Jason Neelis. For their time, advice and assistance, I would like to thank Dr. Travis Smith, Dr. Manuel Vásquez, Eleanor Finnegan, and Phillip Green. I would also like to thank Annie Newman for her continued help and efforts, David Hickey who assisted me in my research, and Paul Gomes III of the University of Hawai’i for volunteering his research to me. Additionally I want to thank all of my friends at the University of Florida and my husband, Kyohei, for their companionship, understanding, and late-night counseling. Lastly and most importantly, I would like to extend a sincere thanks to the Shinto community of the Tsubaki Grand Shrine of America and Reverend Koichi Barrish. Without them, this would not have been possible. 4 TABLE OF CONTENTS page ACKNOWLEDGMENTS ...............................................................................................................4 ABSTRACT.....................................................................................................................................7 -
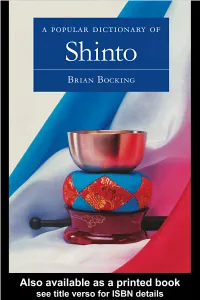
A POPULAR DICTIONARY of Shinto
A POPULAR DICTIONARY OF Shinto A POPULAR DICTIONARY OF Shinto BRIAN BOCKING Curzon First published by Curzon Press 15 The Quadrant, Richmond Surrey, TW9 1BP This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2005. “To purchase your own copy of this or any of Taylor & Francis or Routledge’s collection of thousands of eBooks please go to http://www.ebookstore.tandf.co.uk/.” Copyright © 1995 by Brian Bocking Revised edition 1997 Cover photograph by Sharon Hoogstraten Cover design by Kim Bartko All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the publisher. British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 0-203-98627-X Master e-book ISBN ISBN 0-7007-1051-5 (Print Edition) To Shelagh INTRODUCTION How to use this dictionary A Popular Dictionary of Shintō lists in alphabetical order more than a thousand terms relating to Shintō. Almost all are Japanese terms. The dictionary can be used in the ordinary way if the Shintō term you want to look up is already in Japanese (e.g. kami rather than ‘deity’) and has a main entry in the dictionary. If, as is very likely, the concept or word you want is in English such as ‘pollution’, ‘children’, ‘shrine’, etc., or perhaps a place-name like ‘Kyōto’ or ‘Akita’ which does not have a main entry, then consult the comprehensive Thematic Index of English and Japanese terms at the end of the Dictionary first. -

Jahresbrauchtum Im Japanischen Dorf
Jahresbrauchtum im japanischen Dorf Von Takeda Hisayoshi Vorwort des Herausgebers Das japanische Original dteser Arbeit von Dr, Takeda Hisayoshi (武田 久吉)ist in Buchform unter dem Titel Noson no nenju gyoji (農村の年中行事) Shozca 18 (1943) im Verlage Ryuseikaku (龍星闇)erschienen. Die deutsche (Jbersetzung besorgte aufmeine Anregung Frau Dr. Nelly 'Wang-Josty Shanghai• Ich. habe Herrn D r. Takeda,s Buch iiber im Kreislauf des Jahres in den japani schen Bauernddrfern ausgeubte Brauchtiimer fiir eine Verdffentlichung in einer europdischen Sprache hauptsdchlich aus zwei Grunden fu r geeignet gefunden, zundchst wed sie uns zeigt, in welchem reichhaltigen Ausmafie das Idndliche Leben Japans noch mit Festen, Sitten und Brducheti, iiber die zcir in unserer ethnogra- phischen Literatur noch verhaltnismafii^ zoenig wissen, durchwoben ist; ferner zceil der Verfasser den Staff geniigend eingehend und umsichtig behandelt,sodafi er ah M aterial fiir vergietchende volkskundliche Studien verzcandt werden kann. Bei diesen denke ich in erster Linie an die interessante Frage, zvie weit und zvieviel chinesisches Brauchtum im Zuge der Ausbreitung der chinesischen Kultur in das japanische Volksleben eingedrungen ist, Der erste Eindruck beim Lesen des Buches ist、dafi das ausserordentlich weitgehend der F a ll war. Im Einzelnen konnen zceitere Studien noch zeigen, wann und in toelcher Form chmesische Brduche nach Japan gelangt sind,sich hier erhalten und wie sie sich mit ein~ heimischen Elementen vermischt haben. DariiOer hinaus kann die Arbeit Take- da’s auch fiir weiter ausholende Studien iiber Kulturzusammenhdn^e una fiir volkerpsvchologische Betrachtungen verwertet werden. Nur kurz set erwdknt, dafi Takeda sich von fachfretnden Einstellungen und Nebenabstchten zeitbedingter politischer Natur vollstdndig freigehalten hat. -
![The Shinto Cases: Religion, Culture, Or Both-The Japanese Supreme Court and Establishment of Religion] Urisprudence, 2013 BYU L](https://docslib.b-cdn.net/cover/8840/the-shinto-cases-religion-culture-or-both-the-japanese-supreme-court-and-establishment-of-religion-urisprudence-2013-byu-l-2158840.webp)
The Shinto Cases: Religion, Culture, Or Both-The Japanese Supreme Court and Establishment of Religion] Urisprudence, 2013 BYU L
Michigan State University College of Law Digital Commons at Michigan State University College of Law Faculty Publications 2013 The hinS to Cases: Religion, Culture, or Both-The Japanese Supreme Court and Establishment of Religion] urisprudence Frank S. Ravitch Michigan State University College of Law, [email protected] Follow this and additional works at: http://digitalcommons.law.msu.edu/facpubs Part of the Jurisprudence Commons, and the Religion Law Commons Recommended Citation Frank S. Ravitch, The Shinto Cases: Religion, Culture, or Both-The Japanese Supreme Court and Establishment of Religion] urisprudence, 2013 BYU L. Rev. 505 (2013). This Article is brought to you for free and open access by Digital Commons at Michigan State University College of Law. It has been accepted for inclusion in Faculty Publications by an authorized administrator of Digital Commons at Michigan State University College of Law. For more information, please contact [email protected]. The Shinto Cases: Religion, Culture, or Both-The Japanese Supreme Court and Establishment of Religion] urisprudence Frank S. Ravitch * I. INTRODUCTION Japanese "Establishment Clause" law, cases under Article 20 and 1 Article 89 of the Japanese Constitution, is heavily based on situations involving Shinto shrines or Shinto rituals. For a number of historical, theological, and cultural reasons, discussed in greater 2 detail in Part II, this should not be surprising. The history and evolution of this area of jurisprudence from the Meiji era to the most recent cases creates a fascinating legal and cultural journey. There is a tendency to consider the "Shinto cases" as a single line of cases that are at the core of Japanese Establishment of Religion jurisprudence. -

“Religion and Law in Japan”
“Religion and Law in Japan” A Brief Sketch of Japanese History, Tradition, and Cases Dedicated to Nineteenth Annual International Law and Religion Symposium at Brigham Young University October 2012 Tasuku Matsuo Attorney at law, Matsuo & Kosugi Preface I would like to express my deepest gratitude to my dearest friend, Mr Connan Grames of the Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints for his giving me this honorable opportunity. I truly appreciate the long-time friendship with Mr Grames, whom I have respected for his accomplishment as a lawyer and sociologist, and his dedication to his family as a father. Chapter 1 – Japanese Society and Its Traditional Faith – Animism Law and religion are an inalienable part of society. Religious values constitute central elements of societal values that form the rules, principles and institutions governing society. First of all, there is a long tradition of animism in Japan. In the Japanese worldviews, there is less distance between man and the divine. From prehistoric times, Japanese people worshiped nature as divine. They believed that natural features such as mountains, rivers, stones, and plants all had spirits and venerated those as Kami or gods, which most were seen as the sacred powers within nature. The people offered prayers to them and sought salvation from them. Typically, the core of Shintoism, an indigenous religion of Japan, is based on the worship of nature. Also, another special feature of Japanese religious culture rests on the polytheism in it. Contrary to the Western Judeo-Christian monotheistic tradition, so many different gods are enshrined in Japan, including human beings, animals, natural gods and even foreign gods, that there is a term "Yaorozu no kami", literally meaning 'eight million gods'. -

59179323.Pdf
SACREDTWIGANDTREE: TAMAGUSH ZAND SAKAKI INJAPANESE-ENGLISHDICTIONARIES MichaelCarr ThepresentarticleanalyzesJapanese-Englishdictionarytransla- tionsfor tamdguShi 玉串 `aShintooffertory sakaki branch'and sakaki 榊 `anevergreen (Cleye71aOChnacea) regardedassacred.'lThiscasestudyin bilinguallexicographyhasfoursections_Thefirstreviewshow tamagu- shi wastranslatedasEnglish"sacredtwig"inanewspaperstoryabout theconstitutionalseparationofreligionandstate.Thesecondsection introducestheJapanesewords ta magushi and sakaki ,andpresentsout- standingdefinitionsfromamonolingualdictionary(Figures1and2). Thethirdcompares tamLquShi and sakaki translationequivalentsfrom twodozenJapanese-Englishdictionaries(Tables1and2),findingtypo- graphicalerrorslike"offerasprigbranch"insteadof"offerasprig or branch."Theconcludingsectiondiscussesbilingualdictionaryerrors abou ttamqushi asexemplifyingoftenunreliableEnglishequivalentsof Japanesefloraandfaunanames.Forinstance,the hzmLquShi entryin 1.Anumberoffriends,colleagues,editors,andrefereessuggestedimprove一 meれtsuponearlierversionsofthispape r.ThanksgotoYukieAihara,Lew Ballard,CarlBecker,EdandRuthCarr,WilliamChisholm,GeraldCohen , LotharYonFalkenhausen,MatthewHanley,SheilaHanley,RobertIIson , HisanoriKimira,MichaelSherard,IsaoShimomura,OsamuTakai,Steve Toskar,YokoTsuboya,andHisaoYamamoto.Theauthordiscussed tama- gushi and sakak iinapubliclectureentitledHNihongonojishonitsuite 日本 語の辞書についで '[OnJapaneseDictionaries](summarizedinCarr1992). 2 人 文 研 究 第 89 輯 theprestigiousKenkyusha'sNe u) Japanese-EnglikhDictiona7y(4thed.) misspellsCleyeraochnaceaas"CleyeyiaWChnacca." -

Aspects of Shinto in Japanese Communication*
Intercultural Communication Studies XII-4 2003 Asian Approaches to Human Communication Aspects of Shinto in Japanese Communication* Kazuya Hara Meikai University, Japan Abstract A person’s religious view is one of the elements that strongly influences his or her guiding principle in daily communication. In this essay, the author focuses on Shinto and attempts to conceptualize its influence on aspects of Japanese daily life and communication. First, the author reviews Shinto’s definitions, types of modern Shinto, the concept of kami (gods), the-other- world-views, reverence of nature, worship of ancestors, musubi (the mystical power of becoming or creation), and purity. Then, the author proposes two communication models based on a Shinto perspective: (1) kan’no (responding to nature as a deity) as intrapersonal communication; and (2) the sense of oneness with kami achieved by carrying mikoshi (a portable Shinto shrine) in matsuri festival. Introduction Sound human communication is being confronted with crises because of environmental disruption, superficial human relationships in society, or inhumane crimes. In such a time, it seems meaningful to rethink what we live by, and to what we owe our appreciation for our existence in this world. A person’s religious view is one of the elements that strongly influences his or her guiding principle in daily communication. For example, Wakimoto (1990) states that religious worldview not only inspires a person’s way of life, but also sways his or her value judgment and decision making. Among various religious and cultural views held, for most Japanese people, Shinto1 has had the greatest influence on their communication as the nucleus of their mental and behavioral culture with its simplicity (e.g., Irwin, 1996; Tsujimura, 1987). -

Shintō Comes to America
Shintō Shintō Comes to America Shintō Comes to America Summary: The Tsubaki Grand Shrine first took root in an ordinary suburban home in Stockton, California. The shrine soon found itself making special connections with the wider community, representing the Shintō tradition in conversations with Unitarian Universalist communities and with the Graduate Theological Union in Berkeley. On Alpine Avenue in Stockton, California, not far from the University of the Pacific, is the site of the original Tsubaki America Grand Shrine. While there had long been Shintō shrines on the islands of Hawaii, where many Japanese lived for over a century, this Shintō shrine was the first to have been built in mainland America. In 1992, the priests of the Tsubaki shrine in Stockton conducted a ceremony at Rocky Mountain Dharma Center in Red Feather Lakes, Colorado, to enshrine four kami in a newly constructed Shintō shrine there in the mountains. The priests carried four white-wrapped boxes into the shrine, each symbolizing the spirit of the kami. The principal kami enshrined here is Amaterasu Omikami, the Sun Goddess. That same year, Kannagara Jinja was established by Rev. Koichi Barrish in Granite Falls, Washington. It was here in 2001 that Kannagara Jinja and Tsubaki America merged and became the new home of the Tsubaki Grand Shrine in America. In the early days, the house on Alpine Avenue in Stockton appeared to be an ordinary suburban home. Inside, however, at the household altar, called a kamidana, the Shintō priest would make daily offerings to the kami. And behind the house, the distinctive torii gateway marked the path toward the Tsubaki Shrine, located in the garden. -

Encyclopedia of Shinto Chronological Supplement
Encyclopedia of Shinto Chronological Supplement 『神道事典』巻末年表、英語版 Institute for Japanese Culture and Classics Kokugakuin University 2016 Preface This book is a translation of the chronology that appended Shinto jiten, which was compiled and edited by the Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University. That volume was first published in 1994, with a revised compact edition published in 1999. The main text of Shinto jiten is translated into English and publicly available in its entirety at the Kokugakuin University website as "The Encyclopedia of Shinto" (EOS). This English edition of the chronology is based on the one that appeared in the revised version of the Jiten. It is already available online, but it is also being published in book form in hopes of facilitating its use. The original Japanese-language chronology was produced by Inoue Nobutaka and Namiki Kazuko. The English translation was prepared by Carl Freire, with assistance from Kobori Keiko. Translation and publication of the chronology was carried out as part of the "Digital Museum Operation and Development for Educational Purposes" project of the Institute for Japanese Culture and Classics, Organization for the Advancement of Research and Development, Kokugakuin University. I hope it helps to advance the pursuit of Shinto research throughout the world. Inoue Nobutaka Project Director January 2016 ***** Translated from the Japanese original Shinto jiten, shukusatsuban. (General Editor: Inoue Nobutaka; Tokyo: Kōbundō, 1999) English Version Copyright (c) 2016 Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University. All rights reserved. Published by the Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University, 4-10-28 Higashi, Shibuya-ku, Tokyo, Japan. -

The Construction of Separation of Religion and State in Post-War Japan
UCLA UCLA Pacific Basin Law Journal Title Reexamining Separation: The Construction of Separation of Religion and State in Post-War Japan Permalink https://escholarship.org/uc/item/7zb9f29b Journal UCLA Pacific Basin Law Journal, 22(1) Author White, Brent T. Publication Date 2004 DOI 10.5070/P8221022170 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California REEXAMINING SEPARATION: THE CONSTRUCTION OF SEPARATION OF RELIGION AND STATE IN POST-WAR JAPAN Brent T. White ABSTRACT This article provides a comprehensive doctrinal analysis and critique of the Japanese Supreme Court's treatment of separa- tion of religion and the state in post-war Japan. After placing the development of the doctrine in its proper historical and political context, the article argues that the Court's construc- tion of the doctrine threatens to undermine religious liberty and equality in Japan. The article then considers the various socio-political forces underlying the Court's construction of the doctrine, including the role that the Court sees itself play- ing in the contest over separation of religion and state in Ja- pan. The article concludes by arguing that, through the lens of the Japanese experience, one can draw normative lessons about the dangers of religious identity exclusion and the inap- propriateness of relying upon one constitutional standard-be it the Japanese Court's purpose and effect test, the Lemon test, or the O'Connor endorsement test-in interpreting the constitutional principle of separation of religion and the state. TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ........................................ 30 PART I: HISTORICAL BACKGROUND ................ 33 PART II: THE POLITICIZATION OF SEPARATION OF RELIGION AND STATE IN JAPAN ........