À L'aube De La Modernité
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

2019-2020 SCHOOL GROUP GUIDE Winter Or Summer, 7 TOURIST ATTRACTIONS Day Or Night, Montréal Is Always Bustling with Activity
2019-2020 SCHOOL GROUP GUIDE Winter or summer, 7 TOURIST ATTRACTIONS day or night, Montréal is always bustling with activity. 21 ACTIVITIES Known for its many festivals, captivating arts and culture 33 GUIDED TOURS scene and abundant green spaces, Montréal is an exciting metropolis that’s both sophisticated and laid-back. Every year, it hosts a diverse array of events, exhibitions 39 PERFORMANCE VENUES and gatherings that attract bright minds and business leaders from around the world. While masterful chefs 45 RESTAURANTS continue to elevate the city’s reputation as a gourmet destination, creative artists and artisans draw admirers in droves to the haute couture ateliers and art galleries that 57 CHARTERED BUS SERVICES line the streets. Often the best way to get to know a place is on foot: walk through any one of Montréal’s colourful and 61 EDUCATIONAL INSTITUTIONS vibrant neighbourhoods and you’ll discover an abundance of markets, boutiques, restaurants and local cafés—diverse expressions of Montréal’s signature joie de vivre. The energy 65 ACCOMMODATIONS is palpable on the streets, in the metro and throughout the underground pedestrian network, all of which are remarkably safe and easy to navigate. But what about the people? Montréalers are naturally charming and typically bilingual, which means connecting with locals is easy. Maybe that’s why Montréal has earned a spot as a leading international host city. From friendly conversations to world-class dining, entertainment and events, there are a lot of reasons to love Montréal. All email and website addresses are clickable in this document. Click on this icon anywhere in the document to return to the table of contents. -

Proquest Dissertations
"The House of the Irish": Irishness, History, and Memory in Griffintown, Montreal, 1868-2009 John Matthew Barlow A Thesis In the Department of History Present in Partial Fulfilment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy at Concordia University, Montreal, Quebec, Canada March 2009 © John Matthew Barlow, 2009 Library and Archives Bibliotheque et 1*1 Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-63386-1 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-63386-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par Nnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre im primes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation. -
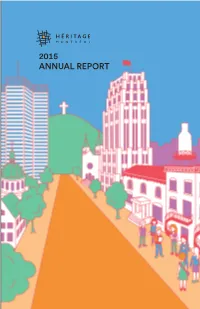
2015 Annual Report
2015 ANNUAL REPORT MISSION AND VISION Heritage Montreal has worked to promote and to protect the architectural, historic, natural and cultural heritage of Greater Montreal, its neighbourhoods and communities. This private non- profit organization is at the heart of an extensive network of partners, working through education and representation to celebrate, develop and preserve Montreal’s identity and uniqueness. McGill College © Jean-François Séguin, photographer Séguin, © Jean-François Avenue 2015 ANNUAL REPORT | HERITAGE MONTREAL 1 MESSAGE FROM THE PRESIDENT It is now four decades since Heritage Montreal began raising Montrealers’ awareness of the importance of safeguarding and enhancing their urban heritage, and accompanying them on explorations of our city. With celebrations marking our 40th anniversary held throughout the year, 2015 provided opportunities for us to assert more forcefully than ever our collaborative and strategic- action role vis-à-vis elected officials, the media, and members of the Greater Montreal community. While some files had very unfortunate outcomes—for example, the elimination of the vestiges of the former tanneries settlement in Saint-Henri—others were more successful, such as Maison Alcan and the Square Viger project, thanks to the productive actions of Heritage Montreal, among others. As has been the case since the founding of the organization, we will remain vigilant and spare no effort to ensure that heritage value and intelligent land use are considered integral to our city’s identity as well as its social, economic and cultural development. We engaged in many and varied projects during the past year, including the unveiling of our new digital H-MTL platform. -

Press Censorship, Politics and French Canada, 1940
Skirting the Minefield: Press Censorship, Politics and French Canada, 1940 GEORGE D. KERR, University of Western Ontario In a democracy with a strong tradition of freedom of the press, the imposition of censorship as a wartime necessity is rarely accomplished without considerable difficulty in its execution and in the definition of its limits. In Canada during the Second World War, the difficulty of controlling the flow of news in the interests of the war effort was compounded because the French-Canadians were in general unenthusiastic about their country's participation in a war which many regarded as none of Canada's business. The imposition of censorship had to take into account not only the general curtailment of freedom of expression, but also the sensitivities of that part of the population which had previously shown its reluctance to accept coercive or restrictive measures during the First World War.' Although press censorship remained a controversial issue in Canada for the duration of the war, the most intense opposition to it was manifested in 1940, not merely because the precipitating cause was controversial in itself, but because it highlighted the most divisive domestic issue in the country, the different perception of national goals and purposes maintained by Canada's two 'founding peoples.' It was over an issue arising from the imposition of press censorship that this major cleavage revealed itself for the first, but not the last time in Canada. Censorship was accepted as an unpleasant, but unavoidable necessity by most of Canada's newspapers when war broke out in 1939. As Canada's leading daily newspaper, the Toronto Globe and Mailstated, 'Freedom of speech must be curtailed when the nation is . -

Camillien Houde, «Le P'tit Gars De Sainte-Marie»
CAMILLIEN HOUDE Alexis Martin théâtre Alexis Martin est né à Montréal en 1964. Formé au conservatoire d’art dramatique et au départe- ment de philosophie de l’Université de Montréal, il a écrit plus de vingt-cinq pièces de théâtre et joué pendant près de trente ans sur les scènes montréalaises, au Québec et à l’étranger, en plus d’oeuvrer au cinéma et à la télévision comme acteur et scénariste. Il est codirecteur du Nouveau Théâtre Expérimental. CAMILLIEN HOUDE «LE P’TIT GARS DE SAINTE-MARIE» Alexis Martin Camillien Houde « le p’tit gars de Sainte-Marie » théâtre Chargé de projet : Jonathan Caquereau Vartabédian Révision : Julie Veillet Correction des épreuves : Gabrielle Barbeau Bergeron Mise en pages : Pierre-Louis Cauchon Maquette de couverture : Kim Dagenais Photographie de la couverture : T. Anthony Gharzouzi Photographies des répétitions : Evelyne Potvin-Cloutier Si vous désirez être tenu au courant des publications de HAMAC, vous pouvez nous écrire par courrier, par courriel à [email protected] ou consulter notre catalogue sur Internet : www.hamac.qc.ca © Les éditions du Septentrion Diffusion au Canada : 835, av. Turnbull Diffusion Dimedia Québec (Québec) 539, boul. Lebeau G1R 2X4 Montréal (Québec) H4N 1S2 Dépôt légal : Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017 Ventes en Europe : ISBN papier : 978-2-89448-900-0 Distribution du Nouveau Monde ISBN PDF : 978-2-89448-257-5 30, rue Gay-Lussac ISBN EPUB : 978-2-89448-258-2 75005 Paris Hamac est une division des éditions du Septentrion. Nous remercions le Conseil des Arts du Canada et la Société de développement des entreprises culturelles du Québec (SODEC) pour le soutien accordé à notre programme d’édition, ainsi que le gouvernement du Québec pour son Programme de crédit d’impôt pour l’édition de livres. -

The Notre-Dame Street Overpass Sidewalk: from Bill Vazan's
Palimpsest III: The Dialectics of Montreal’s Public Spaces Department of Art History, Concordia University The Notre-Dame Street Overpass Sidewalk: From Bill Vazan’s Highway #37 to Today Philippe Guillaume September 2010 Cynthia I. Hammond, and Anja Bock, eds. Palimpsest III: The Dialectics of Montreal’s Public Spaces An already-made geography sets the stage, while the willful making of history dictates the action …1 The sidewalk plays a fundamental role as a place of transit in the modern city, as well as being a space of sensorial experience. A specific walkway can represent aesthetic change across generations while, nonetheless, eliciting sensory experiences where the pedestrian’s feeling of safety is axiomatic. Such a space is seen in a photograph that is part of Montreal artist Bill Vazan’s conceptual project Highway #37, created in 1970. Detail 151 (Fig. 1), a black and white photograph, illustrates an eastward view of Notre-Dame Street taken from the southern sidewalk along the Notre-Dame Street overpass, a viaduct that spans over the old Dalhousie and Viger stations rail-yards. This is a historic locus linked to travel: this epic street exits Old Montreal towards the eastern part of the island. On today’s maps it spans between Berry and St-Christophe streets. When viewed through Vazan’s framing, this cityscape still serves as a striking palimpsest of the city’s modernist past, where, formally, the sidewalk encompasses all the elements associated with a safe space for pedestrian travel. A comparative view of the landscape seen in Vazan’s photograph between the time it was made and the present further enriches the narrative of this place, which nowadays sits on the cusp of the city’s salient tourist space, Old Montreal. -

Canadian Content Journal V.12
McGill Undergraduate Journal of Canadian Studies ISSN 2369-8373 (Print) ISSN 2369-8381 (Web) Volume 12 Canadian Content Volume 12 Canadian Content 2020 CanadianThe McGill Undergraduate Journal Content of Canadian Studies Volume 12, 2020 Editors-in-Chief Arimbi Wahono Meaghan Sweeney Senior Editor Simona Bobrow Editors Brent Jamsa Tamara North Eva Oakes Blind Review Coordinator Allison McCook McGill Institute for the Study of Canada Rm 102, Ferrier Building 840 Avenue Docteur-Penfield Montreal, Québec H3A 1A4 © Canadian Studies Association of Undergraduate Students 2020 ISSN 2369-8373 (Print) ISSN 2369-8381 (Web) With the exception of passages quoted from external authors, no part of this book may be reproduced without written permission from the Canadian Studies Association of Undergraduate Students. We cannot guarantee that all URLs are functional. Printed in Montreal, Canada All works contained in this journal are licensed under an Attribution-Non- Commercial-NoDerivatives 4.0 International Creative Commons License. Canadian Content is generously supported by: Cover Photography: “Spring Day” by Arimbi and Dewi Wahono. Contents Chapter Photography by (in order as seen) Eva Oakes, Arimbi and Dewi Wahono, Sarah Ford, Arimbi and Dewi Wahono, Sarah Ford, Elisabeth Levin Land Acknowledgement Originally written by Lucy Everett (adapted and condensed by CSAUS) Daniel Béland Foreword: How Canada Responds to Global Crises: Comparative Social Policy Lessons from the Past for the COVID-19 Era Letter from the Editors Tessa Groszman His Worship and -

A Note on Simultaneous Candidacies in the Québec Legislature
A Note on Simultaneous Candidacies in the Québec Legislature by Jacques Carl Morin Candidates in an election for the Québec National Assembly can choose to run in any riding, even if they have never lived in that riding or do not have an office there. However, a potential member of the National Assembly must choose a single riding, which means that simultaneous candidacies are prohibited. In other words, a candidate cannot run in more than one riding during the same general election. A look at history shows that this was not always the case. n 1867, with the proclamation of the British North One person was allowed to run for a seat in the Legisla- America Act, Québec was granted its own parliamen- tive Assembly and the House of Commons, be elected Itary institutions. The first election to choose the 65 and sit in those two parliaments. members of the new Legislative Assembly took place in August and September 1867. Nineteen candidates ran unopposed, including lawyer Edward Brock Carter in the riding of Montreal Centre. The First Simultaneous Candidacy Carter ran for re-election in the 1871 election. Nomina- tions were held on June 30 at the Montreal courthouse in front of 300 to 400 people. Carter wrongfully assumed he would once again be re-elected by acclamation. But he did not have the right profile. In fact, the newspaper La Minerve reminds us that when Montreal Island was split into three ridings, there had been an understanding that the representative for Montreal Centre would be chosen from among the merchant class1. -

(RAM) Collection - English Resources
Restricted Access Material (RAM) Collection - English Resources PUBLISHER CALL NUMBER AUTHOR TITLE DATE LANGUAGE [1936] eng Essays in honour of Gilbert Murray [by] the Rt. Hon. H .A. L. Fisher, 1 AC 5 E68 Senor S. A. de Madariaga, Lt.-Col. Charles Archer [and others]... 2 AC 8 S62 1881 Smith, Goldwin, 1823-1910. Lectures and essays / by Goldwin Smith. 1881. eng 3 AP 4 L495 Leigh Hunt's London journal. 1967. eng 4 AP 5 D67 Dominion illustrated. eng 5 AP 5 M818 Moon / Moon Publishing [Canadian satirical "magazine"] 1902-1903. eng 6 AS 42 Q3 no.17 Millett, Fred Benjamin, 1890- Craft-guilds of the thirteenth century in Paris, by F. B. Millett. [1915] eng 7 AS 42 Q3 no.19 Sage, Walter Chronicles of Thomas Sprott, by Walter Sage. [1916] eng 8 AS 42 Q3 no.20 Clark, William Clifford, 1889- Country elevator in the Canadian West, by W. C. Clark. [1916] eng 9 AS 42 Q3 no.21 Macpherson, W. E. Ontario grammar schools, by W. E. Macpherson. [1916] eng 10 AS 42 Q3 no.22 Dorland, Arthur Garratt. Royal disallowance in Massachusetts, by A. G. Dorland. [1917] eng 11 AS 42 Q3 no.24-5 Baumgartner, F. W. Neutralization of states, by F. W. Baumgartner. [1917] eng Michell, H. (Humfrey), 1883- [1918] eng 12 AS 42 Q3 no.26 Profit-sharing and producers' co-operation in Canada, by H. Michell. Sage, Walter Sir George Arthur and his administration of Upper Canada, by Walter [1918] eng 13 AS 42 Q3 no.28 Sage. Skelton, Oscar D. -

Plan Directeur D'aménagement Et De Développement Du Parc Jean-Drapeau
Rapport de consultation publique PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU 27 mars 2019 PLAN DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DU PARC JEAN-DRAPEAU Rapport de consultation publique Le 27 mars 2019 Édition et diffusion Office de consultation publique de Montréal 1550, rue Metcalfe, bureau 1414 Montréal (Québec) H3A 1X6 Téléphone : 514 872-3568 Télécopieur : 514 872-2556 Internet : www.ocpm.qc.ca Courriel : [email protected] Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2019 Dépôt légal - Bibliothèque et Archives Canada, 2019 ISBN 978-2-924750-51-3 (imprimé) ISBN 978-2-924750-52-0 (PDF) Le masculin est employé pour alléger le texte. Tous les documents déposés durant le mandat de la commission ainsi que les enregistrements de toutes les interventions publiques sont disponibles pour consultation aux bureaux de l’Office de consultation publique de Montréal. 1550, rue Metcalfe Bureau 1414 Montréal (Québec) H3A 1X6 Téléphone : (514) 872-3568 Télécopieur : (514) 872-2556 ocpm.qc.ca 4 Montréal, le 27 mars 2019 Madame Valérie Plante Mairesse de la Ville de Montréal Monsieur Benoit Dorais Président du comité exécutif Ville de Montréal 275, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6 Objet : Rapport de consultation publique en amont de l’élaboration du Plan directeur d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau Madame la Mairesse, Monsieur le Président du comité exécutif, J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur l’exercice d’amont visant l’élaboration du Plan directeur d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau pour les dix prochaines années. -

The City and the St. Lawrence – Analysis of Development Issues and Potential
CHAPTER ONE The Montréal Harbourfront: A History The City and the St. Lawrence – Analysis of Development Issues and Potential Introduction The story of Montréal's old harbour is at the heart of much of Canada's economic, political and social his- tory, and can consequently be considered of national significance. It is a story rooted in its geography, which combines three features highly conducive to the development of a dynamic port. First, the area forms a natural harbour- an essential precondition for the settlement of New France during the 17th century, when rivers were the only important links to the outside world. It is also situated at the confluence of three major waterways offering access to the interior of the North American continent (the 8 St. Lawrence, Ottawa and Richelieu rivers). Finally, the harbour is located at the western boundary of the navigable section of the St. Lawrence. Since navigation was hampered by the Lachine Rapids, it was for a significant time an obligatory stopping point, as well as a hub for the exploration and development of the hinterland. Birthplace of the modern port of Montréal (today North America's largest inland fresh- water port), the old harbourfront is also, more broadly, the cradle of Montréal and its surroundings. Figure 1.1 Plan of the canal proposed by the Sulpicians (not construct- ed), designed to bypass the Lachine Rapids. Plan by Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, 1733. Source: Archives nationales de France. Centre d'Archives d'Outre-Mer, Aix-en-Provence. Assessment of the Situation 1.1 The harbourfront, cradle of Montréal: 1535-1700 1.1.1 Aboriginal people and the shallow areas. -

Concordia University Montreal, Quebec, Canada
Beyond Eden: Cultivating Spectacle in the Montreal Botanical Garden Ana Armstrong A Thesis in The Department of Art History Presented in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of Magisteriate in Arts at Concordia University Montreal, Quebec, Canada August 1997 O Ann Armstrong, 1997 National Library Bibliothèque nationale 1 of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographie Services services bibliographiques 395 Wellington Street 395, rue Wellington ONawaON KlAON4 Ottawa ON K1A ON4 Canada Canada Your hle Votre retersnce Our file Narre reterence The author has granted a non- L'auteur a accordé une licence non exclusive licence allowing the exclusive permettant à la National Library of Canada to Bibliothèque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sel1 reproduire, prêter, distribuer ou copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette thèse sous paper or electronic formats. la forme de microfiche/film, de reproduction sur papier ou sur format électronique. The author retains ownership of the L'auteur conserve la propriété du copyright in ths thesis. Neither the droit d'auteur qui protège cette thèse. thesis nor substantial extracts fiom it Ni la thèse ni des extraits substantiels may be printed or otherwise de celle-ci ne doivent être imprimés reproduced without the author's ou autrement reproduits sans son permission. autorisation. Abstract Beyond Eden: Cultivating Spectacle in the Montreal Botanical Garden AM Armstrong The Montreal Botanical Garden, a 180-acre complex comprised of over thmy outdoor and ten indoor landscapes located in the city's east-end, is the product of a Depression-era government funded Public Works project.