Notice Explicative
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Jewish Presence in Soufflenheim
THE JEWISH PRESENCE IN SOUFFLENHEIM By Robert Wideen : 2018 Soufflenheim Genealogy Research and History www.soufflenheimgenealogy.com Jews are first mentioned in Alsace in the 12th century. There were 522 families in 1689 and 3,910 families in 1784, including four families totaling 19 people in Soufflenheim. By 1790, the Jewish population in Alsace had grown to approximately 22,500, about 3% of the population. They maintained their own customs, spoke Yiddish, and followed Talmudic laws enforced by their Rabbis. There was a Jewish presence in Soufflenheim since the 15th century, and probably earlier. By the late 1700’s there was a Jewish street in the village, a Jewish lane on the outskirts, a district known as Juden Weeg, and a Jewish path in the Judenweg area of the Haguenau Forest leading to the Jewish Forest Road. Their influence on the local dialect is documented in Yiddish in the Speech of Soufflenheim. Jewish Communities of Alsace, Including those of the Middle Ages. Encyclopaedia Judaica (1971) CONTENTS The Jewish Presence in Soufflenheim .......................................................................................................... 1 Soufflenheim Jews ........................................................................................................................................ 3 Their History .................................................................................................................................................. 5 The Earliest Jews ..................................................................................................................................... -
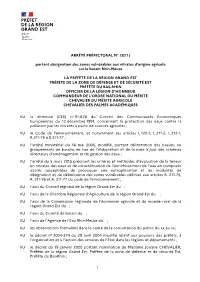
Ap Designalation Zv Rhm 2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2021 / portant désignation des zones !"néra#"es a!$ nitrates d%origine agri&o"e s!r "e #assin R'in()e!se LA PRÉF*TE +E LA RÉ,-ON ,RAN+ E.T PRÉF*TE +E LA /ONE +E +ÉFEN.E ET +E .ÉC0R-TÉ E.T PRÉF*TE +0 1A.(R2-N OFF-C-ER +E LA LÉ,-ON +%2ONNE0R CO))AN+E0R +E L%OR+RE NAT-ONAL +0 )ÉR-TE C2E3AL-ER +0 )ÉR-TE A,R-COLE C2E3AL-ER +E. PAL)E. ACA+É)-40E. VU la directive (CEE) n° 91-676 du Conseil des Communautés Économiques Européennes du 1 décembre 1991" concernant la protection des eau# contre la pollution par les nitrates $ partir de sources a%ricoles & VU le Code de l'environnement" et notamment ses articles ()120-1" ()211- " ()212-1" +)211-75 $ +)211-77 & VU l'arrêté ministériel du 16 mai **," modi.ié, portant délimitation des !assins ou %roupements de !assins en vue de l'éla!oration et de la mise $ /our des sc0émas directeurs d'aména%ement et de %estion des eau# & VU l'arrêté du , mars 201, précisant les critères et mét0odes d'évaluation de la teneur en nitrates des eau# et de caractérisation de l'enric0issement de l'eau en composés a2otés suscepti!les de provoquer une eutrop0isation et les modalités de dési%nation et de délimitation des 2ones vulnéra!les définies au# articles +) 211-75, +) 211-76 et +) 211-77 du code de l'environnement & VU l'avis du Conseil régional de la région Grand-Est du & VU l'avis de la C0am!re +égionale d'4%riculture de la région Grand-Est du & VU l'avis de la Commission régionale de l'économie a%ricole et du monde rural de la région Grand-Est du & VU l'avis du Comité de !assin du & VU l'avis de l'4%ence de l'Eau +0in-5euse du & VU les o!servations .ormulées dans le cadre de la consultation du pu!lic du ## au ##& VU le décret n° 2004-374 du 29 avril **6 modi.ié relati. -

Accompagner Les Parents Dans Le Bas-Rhin Référentiel Du Schéma Et Du Réseau D’Accompagnement Des Parents : Gouvernance Et Mise En Œuvre
Accompagner les parents dans le Bas-Rhin Référentiel du Schéma et du Réseau d’accompagnement des parents : Gouvernance et mise en œuvre NOVEMBRE 2017 Udaf Bas-Rhin - 19 rue du Faubourg National - CS 70062 67067 Strasbourg Cedex www.reseaudesparents67.fr 2 SOMMAIRE Le Schéma Départemental d’Accompagnement des parents (SDAP) 1. Ses objectifs ............................................................................................................................................................................................................ 4 2. Son fonctionnement ............................................................................................................................................................................... 4 3. Les actions prioritaires 2017-2018 ........................................................................................................................ 5-9 Le Réseau d’Accompagnement des parents 1. Ses objectifs ........................................................................................................................................................................................................ 10 2. Ses ressources..................................................................................................................................................................................................... 11 3. Les contacts ......................................................................................................................................................................................................... -

Observatoire Des Mobilités 2018 En Chiffres 279 Septembre 2019
DE L’ADEUS OBSERVATOIRE DES MOBILITÉS 2018 EN CHIFFRES 279 SEPTEMBRE 2019 DÉPLACEMENT Christophe Urbain / Citiz Urbain / Christophe L’Observatoire des mobilités de l’ADEUS début d’année. Ces nombreuses presqu’à l’équilibre : une première en est une plateforme d’échange et de données relatives aux déplacements France (hors Île-de-France). Et les suivi des problématiques de mobilités, des habitants du Bas-Rhin et de autres modes, vélo, transports collectifs transport et déplacements visant l’Eurométropole de Strasbourg sur urbains mais aussi interurbains, ne à comprendre le fonctionnement une journée « type » permettent sont pas en reste avec des croissances territorial et à alimenter les politiques de confirmer la nette tendance à la marquées sur la plupart des secteurs. publiques. diminution de la voiture au profit des Cet observatoire publie annuellement modes alternatifs à celle-ci : marche, Au-delà de ces données de mobilité, un rapport synthétique, qui recueille, vélo et transports en commun. le rapport 2019 de l’ODM confirme analyse et met à disposition l’essentiel d’autres tendances observées des données relatives aux mobilités À l’échelle du Bas-Rhin, la baisse ces dernières années comme le à l’échelle du Bas-Rhin. de l’usage de la voiture se fait développement des services à la principalement sur les déplacements mobilité (autopartage, vélos en libre- La version 2019 du rapport (traitant les de proximité, au profit de la marche, service…) et la hausse de fréquentation dernières données disponibles) intègre ou entre les polarités. -

Delta De La Sauer
RÉSERVE NATURELLE DU DELTA DE LA SAUER Réglementation Vous pouvez vous promener librement à pied sur Conservatoire des sites alsaciens - antenne Bas-Rhin, 1, rue des Écoles, Les saules têtards les sentiers de la réserve, mais sans les quitter. Il est possible de traverser 67850 Offendorf, tél. 03 89 83 34 10 ; Salix alba Le sympétrum rouge La rousserolle effarvatte la réserve à vélo en restant sur le tracé de la piste cyclable. En revanche, sang Sympetrum Acrocephalus scirpaceus [email protected] ; la circulation motorisée est interdite, tout comme la navigation dans www.conservatoire-sites-alsaciens.eu l’aise les pieds dans sanguineum Si le mâle Présent à partir de mai, ce petit les bras d’eau pour la tranquillité de la faune. Pour la même raison, les de cette espèce se reconnaît passereau niche dans les secteurs l’eau, les saules chiens ne sont pas autorisés, même tenus en laisse. Par ailleurs, vous Maison de la Nature du delta de la Sauer, 42, rue du Rhin, au rouge vif de son abdomen, de roselières où l’on peut ne pouvez pas camper, ni bivouaquer ni allumer de feu dans la réserve. À se concentrent la femelle présente un coloris facilement l’entendre chanter. 67470 Munchhausen, tél. 03 88 86 51 67 ; www.nature-munchhausen.com La chasse y est interdite, la pêche, elle, y est autorisée dans le respect de dans les secteurs plutôt brunâtre. Visible de mai Il n’est pas rare que le coucou Expositions et animations pédagogiques. les plus inondés. Leurs la réglementation en vigueur. -

Touristische Landkarte
PASSAGE309 - RHEINAREAL TOURIST INFO 8 Musée de la poterie / 12 Maison rurale de l’Outre-Forêt / 18 Maison de l’archéologie avec 25 Musée de la bataille du 6 août 34 Die Kasematte Rieffel Außerdem, GAMBSHEIM-RHEINAU PAYS DE SELTZ-LAUTERBOURG Töpfermuseum Das Landhaus von Outre-Forêt sa maison du néolithique / Haus 1870 / Museum der Schlacht vom In Oberroedern Kasematten in Dambach TOURISMUS PAVILLON Eine reiche Kollektion alter und Alter Bauernhof, der restauriert und der Archäologie mit dem Haus 6. August 1870 Tel. +33 (0)3 88 80 01 35 Tel. +33 (0)3 88 09 21 46 2 avenue du Général Schneider zeitgenössischer Keramikwaren in in ein Museum umgebaut wurde. des Neolithikums Dieses Museum ist der Schlacht vom Heidenbukel in Leutenheim Ecluses du Rhin F-67470 SELTZ Präsentation des elsässischen 6. August 1870 gewidmet, die auch „die einem herrlichen Bauernhof. Archäologische Forschung im Nord- 35 Die Infanterie-Kasematte Esch Tel. +33 (0)3 88 86 40 39 F-67760 GAMBSHEIM Tel. +33 (0)3 88 05 59 79 Kulturerbes. Schlacht von Reichshoffen“ genannt wird. Betschdorf Elsass, von der Vorgeschichte bis Tel. +33 (0)3 88 96 44 08 [email protected] Kutzenhausen Woerth In Hatten Tel. +33 (0)3 88 54 48 07 [email protected] www.tourisme-pays-seltz- Tel. +33 (0)3 88 80 53 00 zum industriellen Zeitalter. Überreste Tel. +33 (0)3 88 09 30 21 Tel. +33 (0)3 88 80 96 19 www.betschdorf.com www.passage309.eu lauterbourg.fr www.maison-rurale.fr der ehemaligen römischen Therme. http://webmuseo.com/ws/ Niederbronn-les-Bains musee-woerth 30 Musée français du pétrole / 5 Cave vinicole de Cléebourg / 13 Musée d’arts et traditions Tel. -

Zones PTZ 2017
Zones PTZ 2017 - Maisons Babeau Seguin Pour construire votre maison au meilleur prix, rendez-vous sur le site de Constructeur Maison Babeau Seguin Attention, le PTZ ne sera plus disponible en zone C dès la fin 2017 et la fin 2018 pour la zone B2 Région Liste Communes N° ZONE PTZ Département Commune Région Département 2017 67 Bas-Rhin Adamswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Albé Alsace C 67 Bas-Rhin Allenwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Alteckendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Altenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Altwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Andlau Alsace C 67 Bas-Rhin Artolsheim Alsace C 67 Bas-Rhin Aschbach Alsace C 67 Bas-Rhin Asswiller Alsace C 67 Bas-Rhin Auenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Baerendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Balbronn Alsace C 67 Bas-Rhin Barembach Alsace C 67 Bas-Rhin Bassemberg Alsace C 67 Bas-Rhin Batzendorf Alsace C 67 Bas-Rhin Beinheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bellefosse Alsace C 67 Bas-Rhin Belmont Alsace C 67 Bas-Rhin Berg Alsace C 67 Bas-Rhin Bergbieten Alsace C 67 Bas-Rhin Bernardvillé Alsace C 67 Bas-Rhin Berstett Alsace C 67 Bas-Rhin Berstheim Alsace C 67 Bas-Rhin Betschdorf Alsace C 67 Bas-Rhin Bettwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Biblisheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bietlenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bindernheim Alsace C 67 Bas-Rhin Birkenwald Alsace C 67 Bas-Rhin Bischholtz Alsace C 67 Bas-Rhin Bissert Alsace C 67 Bas-Rhin Bitschhoffen Alsace C 67 Bas-Rhin Blancherupt Alsace C 67 Bas-Rhin Blienschwiller Alsace C 67 Bas-Rhin Boesenbiesen Alsace C 67 Bas-Rhin Bolsenheim Alsace C 67 Bas-Rhin Boofzheim Alsace C 67 Bas-Rhin Bootzheim Alsace C 67 Bas-Rhin -

Grand-Plan-2019.Pdf
Eckwersheim La Wantzenau Le Golf Eckwersheim 71 flex’hop 72 72 Cimetière Eckwersheim Hippodrome La Wantzenau RD 223 Eckwersheim ZA Mairie Canal Vendenheim La RD 226 Gutenberg Wantzenau Gare Château d'Eau train 71 train La Wantzenau Eglise Vendenheim La Wantzenau Le Tilleul Hohl Au Tilleul Pont Vendenheim Temple SNCF Gare La Wantzenau Ecole www.cts-strasbourg.eu L6 La Wantzenau Mairie 75 La Wantzenau Patronage Vendenheim Perdrix Général Leclerc Mairie 74 Vendenheim Faubourg d'Alençon Légende Artisans Saint-Yrieix Zone Commerciale Nord Legende/Key Reichstett Vergers RD 64 Rochechouart Terminus de ligne Lampertheim 74 76 Endhaltestelle der Linie 75 Terminus 74 Arrêt desservi dans les deux sens Lorraine TER Hay Ecomusée Haltestelle in beide Richtungen Lampertheim Lampertheim Eglise TER Stop with services in both directions Lampertheim Alisiers Rue des Arrêt desservi Mairie Reichstett Hirondelles au dans un seul sens 73 en Champs Haltestelle in einer Richtung tz an Stop with service in one direction W Rue de Alouettes Circuit parcouru train L6 Honau Mundolsheim à certaines heures Mehrstündiger Parcours Electricité a 72 L Stretch operated at certain times only 73 Collège Anémones 60 TER e d Mundolsheim 74 RD 863 76 Petite R Connexion bus-tram-train Mundolsheim Découvertes o u Verbindung Bus Straßenbahn Zug Mairie t Saules Bus tram train connexion e te Souffelweyersheim R Souffelweyersheim Parking Relais Tram Bouvreuils Canal Mundolsheim Berlioz Centre P+R Tram / Tram P&R car park Dauphiné tre de d Unterjaegerhof Lat Ta e e s D s l ig Ballastière -

Réunions De Bout De Parcelles Arboriculture
RÉUNIONS DE BOUT DE PARCELLES ARBORICULTURE PROGRAMME 2020 Chaque jeudi, la Chambre d’agriculture d’Alsace et FREDON Grand Est proposent des réunions techniques de bout de parcelle. Elles sont gratuites et ouvertes à tous : producteurs professionnels ou amateurs, techniciens, distributeurs de produits phytosanitaires, étudiants… Il s’agit de faire le point sur l’état sanitaire des vergers et les méthodes de lutte possibles, aux moments clés de la saison. Ces réunions sont aussi des temps d’échanges réguliers sur le terrain semaine après semaine. À partir d’observations de terrain (maladies, ravageurs et auxiliaires), de données météorologiques et de modèles de prévisions statistiques, le diagnostic permet d’adapter vos méthodes de défense - prioritairement la prophylaxie et la lutte intégrée. D’autres sujets d’actualité sur la conduite des vergers sont abordés par les techniciens dans le cadre d’une production fruitière respectueuse de la ressource en eau et de la santé humaine. Les réunions de bout de parcelle sont soutenues par l’Agence de l’eau Rhin-Meuse et la Région Grand Est. PLANNING 2020 COMMENT VENIR ? Avril Juin SIGOLSHEIM : Jeudi 02 Jeudi 04 entre Bennwihr et Ingersheim sur la 10h30 à SIGOLSHEIM 11h à ROTTELSHEIM D10 au verger Pom d’Or (TEMPE), à droite en venant de 14h à TRAENHEIM 14h à SCHOENENBOURG Bennwihr. Jeudi 09 Jeudi 11 TRAENHEIM : à la ferme fruitière ROTHGERBER, en 11h à ROTTELSHEIM 10h30 à SIGOLSHEIM face de la Cave du Roi Dagobert. 14h à SCHOENENBOURG 14h à TRAENHEIM ROTTELSHEIM : sur la D419 entre Pfaffenhoffen et Jeudi 16 Jeudi 18 Brumath, le chemin à gauche, sur la parcelle sous filet 10h30 à SIGOLSHEIM 11h à ROTTELSHEIM de M. -

Aide-Train-Alsace.Pdf
% Vous VoyAgez - pour les Vous êTes 5012-25 ans une ou deux collégien Jusqu’à fois par semaine ? ou lycéen ? % Que vous soyez externe ou demi-pensionnaire- TONUS Alsace dans un collège ou dans un lycée, l’abonnement70 scolaire réglementé est fait pour vous. Il vous est la carte permet de voyager librement entre votre domicile et votre lieu d’études. Il est subventionné par le qu’il vous faut ! conseil général en fonction de votre âge. Jusqu’à 16 ans vous ne payez rien. Au-delà une part du prix Réservée aux moins de 26 ans, elle vous permet reste à votre charge. de voyager à moitié prix pendant un an, sur tout le réseau TeR Alsace pour 16 € seulement. pour vous abonner : Valable également de ou vers Belfort, Saint-Dié-des- 1. Retirez un formulaire d’abonnement dans votre Vosges, Sarreguemines, Sarrebourg ou Bâle. collège ou lycée. 2. Retournez-le à votre établissement scolaire qui prix d’un trajet simple à -50 % le transmettra à votre Conseil général. Molsheim – strasbourg 2,00 € 3. Vous serez averti par courrier des modalités de retrait de votre carte. Haguenau – strasbourg 3,50 € Saverne – strasbourg 4,30 € Colmar – Mulhouse 4,00 € Saint Louis – Mulhouse 2,80 € Tarifs au 4 janvier 2012 connecTez-vous • Retrouvez tous les horaires, prix et produits pour acheter la carte : TeR Alsace, sur www.ter-sncf.com/alsace ou Abonnements étudiants Pour obtenir votre carte Tonus alsace, il suffit appelez le 0 800 77 98 67 (appel gratuit depuis un poste fixe). de vous rendre au guichet d’une gare muni • Grilles horaires personnalisées, Divisez vos dépenses et d’une photo d’identité et elle vous sera délivrée prochains départs, immédiatement. -

Fiche Haguenau
Plateforme d’échanges Urbagare Direction Régionale de l’Equipement Alsace Plateforme d’échanges 3. Perspectives d’évolution urbaine Urbagare Fiche de cas L’ilot de la gare, les boulevards Restructuration pôle d'échanges Nessel et de l’Europe, le quar- 500 m Atelier de tier de la Vieille Ile et l’ancien- Restructuration Vieille Ile ne caserne Thurot composent canal de décharge et réorganisation des espaces publics ensemble une vaste ceinture Barberousse de sites de développement P Vieille Ile urbain enveloppant tout le côté sud, ouest et nord-ouest P MModeroder 200 m Haguenau du centre ville commerçant de Utilisation de la Moder pour qualifier et structurer les espaces publics Articuler développement urbain et ferroviaire dans les villes moyennes alsaciennes Haguenau. (sous forme de coulée verte par ex.) Quels potentiels et quels leviers d’actions pour les territoires ? Articulation spatiale pôle d'échanges/Vieille Ile Traitement bd Europe et Nessel La transformation urbaine de Articulation spatiale pôle d'échanges/centre ville Gare ces espaces offre l’opportu- Devenir du quartier Ouest : valoriser P P Deuxième ville du Bas-Rhin avec ses 36 000 habitants, Haguenau est un pôle démo- nité d’étendre et renforcer le la proximité du pôle d'échanges La démarche Urbagare a été l’occasion centre ville, et d’implanter au pour la DRE Alsace d’organiser en 2008 graphique et économique et un pôle d’équipements publics en plein essor. Inscrite Articulation spatiale "Nessel" : coeur de la ville des fonctions pôle d'échanges/Thurot/centre ville des ateliers au sein de plusieurs villes dans une agglomération de plus de 50 000 habitants, rayonnant sur un vaste bassin permettant de renforcer sa vo- moyennes alsaciennes, dont Haguenau. -

(M Supplément) Administration Générale Et Économie 1800-1870
Archives départementales du Bas-Rhin Répertoire numérique de la sous-série 15 M (M supplément) Administration générale et économie 1800-1870 Dressé en 1980 par Louis Martin Documentaliste aux Archives du Bas-Rhin Remis en forme en 2016 par Dominique Fassel sous la direction d’Adélaïde Zeyer, conservateur du patrimoine Mise à jour du 19 décembre 2019 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) Page 2 sur 204 Sous-série 15 M – Administration générale et économie, 1800-1870 (M complément) XV. ADMINISTRATION GENERALE ET ECONOMIE COMPLEMENT Sommaire Introduction Répertoire de la sous-série 15 M Personnel administratif ........................................................................... 15 M 1-7 Elections ................................................................................................... 15 M 8-21 Police générale et administrative............................................................ 15 M 22-212 Distinctions honorifiques ........................................................................ 15 M 213 Hygiène et santé publique ....................................................................... 15 M 214-300 Divisions administratives et territoriales ............................................... 15 M 301-372 Population ................................................................................................ 15 M 373 Etat civil ................................................................................................... 15 M 374-377 Subsistances ............................................................................................