André Messager. Repères Biographiques
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Concert: Thirty-Eighth Annual Ithaca College Choral Composition Contest Ithaca College Choir
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Ithaca College Ithaca College Digital Commons @ IC All Concert & Recital Programs Concert & Recital Programs 11-12-2016 Concert: Thirty-eighth Annual Ithaca College Choral Composition Contest Ithaca College Choir Janet Galván Follow this and additional works at: http://digitalcommons.ithaca.edu/music_programs Part of the Music Commons Recommended Citation Ithaca College Choir and Galván, Janet, "Concert: Thirty-eighth Annual Ithaca College Choral Composition Contest" (2016). All Concert & Recital Programs. 1399. http://digitalcommons.ithaca.edu/music_programs/1399 This Program is brought to you for free and open access by the Concert & Recital Programs at Digital Commons @ IC. It has been accepted for inclusion in All Concert & Recital Programs by an authorized administrator of Digital Commons @ IC. THE THIRTY-EIGHTH ANNUAL ITHACA COLLEGE CHORAL COMPOSITION CONTEST Sponsored jointly by Ithaca College and Mark Foster Foster Publishing (a division of Hal Leonard) Saturday, November 12th, 2016 7:00 pm ITHACA COLLEGE THIRTY-EIGHTH ANNUAL CHORAL COMPOSITION CONTEST AND FESTIVAL Sponsored jointly by Ithaca College and Mark Foster (a division of Hal Leonard) The Choral Composition Festival was founded in 1979 to encourage the creation and performance of new choral music and to establish the Ithaca College Choral Series. Six scores were chosen for performance this evening from the entries submitted from around the world. The festival was founded by Professor Lawrence Doebler. The composition The Voice You Hear by Francisco Núñez was commissioned by Ithaca College and will be premiered by the Ithaca College Choir this evening. -

Class, Respectability and the D'oyly Carte Opera Company 1877-1909
THE UNIVERSITY OF WINCHESTER Faculty of Arts ‘Respectable Capers’ – Class, Respectability and the D’Oyly Carte Opera Company 1877-1909 Michael Stephen Goron Doctor of Philosophy June 2014 The Thesis has been completed as a requirement for a postgraduate research Degree of the University of Winchester The word count is: 98,856 (including abstract and declarations.) THE UNIVERSITY OF WINCHESTER ABSTRACT FOR THESIS ‘Respectable Capers’: Class, Respectability and the D’Oyly Carte Opera Company 1877-1909 Michael Stephen Goron This thesis will demonstrate ways in which late Victorian social and cultural attitudes influenced the development and work of the D’Oyly Carte Opera Company, and the early professional production and performance of the Gilbert and Sullivan operas. The underlying enquiry concerns the extent to which the D’Oyly Carte Opera organisation and its work relate to an ideology, or collective mentalité, maintained and advocated by the Victorian middle- classes. The thesis will argue that a need to reflect bourgeois notions of respectability, status and gender influenced the practices of a theatrical organisation whose success depended on making large-scale musical theatre palatable to ‘respectable’ Victorians. It will examine ways in which managerial regulation of employees was imposed to contribute to both a brand image and a commercial product which matched the ethical values and tastes of the target audience. The establishment of a company performance style will be shown to have evolved from behavioural practices derived from the absorption and representation of shared cultural outlooks. The working lives and professional preoccupations of authors, managers and performers will be investigated to demonstrate how the attitudes and working lives of Savoy personnel exemplified concerns typical to many West End theatre practitioners of the period, such as the drive towards social acceptability and the recognition of theatre work as a valid professional pursuit, particularly for women. -

A Prima Vista
A PRIMA VISTA a survey of reprints and of recent publications 2011/1 BROEKMANS & VAN POPPEL Van Baerlestraat 92-94 Postbus 75228 1070 AE AMSTERDAM sheet music: + 31 (0)20 679 65 75 CDs: + 31 (0)20 675 16 53 / fax: + 31 (0)20 664 67 59 also on INTERNET: www.broekmans.com e-mail: [email protected] 2 CONTENTS A PRIMA VISTA 2011/1 PAGE HEADING 03 PIANO 2-HANDS 14 PIANO 4-HANDS 15 2 AND MORE PIANOS, HARPSICHORD 16 ORGAN 20 KEYBOARD 21 ACCORDION 22 BANDONEON 1 STRING INSTRUMENT WITHOUT AC COMPANIMENT: 22 VIOLIN SOLO 24 VIOLA SOLO, CELLO SOLO, DOUBLE BASS SOLO, VIOLA DA GAMBA SOLO 1 STRING INSTRUMENT WITH ACCOMPANIMENT, piano unless stated otherwise: 24 VIOLIN with accompaniment 26 VIOLIN PLAY ALONG 27 VIOLA with accompaniment, VIOLA PLAY ALONG 28 CELLO with accompaniment 29 CELLO PLAY ALONG, VIOLA DA GAMBA with accompaniment 29 2 AND MORE STRING INSTRUMENTS WITH AND WITHOUT ACCOMPANIMENT: 1 WIND INSTRUMENT WITHOUT ACCOMPANIMENT: 33 FLUTE SOLO, OBOE SOLO, COR ANGLAIS SOLO, CLARINET SOLO, SAXOPHOHNE SOLO, BASSOON SOLO 34 TRUMPET SOLO, HORN SOLO, TROMBONE SOLO, TUBA SOLO 1 WIND INSTRUMENT WITH ACCOMPANIMENT, piano unless stated otherwise: 34 FLUTE with accompaniment 36 FLUTE PLAY ALONG, OBOE with accompaniment 37 OBOE PLAY ALONG, CLARINET with accompaniment 38 CLARINET PLAY ALONG, SAXOPHONE with accompaniment 39 SAXOPHONE PLAY ALONG 40 BASSOON with accompaniment, BASSOON PLAY ALONG 41 TRUMPET with accompaniment 42 TRUMPET PLAY ALONG, HORN with accompaniment 43 HORN PLAY ALONG, TROMBONE with accompaniment, TROMBONE PLAY ALONG 44 TUBA with accompaniment -

The Music of Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847-1935): a Critical Study
The copyright of this thesis rests with the author. No quotation from it should be published without the written consent of the author and infomation derived from it should be acknowledged. The Music of Sir Alexander Campbell Mackenzie (1847-1935): A Critical Study Duncan James Barker A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) Music Department University of Durham 1999 Volume 2 of 2 23 AUG 1999 Contents Volume 2 Appendix 1: Biographical Timeline 246 Appendix 2: The Mackenzie Family Tree 257 Appendix 3: A Catalogue of Works 260 by Alexander Campbell Mackenzie List of Manuscript Sources 396 Bibliography 399 Appendix 1: Biographical Timeline Appendix 1: Biographical Timeline NOTE: The following timeline, detailing the main biographical events of Mackenzie's life, has been constructed from the composer's autobiography, A Musician's Narrative, and various interviews published during his lifetime. It has been verified with reference to information found in The Musical Times and other similar sources. Although not fully comprehensive, the timeline should provide the reader with a useful chronological survey of Mackenzie's career as a musician and composer. ABBREVIATIONS: ACM Alexander Campbell Mackenzie MT The Musical Times RAM Royal Academy of Music 1847 Born 22 August, 22 Nelson Street, Edinburgh. 1856 ACM travels to London with his father and the orchestra of the Theatre Royal, Edinburgh, and visits the Crystal Palace and the Thames Tunnel. 1857 Alexander Mackenzie admits to ill health and plans for ACM's education (July). ACM and his father travel to Germany in August: Edinburgh to Hamburg (by boat), then to Hildesheim (by rail) and Schwarzburg-Sondershausen (by Schnellpost). -

Guide to the Helen Walker Hill Collection
Columbia College Chicago Digital Commons @ Columbia College Chicago CBMR Collection Guides / Finding Aids Center for Black Music Research 2020 Guide to the Helen Walker Hill Collection Columbia College Chicago Follow this and additional works at: https://digitalcommons.colum.edu/cmbr_guides Part of the History Commons, and the Music Commons Columbia COL L EGE CHICAG, 0 CENTER FOR BLACK MUSIC RESEARCH COLLECTION The Helen Walker-Hill Collection, 1887-2012 EXTENT Papers: 41 boxes, 25.1 linear feet COLLECTION SUMMARY The Helen Walker-Hill Collection is composed of musical compositions by black women composers throughout the United States and England. This collection was compiled by pianist and musicologist, Dr. Helen Walker-Hill. PROCESSING INFORMATION The Helen Walker-Hill Collection was processed with funding provided through a Preservation and Access Grant from the National Endowment for the Humanities. The collection was processed by and this finding aid was created by Margaret Gonsalves in 2006. Additional acquisitions donated in 2008 and 2012 were processed by Laurie Lee Moses in 2014. BIOGRAPHICAL NOTE Helen Siemens Walker-Hill was born in Winnipeg, Manitoba, Canada, on May 26, 1936 to George and Margaret (Toews) Siemens. Walker-Hill received her early musical training from her mother, Margaret Siemens, and continued piano studies with Emma Endres Kountz in Toledo, Ohio. In 1957 she received a Bachelor of Art degree in Spanish, German, and French languages and literature from the University of Toledo, Ohio. Walker-Hill was a certified secondary teacher in the state of Ohio. From 1957–1958 she was a Fulbright fellow, studied with Nadia Boulanger, and received a Diplome from École Normale de Musique in Paris in 1958. -
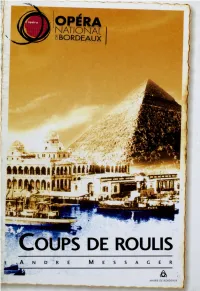
Oops De Roulis
OPÉRA NATIONAL S BORDEAUX an t i » i MIAMI OOPS DE ROULIS MAIRIE DE BORDEAUX j mmm Coups de roulis Opérette en trois actes. Livret d'Albert Willemetz d'après le roman de Maurice Larrouy. Musique d'André Messager. Créé le 29 septembre 1928 au Théâtre Marigny à Paris. Théâtre Fémina Bordeaux É3 SAQUTAM Mars 2004 L'Opéra tient à remercier le Club des Partenaires de l'Opéra National de Bordeaux partenaires fondateurs Actas Consultants Caisse d'Épargne Aquitaine-Nord Cofinoga Mercedes-Benz Bordeaux Société Bordelaise de CIC partenaires associés Air liquide Aquitaine Travaux Banque Populaire du Sud-Ouest Casino de Bordeaux Chlteau Haut-Bailly CORDIER Mestrezat & Domaines EDF Grands Clients Sud-Ouest Gaz de Bordeaux Groupe CMR Chantiers d'Aquitaine Lexus Bordeaux Sanofi Winthrop Industrie (site d'Ambarès) Syndicat Viticole de Pessac-Léognan partenaires Elyo Midi Océan Librairie Mollat THALÏS Avionics les entreprises qui soutiennent des projets... > Caitw de* dépôts et consignation* les actions vers tes jeunes (Carpus en Musique - Ma vow et Toi) > Casino de Bordeaux Orchestre en Féte > Château Haut-Bailly te Baiet de rOpéra National de Bordeaux > Fondation DaimlerChrysler France tes jeunes artistes (Concert tynque H.*-Hé — jian 2004) > Fondation France Telecom La Cenerentota (Production fyr">que — mars 2004) > Fond* d'action SAC «H reniant et la musique (action culturelle) > Groupe Duclot tes productions Vxjues. symphooxju» et chorégraphiques > Syndicat ViticoJe de Pessac-Léognan tes concerts degustabon an* que Baronne Phiiipf»ine de Rothschild -

FY 2016 Fall Grant Announcement December 8, 2015
FY 2016 Fall Grant Announcement December 8, 2015 State and Jurisdiction List Project details are current as of December 1, 2015. For the most up to date project information, please use the NEA's online grant search system. Included in this document are Art Works and Challenge America grants. All are organized by state/jurisdiction and then by city and then by name of organization. Click the state or jurisdiction below to jump to that area of the document. Alaska Kansas Minnesota Alabama Kentucky Ohio American Samoa Louisiana Oklahoma Arizona Maryland Oregon Arkansas Massachusetts Pennsylvania California Michigan Rhode Island Colorado Minnesota South Carolina Connecticut Mississippi South Dakota Delaware Missouri Tennessee District of Columbia Montana Texas Florida Nebraska Utah Georgia New Hampshire Vermont Guam New Jersey Virginia Hawaii New Mexico Washington Idaho New York West Virginia Illinois North Carolina Wisconsin Indiana North Dakota Wyoming Iowa Michigan Some details of the projects listed are subject to change, contingent upon prior Arts Endowment approval. Information is current as of December 1, 2015. Page 1 of 243 Alaska Number of Grants: 5 Total Dollar Amount: $82,500 Anchorage Concert Association, Inc. (aka ACA) $25,000 Anchorage, AK FIELD/DISCIPLINE: Presenting & Multidisciplinary Works To support a multidisciplinary presenting series and related activities. ACA will work with community partners to arrange workshops, residencies, house concerts, and other outreach activities. Proposed artists include Dublin Guitar Quartet (Ireland), Afiara Quartet (Canada), and Bela Fleck with Abigail Washburn. Perseverance Theatre, Inc. (aka Perseverance Theatre) $10,000 Douglas, AK FIELD/DISCIPLINE: Theater & Musical Theater To support the production of "Into the Wild," a new rock musical with book by Janet Allard and music and lyrics by Niko Tsakalakos. -

Les P'tites Michu
Collection « Opéra français / French opera » Editorial direction: Alexandre Dratwicki / Palazzetto Bru Zane Project management: Camille Merlin / Palazzetto Bru Zane Editorial consulting: Carlos Céster Design: Valentín Iglesias English translations by Charles Johnston © 2018 Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française San Polo 2368 – 30125 Venice – Italy bru-zane.com Digital edition of the book: © 2021 Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française Physical edition printed in Spain (ref. bz 1034 ) Legal deposit: Madrid, October 2018 – m-33137-2018 isbn : 978-84-09-05607-1 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright owners and the publisher. Le Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française a pour vocation The vocation of the Palazzetto Bru Zane – Centre de musique romantique française la redécouverte et le rayonnement international du patrimoine musical français du is the rediscovery and international promotion of the French musical heritage of the grand xi x e siècle (178 0- 1920). Il s’intéresse aussi bien à la musique de chambre qu’au period 178 0- 1920. Its interests range from chamber music to the orchestral, sacred répertoire symphonique, sacré et lyrique, sans oublier les genres légers qui caractérisent and operatic repertories, not forgetting the lighter genres characteristic of the ‘esprit « l’esprit français » (chanson, opéra-comique, opérette). Installé à Venise dans un français’ (chanson, opéra-comique, operetta). The Centre was inaugurated in 2009 palais de 1695 restauré spécifiquement pour l’abriter, ce centre, inauguré en 2009, est and has its headquarters in a Venetian palazzo dating from 1695 specially restored une réalisation de la Fondation Bru. -

T Ransnational O Pera S Tudies C Onference @ Bern.2017 2Nd Transnational Opera Studies Conference University of Bern, Switzerland 5 – 7 July 2017
t ransnational o pera s tudies c onference @ bern.2017 2nd transnational opera studies conference University of Bern, Switzerland 5 – 7 July 2017 Programme Committee Marco Beghelli (Università di Bologna) Céline Frigau Manning (Université de Paris-VIII) Anselm Gerhard (Universität Bern) Axel Körner (University College London) Gundula Kreuzer (Yale University) Vincenzina C. Ottomano (Universität Bern) Arne Stollberg (Humboldt-Universität zu Berlin) Cristina Urchueguía (Universität Bern) Conference Organizers Anselm Gerhard (Universität Bern) Vincenzina C. Ottomano (Universität Bern) Assistant Organizer Valeria Lucentini (Universität Bern) contact: [email protected] CREDITS INDEX This conference is organized by Universität Bern Institut für Musikwissenschaft Presentation 4 Programme Committee 5 www.musik.unibe.ch Welcome Reception 9 in collaboration with Site Plan 9 Schweizerische Musikforschende Gesellschaft – Sektion Bern Wednesday, 5th July / Morning 10 www.smg-ssm.ch Wednesday, 5th July / Afternoon I 20 Wednesday, 5th July / Afternoon II 28 We are delighted to acknowledge the generous support of Thursday, 6th July / Morning I 36 Nachwuchsförderungs-Projektpool der Universität Bern Thursday, 6th July / Morning II 44 Philosophisch-historische Fakultät der Universität Bern Thursday, 6th July / Afternoon 49 Schweizerische Akademie der Friday, 7th July / Morning I 60 Geistes- und Sozialwissenschaften Friday, 7th July / Morning II & Afternoon 68 www.sagw.ch Index of Participants 76 Burgergemeinde Bern www.bgbern.ch PRESENTATION The call -

573973 Itunes
Vincent Youmans (1898–1946) Rodolphe Berger Tea for Two 1No, no, Nanette! (1925) Messalinette, ou le tour du demi-monde en 80 nuits Tea for Two (Act II) (arr. Matthieu Michard) 5:31 0(1902) From the Belle Epoque to the Roaring Twenties Text: Otto Harbach (1873–1963), Messalinette, fantaisie-sélection Irving Caesar (1895–1996) (arr. Matthieu Michard) 7:37 ‘I am quite convinced that there is no city in the world orchestras and theatres for decades. André Messager Text: Pierre-Louis Flers (1865–1932) where as much music is consumed as in London’, noted (1853–1929) was one of those who had a successful 2Hope Temple (1859–1938) Berlioz in his column in the Journal des Débats on 29 July career on the English side of the Channel, as a composer, My Lady’s Bower (1887) (arr. Chloé Ducray) 3:24 Reynaldo Hahn (1874–1947) 1851. The observation remained pertinent at the turn of conductor and administrator – he worked in the latter role Text: Frederick E. Weatherly (1848–1929) !Une Revue… (1926) the 20th century. at Covent Garden between 1901 and 1907. Brought to the La Dernière Valse (arr. Philippe Perrin) 4:14 London and Paris shared an artistic vitality that set London music world’s attention in 1891 when the D’Oyly André Messager (1853–1929) Text: Maurice Donnay (1859–1945), Henri Duvernois them apart. Many British artists appeared on stage in Carte Company gave the British premiere of La Basoche , 3Mirette (1894) (1875–1937) Paris, and London was equally enthusiastic about Messager was then commissioned to write a new opera Ah! Nay, do not fly me! (Act I) (arr. -

November 19–20, 2020 32Nd Annual Festival of New Musicals 1
320nd NOVEMBER 19–20, 2020 32ND ANNUAL FESTIVAL OF NEW MUSICALS 1 FROM THE NATIONAL ALLIANCE FOR MUSICAL THEATRE’S PRESIDENT WELCOME TO OUR 32ND ANNUAL FESTIVAL OF NEW MUSICALS! I look forward to this journey every year: usually a physical journey to NYC to see old friends, meet new ones, and immerse myself in the exhilaration of NAMT’s Festival. This year, of course, will be different: I’ll travel to the world of the Festival while in Buffalo, but it will be just as eye-opening, poignant, enjoyable and provocative. I never know where the Festival will take me, but I know that during these two days I will feel a surprising and strong gamut of emotions. Not only will I be entertained and challenged, but I will also have perspectives and opinions reinforced one minute and completely altered the next. We’re delighted that you’re here to join us for these two days—truly just the beginning of the journey for these unique musical theatre pieces and their extraordinarily talented writers. I congratulate each of the writers who participated in this event and thank them for their creativity, intelligence, talent, and courage, which is the lifeblood of our artistic industry. We hope you’ll want to blaze a development path with them. Every year the Festival inspires many long-term relationships among writers, theatres, producers, directors and performers, and we expect this year will again initiate many partnerships, in new and varied ways. NAMT believes that the best way to encourage that ongoing development is to give our writers every possible opportunity to showcase their best work. -

Notable Welsh Musicians
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. http://books.google.com NotableWelshMusicians(ofToday) FredericGriffith /7u3 /<>(. .fZ. a. o HARVARD COLLEGE LIBRARY THE BEQUEST OF EVERT JANSEN WENDELL (CLASS OF 1882) OF NEW YORK 1918 MUSIC LIBRARY NOTABLE WELSH MUSICIANS. c Notable Welsh Musicians (OF TO-DAY), WITH PORTRAITS, BIOGRAPHIES, AND A PREFACE ON THE CONDITION OF MUSIC IN WALES AT THE PRESENT TIME, EDITED BY FREDERIC GRIFFITH, A.R.A.M., Solo-Flautist, Royal Opera House, London. SECOND EDITION. Conbon : FRANCIS GOODWEN, 47, Leadenhau, Street, E.C. 1896. Hub 10 O . 5 3 .0 o U ( !iE O'jf ST OF tvi«T i am S ii vfiHl lids Condon : Perkins Bacon & Co., Ltd., Printers, 36-40, Whitefriars St., E.C. 1896. • TO JOHN RUTSON, Esquire (OK NORTHALLERTON), AS A SLIGHT MARK OF RECOGNITION OF THE MANY SIGNAL SERVICES HE HAS RENDERED TO YOUNG ARTISTS THROUGHOUT GREAT BRITAIN GENERALLY, AND MORE PARTICULARLY AS A TOKEN OF GRATITUDE FOR HIS INESTIMABLE KINDNESS TO THE AUTHOR HIMSELF, THIS BOOK IS RESPECTFULLY DEDICATED. NOTE. The Editor intends this work to be no more than a . brief record of the careers of those of his compatriots who have distinguished, or are likely to distinguish, themselves in the exercise or the practice of the art of music. He has endeavoured to make it as complete as possible, and trusts that it may not be disfigured by any serious omis sions. In conclusion, lie desires to thank those who have been kind enough to assist him ; in particular, his friend Mr.