ANDRIAMAMPIAINGA Rovason Andrianiaina
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Liste Des Communes Beneficiaires Au Financement Fdl-Papsp 2019
LISTE DES COMMUNES BENEFICIAIRES AU FINANCEMENT FDL-PAPSP 2019 N° Region District Nom commune Catégorie 1 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMBOHIDRONONO CR 2 2 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA AMPASIPOTSY MANDIALAZA CR 2 3 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA ANALASOA ( TANANA AMBONY ) CR 2 4 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA BEMBARY CR 2 5 ALAOTRA MANGORO MORAMANGA SABOTSY ANJIRO CR 2 6 AMORON'I MANIA AMBATOFINANDRAHANA AMBATOMIFANONGOA CR 2 7 AMORON'I MANIA AMBATOFINANDRAHANA FENOARIVO CR 2 8 AMORON'I MANIA AMBOSITRA AMBALAMANAKANA CR 2 9 AMORON'I MANIA AMBOSITRA AMBOSITRA CU 10 AMORON'I MANIA AMBOSITRA ANKAZOTSARARAVINA CR 2 11 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO AMBATO CR 2 12 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO AMBOHIPIHAONANA CR 2 13 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO ANJANADORIA CR 2 14 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO MAHABO CR 2 15 ANALAMANGA AMBOHIDRATRIMO MANJAKAVARADRANO CR 2 16 ANALAMANGA ANJOZOROBE ALAKAMISY CR 2 17 ANALAMANGA ANJOZOROBE AMPARATANJONA CR 2 18 ANALAMANGA ANJOZOROBE ANDRANOMISA AMBANY CR 2 19 ANALAMANGA ANJOZOROBE BERONONO CR 2 20 ANALAMANGA ANJOZOROBE TSARASAOTRA ANDONA CR 2 21 ANALAMANGA ATSIMONDRANO AMBATOFAHAVALO CR 2 22 ANALAMANGA ATSIMONDRANO ANDOHARANOFOTSY CR 2 23 ANALAMANGA ATSIMONDRANO BEMASOANDRO CR 2 24 ANALAMANGA AVARADRANO VILIAHAZO CR 2 25 ANALAMANGA MANJAKANDRIANA AMBATOMANGA CR 2 26 ANALAMANGA MANJAKANDRIANA MIADANANDRIANA CR 2 27 ANALANJIROFO FENERIVE EST AMBATOHARANANA CR 2 28 ANALANJIROFO FENERIVE EST AMBODIMANGA II CR 2 29 ANALANJIROFO FENERIVE EST AMPASINA MANINGORY CR 2 30 ANALANJIROFO FENERIVE EST ANTSIATSIAKA CR 2 31 ANALANJIROFO FENERIVE EST BETAMPONA -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Le Cas De La Commune Rurale D'ivato-Centre Ambositra
UNIVERSITE D‟ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT GEOGRAPHIE PROMOTION « MANDRESY » LE « DAHALOÏSME » DANS LE BETSILEO NORD : LE CAS DE LA COMMUNE RURALE D’IVATO-CENTRE AMBOSITRA (REGION AMORON’I MANIA) Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Maîtrise en Géographie PRESENTE PAR : Voahary Mihaja Lucille RAVELOSON SOUS LA DIRECTION DE : Monsieur James RAVALISON Ŕ Maitre de Conférences Le 11 Mai 2012 UNIVERSITE D‟ANTANANARIVO FACULTE DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES DEPARTEMENT GEOGRAPHIE PROMOTION « MANDRESY » LE « DAHALOÏSME » DANS LE BETSILEO NORD : LE CAS DE LA COMMUNE RURALE D’IVATO-CENTRE AMBOSITRA (REGION AMORON’I MANIA) Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de Maîtrise en Géographie PRESENTE PAR : Voahary Mihaja Lucille RAVELOSON DEVANT LE JURY COMPOSE DE : Président du jury : Madame Josette RANDRIANARISON, Professeur Titulaire Rapporteur : Monsieur James RAVALISON, Maître de Conférences Juge : Madame RAZAFIMAHEFA-RASOANIMANANA, Maître de Conférences Le 11 Mai 2012 REMERCIEMENTs Nous adressons ici nos vifs remerciements à tous ceux qui par leur appui, leur sollicitude, leur bonne volonté, leurs conseils et enseignements, nous ont aidé à mener à terme ce travail. Tout d‟abord nous tenons à exprimer notre gratitude à : Madame Josette RANDRIANARISON, Professeur Titulaire au sein du Département de Géographie, qui, malgré ses multiples obligations, nous fait l‟honneur de présider cette soutenance de mémoire. Madame, veuillez trouver ici l‟expression de nos respects les plus sincères. Madame RAZAFIMAHEFA-RASOANIMANANA, Maître de Conférences au sein du Département de Géographie, qui a bien voulu siéger en tant que juge de notre travail et nous apporter son expérience. Madame, veuillez accepter nos sincères remerciements pour l‟honneur que vous nous faites. -

Amoron'i Mania
LISTE DES ENSEIGNANTS FRAM NON SUBVENTIONNES BENEFICIAIRES "AIDE-SPECIALE" FINANCEMENT "ETAT" REGION : AMORON'I MANIA N° DREN CISCO ZAP NIVEAU CODE ETAB ETABLISSEMENT NOM ET PRENOMS CIN EPP AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RAMANATSIHOARANA MIRANA 0001 PRESCO 304010002 AMBATOFINANDRAHANA 202 012 007 769 MANIA NA A NORD AUGUSTINE CENTRALE EPP AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN ANJARASOAMAHAZAVO 0002 PRESCO 304010002 AMBATOFINANDRAHANA 203 012 017 932 MANIA NA A NORD HERINIRINA ELISA CENTRALE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN LALAONIRINA NOMENJANAHARY 0003 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 014 510 MANIA NA A NORD OLIVIA AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RAZAFIMAMPIONONA 0004 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 014 509 MANIA NA A NORD HANITRINIAINA MARIETTE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RASOARIMALALA HASINIAINA 0005 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 009 515 MANIA NA A NORD VERONIQUE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RASOLONOMENJANAHARY 0006 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 009 462 MANIA NA A NORD SOAMIARANA PHILOMENE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN RAZANANIRINA HERILALAO 0007 PRESCO 304010004 EPP AMBATOMENALOHA 202 012 005 075 MANIA NA A NORD CHRISTINE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN EPP AMBOHIBARY RASOAMILANTO NIVOHARISOLO 0008 PRESCO 304010007 202 012 014 513 MANIA NA A NORD RANOMAFANA CLAUDINE AMORON'I AMBATOFINANDRAHA AMBATOFINANDRAHAN HARIMALALA MBININA 0009 PRESCO 304010009 EPP AMBOHIMIARINA 108 072 008 636 -

Cr Ambohimanjaka Madio
Commune Rurale SAHATSIHO AMBOHIMANJAKA MADIO - MISOTRO RANO VOADIO « Le Rôle et la Place des autorités locales dans la gestion des services d’eau potable et d’assainissement » Jeudi 10 décembre2015 à l’Hôtel Le Pavé Antaninarenina. Par: Landis Nirina ANDRIAMIALY PLAN 1. Présentation de la région Amoron’i Mania et la commune Sahatsiho Ambohimanjaka 2. Rôles/ Formes de collaboration des autorités avec les acteurs œuvrant dans l’EAH 3. Réalités sur terrain - 4MA -Eau potable 4. Rôle de la commune sur les réalisations AMORON’I MANIA La région Amoron'i Mania se trouve dans la partie centrale des hautes terres Sud (province de Fianarantsoa) et est constituée de quatre (04) districts: Ambatofinandrahana, A•mbositra, Fandriana et Manandriana. Elle compte actuellement soixante et une (61) communes dont six (06) nouvelles. Le chef lieu de la Région se trouve à Ambositra qui se situe à une distance de 255 km de la capitale en descendant la RN7. Situation en EAH dans la Région Nombre District: 4 Nombre Communes: 61 Nombre Fokontany : 800 Nombre villages ODF: 563 Nombre population: ≈ 677523 source Instat 2012 AMBOHIMANJAKA Carte de localisation de la commune Distance: 52Km d’Ambositra , 39Km d’Antsirabe Superficie: 333, 0625 Km2 Commune limitrophes: Est: CR Tsarazaza Nord: CR Sahanivotry Ouest: CR Alatsinainy Ibity, CR Ambatomifanongoa Sud : CR Ilaka centre Activités économiques et Infrastructure de base – Agriculture et Élevage (> 80%) – Commerce Infrastructures – Éducation (02 CEG - 09 EPP ) – Santé (01 CSB II - 01 CSB I) – Sécurité Situation -

Series of Revisions of Apocynaceae XLIV
WAGENINGEN AGRICULTURAL UNIVERSITY PAPERS 97-2 (1997) Series of Revisions of Apocynaceae XLIV Craspidospermum Boj. ex A. DC, Gonioma E. Mey., Mascarenhasia A. DC, Petchia Livera, Plectaneia Thou., and Stephanostegia Baill. by A.J.M. Leeuwenberg Date of publication: 12Augus t 1997 Wageningen MM Agricultural University rn,,\;!(Ni;-. L.NV 1 iHiisaaAT N Series of Revisions of Apocynaceae XLIV / Craspidospermum Boj. ex A. DC, Gonioma E. Mey., Mascarenhasia A. DC, Petchia Livera, Plectaneia Thou., and Stephanostegia Baill. / A.J.M. Leeuwenberg ISBN 90-73348-76-5 NUGI 823 ISSN 0169-345X Distribution: Backhuys Publishers, P.O.Box 321,230 0 AH Leiden, The Netherlands. Telephone: +31-71-5170208 Fax: +31-71-5171856 E-mail: [email protected] All rights reserved Printed in The Netherlands Series of Revisions of Apocynaceae XLIV Craspidospermum Boj. ex A. DC, Gonioma E. Mey., Mascarenhasia A. DC, Petchia Livera, Plectaneia Thou., and Stephanostegia Baill. byA.J.M . Leeuwenberg Department of PlantTaxonomy, Wageningen Agricultural University, P.O.Box 8010, 6700Wageningen, the Netherlands Abstract Six genera of Apocynaceae have been monographed. These six are restricted to Africa, except for Petchia, which also occurs in Sri Lanka with one endemic species. The study is based on herbarium material and living plants, mostly observed and collected by the author in Madagascar. Petchia replaces the well-known genus name of Cabucala as it has priority, so six new combinations have been made here. Petchia africana from Cameroun has been described as new to science. For Carissa verticillata a new name has been proposed to replace Pichon's homonym, C.pichoniana. In all, 23 names have been reduced to synonymy, 14 of which are even synonymso fPlectaneia thouarsii. -

Contribution a L'etude De La Filiere Bois D'energie Dans La Region Amoron'i Mania Le Cas De La Commune Urbaine D'ambosit
UNIVERSITE DE FIANARANTSOA b INSTITUT DES SCIENCES ET TECHNIQUES REGION AMORON’IDE MANIA L’ENVIRONNEMENT 0 REGION AMORON’I MANIA CONTRIBUTION A L’ETUDE DE LA FILIERE BOIS D’ENERGIE DANS LA REGION AMORON’I MANIA LE CAS DE LA COMMUNE URBAINE D’AMBOSITRA ET LA COMMUNE RURALE D’AMBALAMANAKANA Mémoire de fin de stage pour l’obtention d’un diplôme de technicien supérieur en Sciences et Techniques de l’Environnement Présenté par RANAIVOSON Setraniaina Jean Frédéric Et RAFANOMEZANDRAMAMPY Derantsoa Président de jury : Docteur RATALATA Pascal Examinateur : Monsieur BLANDIN DE CHALAIN Alex Rolland Michel Rapporteur : Monsieur RAKOTOMAMPIONONA Mademoiselle RANDRIAMIFIDISON RINDRA F.A. Mai 2010 REMERCIEMENTS Le présent rapport n’aurait pu être réalisé sans l’aide et la collaboration de certaines personnes, essentiellement celles qui sont citées ci-après. Nous adressons nos sincères reconnaissances à : Docteur RAKOTO Edouard Noëlson, Directeur de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Environnement Membres de jury : Docteur RATALATA Pascal, ancien Recteur de l’université de FIANARANTSOA, ancien Directeur de l’ISTE ; qui nous a orienté jusqu’à la finalisation de ce travail, nous a fait un grand honneur en acceptant de présidé ce mémoire. Monsieur BLANDIN DE CHALAIN Alex Rolland Michel, Architecte paysagiste, consultant indépendant, Enseignant en technique de production végétale et technique d’aménagement en environnement à l’ISTE ; a bien voulu accepter avec bienveillance d’être l’examinateur. Monsieur RAKOTOMAMPIONONA, Directeur du Développement Régional Amoron’i Mania, qui, malgré ses lourdes responsabilités, a bien voulu nous accueillir au sein de sa Direction, d’avoir soutenu notre thème d’étude et ainsi que de nous avoir permis d’effectuer notre stage au niveau de la Région, qui a bien voulu accepter d’être le rapporteur. -
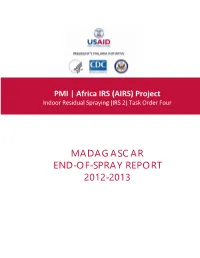
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2012-2013 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. June 2013. Madagascar End-of-Spray Report2012-2013. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2012-2013 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents …. .................................................................................................................................. iii Acronyms … .................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................ 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar during the 2012-2013 IRS Campaigns .................. 2 2. Pre-IRS Campaign Activities ............................................................................................... -
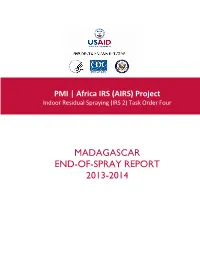
IRS Technical Report Template
PMI | Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT 2013-2014 Recommended Citation: PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four. May 2014. Madagascar End-of-Spray Report 2013-2014. Bethesda, MD. PMI|Africa IRS (AIRS) Project Indoor Residual Spraying (IRS 2) Task Order Four, Abt Associates Inc. Contract No.: GHN-I-00-09-00013-00 Task Order: AID-OAA-TO-11-00039 Submitted to: United States Agency for International Development/PMI Abt Associates Inc. 1 4550 Montgomery Avenue 1 Suite 800 North 1 Bethesda, Maryland 20814 1 T. 301.347.5000 1 F. 301.913.9061 1 www.abtassociates.com 2013-2014 MADAGASCAR END-OF-SPRAY REPORT CONTENTS Contents….. .................................................................................................................................. iii Acronyms… ..................................................................................................................................vii Executive Summary ..................................................................................................................... ix 1. Introduction ............................................................................................................................ 1 1.1 Background of IRS in Madagascar ................................................................................................................... 1 1.2 Objectives for AIRS Madagascar During the 2013-2014 IRS Campaigns ............................................. -

Mapping for Public Health: Initial Plan for Using Satellite Imagery for Micronutrient Deficiency Prediction
Mapping for Public Health: Initial Plan for Using Satellite Imagery for Micronutrient Deficiency Prediction Elizabeth Bondi Andrew Perrault Fei Fang [email protected] [email protected] [email protected] Harvard University Harvard University Carnegie Mellon University Benjamin L. Rice Christopher D. Golden Milind Tambe [email protected] [email protected] [email protected] Princeton University Harvard University Harvard University ABSTRACT physical manifestations. Wasting is only one type of malnutrition The lack of micronutrients is a major threat to the health and that presents itself in physical manifestations. Therefore, regions development of populations, and it is challenging to detect such with micronutrient deficiency are largely unknown to public health deficiency at large scale with low cost. In this work, we planto organizations until direct measurements are made, such as blood use data from a study on micronutrient deficiency in Madagascar, draws. However, these blood draws and questionnaires are costly which include blood draw results and corresponding questionnaires, and time-consuming, and furthermore, quantifying micronutrient along with satellite imagery, to determine whether there are certain levels in a sample requires specialized laboratory equipment that cues visible in satellite imagery that could more easily and quickly is not widely available. We envision a new approach to detect mi- suggest areas where people may be susceptible to micronutrient cronutrient deficiency at large scale with low cost. deficiency. We propose an approach that will (i) determine impor- We hypothesize that the availability of foods with sufficient mi- tant predictors of micronutrient deficiency from blood draws and cronutrients in a community depends in part on environmental corresponding questionnaire data, such as type of food consumed, factors, such as the state of forests or agriculture nearby. -
Infected Areas As at 6 September 2001 Zones Infectées Au 6
Infected areas as at 6 September 2001 For criteria used in compiling this list, see p. 280. - Newly reported areas X Zones infectées au 6 septembre 2001 Les critères appliqués pour la compilation de cette liste, voir p. 280. - Nouvelles zones signalées X • • Bujumbura Province Ashanti Region Maputo City Province Plague Peste America Amérique Bujumbura Arrondissement Central Region Catembe District Bolivia • Bolivie Bururi Province Eastern Region Inhaça District La Paz Department Makamba Arrondissement Upper East Region Maputo Province Africa • Afrique Franz Tamayo Province Rumonge Arrondissement Volta Reg ion Boane District Sud Yungas Province Gitega Province Western Region Magude District Dem. Rep. of Congo Valle Grande Province Gitega Arrondissement Guinea • Guinée Manhica District Rép. dém. du Congo Makamba Province Maputo City Brazil • Brésil Conakry Province Haut Zaïre Province Nyanza-lac Commune Marracuene District Bahia State Forécariah Préfecture Ituri Sub-Region Cameroon • Cameroun Matola OTM District Mahagi Administrative Zone Biritinga Municipio Guinea-Bissau Moamba District Candeal Municipio Province de lExtrême-Nord Guinée-Bissau Ressano Garcia District Madagascar Central Municipio Diamare Département Sabie District Logone-et-Chari Département Bissau District Antananarivo Province Conceição Municipio Xinavane District Feira de Santana Municipio Mayo-Danai Département Biombo District Ambohidratrimo S. Préf. Gabu District Nampula Province Iraquara Municipio Mayo-Sava Département Niassa Province Antananarivo-Avaradrano S. Préf.