Deuxième Partie : LES FATIMIDES
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Traditional Arts and Crafts of Turnery Or Mashrabiya
THE TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS OF TURNERY OR MASHRABIYA BY JEHAN MOHAMED A Capstone submitted to the Graduate School-Camden Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Master of Art Graduate Program in Liberal Studies Written under the direction of Dr. Martin Rosenberg And Approved by ______________________________ Dr. Martin Rosenberg Camden, New Jersey May 2015 CAPSTONE ABSTRACT The Traditional Arts and Crafts of Turnery or Mashrabiya By JEHAN MOHAMED Capstone Director: Dr. Martin Rosenberg For centuries, the mashrabiya as a traditional architectural element has been recognized and used by a broad spectrum of Muslim and non-Muslim nations. In addition to its aesthetic appeal and social component, the element was used to control natural ventilation and light. This paper will analyze the phenomenon of its use socially, historically, artistically and environmentally. The paper will investigate in depth the typology of the screen; how the different techniques, forms and designs affect the function of channeling direct sunlight, generating air flow, increasing humidity, and therefore, regulating or conditioning the internal climate of a space. Also, in relation to cultural values and social norms, one can ask how the craft functioned, and how certain characteristics of the mashrabiya were developed to meet various needs. Finally, the study of its construction will be considered in relation to artistic representation, abstract geometry, as well as other elements of its production. ii Table of Contents Abstract……………………………………………………………………….……….…..ii List of Illustrations………………………………………………………………………..iv Introduction……………………………………………….…………………………….…1 Chapter One: Background 1.1. Etymology………………….……………………………………….……………..3 1.2. Description……………………………………………………………………...…6 1.3. -

Trip to Egypt January 25 to February 8, 2020. Day 1
Address : Group72,building11,ap32, El Rehab city. Cairo ,Egypt. tel : 002 02 26929768 cell phone: 002 012 23 16 84 49 012 20 05 34 44 Website : www.mirusvoyages.com EMAIL:[email protected] Trip to Egypt January 25 to February 8, 2020. Day 1 Travel from Chicago to Cairo Day 2 Arrival at Cairo airport, meet & assistance, transfer to the hotel. Overnight at the hotel in Cairo. Day 3 Saqqara, the oldest complete stone building complex known in history, Saqqara features numerous pyramids, including the world-famous Step pyramid of Djoser, Visit the wonderful funerary complex of the King Zoser & Mastaba (Arabic word meaning 'bench') of a Noble. Lunch in a local restaurant. Visit the three Pyramids of Giza, the pyramid of Cheops is the oldest of the Seven Wonders of the Ancient World, and the only one to remain largely intact. ), the Great Pyramid was the tallest man-made structure in the world for more than 3,800 years. The temple of the valley & the Sphinx. Overnight at the hotel in Cairo. Day 4 Visit the Mokattam church, also known by Cave Church & garbage collectors( Zabbaleen) Mokattam, it is the largest church in the Middle East, seating capacity of 20,000. Visit the Coptic Cairo, Visit The Church of St. Sergius (Abu Sarga) is the oldest church in Egypt dating back to the 5th century A.D. The church owes its fame to having been constructed upon the crypt of the Holy Family where they stayed for three months, visit the Hanging Church (The Address : Group72,building11,ap32, El Rehab city. -
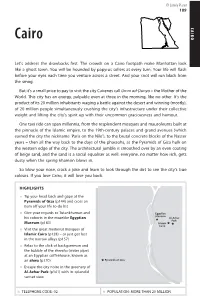
CAIRO T E N a L 109 P Y L E N Park O L
© Lonely Planet 109 Cairo CAIRO Let’s address the drawbacks first. The crowds on a Cairo footpath make Manhattan look like a ghost town. You will be hounded by papyrus sellers at every turn. Your life will flash before your eyes each time you venture across a street. And your snot will run black from the smog. But it’s a small price to pay to visit the city Cairenes call Umm ad-Dunya – the Mother of the World. This city has an energy, palpable even at three in the morning, like no other. It’s the product of its 20 million inhabitants waging a battle against the desert and winning (mostly), of 20 million people simultaneously crushing the city’s infrastructure under their collective weight and lifting the city’s spirit up with their uncommon graciousness and humour. One taxi ride can span millennia, from the resplendent mosques and mausoleums built at the pinnacle of the Islamic empire, to the 19th-century palaces and grand avenues (which earned the city the nickname ‘Paris on the Nile’), to the brutal concrete blocks of the Nasser years – then all the way back to the days of the pharaohs, as the Pyramids of Giza hulk on the western edge of the city. The architectural jumble is smoothed over by an even coating of beige sand, and the sand is a social equaliser as well: everyone, no matter how rich, gets dusty when the spring khamsin blows in. So blow your nose, crack a joke and learn to look through the dirt to see the city’s true colours. -

The Impact of the Arab Conquest on Late Roman Settlementin Egypt
Pýý.ý577 THE IMPACT OF THE ARAB CONQUEST ON LATE ROMAN SETTLEMENTIN EGYPT VOLUME I: TEXT UNIVERSITY LIBRARY CAMBRIDGE This dissertation is submitted for the degree of Doctor of Philosophy in the University of Cambridge, March 2002 ALISON GASCOIGNE DARWIN COLLEGE, CAMBRIDGE For my parents with love and thanks Abstract The Impact of the Arab Conquest on Late Roman Settlement in Egypt Alison Gascoigne, Darwin College The Arab conquest of Egypt in 642 AD affected the development of Egyptian towns in various ways. The actual military struggle, the subsequent settling of Arab tribes and changes in administration are discussed in chapter 1, with reference to specific sites and using local archaeological sequences. Chapter 2 assesseswhether our understanding of the archaeological record of the seventh century is detailed enough to allow the accurate dating of settlement changes. The site of Zawyet al-Sultan in Middle Egypt was apparently abandoned and partly burned around the time of the Arab conquest. Analysis of surface remains at this site confirmed the difficulty of accurately dating this event on the basis of current information. Chapters3 and 4 analysethe effect of two mechanismsof Arab colonisation on Egyptian towns. First, an investigation of the occupationby soldiers of threatened frontier towns (ribats) is based on the site of Tinnis. Examination of the archaeological remains indicates a significant expansion of Tinnis in the eighth and ninth centuries, which is confirmed by references in the historical sources to building programmes funded by the central government. Second, the practice of murtaba ` al- jund, the seasonal exploitation of the town and its hinterland for the grazing of animals by specific tribal groups is examined with reference to Kharibta in the western Delta. -

Staging the City: Or How Mamluk Architecture Coopted the Streets of Cairo
Staging the City: Or How Mamluk Architecture Coopted the Streets of Cairo Gesamttext_UHML_9_Druckfreigabe.indb 1 21.07.2014 21:15:09 Ulrich Haarmann Memorial Lecture ed. Stephan Conermann Volume 9 Gesamttext_UHML_9_Druckfreigabe.indb 2 21.07.2014 21:15:09 Nasser Rabbat Staging the City: Or How Mamluk Architecture Coopted the Streets of Cairo BERLIN EBVERLAG Gesamttext_UHML_9_Druckfreigabe.indb 3 21.07.2014 21:15:10 Bibliogra!sche Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra!e; detaillierte bibliogra!sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Buch, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikrover!lmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Verlags. Rainer Kuhl Copyright ©: EB-Verlag Dr. Brandt Berlin 2014 ISBN: 978-3-86893-153-2 Internet: www.ebverlag.de E-Mail: [email protected] Printed in Germany Gesamttext_UHML_9_Druckfreigabe.indb 4 21.07.2014 21:15:10 Staging the City 5 Staging the City: Or How Mamluk Architecture Coopted the Streets of Cairo In January 1383, Ibn Khaldun arrived in Cairo from Tunis. His reaction to the city, often quoted, captures a feeling that was to engender a staunch nostalgia to his era among subsequent generations of Egyptians. He wrote I beheld the metropolis of the world, orchard of the universe, hive of nations, iwan of Islam, throne of royalty, bursting with palaces and iwans within, shining on the horizon with khanqahs and madrasas, illuminated by the moons and stars of its learned scholars.1 Despite its ornateness, Ibn Khaldun’s passage held true for many of his contemporaries who waxed lyrical about Cairo’s vast expanse, diverse population, and architectural splendor. -

Elective Module 1 - Culture
ELECTIVE MODULE 1 - CULTURE Introducon Egypt, the cradle of civilisaon, is host the last remaining wonder of the ancient world, and is considered to be the place from which modern civilisaon arose. So, to understand why the world admires this civilisaon, we have to return back to the beginning of the story and read carefully. Prehistory of Egypt: The first dynasty of Pharaohs dates back to around 3100 BC. However, there are many evidences talking about a sort of human life in different parts of Egypt especially in the Western Desert that dates back to more than 40,000 years. An amazing example of that period is the swimmers cave in Wadi Sura “Valley of Pictures” in Western Desert with fantasc painngs esmated to be produced around 7000 BC. As from 5000 BC, archaeologists can easily recognise a real human cultural producon, namely the Baradian culture which is considered to be the first known pre-dynasc civilisaon. The Badarian people lived in Upper Egypt, on the eastern bank of the Nile, from approximately 5000 BC to 4400 BC. Though they were a semi-nomadic people, they formed small selements and began to culvate grain and domescate animals. They buried their dead in small cemeteries on the outskirts of these selements, and also conducted ceremonial burials for some of their domescated animals. Although the graves themselves were simple, the deceased was buried with fine ceramics, jewelry, cloth and fur, and they usually included a finely cra ed figurine of a female ferlity idol. They did not mummify their dead, instead burying them in a foetal posion, facing west (towards the seng sun). -

Manufacturing Wooden and Armored Doors in the Mamluk Era Dr
مجلة العمارة والفنون والعلوم اﻻنسانية – عدد خاص )2( ابريل2021 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول" Manufacturing Wooden and Armored Doors in the Mamluk Era Dr. Ola M. Mohammed Ahmed Interior architecture department - Faculty of fine arts, Alexandria University [email protected] Abstract The Mamluk era was characterized by skill, creativity, good design, Mamluk architecture, perfect craftsmanship and accuracy. The doors remained in the mosques of the Muslims for the applied arts, which were used by the worshipers, both in religious and civil architecture, in addition to the defensive war, especially the outer doors, which were a hallowed title for those who looked behind these doors. It was remarkable that the Muslims did not care about the greatness of their doors and always chose two-legged types of mosques, schools and palaces, while the author relied on one piece of houses mainly as well as the doors of castles and forts. The doors of the wooden doors were characterized by fine panels decorated with strips of ivory or precious wood, as well as , it was flourished the manufacture of many of historical doors which was an art of Islamic war architecture, both those built in the Fatimid or Ayyubid, and the most famous were the eight doors Fatimid, which represented the valve safety and security to defend Cairo throughout the ages, each of these doors had a name which was known to the people, and they had been repeating it for hundreds of years, and behind it is a historical story. The doors in the Mamluk era were constructed with an architectural genius. -

Sustainable Tourism and the Rehabilitation of Cairo's Historical Districts: the Case of the Bazaar Area and the Cities of Dead
OPEN ACCESS www. wsforum.org Article Sustainable Tourism and the Rehabilitation of Cairo's Historical Districts: The Case of the Bazaar Area and the Cities of Dead Wael Salah Fahmi1,* 1 Department of Architecture, University of Helwan, 34, Abdel Hamid Lofti Street, Giza, 12311, Egypt; E-Mail: [email protected] * Author to whom correspondence should be addressed; E-Mail: [email protected]; Tel.: +2 02 33370485 ; Fax: + 2- 02- 3335 1630 Received: / Accepted: / Published: Abstract: The current paper examines the impact of recent tourism-related official policy for rehabilitation of historical Cairo and for gentrification of surrounding inner city areas on urban poor's right to the city and their resistance actions against eviction. Despite the main objective of introducing sustainable -tourism principles by improving the environmental quality standards within Historical Cairo through pedestrianization, urban landscaping and public parks, the overall government policy favored business investments more than interests of urban population . This is evident in proposed plans for forced relocation of local residents from Bazaar area and for eviction of squatter tomb dwellers within northern cemeteries Cities of the Dead' to the eastern desert of Kattamiya (New Cairo City). Consequently land developers and investors intend to clear these sites and hold empty land for property speculations and tourism development projects. This could follow the precedent of the Agha Khan organization’s development of the Al-Azhar Urban Cultural Park, opened -

La Mosquée Al-Azhar
HISTOIRE CRITIQUE D’ARCHITECTURE - HCA3- Cours élaboré par Mme BENAOUDA N Année universitaire:2019-2020 1. Les Fatimides : 969- 1171 • Le contexte historique: Les Fatimides conquirent l’Egypte en 969, grâce au général Jawhar al-Siqilli, sur ordre du calife al Mu’izz. Le général entra à Fustat en 969, ils fondèrent près de cette ville une nouvelle capitale qu’il nommèrent al-Qahira (Le Caire). Ils continuèrent à étendre leurs conquêtes jusqu’à la Syrie et parvinrent à s’établir à Malte et en Sicile. A partir de 1060, le territoire des Fatimides se réduisit jusqu'à ne plus comprendre que l’Egypte . La date de 1171 marque la fin de l’empire Fatimide et la prise du pouvoir par les Ayyoubides. • L’architecture fatimide : L’Egypte fut le centre du pouvoir du califat fatimide entre 969 et 1171. Son architecture est des plus brillantes car elle s’inspire à la fois de celle d’Ifriqiya(Kairouan, Mahdia, Sousse) et d’une architecture égyptienne ancienne. Divers édifices religieux subsistent jusqu’à nos jours caractérisant les lignes fondamentales de l’art Fatimide : nous citons notamment les mosquées et les mausolées. Des pans de fortifications et des portes datant pour la plupart du XIe siècle ont aussi perduré au niveau de la ville du Caire. Pour ce qui est des constructions civiles, il ne reste des nombreux palais construits par les Fatimides que des descriptions mettant en exergue leur splendeur. • Réalisations : -La mosquée al-Azhar (969-973) -La mosquée d’al-Hâkim (990-1013) -La fondation de la ville du Caire en 969 -Fortifications et portes -

Islamic Urbanism and Access Regulation
Journal of Engineering Sciences, Assiut University, Vol. 40, No. 3, pp. 943-958, May 2012 ISLAMIC URBANISM AND ACCESS REGULATION AS A GUIDE TO THE FUTURE THE CASE OF MEDIEVAL CAIRO Dr; Hanaa Mahmoud Shokry Associate professor –Department of Architecture- Faculty of Architecture &Design- Jazan University- Saudi Arabia Email; [email protected] Cell Fone,00966534439193 (Received March 25, 2012 Accepted April 4, 2012) In the present century, when not only building styles, but techniques and materials though out the Islamic world are increasingly drawn from alien understand what traditional Islamic society itself sees as significant in its architecture, Islamic settlements reveal a consistent underlying order of hierarchical sequences of access and enclosure responding to pattern of social intercourse and allegiance particular to Islamic society. In this paper we will investigate the domestic sphere in an Islamic context of Medieval Cairo, we will examine Cairene domestic architectural types and access regulation to see how the domestic spaces reflect and addressed include multi-house compound. Privacy and access regulation will be analyzed at four hierarchical levels of settlements within an urban setting; the courtyard house, the residential alley, the quarter and the city .The traditional Islamic city was composed of nested hierarchies of space, based on the primary unit of inward-looking courtyard house. Traditionally, the nested hierarchies were created the development of shari’a established tradition as a guide to the present. In this sense, we will turned to medieval documents, not to reconstruct the past, but to appropriate clear prescribed regulations that will rectify the estrangement caused by the careless intrusion of Western forms . -

ARCE Member-Only Tour to Egypt Fall 2019 0.Pdf
ARCE Member Tour of Egypt October 20- November 3, 2019 Sunday October 20 | Arrive in Cairo Meals Included: Dinner Meet and Greet at Cairo Airport To ensure your journey is seamless from the start, our representative will meet you before passport control to assist with acquiring your visa stamps, moving through passport control, and collecting your luggage. Later you will be transferred to the Cairo Marriott Hotel in Zamalek for check-in Dinner at hotel Overnight in Cairo Monday, October 21 | Pyramids of Giza, Sphinx, Solar Boat, Sakkara Meals Included: Breakfast, Lunch, Dinner 06:30 AM Buffet breakfast at the hotel 07:30 AM Meet your guide and head to the Giza Plateau 08:30 AM Private visit to the Paws of the Sphinx. The Sphinx is the largest monolithic statue in the world and the oldest known monumental sculpture. Proceed to the famous Giza Pyramid Complex. Dominating the plateau and running in a southwest diagonal through the site are the three pyramids of the pharaohs Khufu, Khafra, and Menkaura. The northernmost and the largest belongs to Khufu. Khafra's pyramid is built precisely on a southwest diagonal to his father's pyramid on higher ground to create the illusion of being bigger. The pyramid of Menkaura is much smaller and is not aligned on the same diagonal axis as the other two pyramids. Entry to the Great Pyramid of Khufu and Solar Boat Museum are included. - Lecture by Dr. Zahi Hawass & Mark Lehner at the Paws of the Sphinx Visit to the Conservation Center at the Grand Egyptian Museum Lunch at Sakkara Palm Club Then to Sakkara, the ancient burial site considered by many archaeologists to be home to some of the world's most important excavations. -

Islamic Cairo, Egypt
Islamic Cairo, Egypt Cairo is Islamic, though some areas are more so than others. Actually, this area is no more Islamic than Central Cairo, but as though walking through a time machine we are transported back to Cairo's past Islamic heritage, to a world of ancient mosques and 1,500 hundred year old markets; to medieval forts and the city that was Salah ad-Din's. One should dress appropriately if sightseeing is in order, though it is not necessary when simply shopping in the Khan. Appropriate clothing involves clothing which will be acceptable in the mosques, with little skin showing, and particularly not legs and shoulders. Wear comfortable shoes that can be easily removed. Almost all of the old Mosques and Islamic Monuments will have Markers To start this journey, we return to Midan Ataba. However, before proceeding into the Islamic district, lets head southwest along Mohammed Ali street to the intersection of Port Said (Bur Said) street and visit the Islamic Museum, which will provide us with some additional knowledge and resources prior to entering Islamic Cairo. We can then proceed northeast on Port Said street until it intersects with Sharia al-Azhar, which we will take to the east (right). We will first pass the carpet market (H) and then the Mosque- Madrassa of al-Ghouri (66) and then his Mausoleum (67) (the black and white buildings, circa 1505 AD), which are both worth a visit. This complex is a beautiful reminder of the Mamluk era of Egypt, when slaves were kings, but it was al-Ghouri who turned the rule over to the Ottomans with his defeat in Syria.