Generalites Sur L'impact Environnemental
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Bank Document
Sample Procurement Plan Agriculture and Land Growth Management Project (P151469) Public Disclosure Authorized I. General 2. Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: January 2016 – Revision PP: December 2016 – February 2017 3. Date of General Procurement Notice: - 4. Period covered by this procurement plan: July 2016 to December 2017 II. Goods and Works and non-consulting services. 1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for Procurement: [Thresholds for applicable Public Disclosure Authorized procurement methods (not limited to the list below) will be determined by the Procurement Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of the implementing agency’s capacity.] Type de contrats Montant contrat Méthode de passation de Contrat soumis à revue a en US$ (seuil) marchés priori de la banque 1. Travaux ≥ 5.000.000 AOI Tous les contrats < 5.000.000 AON Selon PPM < 500.000 Consultation des Selon PPM fournisseurs Public Disclosure Authorized Tout montant Entente directe Tous les contrats 2. Fournitures ≥ 500.000 AOI Tous les contrats < 500.000 AON Selon PPM < 200.000 Consultation des Selon PPM fournisseurs Tout montant Entente directe Tous les contrats Tout montant Marchés passes auprès Tous les contrats d’institutions de l’organisation des Nations Unies Public Disclosure Authorized 2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the Guidelines. July 9, 2010 3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 3.17 of the Guidelines: - 4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: Manuel de procedures (execution – procedures administratives et financières – procedures de passation de marches): décembre 2016 – émis par l’Unite de Gestion du projet Casef (Croissance Agricole et Sécurisation Foncière) 5. -

Infected Areas As on 26 January 1989 — Zones Infectées an 26 Janvier 1989 for Criteria Used in Compiling This List, See No
Wkty Epidem Rec No 4 - 27 January 1989 - 26 - Relevé éptdém hebd . N°4 - 27 janvier 1989 (Continued from page 23) (Suite de la page 23) YELLOW FEVER FIÈVRE JAUNE T r in id a d a n d T o b a g o (18 janvier 1989). — Further to the T r i n i t é - e t -T o b a g o (18 janvier 1989). — A la suite du rapport report of yellow fever virus isolation from mosquitos,* 1 the Min concernant l’isolement du virus de la fièvre jaune sur des moustiques,1 le istry of Health advises that there are no human cases and that the Ministère de la Santé fait connaître qu’il n’y a pas de cas humains et que risk to persons in urban areas is epidemiologically minimal at this le risque couru par des personnes habitant en zone urbaine est actuel time. lement minime. Vaccination Vaccination A valid certificate of yellow fever vaccination is N O T required Il n’est PAS exigé de certificat de vaccination anuamarile pour l’en for entry into Trinidad and Tobago except for persons arriving trée à la Trinité-et-Tobago, sauf lorsque le voyageur vient d’une zone from infected areas. (This is a standing position which has infectée. (C’est là une politique permanente qui n ’a pas varié depuis remained unchanged over the last S years.) Sans.) On the other hand, vaccination against yellow fever is recom D’autre part, la vaccination antiamarile est recommandée aux per mended for those persons coming to Trinidad and Tobago who sonnes qui, arrivant à la Trinité-et-Tobago, risquent de se rendre dans may enter forested areas during their stay ; who may be required des zones de -

Observatoire Du Vakinankaratra : Enquête Auprès Des Ménages 1995
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fahafahana - Tanindrazana-Fahamarinana Ministère de l'Economie et de la Promotion des Investissements Institut National de la Statistique OBSERVATOIRE DU VAKINANKARATRA ENQUETE AUPRES DES MENAGES 1995 Premiers résultats Février 1996 .version provisoire MADIO (MAdagascar-Dial-Instat-Orstom) est un projet chargé d'apporter aux autorités malgaches un appui à la réflexion macro-économique. Une partie de ses travaux s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de l'appareil statistique national. Le projet est cofmancé par l'Union Européenne, l'Orstom et le Ministère français de la Coopération et du Développement, pour une durée initiale de deux ans (1994-1996). Il est basé dans les locaux de la Direction Générale de l'Iristat à Antananarivo. Adresse: Projet MADIO, Institut National de la Statistique, Bureau 308 B.P. 485, Anosy - Antananarivo 101, Madagascar --ter:2:S8~32:-Fro(:332=50------- AVANT-PROPOS LES OBSERVATOIRES RURAUX : UN OUTIL DE SUIVI DE L'IMPACT DES REFORMES ECONOMIQUES SUR LES MENAGES RURAUX Le projet MADIü a choisi de mettre en place en 1995 des observatoires en milieu rural. L'objectif de cette opération est de suivre l'évolution d'un certain nombre d'indicateurs de l'impact des politiques économiques sur les producteurs ruraux. Ces indicateurs concernent l'évolution des facteurs' de production agricole (le foncier, le travail et l'équipement agricole), l'offre productive (par exemple 'l'évolution de la production agricole commercialisée en fonction de l'évolution des prix ), mais aussi des indicateurs sur le niveau de vie des ménages (scolarisation, sécurité alimentaire, indicateurs de confort de l'habitat.;.). -

RALAMBOZANANY Reine Dokia ECO N°
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO A/U : 2004/05 Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie ---------------------- Département ECONOMIE ---------------------- Deuxième Cycle – Promotion Sortante ---------------------- Mémoire de Maîtrise ès Science Economique : LA FILIERE FRUITS ET LEGUMES DANS LA REGION DU VAKINANKARATRA Directeur de mémoire : RANDRETSA Maminavalona Professeur titulaire à l’Université d’Antananarivo Présenté par : RALAMBOZANANY Reine Dolcia Date de Soutenance 20 Décembre 2005 REMERCIEMENT : Ce travail a été le fruit d’une longue réflexion et d’une rude recherche. Ceci ne peut être accompli sans la grande aide de ceux qui ont contribué de près ou de loin à sa réalisation. Un remerciement à Monsieur RANDRETSA Maminavalona qui a bien voulu m’encadrer dans la réalisation de ce mémoire. Je dédie aussi un vif remerciement à tous nos professeurs pour leurs enseignements et conseils. J’adresse un profond remerciement à tous les organismes qui ont contribué à la conception de ce mémoire : - à Monsieur Rakotoralahy J. Baptiste, Chef de Service du DRDR du Vakinankaratra - à Madame Ratsimbazafy Modestine, Responsable de la promotion de la filière fruits et légumes dans la Région (DRDR) - aux responsables de la documentation du MAEP - à tous les personnels du CTHA - à Monsieur Nary, ingénieur agronome de la CTHA qui m’a beaucoup aidé lors de ma descente dans la commune d’Ambano. Nous espérons que ce modeste travail, contribuera à la prise de décision non seulement sur les politiques de développement local mais aussi celles du développement rural de Madagascar. TABLE DES MATIERES - 2 - REMERCIEMENT INTRODUCTION……………………………………………………………………….. 05 Partie I : Etat des lieux….…………………………………………………………… 06 Chap I : Contexte socio-économique de la région du Vakinankaratra…………… 06 1. -

RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir
SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Madagascar Sahofika Hydropower Plant RESETTLEMENT ACTION PLAN Part One: Detailed Resettlement Action Plan for the Dam and Reservoir Part Two: Abbreviated Resettlement Action Plan for the Linear Components of the Project Prepared by: Land Resources, Antananarivo, Madagascar With: Frédéric Giovannetti, Lyon, France Date: June 30, 2019 Version: C SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT SUPPLIED TO MARY BOOMGARD, OVERSEAS PRIVATE INVESTMENT CORPORATION ON 22 NOV 19 04:53:40 GMT Eiffage Eranove HIER Themis Consortium Madagascar - Sahofika Hydropower Plant Resettlement Action Plan - Version C TRACEABILITY Version Date Reference Commented on Status by A 04/25/2019 Draft B 06/20/2019 Draft for publication C 07/05/2019 Version for submission to ONE ABBREVIATIONS AEC: Administrative Evaluation Commission AFD: French Development Agency AfDB: African Development Bank AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome ALC: Local Liaison Officer Art.: Article AWS Drinking Water Supply BD: Board of Directors Banky Fampadrosoana ny Varotra (Malagasy subsidiary of the BFV: Société Générale Group) BIF: Birao Ifoton'ny Fananan-tany (Communal Land Office) CASEF: Agricultural Growth and Land Security CIRTOPO: Topographic Constituency COBA: Grassroots Community CPAR: Short Resettlement Plan Framework CSB: Basic Health Center CTD: Decentralized Territorial Communities Inter-Regional Departments and Services for the Environment -

Analyse De L'erosion Dans Le Bassin Versant
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DOMAINE SCIENCES ET TECHNOLOGIES MENTION : Bassins Sédimentaires Evolution Conservation PARCOURS : Bassin sédimentaires, Archives de la terre et Ressources du futur (BAR) MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER II ANALYSE DE L’EROSION DANS LE BASSIN VERSANT SAHASAROTRA VINANINONY-SUD Présenté par : RAHOBISOA Sidonie Colette Soutenu publiquement, le 02 Septembre 2019 Devant les Membres du Jury : Président : Monsieur RASOLOFOTIANA Edmond, Maitre de Conférences Encadreur-Rapporteur: Madame RANAIVOSOA Voajanahary, Docteur ès- Sciences Examinateur : Monsieur RAKOTONDRAZAFY Toussaint, Maitre de Conférences UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DOMAINE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES MENTION : Bassins Sédimentaires Evolution Conservation PARCOURS : Bassin sédimentaires, Archives de la terre et Ressources du futur (BAR) MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER II ANALYSE DE L’EROSION DANS LE BASSIN VERSANT SAHASAROTRA VINANINONY-SUD Présenté par : RAHOBISOA Sidonie Colette Soutenu publiquement, le 02 Septembre 2019 Devant les Membres du Jury : Président : Monsieur RASOLOFOTIANA Edmond, Maitre de Conférences Encadreur-Rapporteur: Madame RANAIVOSOA Voajanahary, Docteur ès- Sciences Examinateur : Monsieur RAKOTONDRAZAFY Toussaint, Maitre de Conférences REMERCIEMENTS Je remercie tout d’abord Dieu tout puissant car la réalisation de ce mémoire a été rendue possible grâce à Sa bénédiction et Son amour qu’Il me donne toujours. Et aussi à toutes les personnes, de près ou de loin, qui m’ont prêtés leurs mains. Je voudrais remercier aussi tous les Enseignants au sein de la Mention Bassins sédimentaires Evolution Conservation de la Faculté des Sciences de l’Université d’Antananarivo. Mes vives reconnaissances également s’adressent à : Monsieur RAMAHAZOSOA Irrish Parker, Maîtres de Conférences, Doyen de la Faculté des Sciences (Domaine des Sciences et Technologies) de l’Université d’Antananarivo, qui m’a donné l’autorisation de présentation de ce mémoire. -

Diagnostic Territorial De La Région Du Vakinankaratra À Madagascar
« Prospective territoriale sur les dynamiques démographiques et le développement rural en Afrique subsaharienne et à Madagascar » ETUDE pour le compte de l’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT RAPPORT PAYS Diagnostic Territorial de la Région du Vakinankaratra à Madagascar Auteurs : Jean-Michel SOURISSEAU, Patrick RASOLOFO, Jean-François BELIERES, Jean-Pierre GUENGANT, Haja Karmen RAMANITRINIONY, Robin BOURGEOIS, Tovonirina Théodore RAZAFIMIARANTSOA, Voahirana Tantely ANDRIANANTOANDRO, Manda RAMARIJAONO, Perrine BURNOD, Hajatiana RABEANDRIAMARO, Nathalie BOUGNOUX Version finale Février 2016 Avant-Propos Ce rapport est un des produits de l’étude « Prospective territoriale sur les dynamiques démographiques et le développement rural en Afrique subsaharienne et à Madagascar » menée dans deux régions d’Afrique : la région de Ségou au Mali et la région de Vakinankaratra à Madagascar Il s’agit du diagnostic territorial rétrospectif de la Région du Vakinankaratra. Une première version a servi à la préparation de l’atelier de prospective « Les avenirs de Vakinankaratra en 2035 » qui s’est tenu du 17 au 21 août 2015 à Antsirabe et qui a donné lieu à la production d’un rapport, également disponible. Une deuxième version, très largement enrichie, datée de janvier 2016, a été éditée à cent cinquante exemplaires, et diffusée lors des ateliers de restitution qui ont eu lieu à Antsirabe et Antananarivo, les 02 et 04 février 2016. Ce document (daté de février 2016) constitue la version finale qui prend en compte les remarques faites lors de ces ateliers. Ce rapport sur la région de Vakinankaratra est le pendant du document établi pour la région de Ségou au Mali. Ses principaux enseignements, complétés par les produits de l’atelier, sont intégrés dans le rapport de synthèse de l’étude, produit final rassemblant les acquis de la prospective dans les deux régions et les perspectives en termes de méthode et de reproduction dans d’autres situations. -

Dimensionnement De La Route Antsirabe-Soanindrariny 1
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE POLYTECHNIQUE D’ANTANANARIVO DEPARTEMENT BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS MEMOIRE DE FIN D’ ETUDES EN VUE DE L’ OBTENTION DU DIPLOME D’ INGENIEUR DDIIMMEENNSSIIOONNNNEEMMEENNTT DDEE LLAA RROOUUTTEE AANNTTSSIIRRAABBEE--SSOOAANNIINNDDRRAARRIINNYY (( DDUU PP..KK 00++000000 AAUU PP..KK 2288++225500 )) Présenté par : ANDRIANANTOANDRO Hajaniaina Herilalaina Encadré par : RALAIARISON Moïse Date de soutenance : 03 Février 2005 REMERCIEMENTS Le présent travail n’a pu être effectué sans la grâce de Dieu Tout Puissant. J’exprime mes vifs et sincères remerciements ainsi que ma profonde reconnaissance à : M. RANDRIANOELINA Benjamin, Directeur de l’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, qui, par son administration clairvoyante a fait de l’école ce qu’elle est ; M. RABENATOANDRO Martin, Chef de département du Bâtiment et Travaux Publics, grâce à qui, j’ai apprécié ma spécialité ; M. RALAIARISON Moïse, Maître de conférence, mon encadreur pédagogique, qui n’a pas ménagé ses conseils pour me guider tout au long du travail ; Je remercie également : Les Maires de la commune de Soanindrariny et de la commune d’Ambohidranandriana ; Tout le personnel enseignant et administratif de l’ ESPA Je ne saurais oublier de remercier ma famille et mes proches qui m’ont toujours soutenu et encouragé tout au long de mes études. SOMMAIRE INTRODUCTION GENERALE PREMIERE PARTIE : ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES Chap. I : DESCRIPTION DU PROJET I- PRESENTATION GLOBALE DU PROJET II- OBJECTIF DU PROJET III- RESULTATS ATTENDUS CONCLUSION PARTIELLE Chap. II : PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET OBJECTIF I- COMMUNE RURALE DE SOANINDRARINY II- COMMUNE URBAINE D’ANTSIRABE III- COMMUNE RURALE D’AMBOHIDRANANDRIANA CONCLUSION PARTIELLE Chap. III : PREVISION SOCIO-ECONOMIQUE I. -
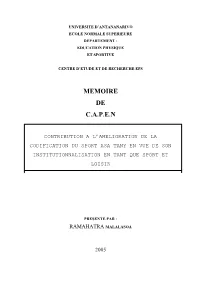
Memoire De C.A.P.E.N
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT : EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE EPS MEMOIRE DE C.A.P.E.N CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR PRESENTE PAR : RAMAHATRA MALALASOA 2005 1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE CENTRE D’ETUDE ET DE RECHERCHE ENS. /EPS Promotion : « VARATRA » MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (CAPEN) « CONTRIBUTION A L’AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU SPORT ASA TANY EN VUE DE SON INSTITUTIONNALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » Présenté et soutenu publiquement le : 26 Octobre 2005 Par : RAMAHATRA Malalasoa Né le : 08 Mars 1978 A : Arivonimamo MEMBRE DU JURY : Président : ANDRIANAIVO Victorine Juge : RASOLONJATOVO Haingo Harinambinina Rapporteur : RAKOTONIAINA Jean Baptiste 2 TITRE : «CONTRIBUTION A L’ AMELIORATION DE LA CODIFICATION DU « SPORT ASA TANY » EN VUE DE SON INSTITUTIONALISATION EN TANT QUE SPORT ET LOISIR » AUTEUR : RAMAHATRA Malalasoa NOMBRE DE PAGES : 76 NOMBRE DE TABLEAUX : 10 RESUME : La richesse culturelle de Madagascar mérite une recherche particulière, au niveau de la tradition aussi bien que de sa civilisation. En effet, le présent mémoire essaie d’apporter des améliorations à la codification, de la pratique du sport asa tany que l’association sport asa tany Madagascar a déjà essayé dans quelques territoires malgache et ailleurs, mais elle n’est pas arrivée à le sportiviser comme le cas des autres sports traditionnels. De ce faite, l’existence des règlements officiels et uniques facilite l’organisation des championnats qui peut entraîner la naissance des clubs, les sections et la fédération sportive pour ce nouvel sport venant des paysans malgaches. -

WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE 15 SEPTEMBER 1995 ● 70Th YEAR 70E ANNÉE ● 15 SEPTEMBRE 1995
WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD, No. 37, 15 SEPTEMBER 1995 • RELEVÉ ÉPIDÉMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE, No 37, 15 SEPTEMBRE 1995 1995, 70, 261-268 No. 37 World Health Organization, Geneva Organisation mondiale de la Santé, Genève WEEKLY EPIDEMIOLOGICAL RECORD RELEVE EPIDEMIOLOGIQUE HEBDOMADAIRE 15 SEPTEMBER 1995 c 70th YEAR 70e ANNÉE c 15 SEPTEMBRE 1995 CONTENTS SOMMAIRE Expanded Programme on Immunization – Programme élargi de vaccination – Lot Quality Assurance Evaluation de la couverture vaccinale par la méthode dite de Lot survey to assess immunization coverage, Quality Assurance (échantillonnage par lots pour l'assurance de la qualité), Burkina Faso 261 Burkina Faso 261 Human rabies in the Americas 264 La rage humaine dans les Amériques 264 Influenza 266 Grippe 266 List of infected areas 266 Liste des zones infectées 266 Diseases subject to the Regulations 268 Maladies soumises au Règlement 268 Expanded Programme on Immunization (EPI) Programme élargi de vaccination (PEV) Lot Quality Assurance survey to assess immunization coverage Evaluation de la couverture vaccinale par la méthode dite de Lot Quality Assurance (échantillonnage par lots pour l'assurance de la qualité) Burkina Faso. In January 1994, national and provincial Burkina Faso. En janvier 1994, les autorités nationales et provin- public health authorities, in collaboration with WHO, con- ciales de santé publique, en collaboration avec l’OMS, ont mené ducted a field survey to evaluate immunization coverage une étude sur le terrain pour évaluer la couverture vaccinale des for children 12-23 months of age in the city of Bobo enfants de 12 à 23 mois dans la ville de Bobo Dioulasso. L’étude a Dioulasso. The survey was carried out using the method of utilisé la méthode dite de Lot Quality Assurance (LQA) plutôt que Lot Quality Assurance (LQA) rather than the 30-cluster la méthode des 30 grappes plus couramment utilisée par les pro- survey method which has traditionally been used by immu- grammes de vaccination. -

Diversité Des Systèmes D'alimentation Des Vaches Laitières À Vinaninkarena Et À Antsampanimahazo Faratsiho
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE SUPERIEURE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DEPARTEMENT ELEVAGE Mémoires de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Ingénieur Agronome Option Elevage Diversité des systèmes d’alimentation des vaches laitières à Vinaninkarena et à Antsampanimahazo Faratsiho REGION VAKINANKARATRA Présentée par : RARIVOARIMANANA Harivololonirina Bakoly Président de Jury : Monsieur RAKOTOZANDRINY Jean de Neupomuscène Tuteur : Monsieur RABEARIMISA Rivo Examinateurs : Monsieur RANARISON Jean : Monsieur RANDRIANARIVELOSEHENO Jules Arsène Maitre de stage : Eric PENOT 16 août 2010 RESUME A Madagascar, l’élevage laitier est pratiqué surtout dans la région du Vakinankaratra, au cœur du triangle laitier malgache. La présente étude vise à mieux connaître les divers systèmes d’alimentation des vaches laitières mis en place par les éleveurs après la crise 2009 dans cette région. Une étude similaire a déjà été effectuée en 2008 à Betafo, une zone particulière de la région. En 2009, la présente étude est élaborée et effectuée dans deux autres zones, Antsampanimahazo, Faratsiho et Vinaninkarena. L’étude est basée sur des enquêtes individuelles effectuées dans 37 exploitations laitières à Vinaninkarena et 40 exploitations laitières à Antsampanimahazo. Ces enquêtes se sont déroulées du mois de Novembre 2009 au mois d’Avril 2010. Elles nous ont permis d’élaborer une typologie de base des exploitations laitières qui sont ainsi classées à partir de trois clés : la surface fourragère disponible par tête de bovin laitier, l’achat ou non de concentrés et les sources de revenu (Agriculture/Elevage ou off farm). Après analyses, 9 types d’exploitations laitières sont apparus. L’enquête typologique nous a permis d’entamer une enquête sur les systèmes d’alimentation. -

Bulletin De Situation Acridienne Madagascar
BULLETIN DE SITUATION ACRIDIENNE MADAGASCAR Bulletin N°18 Août 2014 SOMMAIRE CELLULE DE VEILLE ACRIDIENNE Situation générale : page 1 Situation éco-météorologique : page 3 Situation acridienne : page 4 Situation agro-socio-économique : page 10 Situation antiacridienne : page 10 Annexes : page 13 SITUATION GÉNÉRALE En août 2014, la pluviosité était faible, variant de 15 à 50 mm dans l’Aire grégarigène et de 0 à 50 mm dans l’Aire d’invasion sauf dans l’Aire d’invasion Nord Betsiboka Hautes-Terres (AINB-HT) où elle était supérieure à 50 mm. Par rapport au mois précédent, une légère augmentation de la pluviosité a été constatée mais celle-ci restait généralement déficitaire par rapport à l'optimum hydrique de développement du Criquet migrateur malgache. Par conséquent, les sites offrant des conditions favorables aux criquets solitaires ou plus ou moins transiens se limitaient aux zones de dépression et bas-fonds où une certaine humidité persistait. Les populations solitaires ou plus ou moins transiens se réfugiaient dans ces zones alors que les grégaires continuaient à nomadiser au gré des vents. Les températures minimales étaient comprises entre 11 et 17 °C dans l’Aire grégarigène et 7 et 19 °C dans l’Aire d’invasion. Les températures maximales variaient de 23 à 28 °C dans l’Aire grégarigène et de 21 à 32 °C dans l’Aire d’invasion. Par rapport au mois de juillet 2014, dans l’Aire grégarigène, les températures augmentaient très légèrement. Dans l’Aire d’invasion, l’augmentation de la température diurne rendait plus actives les populations essaimantes qui restaient sexuellement immatures.