Chroniques Sous Haute Tension
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Enseignement ESVA, Jour
Commune d’Attert Gemeng Atert BULLETIN D’INFORMATION N°7 | JUIN 2021 COMMUNE D’ATTERT-GEMENG ATERT www.attert.be Infos communales Les marches de l'été Le PCS d’Attert vous propose durant cet été de partir en ballade juste pour le bien être et le plaisir de partager un petit moment de détente. Cette petite ballade sera assez courte (maximum 3 km) et accessible à tous. A petit feu Le PCS vous propose une petite pause au milieu de la balade avec un moment pour re agréable au cœur de notre belle commune. démarrer…. Les marches se feront de 9h30 à 12h. Le PCS vous donne rdv les : « Plaisir, bien- Jeudi 24.06; Jeudi 08.07; Jeudi 19.08; Jeudi 09.09 être et santé sont les secrets INSCRIPTION OBLIGATOIRE auprès de Stéphanie Annet au 063/24.27.70 ou au 0485/56.88.97 ou du bonheur! » par mail à [email protected] Yves M. Toutes les marches seront organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur Les ateliers du Plan de Cohésion sociale Vous aimez découvrir et/ ou partager? Vous êtes talentueux dans un domaine ou vous souhaitez découvrir? Rejoignez-nous ! Marche Photographie VOLONTAIRE Informatique ARTISTE Cuisine BÉNÉVOLE ÇA T’INTÉRESSE? Sport Santé Réparation Le Plan de Cohésion sociale souhaite organiser vous Citoyens quant au projet à venir sur notre des ateliers sympas, attractifs et pour tous ! Le commune… Plan de cohésion sociale souhaite réfléchir avec PLUS D'INFO auprès de Stéphanie Annet au 063/24.27.70 ou au 0485/56.88.97 ou par mail à [email protected] 2 Sommaire Page Facebook Cette année 2020, la commune d’Attert a souhaité augmenter sa visibilité et sa communication. -

Reproductions Supplied by EDRS Are the Best That Can Be Made from the Original Document
DOCUMENT RESUME ED 447 692 FL 026 310 AUTHOR Breathnech, Diarmaid, Ed. TITLE Contact Bulletin, 1990-1999. INSTITUTION European Bureau for Lesser Used Languages, Dublin (Ireland). SPONS AGENCY Commission of the European Communities, Brussels (Belgium). PUB DATE 1999-00-00 NOTE 398p.; Published triannually. Volume 13, Number 2 and Volume 14, Number 2 are available from ERIC only in French. PUB TYPE Collected Works Serials (022) LANGUAGE English, French JOURNAL CIT Contact Bulletin; v7-15 Spr 1990-May 1999 EDRS PRICE MF01/PC16 Plus Postage. DESCRIPTORS Ethnic Groups; Irish; *Language Attitudes; *Language Maintenance; *Language Minorities; Second Language Instruction; Second Language Learning; Serbocroatian; *Uncommonly Taught Languages; Welsh IDENTIFIERS Austria; Belgium; Catalan; Czech Republic;-Denmark; *European Union; France; Germany; Greece; Hungary; Iceland; Ireland; Italy; *Language Policy; Luxembourg; Malta; Netherlands; Norway; Portugal; Romania; Slovakia; Spain; Sweden; Ukraine; United Kingdom ABSTRACT This document contains 26 issues (the entire output for the 1990s) of this publication deaicated to the study and preservation of Europe's less spoken languages. Some issues are only in French, and a number are in both French and English. Each issue has articles dealing with minority languages and groups in Europe, with a focus on those in Western, Central, and Southern Europe. (KFT) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the original document. N The European Bureau for Lesser Used Languages CONTACT BULLETIN This publication is funded by the Commission of the European Communities Volumes 7-15 1990-1999 REPRODUCE AND PERMISSION TO U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION MATERIAL HAS Office of Educational Research DISSEMINATE THIS and Improvement BEEN GRANTEDBY EDUCATIONAL RESOURCESINFORMATION CENTER (ERIC) This document has beenreproduced as received from the personor organization Xoriginating it. -
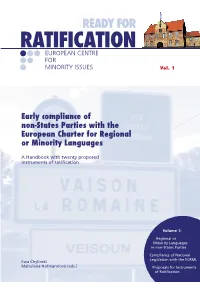
Ratification
READY FOR RATIFICATION Vol. 1 Early compliance of non-States Parties with the European Charter for Regional or Minority Languages A Handbook with twenty proposed instruments of ratification Volume 1: Regional or Minority Languages in non-States Parties Compliance of National Legislation with the ECRML Ewa Chylinski Mahulena Hofmannová (eds.) Proposals for Instruments of Ratification READY FOR RATIFICATION Vol. 1 Imprint Preface Publisher: European Centre for Minority Issues (ECMI) For a number of years, the European Centre for Minority Issues (ECMI) and the Council of Europe co-operated on the © ECMI 2011 publication of a handbook series on various minority issues. The topical areas were legal provisions for the protection and promotion of minority rights under the Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM), Editors: Ewa Chylinski/Mahulena Hofmannová power sharing arrangements and examples of good practice in minority governance. The present Handbook concerns the other Council of Europe convention dealing with minorities: the European Charter for Regional or Minority Languages (ECRML). The ECRML represents the European legal frame of reference for the The opinions expressed in this work are the responsibility protection and promotion of languages used by persons belonging to traditional minorities. of the authors and do not necessarily reflect the position of the ECMI. Regrettably, the importance of the ECRML is not reflected by the number of ratifications. While the FCNM has 39 States Parties, the ECRML has so far been ratified by 25 member States of the Council of Europe and signed by Any person who does any unauthorized act in relation a further eight member States. -

Rapport D'activités 2018
Parc naturel de la Vallée de l’Attert Rapport d’activités 2018 Photo de couverture © Olivier Oswald Rapport d’activités 2018 - Parc naturel de la Vallée de l’Attert 2 DYNAMIQUE GÉNÉRALE Grandes orientations stratégiques du parc La commune d’Attert ayant décidé de renouveler attentes des agriculteurs (conférences, formations, naturel une partie de sa flotte automobile, l’ouvrier du Parc rencontres, tours de plaines…). Pour y parvenir, une naturel a pu bénéficier d’un ancien véhicule commu- subvention d’un an a été accordée par la Région Le Parc naturel de la Vallée de l’Attert (PNVA) a mené nal. L’achat d’un véhicule prévu dans le budget 2018 wallonne aux trois parcs naturels. des actions tout au long de l’année suivant les objec- n’a donc pas dû se faire. tifs stratégiques et opérationnels définis dans son Pour les trois parcs concernés, cela a impliqué le plan de gestion 2015-2025. Pour plus de clarté, la recrutement d’un chargé de mission agricole pour le structure du rapport d’activités se base, comme les Des projets communs avec les autres Parcs suivi du dossier. Au niveau du PNVA, Maxime Doffagne années précédentes, sur celle du plan de gestion. naturels wallons a rejoint l’équipe le 1er décembre 2018. La dynamique mise en place par la Fédération des Les subventions de fonctionnement annuelles accor- Le Contrat de rivière (CR) Moselle permet également Parcs naturels de Wallonie permet aux Parcs naturels dées par la Région wallonne permettent d’assurer la de nombreux échanges avec le Parc naturel Haute de se rencontrer régulièrement, d’échanger, de gestion au quotidien de l’équipe du Parc, mais égale- Sûre Forêt d’Anlier (PNHSFA) et le Parc naturel Hautes participer à des formations communes, mais égale- ment de mener de nombreuses actions de sensibili- Fagnes-Eifel (PNHFE) qui suivent respectivement la ment de monter des projets communs sous la houlette sation, de financer la charte paysagère et des aména- Sûre et l’Our. -

Nimm Vu Belschen Uertschaften Op Lëtzebuergesch
Nimm vu belschen Uertschaften op Lëtzebuergesch Zesummegestallt vum Henri Leyder © (Lëtz. Marienkalender 1997; iwwerschaft 3/2011 a 7/2017) Ar = Arelerland, Li = Provënz Léck - Ar an Li sinn zum germanesche Sproochraum ze zielen All déi aner gehéieren zum franséischsproocheg/wallounesche Sproochraum Aix-sur-Cloie (Ar) Esch-op-der-Huurt Aldringen (Li) Aalger Almeroth (Ar) Almerott Alster (Li) Aalster Anlier Aasler Arlon (Ar) Arel Athus (Ar) Attem Attert (Ar) Atert Aubange (Ar) Éiben / Ibeng Auel (Li) Aul Autelbas (Ar) Nidderälter Autelhaut (Ar) Uewerälter Barnich (Ar) Barnech Bastogne Baaschtnich Battincourt Bettenuewen / Betem Bébange (Ar) Bieben Bého (Däitsch-)Boukëlz Benonchamps Bëndelt Bizory Bisury Bodange (Ar) Biedeg Boeur Biirz Bonnert (Ar) Bunnert Bourcy Borzig Bovigny Buawiss / Buawiëss Buvange (Ar) Béiwen Bracht (Li) Braït Bras Briëch Braunlauf (Li) Bronglëf Buret Beirig Burg-Reuland (Li) Reiland Cetturu Schätereg Chantemelle Chântmiël Châtillon Schättljong Clairefontaine (Ar) Badebuerg (= d’Duerf) Clémarais Klämeräsch Commanster Gommels Côte-Rouge (Ar) Beierchen (bei Metzert) Courtil Kordes Deiffelt Déiwent Differt (Ar) Déifert Dürler (LI) Dirrler Espeler (Li) Eesper Faascht (Ar) Faascht (Haff bei Tountel) Fauvillers Fäteler Fouches (Ar) Affen Frassem (Ar) Fruessem Freylange (Ar) Frällen Gaichel (Ar) Giechel Gouvy Geilech / Gellich Grendel (Ar) Grendel Grüfflingen (Li) Griwweljen Grumelange (Ar) Greimel Guelff (Ar) Gielef Guerlange (Ar) Gierleng Guirsch (Ar) Giisch Habay Habich Habergy (Ar) Hiewerdang Hachy (Ar) Häerzeg Halancy -
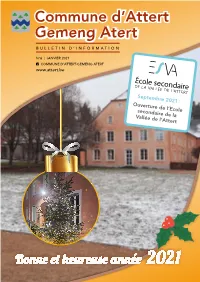
Bulletin Janvier 2021.Pdf
Commune d’Attert Gemeng Atert BULLETIN D’INFORMATION N°6 | JANVIER 2021 COMMUNE D’ATTERT-GEMENG ATERT www.attert.be Septembre 2021 : Ouverture de l’Ecole secondaire de la Vallée de l’Attert Bonne et heureuse année 2021 Plan de cohésion sociale Regard dans le rétro 2020… Pcs et ses premiers pas.. Un petit regard dans le rétroviseur du Plan de cohésion sociale qui a fait ses premiers pas en 2020… Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour votre présence, et même plus encore, pour votre participation à notre formation en informatique ainsi qu’à notre remise à niveau du permis de conduire qui se sont toutes deux tenues en septembre et octobre. Ces deux formations ont été un réel succès de départ pour le Plan de cohésion Sociale. S’ajoute à ces deux formations, l’action Smile box à laquelle vous avez mis beaucoup d’enthousiasme et de cœur. La formation informatique, suspendue depuis mi-octobre, reprendra espérons-le rapidement. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès que des possibilités s’ouvrent à nous pour diverses activités… Smile box 2020 « plus de 190 cadeaux distribués ! »… « Merci pour cette belle mobilisation qui, en cette période de Noël, a ainsi illuminé de nombreux visages !… Un peu de réconfort, de bonheur et de douceur pour ces personnes les plus fragilisées ». 2 Sommaire PLAN DE COHÉSION SOCIALE ENVIRONNEMENT - Regard dans le rétro 2020… - Plastiques agricoles : nouvelles Pcs et ses premiers pas.. 2 consignes de tri pour 2021 22 - Remerciement smile box 2 - Récolte des emballages P+MC 22 - Aide financière pour les -

A Pi a L'copette
Editeur responsable PARMENTIER Adelin Belgique - Belgïe Route de Bastogne 355 P.P. 6700 ARLON 1 6700 ARLON 11/616 /Fax 063/21.72.06 [email protected] Bureau de dépôt : ARLON 1 Agréation P501175 Dans ce numéro : La marche de l'Arelerland Les comètes A PI A L’COPETTE Feuillet d’information de l’Arel’s Club Marcheurs Affilié à la FFBMP - LUX 012 Mensuel - n°161 – novembre 2005 Pour la fin du mois d'octobre ! 2 Les anniversaires Les marches du mois WIOMONT Rita 02 D 06 08h OBERDONVEN L 6-12-16 GARLEMANT Henri 02 V 11 07h FRAITURE EN C. B 6-12-21 de GRAEVE Adolphe 03 S 12 14h ATHUS B 6-12 VANDERVILT Laurie 05 S 12 07h BOOFZHEIM F 10-20-42 GLAUDE Luc 06 D 13 07h BOOFZHEIM F 10-20-42 D 13 07h KEHLEN L 5-11 REILAND Marie-Laure 07 D 20 07h BETTENDORF L 5-10-20 HOTTON Vanessa 08 D 27 07H HULZWEILER D 10-20 PARMENTIER Adelin 10 DUBOIS Geneviève 12 WEISGERBER Nadine 13 VAN CAUSBROUCK Maxime 13 BIDAINE Laura 14 JAMINON Corentin 15 LUC Maria 15 LASSENCE Josiane 16 LEROY Rita 16 LUCAS Annie 19 SCHMIT Véronique 22 MATHIEU Nadine 23 VANDERVILT René 24 GEORGES Mwéma 27 RAPAILLE Julien 28 MEINGUET Monique 30 Bon anniversaire Pour se rendre à : OBERDONVEN: Autoroute vers Luxembourg, puis Trier (Trêve). Sortie Wormeldange (52 km) FRAITURE EN CONDROZ : N4 jusque Marche puis vers Liège Jusque Tinlot et à droite vers Fraiture (110 km) ATHUS : Vers Longwy, sortie Athus (15 km) BOOFZHEIM : Autoroute Metz, Strasbourg , voie rapide vers Colmar, sortie Beinheim (280 km) KEHLEN : Par Steinfort, Capellen, Olm, Kehlen ou autoroute sortie Capellen, environ 700 m vers Mamer puis à Gauche vers Kehlen (25 km) BETTENDORF: Suivre vers Diekirch, Ettelbrück. -

Arlon De 1940 À 1949 Par Jean-Pierre HERWEG ------Page
Arlon de 1940 à1949 Arlon de 1940 à 1949 par Jean-Pierre HERWEG --------------------------------------------------------------------- page Introduction: 003 01. L'architecture de la ville 011 a) Les belles images. b) Les petits commerces à Arlon c) du béton qui dégueulasse tout 02. A l'école ... par tous les temps 034 a) l'école des soeurs de Notre Dame. b) l'école des soeurs des Frère Maristes. c) et quand il y avait de la neige. 03. La Hetchegas 044 a) La Hetchegas, le coeur d'Arlon. b) Le Bamboula c) Les enfants de la Hetchegas d) Le Folklore e) Ida la Rouge. f) Les héros g) Les bagarres h) Les chiens de la Hetchegas i) Les pâtisseries de chez Beicht 04. Le Mahrt (le marché) 063 05. Le Botermahrt (la Grand Place) 070 a) Le Marché au beurre c'est où ? b) Les arbres de la Grand Place: la grande menace ! c) Les arbres: le complot. d) "As-tu senti tes pieds...?" 06. Mes premiers livres. 077 a) Tintin b) Spirou. c) les autre livres 07. Les enterrements 083 08. Faire ses courses dans les années quarante 089 09. Madame Antoinette. 094 10. Chröschtag zu Arel (Noël à Arlon) 098 a) la messe de minuit b) Une crèche au Botermahrt 11. Cléricalisme et anticléricalisme 103 a) le cléricalisme. b) l'anticléricalisme 12. La Knip'tchen, le curé Firmin Schmitz et ses vicaires. 109 13. Eppes fir z'iessen (Si on bouffait ?) 116 a) On mangeait et on buvait bien ... 1 Arlon de 1940 à1949 b) Le porc c)Le boeuf à la mode d) La basse cour et les clapiers e) La chasse et la pêche f) Les Soupes 14. -

Judo Club Stockem Centre Sportif De L’ADEPS, Rue De L’Hydrion À Arlon Les Inscriptions SPORTS Se Font Sur Place
WWW.INFORJEUNESLUXEMBOURG.BE - -- ..._._, -._ ._--- - ~ - ._...... - --~ - - - .._ - ----.- - --....._, - Informatique-- 063 22 14 26 Création de sites Internet • http://www.idt.be Rue de l'Hydrion 113 - 6700 Arlon Ce guide biennal présente les informations relatives à plus de 400 activités de loisirs organisées dans le grand Arlon. INFOR JEUNES LUXEMBOURG a ré- colté les informations avec le plus grand soin. N’hésitez pas à nous contacter pour signaler un changement, une nouvelle activité ou un oubli. Pour vous ai- der dans votre recherche, vous trouverez, ci-contre, un sommaire par thème. À la fin du guide se trouve un index alphabétique des activités. Infor Jeunes Luxembourg asbl Place Didier 31 - 1er étage à 6700 Arlon Éditeur responsable : Yannick Boelen TEL : 063/23.68.98 FAX : 063/23.67.99 [email protected] www.inforjeunesluxembourg.be Infor Jeunes Luxembourg s’efforce d’apporter le plus grand soin à la qualité de ses informations. Le service ne pourra cependant être tenu pour responsable de dommages fortuits ou indirects, quels qu’ils soient, de l’interprétation ou l’utilisation faite du contenu de cette brochure. Nous tenons à remercier pour SPORTS ................................................................. 5 INFRASTRUCTURES SPORTIVES ....................................... 6 leur aide précieuse SPORTS DE COMBAT ........................................................... 7 Tous les organisateurs de SPORTS DE RAQUETTE .................................................... 13 loisirs et les sponsors SPORTS D’EQUIPE ............................................................ -

Programme 2018 DYNAMIQUE GÉNÉRALE
Parc naturel de la Vallée de l’Attert Programme 2018 DYNAMIQUE GÉNÉRALE Grandes orientations stratégiques du technique d’Access-I, notamment pour l’écriture des ouvriers communaux. Le Parc naturel finan- Parc naturel du cahier de critères nécessaires à l’accessibilité cera le matériel nécessaire aux aménagements des sites naturels. environnementaux et à la formation de l’ouvrier. Les orientations stratégiques du parc en 2018 L’équipe du Parc naturel établira la liste des tâches suivent les objectifs stratégiques et opérationnels Les parcs naturels contribuent à des programmes à réaliser au cours de l’année et la transmettra décrits dans le plan de gestion établi en 2015 de recherche et initient des actions expérimen- à l’échevin des travaux de la commune d’Attert. pour les dix prochaines années. tales menées en fonction des projets et de leurs problèmes rencontrés sur le terrain. De nouveaux Suite à l’adoption du Décret wallon du 7 novembre Les deux projets introduits dans le cadre du processus de planification et de gestion de l’espace 2007 organisant les Contrats de Rivière et de son Programme Interreg V Grande Région « Valorisa- rural sont imaginés, testés et ensuite reproduits arrêté d’application du 13 novembre 2008, les tion artistique et touristique des milieux humides sur d’autres territoires. Le PNVA souhaite mettre Contrats de Rivière sont regroupés par sous-bas- de la Grande Région » et « AGRETA – Ardenne, en place avec la commune d’Attert et les agri- sin versant, ce qui a impliqué pour le Contrat de Grande Région, Eco-Tourisme et Attractivité » ayant culteurs une zone pilote « zéro pesticide ». -

Arlon Streek Van Arlon 2017 Arelerland Hébergements Overnachten Accomodation Ubernachten WELCOME !
Le Luxembourg Belge - Belgisch Luxemburg Restauration Uit eten gaan Restaurants Pays d’Arlon Streek van Arlon 2017 Arelerland Hébergements Overnachten Accomodation Ubernachten WELCOME ! la wallonie. la chaleur de vivre. wallonië. omringt je met warmte. 2 2017, la Wallonie Gourmande ! En 2017, le Pays d’Arlon est plus gourmand que jamais ! Au programme : • Routes thématiques • Itinéraires gourmands • Événements festifs et savoureux i www.lawalloniegourmande.be In 2017 is de streek van Arlon meer dan ooit een be-stemming voor smulpapen ! In het programma : • Themaroutes • Smulroutes • F eestelijke en ’smakelijke’ evenementen i www.smulleninwallonie.nl 2017 ist das Arelerland zum Anbeissen nah ! Auf dem Programm : • Themenrouten • Genusstouren • Events und Feste für Geniesser i www.walloniezumanbeissen.de In 2017, « Pays d’Arlon » is a great food-lover’s destination ! What’s on : • Themed routes • Itineraries • Tasty events i www.atasteofthegoodlife.co.uk 3 Sommaire Inhoud • Inhaltsverzeichnis • Contents 2017, LA WALLONIE GOURMANDE ! 2 PICTOGRAMMES / PICTOGRAMMEN / PIKTOGRAMME / PICTOGRAMS 4 PLAN DE LOCALISATION / LOCALISATIE / LOKALISATION / LOCALIZATION 5 HEBERGEMENTS / OVERNACHTEN / ÜBERNACHTUNGEN / ACCOMODATION HOTELS / HOTELS 6 GITES / VAKANTIEWONINGEN / FERIENWOHNUNGEN / GITES 9 CHAMBRES D’HOTES / GASTENKAMERS / GÄSTEZIMMER / GUEST ROOMS 13 CAMPINGS 13 MOTORHOMES / CAMPERPLEKKEN / CAMPINGWAGEN / CAMPING CAR 14 CENTRE SPORTIF / SPORTCENTRUM / SPORTZENTRUM / SPORT CENTER 14 CENTRE D’ACCUEIL / ONTHAALCENTRUM 14 HEBERGEMENTS POUR JEUNES -

Inventing Luxembourg National Cultivation of Culture
Inventing Luxembourg National Cultivation of Culture Edited by Joep Leerssen Editorial Board John Breuilly, Ina Ferris, Patrick Geary, John Neubauer, Tom Shippey, Anne-Marie Th iesse VOLUME 1 Inventing Luxembourg Representations of the Past, Space and Language from the Nineteenth to the Twenty-First Century By Pit Péporté, Sonja Kmec, Benoît Majerus and Michel Margue LEIDEN • BOSTON 2010 Th is book was published with the kind support of the Fonds National de la Recherche Luxembourg and the University of Luxembourg. Cover illustration: Michel Engels, Allegorie de la Patria. © Musée National d’Histoire et d’Art (Luxembourg). Photo by Christof Weber. Th is book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Inventing Luxembourg : representations of the past, space, and language from the nineteenth to the twenty-fi rst century / by Pit Peporte . [et al.]. p. cm. — (National cultivation of culture ; v. 1) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-18176-2 (hardback : alk. paper) 1. Luxembourg—Historiography. 2. Luxembourg—Boundaries. 3. Nationalism— Luxembourg. 4. Luxembourg—Languages. 5. Luxembourgish language. 6. Language policy—Luxembourg. 7. Sociolinguistics—Luxembourg. I. Péporté, Pit. II. Title. III. Series. DH908.I55 2010 949.350072—dc22 2009048080 ISSN 1876-5645 ISBN 978 90 04 18176 2 Copyright 2010 by Koninklijke Brill NV, Leiden, Th e Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Hotei Publishing, IDC Publishers, Martinus Nijhoff Publishers and VSP. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, translated, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior written permission from the publisher.