Nicolae Grigorescu (1838-1907)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
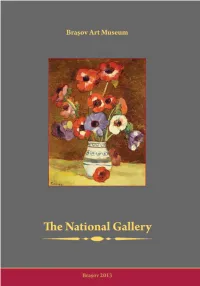
Ghid EN Web.Pdf
Guide financed by Braşov County Council Written and devised: Radu Popica Proof: Simona Tătaru Photos: Nicolae Panaite , Răzvan Precup, Radu Tătaru, Árpád Udvardi DTP: Radu Tătaru English version: Alice Haţegan ISBN 978-606-93303-6-4 Cover: Ştefan Luchian, Anemone The National Gallery 1* comprises a selection of artworks (paintings and sculpture) which are representative for Romanian modern art. The exhibition illustrates the evolution of Transylvanian painting between the 18th and the 19th centuries and Romanian art from the first half of the19th century through to post-war years. Alongside the masterpieces of the Romanian art masters, the exhibition also includes the artworks of the artists active in Braşov, from the Saxon patriciate portraits to the contemporary artist’s creations. The Portrait of Joseph von Drauth (1709-1762), senator of the city of Braşov, painted by Johann Ölhan the Elder (?-1763), opens the exhibition. [ST] The painting is typical for Saxon patriciate portraiture, a provincial variant of portrait d`apparat. The artist insists on the details which indicate that the commissioner boasted a high social status (coat of arms, apparel, as well as on the objects which suggest the official duties he exercised. The City Hall and the buildings surrounding it, depicted in the background of the portrait, are also meant to illustrate his position. But the posture of the model is conventional and artificial. We find the same interest in underlining the social position of the model in the creation of an anonymous artist active in the late 1700s, who painted the Portrait of Oprea Ţârcă, the head of the shepherds’guild of Săcele. -

Razing of Romania's Past.Pdf
REPORT Ttf F1 *t 'A. Í M A onp DlNU C GlURESCU THE RAZING OF ROMANIA'S PAST The Razing of Romania's Past was sponsored by the Kress Foundation European Preservation Program of the World Monuments Fund; it was published by USACOMOS. The World Monuments Fund is a U.S. nonprofit organization based in New York City whose purpose is to preserve the cultural heritage of mankind through administration of field restora tion programs, technical studies, advocacy and public education worldwide. World Monuments Fund, 174 East 80th Street, New York, N.Y. 10021. (212) 517-9367. The Samuel H. Kress Foundation is a U.S. private foundation based in New York City which concentrates its resources on the support of education and training in art history, advanced training in conservation and historic preservation in Western Europe. The Samuel H. Kress Foundation, 174 East 80th Street, N.Y. 10021. (212) 861-4993. The United States Committee of the International Council on Monuments and Sites (USACOMOS) is one of 60 national committees of ICOMOS forming a worldwide alliance for the study and conservation of historic buildings, districts and sites. It is an international, nongovernmental institution which serves as the focus of international cultural resources ex change in the United States. US/ICOMOS, 1600 H Street, N.W., Washington, D.C., 20006. (202) 842-1866. The text and materials assembled by Dinu C. Giurescu reflect the views of the author as sup ported by his independent research. Book design by DR Pollard and Associates, Inc. Jacket design by John T. Engeman. Printed by J.D. -
The Red Army Lei
A BRIEF HISTORY OF THE ROMANIAN LEU A BRIEF HISTORY OF THE ROMANIAN LEU The thaler was a very popular coin which came in many different shapes and enjoyed a wide circulation throughout Europe. The Leeuwendaalder (the lion-thaler or simply the lion) had an overwhelming influence on the money circulation in the Romanian provinces. Minted in the United Provinces of the Netherlands, the coin featured a rampant lion, standing on its back feet, on the reverse. The first issue of this type was minted in 1575 in the province of Holland. In the 17th century, the lion-thaler became the most frequently used high-value silver coin not only in the Romanian principalities, but also throughout the Balkan Peninsula. Greatly appreciated by the people and being circulated in vast amounts, the lion-thaler was even exhibited as merchandise in fairs across the Ottoman Empire. Before the minting of the lion-thaler was discontinued around the mid-18th century, the population in the Romanian principalities had come to identify the lion ( leu in Romanian) with money. This is the most illustrative evidence of the influence that the coin had on the Romanian monetary economy. The leu had become the unit of account both in Moldavia and Wallachia, subdivided into 40 parale . Consequently, calculations were made in lei and parale, whereas the payments were made in real currency, of different origins and denominations, at a pre-established exchange rate. a z 1774 1775 1812 1821 u C The Peace Treaty of Bukovina is annexed to The Treaty of Bucharest The rebellion Küçük Kaynarca is signed, the Habsburg Empire is signed between the led by Tudor n ending the Russian- Ottoman and the Russian Vladimirescu a Turkish War of 1768–1774 Empires. -

Colecłia De Artă Românească Modernă Din Patrimoniul Muzeului De Artă Timi�Oara
COLECłIA DE ARTĂ ROMÂNEASCĂ MODERNĂ DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ TIMIŞOARA RAMONA ORBAN Muzeul de Artă Timişoara Cuvinte cheie: colecŃie, pictură, artă românească, perioada modernă, artişti Keywords: collection, painting, romanian art, modern period, artists Constituirea colecŃiei de artă românească modernă, care a pus bazele Muzeului de Artă Timişoara, s-a întins pe o perioadă de 130 de ani, fiind rezultatul donaŃiilor, achiziŃiilor şi transferurilor de la Muzeul de Artă R.S.R. din Bucureşti. Anul 1879 este considerat anul naşterii colecŃiei, prin înregistrarea primei picturi în evidenŃele muzeale iar Sigismund Ormós părintele colecŃiei, prin donarea colecŃiei sale personale muzeului. ColecŃia actuală cuprinde lucrări ale unor artişti români de prestigiu, cum ar fi Gh. Tattarescu, I. Andreescu, N. Grigorescu, Th. Aman, C. Lecca, S. HenŃia ş.a. Muzeul de Artă din Timişoara de azi este rezultatul unui demers ştiinŃific şi cultural care a durat timp de 130 de ani. În anul 1872 apar primele însemnări legate de începuturile unei activităŃi muzeale în Banat, iar în 1879 a fost înregistrată în evidenŃele muzeale prima pictură din cadrul viitoarei SecŃii de Artă. În perioada 1888-1895, Sigismund Ormós (1813-1893), fondatorul SocietăŃii de Istorie şi Arheologie din Timişoara (1872), colecŃionar şi istoric de artă, donează prin testament colecŃia sa personală de pictură europeană noii instituŃii. Această perioadă marchează formarea primei colecŃii de artă plastică a muzeului timişorean. Din 1927 muzeul este condus de Ioachim Miloia (1897-1940), care organizează Muzeul Banatului, iar începând cu 1940 Aurel Ciupe (1900-1988) preia conducerea şi structurează muzeul pe domenii, astfel luând fiinŃă SecŃia de Artă sau Pinacoteca. -
Characteristics of Collectionism in Wallachia
CRISTINA ADAM TOMA1 CHARACTERISTICS OF COLLECTIONISM IN WALLACHIA Abstract: The paper presents the characteristics of private art collectionism in Wallachia during the second half of the nineteenth century and the first quarter of the twentieth century. Most collectors were intellectuals who came from wealthy families, being educated in Western European countries and becoming accustomed, during their studies, to the custom of visiting museums, art galleries and attending auctions, so much so that on their return home, they began to compile their own collections. They collected mostly ancient and contemporary European art, as well as Romanian art, in the late nineteenth century. Art collections coexisted with those of archaeological vestiges, numismatics, and decorative art, and the reasons for their formation included the desire to educate the public (hence, the possibility of viewing the works during the life of their owners), to support and protect modern Romanian art, and the desire to create an environment similar to that in Western Europe. Keywords: Collectionism, collectors, collections, paintings, Wallachia, the second half of the nineteenth century - the first quarter of the twentieth century. The second half of the nineteenth century brought about political, social and economic changes throughout Europe. The desire for emancipation, the national idea and the emphasis on national identity entailed geopolitical and mentality changes, which would steer the evolution of historical events during this period. The new mentality, embraced and brought over into the Romanian Principalities by the intellectuals who had studied in Western Europe, was reflected in all the aspects of society, at the ideological, economic, political, and social levels,2 as well as in culture: in the visual arts, the theatre, music and even in the method of collecting artefacts. -

Teenmagz Cultural Personalities from Prahova
TEENMAGZ Acting 2 Speak English November 2016 "People are birds with wings growing inside" (Nichita Stanescu) CULTURAL PERSONALITIES FROM PRAHOVA Contents I.L.Caragiale 3 By Georgiana Stefania Petre, Mihaela Movila Iulia Hasdeu 8 By Georgiana Stefania Petre, Mihaela Movila Nicolae Iorga 11 By Mihaela Cosmina Daiana Dobre, Georgiana Stefania Petre Nichita Stanescu 14 By Mihaela Cosmina Diana Dobre, Mihaela Movila Ion Stratan 16 By Mihaela Movila, Mihaela Cosmina Diana Dobre, Georgiana Stefania Petre Nicolae Grigorescu 18 By Mihaela Movila, Mihaela Cosmina Diana Dobre, Georgiana Stefania Petre Cover graphics: Veronica Hutanu Coordinating teacher: Veronica Hutanu Made for the project "Acting 2 Speak English" TEENMAGZ Ion Luca Caragiale INFOMAG Borne: 13 february 1852, Haimanale, Prahova Died: 9 June 1912, Berlin, Germany His name pronunciation: [iˈon ˈluka kara ˈd͡ʒjale] Occupation: short story writer, journalist, essayist, Literary Creation actor,translator,poet Genre: drama, comedy, tragedy, shor story, sketch story, novella,satire, fantasy, memoir,fairy Creator of a complex, diverse and original tale work, starting with prose and verses, elegy, politicSubject: fable, sonnet, anecdote, serial, pamphlet and everyday life, morals and manners, sketches, I. L. Caragiale masters drama art like politics, social no other. Plays like A Tempestuous Night criticism (1879), Cone Leonida faces the reaction (1880), D-ale carnavalului (1885), A Lost Letter (1884), The Calamity (1890) constitute a perfect radiography of the romanian society. http://muzeedambovitene.ro/arhiva_web/en /casa_caragiale_opera.php TEENMAGZ “I only write about our life and for our life, because I don't know another one and I don't care about another one. ” Tragic and fantastic can be found I.L. -

Cluj-Napoca Tourist Guide for Visually Impaired Visitors
BABILON TRAVEL NGO TERRA MIRABILIS TOURIST TRACKS FOR VISUALLY IMPAIRED YOUNG PEOPLE Cluj-Napoca Tourist Guide for visually impaired visitors BABILON TRAVEL NGO TERRA MIRABILIS TOURIST TRACKS FOR VISUALLY IMPAIRED YOUNG PEOPLE The project „Terra Mirabilis: Tourist Tracks for Visually Impaired Young People” was created and developed by Asociația Babilon Travel (NGO) Cluj- Napoca. Project team: Gabriel Nagy Maria Mosora Manuela Cîmpean Roxana Bota Cristina Hosu Gabriel Sebastian Nagy Ioana Bere The project was supported by the City Hall and the City Council of Cluj-Napoca. The project supports the candidacy of Cluj-Napoca for the title of „European Capital of Culture 2021”. The project supports the programme „Cluj-Napoca 2015: European Capital of Youth”. Partners to the project: • High School for Visually Impaired Cluj-Napoca • Cluj-Napoca Tourist Information Center • Blind Persons Association Romania • Ethnographic Museum of Transylvania • Cluj-Napoca Volunteer Center Project sponsor: Class Shoe SRL. Babilon Travel NGO _____Terra Mirabilis: Tourist Tracks for Visually Impaired Young People_____ Cluj-Napoca Tourist Guide For The Visually Impaired Visitors 1 Babilon Travel NGO _____Terra Mirabilis: Tourist Tracks for Visually Impaired Young People_____ 2 Babilon Travel NGO _____Terra Mirabilis: Tourist Tracks for Visually Impaired Young People_____ Introduction A city of lights, a city of the future, always different, always unpredictable, proudly flaunting its cultural and artistic diversity, Cluj-Napoca doesn’t cease to amaze. Hidden in the heart of Romania, one of the most beautiful areas in central Europe, the Transylvanian settlement is the kind of place you can’t help falling in love with. The huge progress made in the last decades, as well as its ability to keep its traditions and local charm alive, stand as proof that Cluj deserves its honorable spot along other European locations, such as Prague, Vienna and Berlin. -

Love of Country
LOVE OF COUNTRY DRAGOSTEA DE PATRIE AMOR A LA PATRIA- Spanish ЛЮБОВТА НА СТРАНАТА –Bulgarian ΑΓΆΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΊ∆Α-Greek AMOR DI PATRIA –Italian RAKKAUS ISӒNMAAHAN –Finnish LIEFDE VOOR JE LAND - Dutch VATAN SEVGISI – Turkish 1 HOW TO LOVE YOUR COUNTRY It's always good to love your country. After all, it's where you live. There are some steps you have to consider when talking about your positive feelings towards your country; so, you will see how great your country really and truly is: 1. Be an active citizen. Actively demonstrate your love for your country by being part of its political process. Continually strive for a better country for all! 2. Study the history of your country. What are some of the great things people have done and how they showed their love of their country? What are some of the things people have done with good intentions but poor results? Learn from your country's history -- both the good times and the bad times. 3. Focus on current events. For example, focus on what is also going on in the world as a whole and how your country is involved in it as well. 4. Read stories, tall tales, and patriotic legends of your country. You will be amazed with such the creativity and imagination of those who wrote or thought up them. 5. Have a hero. Someone who represents your country and is a good role model for you will make you proud to be where you call home. 6. Wear patriotic colors. Nothing shows you love your country more than showing it through clothing or accessories! 7. -

He Romanian Libraries in the Electronic
Romania SHORT Oana Lucia ARTICLEST he Romanian Libraries Dimitriu FROM in the Electronic Age CLOSED DOORS TO OPEN The importance of preserving and sharing With the valuable help of UPC, Romanian heritage is a constant preoccupation of cable television operator, the RAL has started humanity. In 1974 René Maheu, the sixth the program "Personalities that have changed GATES general manager of UNESCO, said "Par la the world" based upon materials available in prise conscience d'un patrimoine culturel Romanian Libraries. This virtual library can be universel, l'humanite se reconnaît solidaire accessed online on the site of Romanian dans le temps et dans l'espace et proclame Academy Library: l'unité de son destin a travers les siecles et les www.biblacad.ro/UPCprezentare.html. nation".1 The works of 29 Romanian and foreign Over the centuries humanity has tried to find personalities, starting with the most famous solutions for saving its discoveries from work of Dante Alighieri – La Divina Com- destruction due to many and varied causes. media, translated into Romanian by the famous The dream of continuity is old as humanity. Romanian poet, translator, and journalist We live in a world full of contradictions and George Cosbuc (1866-1918) – are available different customs and we have to coexist in online. The program was started two years this finite space, with rules that defend values ago by the Romanian Academy Library recognized by all of us. Today everyone together with UPC, and the results are believes that the Internet is the solution for available for all to see. The 40 books and making us known to others and others known articles, including 360 drawings and to us. -

Comparative Study Between Romania and Portugal. My
COMPARATIVE STUDY BETWEEN ROMANIA AND PORTUGAL. MY PORTUGUESE EXPERIENCE INTERCULTURAL STUDIES MRS. CLARA SARMENTO JANUARY 21ST 2015 VALENTIN FLORIN ȘTEFAN (12140094) TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION…………………………………………………………………………………………………….. 3 CHAPTER I – ROMANIAN CULTURE AND CIVILIZATION…………………………………………… 4 CHAPTER II – PORTUGUESE CULTURE AND CIVILIZATION………………………………………. 13 SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN ROMANIA AND PORTUGAL………………… 17 MY PORTUGUESE EXPERIENCE ………………………………………………………………………………. 18 CONCLUSION ………………………………………………………………………………………………………… 19 BIBLIOGRAPHY………………………………………………………………………………………………………… 20 2 INTRODUCTION Culture is a complex principle of behavior, values, beliefs, traditions and art that is passed from generation to generation. Culture finds its meaning in the life of an individual and of society. Culture is a part of every society and creates an attitude of belonging as well as a close union and communication between people from that society. Culture covers various aspects of communication, including attitude, label, beliefs, values, customs, rules, food, art, jewelry, clothing style, tradition, music and much more. Each society has a different culture, which confer identity and uniqueness. SHORT DESCRIPTION OF ROMANIA Romania is situated in the southeastern part of Central Europe and shares borders with Hungary to the northwest, Serbia to the southwest, Bulgaria to the south, the Black Sea to the southeast, Ukraine to the east and north and the Republic of Moldova to the east. Romania is the 13th biggest country in Europe with 238.391 square km. It stretches 514 km from North to South and 720 km from East to West. Romania's territory features splendid mountains, beautiful rolling hills, fertile plains and numerous rivers and lakes. The Carpathian Mountains traverse the centre of the country bordered on both sides by foothills and finally the great plains of the outer rim. -

Raport De Activitate Al Bibliotecii Județene „V.A
APROBAT, DIRECTOR / MANAGER 653/28.02.2020 CORINA-EMANUELA DOBRE Raport de activitate al Bibliotecii Județene „V.A. Urechia” pe anul 2019 Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia” administrează un patrimoniu documentar de 941.240 documente de bibliotecă îndeplinind atât funcţii de bibliotecă publică judeţeană, cât și funcţii de bibliotecă publică municipală, având sediul central în municipiul Galați. În anul de raportare, Biblioteca „V.A. Urechia” şi-a îmbogăţit colecţiile cu un nr. de 19.245 u.b., reprezentând 7158 titluri cărți/multimedia/cs/seriale din care 5368 titluri noi (înregistrare bibliografică nouă) și 1790 titluri în completare (înregistrare bibliografică actualizată), în concordanţă cu cerinţele utilizatorilor şi posibilităţile bugetare ale instituţiei. Pe lângă accesul la colecțiile pe care le deține, oferă servicii de referințe, acces gratuit la Internet, servicii de împrumut național și internațional, prin intermediul sediului central și al celor 5 (cinci) filiale. De asemenea, au fost puse la dispoziție, contra-cost, conform HCJ 290/19 decembrie 2018, spații pentru derulare activități publice (conferințe, prezentări, lansări), spații expoziționale, spații multifuncționale și spații de formare profesională. În anul 2019, situația profesională și economico-financiară la nivel de instituție publică de cultură se prezintă astfel : 1 Realizarea de studii vizând cunoaşterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative şi calitative efectuate în perioada raportată. I. Măsurătorile și indicatorii principali de performanţă care -

Romanian Folk Costume in Paintings: Take the Second Half of the 19Th Century and the Early 20Th Century
Frontiers in Educational Research ISSN 2522-6398 Vol. 3, Issue 11: 58-63, DOI: 10.25236/FER.2020.031110 Romanian Folk Costume in Paintings: Take the Second Half of the 19th Century and the Early 20th Century Mo Xu Beijing Foreign Studies University, Beijing, China ABSTRACT. Since the beginning of the 19th century, especially after Romania participated in the Revolution of 1848, Romanian cultural elites have striven to find a representative and easily recognizable image of Romania as an independent European country. In this context, the rural world was rediscovered, and traditional folk costume which represents the product of the continuity, development and transformation of Romanian society, was reinterpreted and considered as the strongest visual support of national values. Meanwhile, after the Revolution of 1848, the connection between Western Europe and Romania has been increasingly closer, especially in terms of the art and cultural fields. Since Western Europe had already developed mature art schools by that time, it exerted the dominant influence on Romania and encouraged a small part of Romanian painters to focus on some themes that were not conventional in their country, such as the idyllic rural life and the exquisite folk costume worn in the village. Thus, the evolution of art in Romania had been affected by Western European until such influence was absorbed and organically integrated into the Romanian indigenous culture. KEYWORDS: Romanian folk costume, National identity, Schools of painting, Art criticism 1. Introduction 1.1 The Legacy of Romanian Costume and Its Continuity It is known that the main pieces of traditional folk costume preserved to this day come from large-scale collections made in the early 20th century.