Commune Rurale D'analaroa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Stratégies Et Programmation Des Activités
MINISTÈRE DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, ET DES TRAVAUX PUBLICS SECRETARIAT GENERAL DIRECTION GENERALE DES TRAVAUX PUBLICS Stratégies et Programmation des Activités 2020 - 2024 SECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS Version finale Novembre 2020 DIRECTION GÉNÉRALE DES TRAVAUX PUBLICS Sommaire 1.État des lieux 5 1.1 Performances du transport routier 5 1.2 Consistance des dépenses publiques 6 2.Stratégies de développement du réseau routier 7 2.1 Vision et repères sectoriels 7 2.2 Cadrage macroéconomique 7 2.3 Logique de développement du réseau 7 2.4 Innovations et réformes 8 3.Programmes d’activités 9 A. Activités physiques 9 a. Routes nationales (RN) 10 b. Autoroutes 10 c. Routes Rurales 10 a.Entretien périodique RN 12 b. Entretien courant RN 12 c.Entretien courant RR 13 B. Activites non physiques 13 4. Moyens du MATP 15 4.1 Ressources humaines 15 4.2 Logistiques et matériels 16 Hypothèses 17 Liste des annexes 18 Catégories priorités projets 19 Annexe 1 20 Coûts km des projets routiers RN 20 Annexe 2 21 Carte des réseaux routiers de Madagascar 21 Annexe 2 bis 22 Prévision de la situation des projets sur RN en 2024 22 Annexe 3 23 Infrastructure structurante du PEM 23 Annexe 4 24 Détails des programmes routiers 24 Préambule Le présent document sur les Stratégies et Programmes des Activités (SPA) du sous-secteur des Travaux Publics (TP) est une nouvelle version du précédent, établi périodiquement pour une période quinquennale glissante initialement jusqu’en 2018. Pour 2020 - 2024, ces stratégies et programmations sont alignées aux actions prévues par la Politique Générale de l’État, le document PEM et le Document Programme du Ministère de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics. -

Projet Arina
Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques Financé par l’Union européenne CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Projet mis en œuvre par : Jean-Pierre Bouillet, Alain Rasamindisa, Hery A. Rakotondraoelina et Serge Razafimahatratra Editeurs scientifiques Financé par l’Union européenne CAPITALISATION DES REALISATIONS ET DES ACQUIS DU PROJET ARINA Aménagement et Reboisements INtégrés dans le district d’Anjozorobe en bois-énergie Ouvrage de synthèse édité à partir des résultats des travaux de recherche - action menés de 2015 à 2019 dans 3 districts et 8 communes de la région Analamanga à Madagascar. Avec la participation du Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD), du Centre National de la Recherche Appliquée au Développement Rural (FOFIFA), de l’Association PArticipation à la Gestion de l’Environnement (PARTAGE), des partenaires associés des Administrations malgaches chargées des Forêts (DGEF, DREED, CEDD), de l’Energie (MEEH) et des prestataires de service (Association LLD - Fampandrosoana Ifotony, ONG HARDI, Association Angovo Maharitra et Association YPA). Cette initiative rentre dans le cadre du contrat de subvention Union Européenne - CIRAD N° 2015/358-609 du 20 Avril 2019. Elle est issue de la réponse faite le 25/08/2014 par le CIRAD et ses partenaires FOFIFA et PARTAGE à l’appel à proposition EuropeAid/135-812/DD/ACT/MG sur le 10ème Fonds Européen de Développement. -

Ecosystem Profile Madagascar and Indian
ECOSYSTEM PROFILE MADAGASCAR AND INDIAN OCEAN ISLANDS FINAL VERSION DECEMBER 2014 This version of the Ecosystem Profile, based on the draft approved by the Donor Council of CEPF was finalized in December 2014 to include clearer maps and correct minor errors in Chapter 12 and Annexes Page i Prepared by: Conservation International - Madagascar Under the supervision of: Pierre Carret (CEPF) With technical support from: Moore Center for Science and Oceans - Conservation International Missouri Botanical Garden And support from the Regional Advisory Committee Léon Rajaobelina, Conservation International - Madagascar Richard Hughes, WWF – Western Indian Ocean Edmond Roger, Université d‘Antananarivo, Département de Biologie et Ecologie Végétales Christopher Holmes, WCS – Wildlife Conservation Society Steve Goodman, Vahatra Will Turner, Moore Center for Science and Oceans, Conservation International Ali Mohamed Soilihi, Point focal du FEM, Comores Xavier Luc Duval, Point focal du FEM, Maurice Maurice Loustau-Lalanne, Point focal du FEM, Seychelles Edmée Ralalaharisoa, Point focal du FEM, Madagascar Vikash Tatayah, Mauritian Wildlife Foundation Nirmal Jivan Shah, Nature Seychelles Andry Ralamboson Andriamanga, Alliance Voahary Gasy Idaroussi Hamadi, CNDD- Comores Luc Gigord - Conservatoire botanique du Mascarin, Réunion Claude-Anne Gauthier, Muséum National d‘Histoire Naturelle, Paris Jean-Paul Gaudechoux, Commission de l‘Océan Indien Drafted by the Ecosystem Profiling Team: Pierre Carret (CEPF) Harison Rabarison, Nirhy Rabibisoa, Setra Andriamanaitra, -

TDR Annexe7 Rapport Analyse 322 Communes OATF
ETAT DES LIEUX DES 319 COMMUNES POUR LE FINANCEMENT ADDITIONNEL DU PROJET CASEF Février 2019 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES .................................................................................................................... i LISTE DES ACRONYMES ................................................................................................................ iii Liste des tableaux ......................................................................................................................... v Listes des Cartes ........................................................................................................................... v Liste des figures ............................................................................................................................vi Liste des photos ...........................................................................................................................vi I INTRODUCTION ....................................................................................................................... 1 II METHODOLOGIES .................................................................................................................... 2 II.1 CHOIX DES 322 COMMUNES OBJETS D’ENQUETE ............................................................... 2 II.2 CHOIX DES CRITERES DE SELECTION DES COMMUNES ........................................................ 5 II.3 METHODOLOGIE DE COLLECTE DE DONNEES ET ACTIVITES ................................................. 6 -

Rep 2 out Public 2010 S Tlet Sur of Ma Urvey Rvey Adagas Repor Scar Rt
Evidence for Malaria Medicines Policy Outlet Survey Republic of Madagascar 2010 Survey Report MINSTERE DE LA SANTE PUBLIQUE www. ACTwatch.info Copyright © 2010 Population Services International (PSI). All rights reserved. Acknowledgements ACTwatch is funded by the Bill and Melinda Gates Foundation. This study was implemented by Population Services International (PSI). ACTwatch’s Advisory Committee: Mr. Suprotik Basu Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Rik Bosman Supply Chain Expert, Former Senior Vice President, Unilever Ms. Renia Coghlan Global Access Associate Director, Medicines for Malaria Venture (MMV) Dr. Thom Eisele Assistant Professor, Tulane University Mr. Louis Da Gama Malaria Advocacy & Communications Director, Global Health Advocates Dr. Paul Lavani Executive Director, RaPID Pharmacovigilance Program Dr. Ramanan Senior Fellow, Resources for the Future Dr. Matthew Lynch Project Director, VOICES, Johns Hopkins University Centre for Dr. Bernard Nahlen Deputy Coordinator, President's Malaria Initiative (PMI) Dr. Jayesh M. Pandit Head, Pharmacovigilance Department, Pharmacy and Poisons Board‐Kenya Dr. Melanie Renshaw Advisor to the UN Secretary General's Special Envoy for Malaria Mr. Oliver Sabot Vice‐President, Vaccines Clinton Foundation Ms. Rima Shretta Senior Program Associate, Strengthening Pharmaceutical Systems Dr. Rick Steketee Science Director, Malaria Control and Evaluation Partnership in Africa Dr. Warren Stevens Health Economist Dr. Gladys Tetteh CDC Resident Advisor, President’s Malaria -

Répartition De La Caisse-École 2020 Des Collèges D'enseignement
Repartition de la caisse-école 2020 des Collèges d'Enseignement Général DREN ALAOTRA-MANGORO CISCO AMBATONDRAZAKA Prestataire OTIV ALMA Commune Code Etablissement Montant AMBANDRIKA 503010005 CEG AMBANDRIKA 1 598 669 AMBATONDRAZAKA 503020018 C.E.G. ANOSINDRAFILO 1 427 133 AMBATONDRAZAKA 503020016 CEG RAZAKA 3 779 515 AMBATONDRAZAKA SUBURBAINE 503030002 C.E.G. ANDINGADINGANA 1 142 422 AMBATOSORATRA 503040001 CEG AMBATOSORATRA 1 372 802 AMBOHIBOROMANGA 503070012 CEG ANNEXE AMBOHIBOROMANGA 878 417 AMBOHIBOROMANGA 503150018 CEG ANNEXE MARIANINA 775 871 AMBOHIBOROMANGA 503150016 CEGFERAMANGA SUD 710 931 AMBOHIDAVA 503040017 CEG AMBOHIDAVA 1 203 171 AMBOHITSILAOZANA 503050001 CEG AMBOHITSILAOZANA 1 671 044 AMBOHITSILAOZANA CEG TANAMBAO JIAPASIKA 622 687 AMPARIHINTSOKATRA 503060013 CEG AMPARIHINTSOKATRA 1 080 499 AMPITATSIMO 503070001 CEG AMPITATSIMO 1 530 936 AMPITATSIMO 503070015 CEG ANNEXE AMBOHITANIBE 860 667 ANDILANATOBY 503080025 CEG ANDRANOKOBAKA 760 039 ANDILANATOBY 503080001 CEG ANDILANATOBY 1 196 620 ANDILANATOBY 503080026 CEG ANNEXE SAHANIDINGANA 709 718 ANDILANATOBY 503080027 CEG COMMUNAUTAIRE AMBODINONOKA 817 973 ANDILANATOBY 503080031 CEG COMMUNAUTAIRE MANGATANY 723 676 ANDILANATOBY 503080036 CEG COMMUNAUTAIRE RANOFOTSY 668 769 ANDROMBA 503090005 CEG ANDROMBA 1 008 043 ANTANANDAVA 503100020 CEG ANTANANDAVA 1 056 579 ANTSANGASANGA 503110004 CEG ANTSANGASANGA 757 763 BEJOFO 503120016 C.E.G. -

Table Des Matieres La Region…………………………………………………….…………………..……………….1 1 Milieu Physique
TABLE DES MATIERES LA REGION…………………………………………………….…………………..……………….1 1 MILIEU PHYSIQUE ........................................................................................................................13 1.1 RELIEF .......................................................................................................................................13 1.2 GEOLOGIE .................................................................................................................................13 1.3 CLIMAT ......................................................................................................................................14 1.3.1 Le réseau de stations météorologiques ................................................................................15 1.3.2 Température ........................................................................................................................16 1.3.3 Pluviométrie ........................................................................................................................17 1.3.4 Diagrammes ombrothermiques ...........................................................................................18 1.3.5 Cyclones ..............................................................................................................................19 1.4 HYDROLOGIE ...........................................................................................................................19 1.5 SOLS ET VEGETATIONS .........................................................................................................20 -

Evolution De La Couverture De Forets Naturelles a Madagascar
EVOLUTION DE LA COUVERTURE DE FORETS NATURELLES A MADAGASCAR 1990-2000-2005 mars 2009 La publication de ce document a été rendue possible grâce à un support financier du Peuple Americain à travers l’USAID (United States Agency for International Development). L’analyse de la déforestation pour les années 1990 et 2000 a été fournie par Conservation International. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DES FORETS ET DU TOURISME Le présent document est un rapport du Ministère de l’Environnement, des Forêts et du Tourisme (MEFT) sur l’état de de l’évolution de la couverture forestière naturelle à Madagascar entre 1990, 2000, et 2005. Ce rapport a été préparé par Conservation International. Par ailleurs, les personnes suivantes (par ordre alphabétique) ont apporté leur aimable contribution pour sa rédaction: Andrew Keck, James MacKinnon, Norotiana Mananjean, Sahondra Rajoelina, Pierrot Rakotoniaina, Solofo Ralaimihoatra, Bruno Ramamonjisoa, Balisama Ramaroson, Andoniaina Rambeloson, Rija Ranaivosoa, Pierre Randriamantsoa, Andriambolantsoa Rasolohery, Minoniaina L. Razafindramanga et Marc Steininger. Le traitement des imageries satellitaires a été réalisé par Balisama Ramaroson, Minoniaina L. Razafindramanga, Pierre Randriamantsoa et Rija Ranaivosoa et les cartes ont été réalisées par Andriambolantsoa Rasolohery. La réalisation de ce travail a été rendu possible grâce a une aide financière de l’United States Agency for International Development (USAID) et mobilisé à travers le projet JariAla. En effet, ce projet géré par International Resources Group (IRG) fournit des appuis stratégiques et techniques au MEFT dans la gestion du secteur forestier. Ce rapport devra être cité comme : MEFT, USAID et CI, 2009. Evolution de la couverture de forêts naturelles à Madagascar, 1990- 2000-2005. -

Résultats Détaillés Antananarivo
RESULTATS SENATORIALES DU 29/12/2015 FARITANY: 1 ANTANANARIVO BV reçus: 313 sur 313 GASIKA MARINA HVM MAPAR MMM NY AREMA ASSOCI TIM RA MANGA ATION MAINTS RANO MALAG N°BV Emplacement AP AT Inscrits Votants B N S E O MALAZA ASY SAMBA REGION 11 ANALAMANGA BV reçus 140 sur 140 DISTRICT: 1101 AMBOHIDRATRIMO BV reçus24 sur 24 01 AMBATO 0 0 8 7 0 7 0 3 4 0 0 0 0 0 0 02 AMBATOLAMPY 0 0 8 8 0 8 0 1 4 1 0 0 0 0 2 03 AMBOHIDRATRIMO 0 0 10 10 0 10 0 1 8 0 0 0 0 0 1 04 AMBOHIMANJAKA 0 0 6 6 0 6 0 3 3 0 0 0 0 0 0 05 AMBOHIMPIHAONANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 1 2 06 AMBOHITRIMANJAKA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 07 AMPANGABE 0 0 8 7 0 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 08 AMPANOTOKANA 0 0 8 8 0 8 0 4 2 0 1 0 0 0 1 09 ANJANADORIA 0 0 6 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 10 ANOSIALA 0 0 8 8 0 8 0 2 2 1 0 0 0 0 3 11 ANTANETIBE MAHAZA 0 0 8 8 0 8 0 0 6 0 0 0 0 0 2 12 ANTEHIROKA 0 0 8 6 0 6 0 0 5 0 0 0 0 0 1 13 ANTSAHAFILO 0 0 6 6 0 6 0 3 2 0 0 0 0 0 1 14 AVARATSENA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 15 FIADANANA 0 0 6 6 0 6 0 0 3 0 0 0 0 0 3 16 IARINARIVO 0 0 6 6 0 6 0 2 3 0 0 0 0 0 1 17 IVATO 0 0 8 8 0 8 0 1 4 2 0 0 0 0 1 18 MAHABO 0 0 6 6 0 6 0 0 4 0 0 0 0 0 2 19 MAHEREZA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 MAHITSY 0 0 8 8 0 8 0 4 3 0 0 0 0 0 1 21 MANANJARA 0 0 6 5 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 22 MANJAKAVARADRAN 0 0 6 6 0 6 0 1 2 1 0 0 0 1 1 23 MERIMANDROSO 0 0 8 8 0 8 0 2 5 0 1 0 0 0 0 24 TALATAMATY 0 0 8 8 0 8 0 0 3 2 0 0 0 0 3 TOTAL DISTRICT 0 0 172 165 0 165 0 28 98 7 2 0 0 2 28 DISTRICT: 1102 ANDRAMASINA BV reçus14 sur 14 01 ALAROBIA VATOSOLA 0 0 8 8 0 8 0 2 6 0 0 0 0 0 0 02 ALATSINAINY -

REPOBLIKAN'i MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret n° 99-777 portant classement des Routes Provinciales ------------------- LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, - Vu la constitution - Vu la loi n° 98- 026 du 20 Janvier 1999 portant refonte de la Charte routière - Vu le décret n° 98-522 du 23 Juillet 1998, portant nomination du Premier Ministre Chef du Gouvernement - Vu le décret n° 98-530 du 31 Juillet 1998, portant nomination des membres du Gouvernement Sur proposition du Ministère des Travaux Publics, En Conseil du Gouvernement, DECRETE : ARTICLE PREMIER : sont classées, dans la voirie provinciale, suivant l’article 6 de la loi n° 98-026 du 20 janvier 1999, les sections de routes ci-dessous : Routes Provinciales( Km) REGIONS N° Bitumée En Totale LIAISONS terre ANALAMANGA 1.T 7 9 16 - ANOSIZATO-AMBOHIJOKY 3.T 2 10 12 - RN2- ANJEVA-AMBATOMANGA 4.T - 10 10 - ANJEVA –ANTELOMITA 5.T - 34 34 - RN2 PK11 –FIHASINA 6.T 2 10 12 - AMBOHIMANGA vers MAHITSY 7.T 1 13 14 - RN1-FENOARIVO-AMPANGABE 8.T 5 22 27 - RN7/PK22- RN1/PK8 9.T - 7 7 - FENOARIVO RP8.T 10.T - 30 30 - RN7/PK19 – ZAFIMBAZAHA 11.T 4 11 15 - RN7/PK16+300-ANKADITDRATOMBO 12.T - 5 5 - ALASORA AMBOHIMARINA 13.T 8 - 8 - ANDOHATAPENAKA AMBOHIMANDROSO 14.T 3 - 3 - RN1/PK6+700-RP13T 15.T - 29 29 - RN2-FIEFERANA TALATA VOLONONDRY 16.T - 19 19 - RR3/PK8-VOLIHAZO 17.T - 12 12 - RN7- TSIAFAHY –vers MANDROSOA 18.T - 11 11 - IVATO-RN3-LAZAINA-RP33T 20.T - 8 8 - RN7 PK 22- vers ANDRAMASINA 21.T - 20 20 - ANKADINANDRIANA –TSIAFAHY 22.T - 6 -
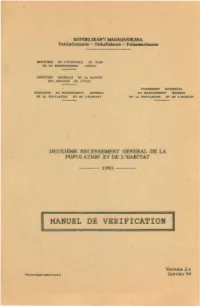
[ Manuel De Verification'i
~POBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahanâ - Fahamarinana YIN1ST~RB DE L' ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRBSSBMENT SOCIAL DIRBCTION' GBNERALE DE LA BANQUE DES DON NEES DE L'BTAT COMMISSION N'ATIONALE DIRECTION DV RECENSEMBNT GENERAL- DU iECBNSENENT ~ENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DB LA 1'OPULATION ST J)E L'HABITAT ,. DEUXIEME RECENSEMENT GENERAL DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT 1993 --- 1 / [ MANUEL DE VERIFICATION ' I Version 2.s . fO\<l.ocrsph\lIIanveT2.8 Janvier 94 REPOBLlKAN'I MADAGASlKARA 'farundrazalla - Fahafahana - Fahamarinana UINISTERE DE L'ECONOMIE, DU PLAN ET DU REDRESSEMENT SOCIAL DIRECTIO:-: GENERALE DE LA BANQUE DES DONNEES DE L'ETAT COMMISSION NATIONALE DIREC1ION Dl! RECENSEMENT GENERAL DU RECENSEMENT GENERAL DE LA POP U LATIO:i ET DE l' HABITAT DE LA POPULATION ET DE L'HABITAT DEUXIEME RECENSEMEl\rrr GEN]~RAL DE LA POPULATION Err DE L ~HA,BI'TAT 1993 MANUEL DE VERIFICATION 1 Il Version 2.s fb\docrBPh\manver2.s Janvier 94 SOI\.iMA1RE INTRODUCTIO~~ . 2 l - GENERALITES SUR LA VERIFICATION 1.1 - LA SECTION V"ERIFICATION ..•.........' , . ,........... 2 1.2 - LE TR~ VAIL DU \lt:RlFICATEUR ..................... 2 1.3 - L'IDEN1IFICATION DES QUESTIONNAIRES .. ,.... ~, ...... 3 1.4- LES QUESTIOl'.~.AIRES-SUITE ...................... 5 ,2 '- METIIODE DE'VERIFICATION o - MILIEU ..............................••........ 5 l - 'FARITA.N1" 2 - F IVONDRONA1\fPOK0l'41 Al"\""l , 3 - FIRAISM1POKONTMry· ..............•...•..........• 5 4 -. N°DE LA ZONE 5 - N e DU S EGME?\l . ~ . .. .... 6 6 "- FOKONTAl~l'· 7 - LOCALITE .... ' .....•..............•..... la ••' • • • • • • 8 8 - N ~ 'DU B.ATIMEr1T .•..-. _ .....•.. ~ ..••.•' .•••.•..•• · • 8 . 9 - TI'1>E' D'UTILISATION . '........................ · . 8 , <> DU ,..,.-c.... TAGE .. 9 ,~ 10. ~ _N Ir}...!::..l'" .• • . -

World Bank Document
Ministry of Transportation and Meteorology World Bank Ministry of Public Works E524 Volume 1 Public Disclosure Authorized Rural Transportation Project Environmental and Social Public Disclosure Authorized Impact Assessment Public Disclosure Authorized December 2001 Prepared by Transport Sector Project (TSP) NGO Lalana Basler & Hofmann Based on the preliminary designs of the following consulting firms: Public Disclosure Authorized DINIKA (Tananarive) MICS - ECR - AEC - SECAM (Fianarantsoa) ESPACE - MAHERY (Taomasina) EC PLUS - JR SAINA (Mahajanga) 4 A OSIBP - SOMEAH (Toliary) F CO PY EIIRA - ANDRIAMBOLA - BIC (Antsiranana) Projet de Transport Rural, Madagascar - Evaluation des impacts environnementaux et sociaux Table of Contents 1 Summary of Environmental and Social Assessment .................................................. 1 1.1 Proposed Project ........................................ 1 1.2 Transport Sector Environmental Assessment ...................................... 1 1.3 Environmental Assessment for APL 2 ...................................... 1 1.4 Policy and Legislative Framework ....................................... 1 1.5 Methodology ...................................... 2 1.6 Participatory approach ...................................... 2 1.7 Rural transport rehabilitation component ....................................... 3 1.8 Potential environmental impacts ...................................... 3 1.9 Resettlement and cultural heritage ....................................... 4 1.10 Rail and port infrastructure rehabilitation