Télécharger Le Numéro En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

WR 16Mar 1928 .Pdf
World -Radio, March 16, 1928. P n n rr rrr 1 itiol 111111 SPECIAL IRISHNUMBER Registered at the.G.P.O. Vol. VI.No. 138. as a Newspaper. FRIDAY. MARCH 16, 1928. Two Pence. WORLD -RADIO 8 tEMEN Station Identification Panel- Konigswusterhausen (Zeesen). Germany REC GE (Revised) Wavelength : 125o in. Frequency : 240 kc. Power :35 kw. H. T. BATTERY Approximate Distance from London : 575 miles. (Lea-melte Tide) Call " Achtung !Achtung !Hier die Deutsche Welle, Berlin,-Konigswus- terhausen."(Sometimes wavelength POSSESSES all the advantages of a DRY BATTERY given :" . auf Welle zwolf hun- dert and fiinfzig," when callre- -none of the disadvantages of the ordinary WET peated.)When relaying :" Ferner Ubertragimgauf "... (nameof BATTERY. relaying stations). Interval Signal:Metronome.Forty beats in ten seconds. 1. Perfectly noiseless, clean SpringConnections,no IntervalCall :" Achtung !Konigs. and reliable. 4.soldering. wusterhausen.DerVortragvon [name of lecturer]uber[titleof 5. No "creeping of salts. lecture]ist beendet.Auf Wieder- 2. Unspillable. Easily recharged, & main- 'toren in . Minuten."When 6. relaying :`& Auf Wiederhorenfur 3No attention required until tains full energy through- Konigswusterhausen in . exhausted. out the longest programme. Minuten ;fur Breslau and Gleiwitz [or as the case may be] nach eigenem Programm." 711,2 ails are null: in thefoll,n,ing three sizes: Own transmissionsandrelays.In eveningrelaysfromotherstations. H.T.1.Small ... 8d. each. Closes down at the same time as the relaying station. H.T.2.Large ... 10d. each. H.T.3.Extra Large 1:- each. (Copyright) A booklet containing alargenumberof these Guaranteed to give I a,volts per cell. panels canbeobtainedof B.B.C.Publications, Savoy Hrll, W. -

Contenido Estrenos Mexicanos
Contenido estrenos mexicanos ............................................................................120 programas especiales mexicanos .................................. 122 Foro de los Pueblos Indígenas 2019 .......................................... 122 Programa Exilio Español ....................................................................... 123 introducción ...........................................................................................................4 Programa Luis Buñuel ............................................................................. 128 Presentación ............................................................................................................... 5 El Día Después ................................................................................................ 132 ¡Bienvenidos a Morelia! ................................................................................... 7 Feratum Film Festival .............................................................................. 134 Mensaje de la Secretaría de Cultura ....................................................8 ......... 10 Mensaje del Instituto Mexicano de Cinematografía funciones especiales mexicanas .......................................137 17° Festival Internacional de Cine de Morelia ............................11 programas especiales internacionales................148 ...........................................................................................................................12 jurados Programa Agnès Varda ...........................................................................148 -

Tnemreie and RADIO REVIEW
TNeMreIe AND RADIO REVIEW VOLUME XXIII JULY 4th -DECEMBER 26th, 1928 ALL RIGHTS RESERVED Published from the Offices of " THE WIRELESS WORLD " ILIFFE & SONS LTD., DORSET HOUSE, TUDOR ST.. LONDON. E.C.4 www.americanradiohistory.com 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11I I l l I1I111I I l 1111111111111111111111111111111111I111111 INDEX VOLUME XXIII JULY 4th -DECEMBER 26th, 1928 i l l l l l l __ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1111111111111111 r A.B. Products -H.F. Choke, 774 Brayton Trickle Charger, The, 08e Current Topics, 11, 43, 69, 109, 133, 167, 195, Abroad, Programmes from, 15, 45, 78, 105, 135, Bright Emitters as Rectifiers, 183 231, 255, 287, 317, 359, 391, 472, 603, 531, 169, 197,- 227, 257, 283, 319, 365, 393, 468, British Acoustic Film System, The (Talking 561, 587, 633, 661, 701, 727, 765, 795, 818, 505, 533, 565, 601, 635, 673, 713, 733, 761, Films), 842 850 797, 820, 860 Phototone System (Talking Films), 792 " Cylanite," 688 Programmes from (Editorial), 1 -Broadcast ('yldon Synchratune -, Brevities, 23, 54, 85, 117, 143. 177, Twin Condensers, 743 -, Sets for, 808 203, 233, 268, 296, 323, 363, 445, 481, 515. Accumulator Carrier, Weston, 564 543, 573. 599, 641, 682, 711, 745, 772, 805. Charging, 489 832, 865 Damped but Distoitionless, - Discharge, 749 - Equalising, 272 Broadcasting Monopoly, The (Editorial), 155 Davex Eliminator, 19 Knobs, Clix, 112 Scientific Foundations of, 728 Tuners, 564 - or -, Eliminator? 750 Stations, 206 -" D.C.5," A Batteryless Receiver for -Accumulators, D.C. -
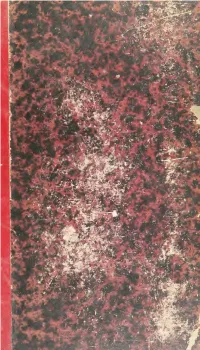
C. of the Late Charles I. Bushnell, Esq., Comprising His Extensive Collections
.^:^ ^-^^ .'';";if^A*' ^^^ ^^^:r i* iififc' ^•i-^*'im v<*^ 5:?^:'/; x^ 11^1 'M QJarttell Unitteraitg Hthtatg Jtljara, New gork FROM THE BENNO LOEWY LIBRARY COLLECTED BY BENNO LOEWY 1854-1919 BEQUEATHED TO CORNELL UNIVERSITY CATALOGUE OK THE LIBRARY, AUTOGRAPHS, EXGRAVINGS, &c. OF THE lATE CHARLES I. BUSH NELL, Esq. TO, BE SOLD BY Bangs & Co. Monday, April 2d, and four following days. 1883. Jln^^ ijj K.h .Jiali I Cornell University j Library The original of tiiis book is in tine Cornell University Library. There are no known copyright restrictions in the United States on the use of the text. http://www.archive.org/details/cu31924031351798 CATALOGUE OF THE LIBRARY, &e. OF THE LATE CHARLES L BUSHNELL, Esq, COMPRISING HIS EXTENSIVE COLLECTIONS OF RARE AND CURIOUS AMERICANA, OF Engravings, Autographs, Historical Relics, Wood-Blocks Engraved by Dr. Anderson, &c., &c. Compiled by ALEX'R DENHAM. TO BE SOLDAT AUCTION, Monday, April 2d, and four following days. Commencing at 3 P. M. and 7.30 P. M., each day, BY Messrs. BANGS & CO., Nos. 739 and 741 Broadway, New York. Gentlemen unable to attend the Sale, may have purchases made to their order by the Auctio?ieers. 1I^"A11 bids should be made by the Volume, and not by the set. NO T E. The late Mr. Charles I. Bushnell was widely known, not only as a persevering collector of rare and quaint books, but also as a diligent student of American history ; whose thorough knowledge of those minutiae which escape the notice of all but the painstaking specialist had been proved by his original essays and scholarly annotations to various books. -

Bibliography of North American Minor Natural History Serials in the University of Michigan Libraries
BIBLIOGRAPHY OF NORTH AMERICAN MINOR NATURAL HISTORY SERIALS IN THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES BY MARGARET HANSELMAN UNDERWOOD Anm Arbor llniversity of Michigan Press 1954 BIBLIOGRAPHY OF NORTH AMERICAN MINOR NATURAL HISTORY SERIALS IN THE UNIVERSITY OF MICHIGAN LIBRARIES BY MARGARET HANSELMAN UNDERWOOD Anm Arbor University of Michigan Press 1954 my Aunts ELLA JANE CRANDELL BAILEY - ARABELLA CRANDELL YAGER and my daughter ELIZABETH JANE UNDERWOOD FOREWORD In this work Mrs. Underwood has made an important contribution to the reference literature of the natural sciences. While she was on the staff of the University of Michigan Museums library, she had early brought to her attention the need for preserving vanishing data of the distribu- tion of plants and animals before the territories of the forms were modified by the spread of civilization, and she became impressed with the fact that valuable records were contained in short-lived publications of limited circulation. The studies of the systematists and geographers will be facilitated by this bibliography, the result of years of painstaking investigation. Alexander Grant Ruthven President Emeritus, University of Michigan PREFACE Since Mr. Frank L. Burns published A Bibliography of Scarce and Out of Print North American Amateur and Trade Periodicals Devoted More or Less to Ornithology (1915) very little has been published on this sub- ject. The present bibliography includes only North American minor natural history serials in the libraries of the University of Michigan. University publications were not as a general rule included, and no attempt was made to include all of the publications of State Conserva- tion Departments or National Parks. -

Forests and Forestry
PROTECTED AREAS AND THE BOTTOM LINE ZONES PROTEGEES : PRUDENCE Proceedings of the 1997 Conference of the Canadian Council on Ecological Areas September 14-16, 1997 Sheraton Hotel Fredericton, New Brunswick <'\erence 19.s> ~ Canadian Council on Ecological Areas ,.J ... 1 ~ Conseil canadien des aires ecologiques .,.,.l)J) (\.,~ > Confe1e. Actes de la Conference 1997 du Conseil canadien des aires ecologiques 14-16 septembre 1997 Hotel Sheraton Fredericton (Nouveau-Brunswick) Information Report/ Rapport d'information : M-X-205E/F Canadian Forest Service/ Service canadien des forets Atlantic Forestry Centre/ Centre de foresterie de I' Atlantique Natural Resources Ressources naturelles Canada Canada Canadian Forest Service canadien Service des forets Canada Protected Areas and the Bottom Line Zones protegees : prudence Proceedings of the 1997 Conference of the Canadian Council on Ecological Areas Actes de la Conference 1997 du Conseil canadien sur les aires ecologiques September 14-16, 1997 / le 14-16 1997 Sheraton Hotel / Hotel Sheraton Fredericton, NB / Fredericton (N. -8.) Compilers/ Cornpilateurs : J. Loo & M. Gorman Information Report/ Rapport d'information : M~X-205 Natural Resources Canada/ Ressources naturelles Canada Canadian Forest Service/ Service canadien des forets Atlantic Forestry Centre/ Centre de foresterie de l'Atlantique P.O. Box / C.P. 4000 Fredericton, N.B. E3B 5P7 Canada 1999 PROTECTED AREAS AND THE BOTTOM LINE• ZONES PROTEGEES: PRUDENCE TABLE OF CONTENTS Page Preface ............. ... ... .. ... ... .... ... .... .. -

Daily Record
LONG BRANCH DAILY RECORD. VOL., 10--N UMBER 11. LONG BRANCH, N^ J.,, SATURDAY, JANUARY 14, 1911. PAGES PRICE ONE CENT CHATTLES WIN IN TO SEND GIRL WHO EXPOSES ABSURDITY READY IN LABOR APOSTLE TO FIRST LEAGUE GAME OF BUREAU ATTACK SENATORIAL TIE-UP SPEttHEBE SOON Strong' Neptune High School iKI^ED L|TTLE Animus and Falsity of Money Fine Course of Lectures Plan- Team Defeated-Other Wasted In Advertising ned by Bible Class of the Basketball Contest TO ELECTRIC CHAIR Charge Discussed IN WEST VIRGINIA First Reformed Church l-hattlo won her ilrsl league game Publicity Director 8. JJ. Bobbin, to- The Men's Bible Class of the First DI the season last night, defeating Story of Pretty Widow of Twenty-Three Who Murda-y made tho following iyateinent re- Republican Senators* Who Are Filibustering to Pre- Reformed Church, of this city, tuw re- NoptuiiB High School, by a score of garding an attack upon Oiu Publicity cently reorganized and elected the fol- ' 2U to 18. Brazo, Oliattle'a ntftr riKJH Bureau in the Long Branch Press yen- lowing officers for th& ensuing year: forward, started the game and his bas- dered Her 5-Year-0ld Child With Carbolic erday: • ' vent Election of Two Democratic Senators L. Wallace Cottrell, president; K. M- kej was followed by a tout shot by "I hardly think it neceaeai y to make Van Gelderen, secretary; F. it- Ben- Grncey, Neptune's pouter- Baskets ny answer to anything said by this nett, treasurer. The class meets ev- followed'In succession by Johnson, Acid That Poverty Was The Cause crson Symthe, and I only dignify him Threatened With Arrest But Soldiers Will ery Sunday afternoon at 2,30. -

Readings in Children's Literature.Pdf (3.306Mb)
1 Readings in Children’s Literature Compiled from Copyright-Cleared Materials Available on Project Gutenberg or the Web 11/3/19 Edited by Joshua Dickinson [email protected] Figure 1 The Swing (Illustration from A Child’s Garden of Verses) 2 Contents LORD MAYOR OF LONDON. ........................................................................................... 11 CAT,...................................................................................................................................... 11 STORY OF SIR WILLIAM THOMPSON. ......................................................................... 12 Dream Days, by Kenneth Grahame .......................................................................................... 30 The Reluctant Dragon ........................................................................................................... 30 THE LIGHT PRINCESS .............................................................................................................. 49 by........................................................................................................................................... 49 GEORGE MACDONALD ....................................................................................................... 49 Contents .................................................................................................................................... 49 1. What! No Children? .......................................................................................................... 49 2. -

Remembering the Forgotten, Archaeology at the Morrissey WW1
Remembering the Forgotten Archaeology at the Morrissey WWI Internment Camp by Sarah Beaulieu B.A., University of the Fraser Valley, 2011 Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts in the Department of Archaeology Faculty of Environment Sarah Beaulieu 2015 SIMON FRASER UNIVERSITY Spring 2015 Approval Name: Sarah Eve Beaulieu Degree: Master of Arts (Archaeology) Title: Remembering the Forgotten Archaeology at the Morrissey WWI Internment Camp Examining Committee: Chair: Dr. Dana Lepofsky Professor Dr. Eldon Yellowhorn Senior Supervisor Associate Professor Dr. Ross Jamieson Supervisor Associate Professor Dr. Adrian Myers External Examiner Archaeologist Amec Foster Wheeler Date Defended/Approved: April 9, 2015 ii Partial Copyright Licence iii Ethics Statement iv Abstract To date, there is very little known archaeologically about First World War era Internment Camps, especially in Canada where many of the Federal Internment records were destroyed in the 1950s. Archaeologists can play a fundamental role in contributing knowledge where there remains a lack of oral and documentary evidence through a triangulation of data sets commonly used by historical archaeologists. This thesis focuses on one of Canada’s twenty-four WWI internment camps – Morrissey Internment Camp, and specifically its cemetery. Through an archaeological landscape analysis, GPR survey of the cemetery, archives retrieval and oral history interviews, the story of the Morrissey Internment Camp was brought to light and gaps in the historical record finally answered. Keywords: Internment archaeology; Confinement; GPR; Morrissey; PoWs; WWI; Austro-Hungarian; German v Dedication To my children Kamran and Sophia who will inherit this world, and make it a much better place. -
États Généraux Du Film Documentaire Lussas, 18-24 Août 2019
états généraux du film documentaire lussas, 18-24 août 2019 ÉDITO Le réel, qu’est-ce que c’est ? À cette question essentielle qui taraude le cinéma documentaire, Juan- David Nasio, psychanalyste renommé et étonnant de pédagogie, propose une réponse : « le trou noir », « ce qui est infiniment impossible de connaître », développée dans un film éponyme. Avec son ton irremplaçable, il ajoute : « les images ont pour fonction de cacher le réel ». Aussi réducteur et obscur que cela puisse paraître en deux extraits de phrases, tout cela se concrétise néanmoins assez clairement, dans le dispositif analytique bien sûr, mais aussi dans ce qui nous intéresse ici tout parti- culièrement, la production des images. Qu’est-ce qui affleure à la surface des choses et des êtres ? Comment précisément, les cinéastes inventent-ils des situations pour espérer approcher, apercevoir, toucher des éclats de réel, ce réel insaisissable ? Dans l’intonation d’une voix, la lueur d’un regard ou la tension d’un geste, en substance dans la vibration d’une image, que peut-on déceler de leur part inconnaissable et qui parvient à nous troubler ? Alain Bergala explorera pour nous la « création-cinéma » à la recherche de ces moments d’effraction dans les films. Tout aussi troublante et engageante est la proposition d’Érik Bullot et de Muriel Pic de penser le cinéma comme une expérience de désorientation qui nous expose à l’hypothèse de notre archive animale et nous rappelle comment « la naissance du cinéma est venue rétablir notre rapport à la perception sensible ». Federico Rossin ne viendra pas démentir cette approche avec la découverte privilégiée de l’œuvre de Robert E. -
"A L L a L O N E T O G E T H E R " B Y T H O M a S C H R Is
LOOKING YOU IN THE THIRD EYE SINCE 1992 "ALL ALONE TOGETHER" BY THOMAS CHRISTOPHER HAAG • THOMASCHRISTOPHERHAAG.COM VOLUME 24 | ISSUE 7 | FEBRUARY 12-18, 2015 | FREE [2] FEBRUARY 12-18 , 2015 WEEKLY ALIBI WEEKLY ALIBI FEBRUARY 12-18 , 2015 [3] CRIB NOTES BY AUGUST MARCH alibi Crib Notes: Feb. 12, 2015 VOLUME 24 | ISSUE 7 | FEBRUARY 12-18 , 2015 1 After only one episode, some are saying that AMC’s new Burque-based EDITORIAL drama “Better Call Saul” is set to MANAGING EDITOR/MUSIC EDITOR: Samantha Anne Carrillo (ext. 243) _________________. [email protected] FILM EDITOR: a) Improve our town’s struggling Devin D. O’Leary (ext. 230) [email protected] economy FOOD EDITOR/FEATURES EDITOR : b) Destroy our city’s reputation Ty Bannerman (ext. 260) [email protected] c) Influence local law practices ARTS & LIT EDITOR/ WEB EDITOR : Lisa Barrow (ext. 267) [email protected] d) Provide a template for all teevee CALENDARS EDITOR/COPY EDITOR: shows of the distant future Mark Lopez (ext. 239) [email protected] CONTRIBUTING WRITERS: Cecil Adams, Steven Robert Allen, Captain 2 Last Saturday night, a shopkeeper on America, Gustavo Arellano, Rob Brezsny, Shawna Menaul shot a would-be shoplifter who Brown, Suzanne Buck, Eric Castillo, David Correia, made off with ___________________. Erik Gamlem, Gail Guengerich, Nora Hickey, Kristi D. Lawrence, Ari LeVaux, Mark Lopez, August March, Genevieve Mueller, Amelia Olson, a) A box of bath salts Geoffrey Plant, Benjamin Radford, Jeremy b) A large New York-style pizza Shattuck, Mike Smith, M. Brianna Stallings, M.J. c) An expensive “growers lamp” Wilde, Holly von Winckel d) A large bag of vermiculite PRODUCTION ART DIRECTOR: Jesse Schulz (ext. -
Translation Quality Assessment
Voices and Silences: Exploring English and French Versions at the National Film Board of Canada, 1939-1974 Christine York Thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in partial fulfillment of the requirements for the Doctorate of Philosophy degree in Translation Studies School of Translation and Interpretation University of Ottawa © Christine York, Ottawa, Canada, 2014 Table of Contents Chapter One: Understanding NFB versions as a site of competing voices ................................................... 1 1.1 Interwoven threads of English and French production ........................................................................ 3 1.2 Defining a corpus ................................................................................................................................ 6 1.3 Defining concepts: Beyond source and target text ............................................................................ 11 1.4 Literature review: NFB ..................................................................................................................... 19 1.5 Literature review: Translation studies ............................................................................................... 25 1.6 Considering multiple voices .............................................................................................................. 32 1.6.1 Voice-over in film studies and audiovisual translation .................................................................. 33 1.6.2 Voice of the text ............................................................................................................................