Journals.Openedition.Org/Com/174 DOI : 10.4000/Com.174 ISSN : 1961-8603
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Les Societes Ultramarines Face Aux Risques De Montee Du Niveau Marin. Quelles Strategies D'adaptation?
Les societes ultramarines face aux risques de montee du niveau marin. quelles strategies d’adaptation ? : exemples des iles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou Sophie Bantos To cite this version: Sophie Bantos. Les societes ultramarines face aux risques de montee du niveau marin. quelles strate- gies d’adaptation ? : exemples des iles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou. Géographie. Université de la Sorbonne (Paris 4), 2011. Français. tel-01172166 HAL Id: tel-01172166 https://hal.ird.fr/tel-01172166 Submitted on 7 Jul 2015 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Université Paris 4 - Sorbonne Université de la Nouvelle Calédonie IRD, US ESPACE Thèse de Doctorat de Géographie Nouveau Régime intitulée : Les sociétés ultramarines face aux risques de montée du niveau marin. Quelles stratégies d’adaptation ? Exemples des îles de Wallis et Futuna, Mayotte et Lifou. Présentée et soutenue publiquement le 17 janvier 2011 par : Sophie BANTOS Sous la direction de : Christian Huetz de Lemps, Professeur et Michel Allenbach, Maître de conférences-HDR Devant le jury composé de : Professeur Franck Dolique Professeur Richard Laganier Professeur Christian Huetz de Lemps Maître de conférences-HDR Michel Allenbach Professeur Jean-Paul Amat - Avant-propos - AVANT-PROPOS La thématique de l’adaptation à la montée des eaux dans les petites îles tropicales est abordée dans ce mémoire d’un point de vue sociétal. -

Introduction À La Végétation Et À La Flore Du Territoire De Wallis Et Futuna
CONVENTION ORSTOM/SERVICE DE L'ECONOMIE RURALE DE WALLIS ET FUTUNA INTRODUCTION ALA VEGETATION ET ALA FLORE DU TERRITOIRE DE WALLIS ET FUTUNA • (Rapport des 3 missions botaniques effectuées dans ce territoire en 1981-1982) P. MORAT J.M.· VEILLON M. HOFF OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE_MER OCTOBRE 1983 ______1 CENTRE OoRoSoToOoMo DE NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE ·1 OFFICE DE LA REC~ERCHE SCIENTifIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER. CENTRE DE NOUMEA. INTRODUCTION ALA VEGETATION ET ALA FLORE DU TERRITOIRE DE ~1ALLIS ET FUTUNA 1 -O§O- PAR Philippe MORAT Jean-Matie VEILLON Mi che l HOFF Rapp~rt des mi~sions botaniques effectuées dans ce tp.rritoire en 1981-1982. OCTOBRE 1983. TABLE DES MATIERES. Page..6 . INTRODUCTION 1 1 - Le milieu 2 1.1. Situation géographique - Relief - Géologie 2 1. 2. Sols 3 1.3. Réseau hydrographique 3 1. 4 Cl i mat 4 1.5. Peuplement humain 4 -' 2 - La végétation 5 2.1. La végétation autochtone 5 2.1.1. la mangrove 5 2.1.2. la végétation littorale 6 2. 1.2. 1. .ecu gJLoupement.6 p.6ammophUe..6. 2.1.2.2• .ea fioJLêt littoJLale 2.1.3. la forêt sempervirente 8 ·2.1.4. la végétation marécageuse 11 2.2. La végétation modifiée 12 2.2.1. les forêts secondarisées et les fourrés 12 2.2.2. cultures, jachères, végétation des zones fortement anthropisées 13 2.2.3. landes à V-i.CJtMOpteJU.o ou IItoafa li 14 3 - La Flore 16 4 - Conclusions - Recommandations 17 5 - Bibliographie 23 ANNEXES 1 - Carte des itinéraires et lieux prospectés au cours des 3 missions ~I - Liste des espèces et échantillons collectés ainsi que leurs biotopes III - Carte de Végé.tation IV - List~ rles noms sciehtifiques et leur correspondances en noms vernaculaires connys. -

Commercial Enterprise and the Trader's Dilemma on Wallis
Between Gifts and Commodities: Commercial Enterprise and the Trader’s Dilemma on Wallis (‘Uvea) Paul van der Grijp Toa abandoned all forms of gardening, obtained a loan, and built a big shed to house six thousand infant chickens flown in from New Zealand. The chickens grew large and lovely, and Toa’s fame spread. Everyone knew he had six thousand chickens and everyone wanted to taste them. A well-bred tikong gives generously to his relatives and neighbours, especially one with thousands of earthly goods. But . Toa aimed to become a Modern Busi- nessman, forgetting that in Tiko if you give less you will lose more and if you give nothing you will lose all. epeli hau‘ofa, the tower of babel Recently, the model of the trader’s dilemma was developed as an ana- lytical perspective and applied to Southeast Asia. The present paper seeks to apply this model in Western Polynesia, where many Islanders, after earning wages in Australia, New Zealand, the United States, or New Cale- donia, return to open a small shop in their home village. Usually, after one or two years of generous sharing, such enterprises have to close down. I analyze this phenomenon through case studies of successful indigenous entrepreneurs on Wallis (‘Uvea), with special attention to strategies they have used to cope with this dilemma. The Paradigm of the Trader’s Dilemma The trader’s dilemma is the quandary between the moral obligation to share wealth with kinfolk and neighbors and the necessity to make a profit and accumulate capital. Western scholars have recognized this dilemma The Contemporary Pacific, Volume 15, Number 2, Fall 2003, 277–307 © 2003 by University of Hawai‘i Press 277 278 the contemporary pacific • fall 2003 since the first fieldwork in economic anthropology by Bronislaw Malinow- ski (1922), Raymond Firth (1929; 1939), and others. -

LIVRET D'accueil Wallis Et Futuna
ADMINISTRATION SUPERIEURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA LIVRETLIVRET D'ACCUEILD'ACCUEIL WallisWallis etet FutunaFutuna 1 LELE MOTMOT DUDU PREFETPREFET L'archipel des îles Wallis et Futuna, à 20 000 km de la Métropole, au coeur du Pacifique Sud, est un jeune territoire français, qui a fêté ses 50 ans d'existence en 2011. L'organisation institutionnelle de cette collectivité d'outre-mer est atypique: l'Etat, le Territoire, les autorités coutumières et religieuses y exercent ensemble leurs responsabilités. Les fonctionnaires qui ont fait le choix de mettre leurs compétences au service de l'Etat et du Territoire à Wallis et Futuna doivent faire preuve de solides capacités d'adaptation. Mais ils vivront une expérience unique, dans ce monde polynésien qui a su conserver beaucoup de ses traditions, au sein d'un environnement remarquable. Ce livret d'accueil a vocation à vous présenter à grands traits ce territoire, et vous aider à préparer le voyage qui vous attend. Je remercie et félicite le Service des Ressources Humaines qui a pris l'initiative de réaliser ce document qui n'a pas la prétention d'être exhaustif, mais s'efforce de donner à celles et ceux qui s'apprêtent à exercer leurs fonctions à Wallis et Futuna, des informations qui leur seront utiles. Michel JEANJEAN 2 LIVRET D'ACCUEIL ILES WALLIS ET FUTUNA SOMMAIRE: 1/ PRESENTATION GENERALE A/ Repères historiques B/ Géographie et démographie des îles C/ Coutumes et traditions 2/ LES SERVICES ADMINISTRATIFS A/ L'Administration Supérieure a- Organisation et fonctionnement b- Organigramme B/ -

Ils Sont Arrivés Dans Une Noix De Coco... Généalogies Du Royaume D
ILS SONT ARRIVES DANS UNE NOIX DE COCO ••. Généalogies du royaume d'Alo et de Sigave ·Par D. F~imigacci,J.P. Siorat, B. Vienne ILS SONT ARRIVES DANS UNE NOIX DE COCO ... (Généalogies d'Alo et de Sigavei par O. Frimigacci, J.P. Siorat, B. Vienne Oa'ns les tel)ips anc ~ens, la' royauté teIl e que nous la connaissons aujourd'hui n'existait pas à Futuna. De nos jours, deux unités politiques existent: Alo et Sigave. C'est une société à titres. Le :3au t"Hiki ou "roi" d'Alo porte le titre de "Tui Agaifo". Jadis, il portait le titre de Fakavelikele. Le SaLi Aliki ou "roi" de Sigave porte le titre de Keletaona ou de Tamole Vai. Les généalogies que nous avons relev~es remontent au 12 ème niveau généalogique c'est à dire à l'an 1644, si nous décidons de compter 28 ans pour une génération, à partir de l:année 1980. A ,la 10 ème génération, les Samoans Mago, Salo et Tafaleata débarquèrent à Anakele "dans une noix de coco": ils sont à l'origine de l'actuelle royauté d"Alo. Mago et sa~i~mme Tafaleata auront une descendance. Petelo Lemo, l'actuel Tui Agaifo du royaume d'Alo possède ce Mago comme lointain ancètre. A cette époque, il y avait à Futuna et à Alofi des territoires de chefferies biens distincts et autonomes,dirigés par un chef. Les titres de chefferies actuels se réfèrent à ces chefs, ancètres prestigieux. L'enquète sur Futuna et Alofi nous a permis de définir les territoires de chefferies qui existaient au cours des ces trois derniers siècles. -

Date: December 22-30, 1986 Roturna, Not''ther·N Vanua I
Agency for Washington D.C. International 20523 Development FIJI- •••••·••••-·- ..-•--oo•••••••)L••• -· C clone-••••·--•·-•-•ooo Date: December 22-30, 1986 L0S:.~_t!.Q.!J.: Roturna, not''ther·n Vanua I...E!\/U, ·raveun i, and thE! L..au Group ....No....... ---·-·---·· Dead: ........ 1 ~.9.. :__ .B.Lfgf..i~.Q..: About 260,000 rE!Sided in affected ar·t~as; 3,000 evacuees p_~!!!~9..~: A pn"?.l imi nar·y estimate of damage to :i nfras tructur·e, hom,~s, cr·ops, and l:i.vestock has bt~tH1 assess1?d at $20,000,000. :r.b..~---·R..t~.~.t~x: After battE!ring the is land of Roturna on December· 2/.···· 24 and the r t''E!rKh territory of Futuna on December 25-27 , Cyclone Raja, the first stonn of the season in the South Pacific, appeared headed f0r a direct hit on F :i j i.' s main is lands of V:it i l...e\JU and Vanua I...(!VU. On l.),:;!c,~mber 29, however, just before midnight, the cyclone changed direction and began moving south---southeast, spar·:in(:3 Vi ·ti I...1?.\/U but str·iking the easb?.rTI islands with destructive for-cE!. Heavy n~ins and winds up to 1.00 knots at.: the center caused I?.Xtensive damage in north1?.t''rl Vanua Levu, lav,:wni, and the Lew Group. L.clbasa repor·ted the wor·s t floods in living mernoi''Y r.~s a result of prolong,?. d tor-rential r·ains. The sev,?.r·e flooding l~Jh:i.ch r·esulted from the coincidence of the stonn aru1 extremely high tides was expected to cr·eate food short:ages and l·walth and sanitation probl,~ms. -
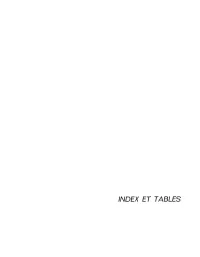
Index Et Tables Index
INDEX ET TABLES INDEX des principaux personnages, toponymes et thématiques narratives Les numéros renvoient à ceux du répertoire 1970-1971 en annexe. Les indications de pages qui font suite à la série des numéros se réfèrent à la pagination de cet ouvrage. Les noms de personnages, suivant la pratique adoptée, sont donnés en capitales, et leur signification entre parenthèses, de façon à les distinguer des toponymes et des noms communs. Les noms communs sont classés suivant l'ordre alphabétique des termes français, traduits en wallisien en caractères maigres. En se servant du lexique botanique et zoologique, il est facile, en partant du vocable wallisien, de retrouver le correspondant français. Les espèces difficilement identifiables sont regroupées sous les entrées : coquillages, crabes, oiseaux, plantes, poissons. Nous remercions M. Richard Rossille pour sa contribution à cet index partiel. Afrique, Afelika : n°s 108, 1.053, 1.185, 1.286 — pp. 19, 98, bananier, fusil : 403, 897, 946, 1.176, 1.207, 1.212, 1.249, 100, 155, 184. 1.271, 1.277 — pp. 66, 69, 72, 74, 75, 77, 177, 182, 183. AGO-MUA (Curcuma-premier) : 144, 177, (396) — p. 96. bêche-de-mer, loli : 580 — p. 141. Ahoa, village du district de Hahake : 826, 935, 987, 1.168, Belle au bois dormant, thématique : 753 — p. 138. 1.235, 1.241, SElvlTSI 1932-2 — pp. 18, 102. bénitier, gaegae : 13, 144, 195, 222, 304, 396, 402, 487, aigle, akuila : 244, 474, 736, 1.053, 1.185 — pp. 34, 115. 741, 895, 1.000, 1.094 — pp. 95 111, 161. ALAALAMAIPE (Réveille-toi) : 325 — p. -

W Allis-Et -Futuna 2017
2017 Wallis-et-Futuna INSTITUT D’ÉMISSION D’OUTRE-MER ÉDITION WALLIS-ET-FUTUNA 2017 2018 THÉMATIQUE DU RAPPORT 2017 POURQUOI LE TOURISME DURABLE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ? Comme chaque année, l’IEDOM et l’IEOM s’inspirent des thématiques célébrées par l’Organisation des Nations Unies pour illustrer leurs rapports annuels. Les années internationales proclamées par l’Assemblée générale des Nations unies sont dédiées, chaque année depuis les années 2000, à un ou plusieurs thèmes particuliers. L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2017 « Année internationale du tourisme durable pour le développement ». Cette décision fait suite à la reconnaissance par les dirigeants mondiaux, lors de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable (Rio+20), qu’un « tourisme bien conçu et bien organisé » peut contribuer au développement durable dans ses trois dimensions (économique, sociale et environnementale), à la création d’emplois et aux débouchés commerciaux. Photo de couverture : Catamaran sur lagon Le tourisme durable est l’un des objectifs de la Stratégie de développement du Territoire. Il s’accompagne de la promotion d’activités durables telles que les sports nautiques, respectueuses de l’environnement et du lagon, atout indéniable du Territoire. © Chloé Desmots INSTITUT D’EMISSION D’OUTRE-MER ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL SIÈGE SOCIAL 115, rue Réaumur 75002 PARIS Wallis-et- Futuna Rapport annuel 2017 Les renseignements autres que monétaires publiés dans la présente étude ont été recueillis auprès de diverses sources extérieures à l’Institut d’émission et ne sauraient engager sa responsabilité. L’IEOM tient à remercier les diverses administrations publiques, les collectivités et les entreprises pour les nombreuses informations qu’elles lui ont communiquées. -

1Ere Page 31 Juillet 2020
N° 539 31 JUILLET 2020 REPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté – Egalité – Fraternité S O M M A I R E ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE Page 20687 ANNONCES LÉGALES Page 20716 DECLARATIONS D’ASSOCIATIONS Page 20718 SOMMAIRE ANALYTIQUE ACTES DU CHEF DU TERRITOIRE L’arrêté n° 2020-617 du 16 juillet 2020 portant Arrêté n° 2020-670 du 22 juillet 2020 autorisant le mesures nécessaires à l’entrée par voie aérienne sur le versement au titre de l’année 2020 à la territoire des îles Wallis et Futuna dans le cadre de la circonscription d’Uvéa du fonds national de lutte contre la propagation du virus Covid-19 a été péréquation des ressources intercommunales et publié dans le NUMERO SPECIAL n° 537 du 16 communales. – Page 20691 juillet 2020 Journal Officiel du Territoire des îles Wallis et Futuna. Arrêté n° 2020-671 du 22 juillet 2020 accordant une subvention à l’association LEA KI ALUGA-OSEZ Les arrêtés n° 2020-618 à 2020-644 du 18 juillet 2020 pour la tenue de la journée de sensibilisation ne sont pas publiables dans le Journal Officiel du organisée le 12 juillet 2020. – Page 20691 Territoire des îles Wallis et Futuna. Arrêté n° 2020-672 du 22 juillet 2020 autorisant Arrêté n° 2020-645 du 17 juillet 2020 portant l’attribution d’une subvention au Budget du publication de la liste des électeurs sénatoriaux. – Territoire pour les actions sociales et la lutte contre la Page 20687 violence du Pôle Social – SITAS. – Page 20692 Arrêté n° 2020-646 du 17 juillet 2020 relatif à l’octroi Arrêté n° 2020-673 du 22 juillet 2020 portant de l’agrément de commissionnaire en douane. -
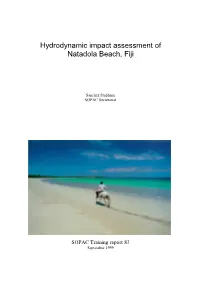
Hydrodynamic Impact Assessment of Natadola Beach, Fiji
Hydrodynamic impact assessment of Natadola Beach, Fiji Sanchez Stephane SOPAC Secretariat SOPAC Training report 83 September 1999 SOPAC Training Report ____________________ ACKNOWLEDGEMENTS I first express my acknowledgements to the Director of SOPAC Alfred Simpson and all the SOPAC staff, especially Franck Martin and my supervisor Robert Smith. I would like to also thank the French Embassy for the funds that enabled my placement at SOPAC. Stephane Sanchez Page 2 03/09/99 SOPAC Training Report ____________________ TABLE OF CONTENTS Acknowledgements______________________________________________________ 1 Abstract_______________________________________________________________ 4 Introduction____________________________________________________________ 5 Warning_______________________________________________________________ 6 I. Presentations ______________________________________________________ 8 A. Presentation of SOPAC __________________________________________________8 1. Background ________________________________________________________________ 8 2. Mission statement ___________________________________________________________ 8 3. Work program ______________________________________________________________ 8 4. Resource development program ________________________________________________ 9 B. Natadola beach ________________________________________________________10 1. Description _______________________________________________________________ 10 2. Physical Environment _______________________________________________________ 11 a)Tidal -

Livret D'accueil 2019
PRÉFET ADMINISTRATEUR SUPÉRIEUR CHEF DU TERRITOIRE DES ILES WALLIS ET FUTUNA LIVRETLIVRET D’ACCUEILD’ACCUEIL ADMINISTRATION SUPÉRIEURE – PRÉFECTURE DES ILES WALLIS ET FUTUNA 20192019 Mis à jour le 30/04/2019 SOMMAIRE P a g e s Avant-propos : Le mot du Préfet, Administrateur Supérieur des îles Wallis et Futuna............................................. 3 CHAPITRE I - PRÉSENTATION GÉNÉRALE A/ Repères historiques …........................................................................................................................................... 4 B/ Présentation Géographique ….............................................................................................................................. 4 C/ Le Climat à Wallis et Futuna ............................................................................................................................... 5 D/ Données Démographiques .................................................................................................................................... 5 E/ Cadre Institutionnel .............................................................................................................................................. 6 1) Le Statut de 1961 .......................................................................................................................................6 2) L’État …..................................................................................................................................................... 6 3) Le Territoire …...........................................................................................................................................6 -

The Legacy of Futuna's Tsiaina in the Languages of Polynesia"
9 The legacy of Futuna 's Tsiaina in the languages of Polynesia ROBERT LANGDON The island of Futuna, 240 km north-east of Vanualevu, Fiji, has always been virtual terra incognita to most Pacific scholars, especially English-speaking ones. Like its nearest neighbour, Wallis Island, otherwise Uvea, Futuna has been in the French sphere since French Marist missionaries established themselves there in 1837. Wallis and Futuna jointly have been both a protectorate and a colony of France. They have had the status of a French overseas territory since 1961. Most of the literature on them is naturally in French. Until fairly recently, the only way to reach them was by ship (Douglas and Douglas 1989:621-{)27). In the circumstances, not to know about the Tsiaina of Futunan tradition and not to suspect their influence on the prehistory of Polynesia and its languages has been a normal condition. Ts iaina is Futunan for 'China'. On Futuna the term describes a group of supposedly Chinese castaways who are said to have been wrecked in prehistoric times on the now uninhabited island of Alofi that is separated from Futuna by a narrow strait. The Tsiaina thereafter played a prominent role in Futunan political and cultural affairs. They were eventually overthrown in a popular uprising. There are at least six recorded versions of the Tsiaina tradition. They give the impression that the reign of the Tsiaina was quite short. In reality, the evidence presented in this paper suggests that it lasted for a goodly period-several generations, at least. Certainly, the Tsiaina left a significant legacy in the language and culture of Futuna that was also carried to other islands.