MEMOIRE HDR Synthèse PETITGIR
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Newly Opened Correspondence Illuminates Einstein's Personal Life
CENTER FOR HISTORY OF PHYSICS NEWSLETTER Vol. XXXVIII, Number 2 Fall 2006 One Physics Ellipse, College Park, MD 20740-3843, Tel. 301-209-3165 Newly Opened Correspondence Illuminates Einstein’s Personal Life By David C. Cassidy, Hofstra University, with special thanks to Diana Kormos Buchwald, Einstein Papers Project he Albert Einstein Archives at the Hebrew University of T Jerusalem recently opened a large collection of Einstein’s personal correspondence from the period 1912 until his death in 1955. The collection consists of nearly 1,400 items. Among them are about 300 letters and cards written by Einstein, pri- marily to his second wife Elsa Einstein, and some 130 letters Einstein received from his closest family members. The col- lection had been in the possession of Einstein’s step-daughter, Margot Einstein, who deposited it with the Hebrew University of Jerusalem with the stipulation that it remain closed for twen- ty years following her death, which occurred on July 8, 1986. The Archives released the materials to public viewing on July 10, 2006. On the same day Princeton University Press released volume 10 of The Collected Papers of Albert Einstein, con- taining 148 items from the collection through December 1920, along with other newly available correspondence. Later items will appear in future volumes. “These letters”, write the Ein- stein editors, “provide the reader with substantial new source material for the study of Einstein’s personal life and the rela- tionships with his closest family members and friends.” H. Richard Gustafson playing with a guitar to pass the time while monitoring the control room at a Fermilab experiment. -

When Michigan Changed the World!
When Michigan Changed the World! Cyber Cloud Digital Library of Alexandria M Publishing, Hathitrust OCW Virtual Universities Profession Schools Consulting Law, Bus, Ed, Policy, Nat R State UG Colleges Nation Socialization World Massication Libraries (Knowledge resources) Biomedical Sciences Hospitals Med, Den, Nurs, Pub H (Medical Center) Graduate School Culture Universitas Public Museums Magisterium Performing Arts et Scholarium (Athletics?) Natural Sciences Spinos Eng, Phys, Chem, Math, SI US Priorities UM Research Laboratories Medical Campus North Campus Central Campus NCRC Basic Research Renaissance Campus Scholarship Innovation Translational Research DaVinci Project Basic Research Tech Transfer UM Ventures UM Global Open Source Franchising M&A © 2020 The Millennium Project, The University of Michigan All rights reserved. The Millennium Project The University of Michigan 2001 Duderstadt Center 2281 Bonisteel Boulevard Ann Arbor, MI 48109-2094 http://milproj.dc.umich.edu Table of Contents Prologue Chapter 1: Leaders and Best Chapter 2: The Hypothesis Chapter 3: The Precursors Universitas Chapter 4: The Internet Chapter 5: Cyberinfrastructure Renaissance Chapter 6: Books into Clouds Chapter 7: The Renaissance Campus Enlightenment Chapter 8: Universities and Enlightenment Chapter 9: Tomorrow’s World Chapter 10: A Roadmap for Michigan’s Future Appendix A: SpaceShip Earth Appendix B: Michigan Computer History Appendix C: Michigan Impact on IT Policy Appendix D: Duderstadts and the Machine 1 Prologue Three times in its recent history, the University of augmented reality). But the most profound impact Michigan has actually changed the world through has been through the Internet, built by a consortium the efforts of its faculty and its research and teaching led by the University of Michigan with IBM and MCI that developed tools remarkably similar to those that in the 1980s and 1990s and supporting software such created our modern civilization in purpose and impact. -

Table of Contents
Table of Contents Schedule at a Glance ....................................... 2 Special Symposia Townes Symposium: Reminiscences – Scientific and Personal . 15 FiO/LS Chairs’ Welcome Letters .............................. 3 International Year of Light – Science to Solutions . 15 General Information ........................................ 5 Symposium on Photoreceptor Analysis and Single-cone-mediated Vision ............................................... 16 Conference Services . 5 Laser Science Symposium on Undergraduate Research . 16 First Aid and Emergency Information . 6 Symposium on Optics for Global Health and Low Resource Sponsoring Society Booths . 6 Settings . 17 Stay Connected Symposium Honoring Adolf Lohmann...................... 17 Conference Materials.................................... 7 Symposium on Optical Remote Sensing for the Climate . 17 FiO/LS Mobile App . 8 Symposium on Applications of Low Noise Frequency Combs . 18 Conference Plenary Session and Awards Ceremony Special Events . 19 Plenary Presentations.................................... 9 APS Arthur L. Schawlow Prize and Lecture . 10 Exhibition Information ..................................... 23 Frederic Ives Medal /Jarus W. Quinn Prize Presentation FiO/LS Committees . 24 and Lecture . 10 OSA Awards and Honors ................................. 11 Explanation of Session Codes ............................... 25 Awards and Special Recognitions FiO/LS Agenda of Sessions ................................. 26 OSA Foundation Boris P. Stoicheff Memorial Scholarship....... -
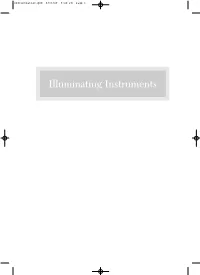
Klaus Staubermann
00frontmatter.qxd 6/13/09 9:00 PM Page i Illuminating Instruments 00frontmatter.qxd 6/13/09 9:00 PM Page ii 00frontmatter.qxd 6/13/09 9:00 PM Page iii Illuminating Instruments Artefacts: STUDIES IN THE HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, VOLUME 7 Edited by Peter Morris and Klaus Staubermann Series Editors Robert Bud, Science Museum, London Bernard Finn, Smithsonian Institution Helmuth Trischler, Deutsches Museum, Munich WASHINGTON, D.C. 2009 00frontmatter.qxd 6/13/09 9:00 PM Page iv 00frontmatter.qxd 6/13/09 9:00 PM Page v he series “Artefacts: Studies in the History of Science and Technology” was established Tin 1996 under joint sponsorship by the Deutsches Museum (Munich), the Science Museum (London), and the Smithsonian Institution (Washington, DC). Subsequent spon- soring museums include: Canada Science and Technology Museum, Istituto e Museo Nazionale di Storia della Scienza, Medicinsk Museion Kobenhavns Universitet, MIT Museum, Musée des Arts et Métiers, Museum Boerhaave, Národní Technické Museum, Prague, National Museum of Scotland, Norsk Teknisk Museum, Országos Mıszaki Múzeum Tanulmánytára (Hungarian Museum for S&T), Technisches Museum Wien, Tekniska Museet–Stockholm, The Bakken, Whipple Museum of the History of Science. Editorial Advisory Board Robert Anderson, Cambridge University Jim Bennett, Museum of the History of Science, University of Oxford Randall Brooks, Canada Science and Technology Museum Ruth Cowan, University of Pennsylvania Robert Friedel, University of Maryland Sungook Hong, Seoul National University David Hounshell, -
A Year in Review
A Year in Review Electrical Engineering & Computer Science UNIVERSITY of MICHIGAN Mcity, where autonomous cars are tested, at sunrise. Read about May Mobility, an autonomous vehicle startup, on page 35. EDITORS: STORY AND PHOTO CONTRIBUTORS: Catharine June Stephen Alvey Gyouho Kim Steven Crang Gabe Cherry Kate McAlpine Faqrul A. Chowdhury Dan Meisler ASSISTANT EDITORS: Robert Coelius Nicole Casal Moore Zach Champion Evan Dougherty Rodrigo Sabadini Dan Newman Danielle Hicks U-M Grid Rose Anderson Darren Hood Joseph Xu Electrical and Computer Engineering Electrical Engineering and GRAPHIC DESIGNER: Computer Science Building Rose Anderson 1301 Beal Avenue Ann Arbor, MI 48109-2122 The Regents of the University of Michigan Computer Science and Engineering Michael J. Behm, Grand Blanc Andrew C. Richner, Grosse Pointe Park A Non-discriminatory, Bob and Betty Beyster Building Mark J. Bernstein, Ann Arbor Ron Weiser, Ann Arbor Affirmative Action Employer. Shauna Ryder Diggs, Grosse Pointe Katherine E. White, Ann Arbor © 2018 2260 Hayward Street Denise Ilitch, Bingham Farms Mark S. Schlissel (ex officio) Ann Arbor, MI 48109-2121 Andrea Fischer Newman, Ann Arbor 2 CONTENTS Research Briefs 5 Student News 68 TECH TRANSFER 35 Honors and Awards 80 Doctorates 85 Department News 39 Alumni News 88 Diversity 44 Alumni Spotlights 88 Outreach 47 Alumni Briefs 95 New Books 49 Alumni Events 96 New Courses 50 Faculty News 54 New Faculty 54 Faculty Honors, Awards, and Activities 57 CSE Advisory Board and ECE Council 97 Donor News 98 In Memorium 102 EECS Faculty 106 3 Message from thE Mingyan Liu, Chair Brian Noble, Chair ChairS Electrical and Computer Computer Science Engineering and Engineering Dear Friends, Change is in the air! And ideas so transformative they are being funded under a In the space of two years, our department has welcomed College of Engineering Blue Sky Initiative give the promise new leadership for both divisions. -

On Extended Quantum-Holographic Framework for Consciousness and Free Will: Round Trip from Science to Spirituality
DOI: 10.24946/IJPLS.20.19.00.00.181107 https://www.journalprenatalife.com TITLE: ON EXTENDED QUANTUM-HOLOGRAPHIC FRAMEWORK FOR CONSCIOUSNESS AND FREE WILL: ROUND TRIP FROM SCIENCE TO SPIRITUALITY Author: Dejan Raković1 Affiliations: Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade, Serbia Abstract. The subject of this papar is our extended quantum-informational theoretical framework for consciousness and free will. The presented framework might have significant epistemological-cognitive and psychosomatic-spiritual implications, providing better understanding of transpersonal origin of quantum- informational psychosomatic processes in integrative medicine and transpersonal psychology. The paper also provides two appendices: the first one reviews what a psychologist needs to know on our extended quantum- holographic / quantum-gravitational informatics, while the other one presents physical and informational extended glossary for more interested readers. Keywords: Extended Hopfield-like quantum-informational theoretical framework, consciousness, free will, integrative medicine, transpersonal psychology. 1. Introduction Consciousness has been the central theme of philosophical essays for a long time from the very beginning of philosophical thought, or traditional esoteric practices of the East and West which have reached significant level in control of altered states of consciousness with significant philosophical-religious implications. The first scientific attempts to enlighten the nature of consciousness appeared only in psychology -

Memorial Tributes: Volume 22 (2019)
THE NATIONAL ACADEMIES PRESS This PDF is available at http://nap.edu/25543 SHARE Memorial Tributes: Volume 22 (2019) DETAILS 396 pages | 6 x 9 | HARDBACK ISBN 978-0-309-49640-7 | DOI 10.17226/25543 CONTRIBUTORS GET THIS BOOK National Academy of Engineering FIND RELATED TITLES SUGGESTED CITATION National Academy of Engineering 2019. Memorial Tributes: Volume 22. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25543. Visit the National Academies Press at NAP.edu and login or register to get: – Access to free PDF downloads of thousands of scientific reports – 10% off the price of print titles – Email or social media notifications of new titles related to your interests – Special offers and discounts Distribution, posting, or copying of this PDF is strictly prohibited without written permission of the National Academies Press. (Request Permission) Unless otherwise indicated, all materials in this PDF are copyrighted by the National Academy of Sciences. Copyright © National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 22 Memorial Tributes NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 22 Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 22 NATIONAL ACADEMY OF ENGINEERING OF THE UNITED STATES OF AMERICA Memorial Tributes Volume 22 THE NATIONAL ACADEMIES PRESS WASHINGTON, DC 2019 Copyright National Academy of Sciences. All rights reserved. Memorial Tributes: Volume 22 International Standard Book Number-13: 978-0-309-49640-7 International Standard Book Number-10: 0-309-49640-3 Digital Object Identifier: https://doi.org/10.17226/25543 Additional copies of this publication are available from: The National Academies Press 500 Fifth Street NW, Keck 360 Washington, DC 20001 (800) 624-6242 or (202) 334-3313 www.nap.edu Copyright 2019 by the National Academy of Sciences. -

(2005) from White Elephant to Nobel Prize: Dennis Gabor's Wavefront
Johnston, S.F. (2005) From white elephant to Nobel Prize: Dennis Gabor’s wavefront reconstruction. Historical Studies in the Physical and Biological Sciences 36(1):pp. 35-70. http://eprints.gla.ac.uk/archive/2891/ Glasgow ePrints Service http://eprints.gla.ac.uk Historical Studies in the Physical and Biological Sciences (HSPS) 36 (2005), 35-70 From white elephant to Nobel Prize: Dennis Gabor’s wavefront reconstruction Sean F. Johnston* Abstract Dennis Gabor devised a new concept for optical imaging in 1947 that went by a variety of names over the following decade: holoscopy, wavefront reconstruction, interference microscopy, diffraction microscopy and Gaboroscopy. A well- connected and creative research engineer, Gabor worked actively to publicize and exploit his concept, but the scheme failed to capture the interest of many researchers. Gabor’s theory was repeatedly deemed unintuitive and baffling; the technique was appraised by his contemporaries to be of dubious practicality and, at best, constrained to a narrow branch of science. By the late 1950s, Gabor’s subject had been assessed by its handful of practitioners to be a white elephant. Nevertheless, the concept was later rehabilitated by the research of Emmett Leith and Juris Upatnieks at the University of Michigan, and Yury Denisyuk at the Vavilov Institute in Leningrad. What had been judged a failure was recast as a success: evaluations of Gabor’s work were transformed during the 1960s, when it was represented as the foundation on which to construct the new and distinctly different subject of holography, a re-evaluation that gained the Nobel Prize for Physics for Gabor alone in 1971. -
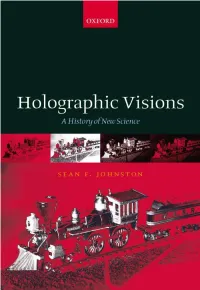
Holographic Visions.Pdf
HOLOGRAPHIC VISIONS This page intentionally left blank HOLOGRAPHIC VISIONS A History of New Science SEAN F. JOHNSTON University of Glasgow 1 3 Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP Oxford University Press is a department of the University of Oxford. It furthers the University’s objective of excellence in research, scholarship, and education by publishing worldwide in Oxford New York Auckland Cape Town Dar es Salaam Hong Kong Karachi Kuala Lumpur Madrid Melbourne Mexico City Nairobi New Delhi Shanghai Taipei Toronto With offices in Argentina Austria Brazil Chile Czech Republic France Greece Guatemala Hungary Italy Japan Poland Portugal Singapore South Korea Switzerland Thailand Turkey Ukraine Vietnam Oxford is a registered trade mark of Oxford University Press in the UK and in certain other countries Published in the United States by Oxford University Press Inc., New York © Sean Johnston 2006 The moral rights of the author have been asserted Database right Oxford University Press (maker) First published 2006 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, without the prior permission in writing of Oxford University Press, or as expressly permitted by law, or under terms agreed with the appropriate reprographics rights organization. Enquiries concerning reproduction outside the scope of the above should be sent to the Rights Department, Oxford University Press, at the address above You must not circulate this book in any other binding or cover and you must impose the same condition on any acquirer British Library Cataloguing in Publication Data Data available Library of Congress Cataloging in Publication Data Johnston, Sean, 1956– Holographic visions : a history of new science / Sean F. -

Table of Contents
Great Lives from History: Inventors and Inventions Table of Contents Publisher's Note Editor's Introduction Contributors Key to Pronunciation Complete List of Contents A `Abbas ibn Firnas Edward Goodrich Acheson George Biddell Airy George Edward Alcorn Ernst Alexanderson Luis W. Álvarez Marc Andreessen Archimedes Aristotle Sir Richard Arkwright Edwin H. Armstrong Arthur James Arnot John Vincent Atanasoff Hertha Marks Ayrton B Charles Babbage Roger Bacon Leo Hendrik Baekeland Alexander Bain Benjamin Banneker John Bardeen Patricia Bath Andrew Jackson Beard J. Georg Bednorz Semi Joseph Begun Georg von Békésy Alexander Graham Bell Carl Benz Friedrich Bergius Emile Berliner Tim Berners-Lee Clifford Berry Sir Henry Bessemer Edwin Binney Gerd Binnig Clarence Birdseye Katharine Burr Blodgett Marie Anne Victoire Boivin H. Cecil Booth Carl Bosch Walther Bothe Herbert Wayne Boyer Otis Boykin Willard S. Boyle Louis Braille Giovanni Branca Jacques Edwin Brandenberger Walter H. Brattain Karl Ferdinand Braun Wernher von Braun John Moses Browning William Bullock Robert Wilhelm Bunsen Luther Burbank William Seward Burroughs David Bushnell Nolan K. Bushnell C Cai Lun Robert Cailliau John Campbell Marvin Camras Chester F. Carlson Wallace Hume Carothers Willis Carrier George R. Carruthers Edmund Cartwright George Washington Carver George Cayley Vinton Gray Cerf Georges Claude Josephine Garis Cochran Sir Christopher Cockerell Stanley Norman Cohen Samuel Colt William Fothergill Cooke William David Coolidge Martin Cooper Peter Cooper Martha J. Coston Frederick Gardner Cottrell Jacques Cousteau Joshua Lionel Cowen Seymour Cray Bartolomeo Cristofori Sir William Crookes Caresse Crosby Ctesibius of Alexandria Nicolas-Joseph Cugnot Glenn H. Curtiss D Louis Jacques Daguerre Gottlieb Daimler Nils Gustaf Dalén Raymond Damadian Abraham Darby Sir Humphry Davy Mark Dean John Deere Lee De Forest Sir James Dewar Rudolf Diesel Walt Disney Carl Djerassi Herbert Henry Dow Charles Stark Draper Charles Richard Drew Richard G. -

2016 • 16–21 October 2016 1 Conference Schedule-At-A-Glance Note: Dates and Times Are Subject to Change
Table of Contents Schedule at a Glance ...................................... 2 Laser Science Symposium on Undergraduate Research ........ 16 FiO/LS Chairs’ Welcome Letters ............................. 3 Symposium on Mesoscopic Optics of Disordered Media . 17 A Tribute to Steve Jacobs ............................... 17 General Information ....................................... 5 Symposium on Mid-Infrared Fiber Sources .................. 17 Conference Services ................................... 5 Symposium on 100 Years of vision at OSA: Most Cited Papers First Aid and Emergency Information ...................... 6 in OSA Journals . 18 Sponsoring Society Booths .............................. 6 Symposium on Integrated Photonic Manufacturing ........... 18 Stay Connected Symposium on Integrated Quantum Optics ................. 18 Conference Materials . 9 Special Events . 19 FiO/LS Mobile App .................................... 9 Exhibition Information ..................................... 23 Conference Plenary Session and Awards Ceremony FiO/LS Committees . 25 Plenary Presentations . 11 APS Arthur L. Schawlow Prize and Lecture .................. 12 Explanation of Session Codes ............................... 26 Frederic Ives Medal /Jarus W. Quinn Prize Presentation FiO/LS Agenda of Sessions ................................. 27 and Lecture ........................................... 12 FiO/LS Abstracts . 36 OSA Awards and Honors FiO/LS Subject Index ..................................... 132 OSA and APS Awards and Special Recognitions . -

Dr. Emmett Leith
9/16/13 leith.html Colorado State University's Information Science and Technology Center (ISTeC) Presents Dr. Emmett Leith University of Michigan Department of Electrical Engineering and Computer Science (one of the first holographic images, April 1964) Tuesday, May 4, 2004 ISTeC Distinguished Lecture "Making the Invisible Visible with Holographic Information Processing" 2:30 p.m. Colorado State University Campus Lory Student Center, Room 230 Reception at 2:00 p.m. file:///D:/backup/ISTeC/ISTeC-old-site-engineering/activities/distinguished_lectures/leith.html 1/3 9/16/13 leith.html and Wednesday, May 5, 2004 Electrical and Computer Engineering Seminar "Holography, Synthetic Apertures, Optical Sectioning, and Photon Migration: Cross-Fertilizations" 9:30 a.m. Colorado State University Campus Lory Student Center, Room 228 Reception at 9:00 a.m. Lectures are free and open to the public ABSTRACTS "Making the Invisible Visible with Holographic Information Processing" X-rays (mammograms), ultrasound, CAT scans and other medical diagnostics extract information about disease in body tissue. Visible light has some attractive possibilities compared to these other techniques: it is potentially much less expensive, and unlike x-rays, is harmless. But the obstacle is that biological tissue is, for light, a highly scattering medium – in other words, tissue transmits light like shower glass so that you can’t see through it. To circumvent this problem and permit the viewing of objects in tissue, various techniques based on sophisticated information processing concepts, have been developed. These techniques allow the seemingly impossible to happen – ideally, rendering biological tissue that was once impossible to see through to be as transparent as window glass.