Gilles Tremblay
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Full Text (PDF)
Document generated on 09/27/2021 7:30 p.m. Circuit Musiques contemporaines Catalogue des oeuvres commandées par la smcq Solenn Hellégouarch Souvenirs du futur : pour les 50 ans de la smcq Volume 27, Number 2, 2017 URI: https://id.erudit.org/iderudit/1040877ar DOI: https://doi.org/10.7202/1040877ar See table of contents Publisher(s) Circuit, musiques contemporaines ISSN 1183-1693 (print) 1488-9692 (digital) Explore this journal Cite this document Hellégouarch, S. (2017). Catalogue des oeuvres commandées par la smcq. Circuit, 27(2), 53–66. https://doi.org/10.7202/1040877ar Tous droits réservés © Circuit, musiques contemporaines, 2017 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Catalogue des œuvres commandées par la smcq Solenn Hellégouarch Ce catalogue présente les œuvres commandées (ou co-commandées) par la Société de musique contemporaine du Québec (smcq) entre 1968 et 2017. Les œuvres sont classées par année de création, puis par date de création1. La 1. Dès lors, seules les œuvres créées présence d’un astérisque indique que la commande a reçu l’aide du Conseil ont été retenues dans le présent catalogue. des arts du Canada (cac). 1968 § *Gilles Tremblay, Souffles (Champs II) (1968), 2 flûtes (et piccolo), hautbois, clari- nette, cor, 2 trompettes en si bémol (et trompettes en do), 2 trombones, piano, 2 per- cussions et contrebasse. -

ATELIER DE JOHN REA, WALTER BOUDREAU ET VINCENT DODIER Salle AB
ATELIER DE JOHN REA, WALTER BOUDREAU ET VINCENT DODIER Salle AB: vendredi de 15h30 à 17h00 Diriger une œuvre contemporaine au secondaire : Danser avec la gravité de John Rea Un atelier incontournable qui offre aux participants un moment de partage d’expertise pratique quant à la direction d’une œuvre contemporaine au secondaire. Rassemblés pour l’occasion : le compositeur John Rea, l’Orchestre à vents Saint-Luc formé de 90 jeunes du secondaire et leur chef, Vincent Dodier, ainsi que le directeur artistique spécialisé en musique contemporaine, Walter Boudreau. Après une présentation de son œuvre Danser avec la gravité (2015) par le compositeur John Rea, les enseignants présents entendront l’œuvre interprétée par les jeunes de Saint-Luc. Suivra ensuite une période d’échange avec Vincent Dodier sur l’apprentissage et l’interprétation de l’œuvre en contexte scolaire et avec le chef Walter Boudreau qui partagera sa vision de la direction d’une œuvre contemporaine. L’atelier se terminera avec une interprétation participative pour les enseignants présents qui pourront jouer des extraits de l’œuvre avec les élèves. Danser avec la gravité est une commande du Centre de musique canadienne dans le cadre de la Série hommage au compositeur John Rea, produite par la Société de musique contemporaine du Québec. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ayant remporté de nombreuses récompenses prestigieuses durant sa carrière et très sollicité par divers organismes, le compositeur John Rea voit ses œuvres jouées au Canada, aux États-Unis et en Europe. Il illustre des genres très variés: musique de chambre instrumentale, théâtre musical, musique électroacoustique, musique de scène, œuvres pour grand ensemble et œuvres vocales. -

Sophie Stévance* Université Laval, Québec Faculty of Music
Article received on 25th May 2011 Article accepted on 12th April 2012 UDC: 78(714.1) 78.07 Мекрир П. Sophie Stévance* Université Laval, Québec Faculty of Music CONTEMPORARY MUSIC AT THE FRINGE: THE EXAMPLE OF “MUSIQUE ACTUELLE” IN CANADA Abstract: The International Week of Today’s Music (SIMA), organised in 1961 by Pierre Mercure within the framework of the Montreal Festivals, is a master event: beside the works of Serge Garant, Karlheinz Stockhausen or Iannis Xenakis, this event permitted to the experimental music of today to be heard as provocative and heterogeneous as it may be, in particular with Cage Atlas Eclipticalis’ creation or Richard Maxfield’s Piano Concert for David Tudor. Mercure challenged an American experimental aesthetic’s different from Europeans experimentations. The hypothesis of this paper is that what has been called “musique actuelle” since 1979 in Quebec, refers to Mercure’s artistic perspectives. How affiliated is musique actuelle to the SIMA? This paper seeks to answer this question by looking at the different uses of the expression of musique actuelle so as to bring to light the historical reasons, roots and fundaments of the expression since its first uses. The ac- tualist movement has in common with Mercure’s project more than a name: it carries and maybe focuses for the Mercure’s aesthetic and social policy by refusing certain zone sys- tem within cultural poles with creation methods such as free and collective improvisation. But beyond this project, it’s definitely of Mercure event’s tradition that actualists arose and built their identity field. * Author contact information: [email protected] 51 New Sound 38, II/2011 Keywords: Musique actuelle, actualism, Pierre Mercure, Productions SuperMusique, mu- sical identity, The International Week of Today’s Music Апстракт: Међународна недеља савремене музике (SIMA), коју је, у оквиру Монт- реалских фестивала, 1961. -

Les Mille Et Une Nuits Tales of the Arabian Nights
Alexander Shelley DIRECTEUR MUSICAL | MUSIC DIRECTOR Orchestre du CNA | NAC Orchestra SAISON 2017/18 SEASON John Storgårds Premier chef invité /Principal Guest Conductor Jack Everly Premier chef des concerts Pops /Principal Pops Conductor Alain Trudel Premier chef des concerts jeunesse et famille/Principal Youth and Family Conductor Pinchas Zukerman Chef d’orchestre émérite/Conductor Emeritus Les mille et une nuits Tales of the Arabian Nights February 20-21 février 2018 SALLE SOUTHAM HALL Alexander Shelley chef d’orchestre /conductor Alain Lefèvre piano Peter A. Herrndorf Président et chef de la direction / President and Chief Executive Officer DISCOVER A WORLD OF COMFORT. PREMIUM ECONOMY CLASS. Step inside this exclusive, quiet cabin and stretch out in a larger seat with more recline and extra legroom. Designed to enhance your travel experience, Premium Economy Class offers dining service you’ll love, an 11” personal touch TV, and a variety of airport priority services along the way – because our priority is your comfort. aircanada.com/premium-economy DÉCOUVREZ UN MONDE DE CONFORT. LA CLASSE ÉCONOMIQUE PRIVILÈGE. Entrez dans cette cabine intime et silencieuse et installez-vous dans un fauteuil plus large, offrant plus d’inclinaison et d’espace pour les jambes. Conçue pour améliorer votre expérience tout au long de votre voyage, la Classe Économique Privilège propose un service de repas raffi nés, un écran individuel à commande tactile de 11 po et des services prioritaires – parce que votre confort est notre priorité. aircanada.com/classe-economique-privilege NAC Development–Air Canada2017-GREY.indd 1 2017-09-07 2:41 PM Programme | Program RAVEL Pavane pour une infante défunte WALTER BOUDREAU Concerto de l’asile I. -
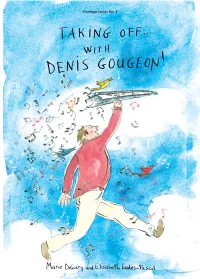
BD Gougeon Preview EN.Pdf
Commissioned by the Societé de musique contemporaine du Québec (SMCQ) as part of its Homage Series to composer Denis Gougeon. Taking off... with Denis Gougeon! Text: Marie Décary Illustrations: Élisabeth Eudes-Pascal Content assistant: Claire Cavanagh Coordination: Noémie Pascal and Claire Cavanagh Biography and chronology: Noémie Pascal Translation: Peggy Niloff Design: Studio atelier Printing: Quadriscan Homage Series/Denis Gougeon Artistic Director: Walter Boudreau General Manager: Aïda Aoun © Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) Legal submission, 2013 ISBN 978-2-9811517-4-2 Bibliothèque nationale du Québec Bibliothèque nationale du Canada 300, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal (Québec) H2X 3X6 Telephone: 514 843-9305 | Fax: 514 843-3167 smcq.qc.ca SMCQ would like to thank the following for their financial support: The notion of travel is fundamental to my music. Denis Gougeon, 2013 Note: words attributed to Denis Gougeon are based mostly on interviews or on his own writings. Biography Departure: Granby Flight Denis Gougeon is born in Granby (Quebec) In 1980, his studies completed, Denis in 1951, just a few steps away from the famous Gougeon accompanies Marie-Danielle Parent, zoo. His childhood is marked by animals, merry- now his wife, to New York, where she perfects her go-rounds and visitors from all over the world. talent. There he composes Voix intimes, for his Holidays are spent working in the amusement wife and her sister Yolande Parent. This work is park, on biking escapades to the aerodrome or on noted for its entirely personal meaning. Recipient train rides, thanks to his father being the station of first prize (Concours de la SOCAN), this opens master. -

GGPAA Gala Program 2015 English
NatioNal arts CeNtre, ottawa, May 30, 2015 The arts engage and inspire us A nation’s ovation. We didn’t invest a lifetime perfecting our craft. Or spend countless hours on the road between performances. But as a proud presenting sponsor of the Governor General’s Performing Arts Awards, we did put our energy into recognizing outstanding Canadian artists who enrich the fabric of our culture. When the energy you invest in life meets the energy we fuel it with, Arts Nation happens. ’ work a O r i Explore the laureates’’ work at iTunes.com/GGPAA The Governor General’s Performing Arts Awards The Governor General’s Performing Arts Recipients of the National arts Centre award , Awards are Canada’s most prestigious honour which recognizes work of an extraordinary in the performing arts. Created in 1992 by the nature in the previous performance year, are late Right Honourable Ramon John Hnatyshyn selected by a committee of senior programmer s (1934–2002), then Governor General of from the National Arts Centre (NAC). This Canada, and his wife Gerda, the Awards are Award comprises a commemorative medallion, the ultimate recognition from Canadians for a $25,000 cash prize provided by the NAC, and Canadians whose accomplishments have a commissioned work created by Canadian inspired and enriched the cultural life of ceramic artist Paula Murray. our country. All commemorative medallions are generously Laureates of the lifetime artistic achievement donated by the Royal Canadian Mint . award are selected from the fields of classical The Awards also feature a unique Mentorship music, dance, film, popular music, radio and Program designed to benefit a talented mid- television broadcasting, and theatre. -

Download the TSO Commissions History
Commissions Première Composer Title They do not shimmer like the dry grasses on the hills, or January 16, 2019 Emilie LeBel the leaves on the trees March 10, 2018 Gary Kulesha Double Concerto January 25, 2018 John Estacio Trumpet Concerto [co-commission] In Excelsis Gloria (After the Huron Carol): Sesquie for December 12, 2017 John McPherson Canada’s 150th [co-commmission] The Talk of the Town: Sesquie for Canada’s 150th December 6, 2017 Andrew Ager [co-commission] December 5, 2017 Laura Pettigrew Dòchas: Sesquie for Canada’s 150th [co-commission] November 25, 2017 Abigail Richardson-Schulte Sesquie for Canada’s 150th (interim title) [co-commission] Just Keep Paddling: Sesquie for Canada’s 150th November 23, 2017 Tobin Stokes [co-commission] November 11, 2017 Jordan Pal Sesquie for Canada’s 150th (interim title) [co-commission] November 9, 2017 Julien Bilodeau Sesquie for Canada’s 150th (interim title) [co-commission] November 3, 2017 Daniel Janke Small Song: Sesquie for Canada’s 150th [co-commission] October 21, 2017 Nicolas Gilbert UP!: Sesquie for Canada’s 150th [co-commission] Howard Shore/text by October 19, 2017 New Work for Mezzo-soprano and Orchestra Elizabeth Cottnoir October 19, 2017 John Abram Start: Sesquie for Canada’s 150th [co-commission] October 7, 2017 Eliot Britton Adizokan October 7, 2017 Carmen Braden Blood Echo: Sesquie for Canada’s 150th [co-commission] October 3, 2017 Darren Fung Toboggan!: Sesquie for Canada’s 150th [co-commission] Buzzer Beater: Sesquie for Canada’s 150th September 28, 2017 Jared Miller [co-commission] -

Jules Léger Prize | Prix Jules-Léger
Jules Léger Prize | Prix Jules-Léger Year/Année Laureates/Lauréats 2020 Kelly-Marie Murphy (Ottawa, ON) Coffee Will be Served in the Living Room (2018) 2019 Alec Hall (New York, NY) Vertigo (2018) 2018 Brian Current (Toronto, ON) Shout, Sisyphus, Flock 2017 Gabriel Turgeon-Dharmoo (Montréal, QC) Wanmansho 2016 Cassandra Miller (Victoria, BC) About Bach 2015 2015 Pierre Tremblay (Huddersfield, UK) Les pâleurs de la lune (2013-14) 2014 Thierry Tidrow (Ottawa, ON) Au fond du Cloître humide 2013 Nicole Lizée (Lachine, QC) White Label Experiment 2012 Zosha Di Castri (New York, NY) Cortège 2011 Cassandra Miller (Montréal, QC) Bel Canto 2010 Justin Christensen (Langley, BC) The Failures of Marsyas 2009 Jimmie LeBlanc (Brossard, QC) L’Espace intérieur du monde 2008 Analia Llugdar (Montréal, QC) Que sommes-nous 2007 Chris Paul Harman (Montréal, QC) Postludio a rovescio 2006 James Rolfe (Toronto, ON) raW 2005 Linda Catlin Smith (Toronto, ON) Garland 2004 Patrick Saint-Denis (Charlebourg, QC) Les dits de Victoire 2003 Éric Morin (Québec, QC) D’un château l’autre 2002 Yannick Plamondon, (Québec, QC) Autoportrait sur Times Square 2001 Chris Paul Harman (Toronto, ON) Amerika Canada Council for the Arts | Conseil des arts du Canada 1-800-263-5588 | canadacouncil.ca | conseildesarts.ca 2000 André Ristic (Montréal, QC) Catalogue 1 (bombes occidentales) 1999 Alexina Louie (Toronto, ON) Nightfall 1998 Michael Oesterle (Montréal, QC) Reprise 1997 Omar Daniel (Toronto, ON) Zwei Lieder nach Rilke 1996 Christos Hatzis (Toronto, ON) Erotikos Logos 1995 John Burke (Toronto, ON) String Quartet 1994 Peter Paul Koprowski (London, ON) Woodwind Quintet 1993 Bruce Mather (Montréal, QC) YQUEM 1992 John Rea (Outremont, QC) Objets perdus 1991 Donald Steven (Montréal, QC) In the Land of Pure Delight 1989 Peter Paul Koprowski (London, ON) Sonnet for Laura 1988 Michael Colgrass (Toronto, ON) Strangers: Irreconcilable Variations for Clarinet, Viola and Piano 1987 Denys Bouliane (Montréal, QC) À propos.. -

At a Glance 2016
At a glance 2016 At a Glance 2016 16308 (04-17) Service des communications, Ville de Montréal de Montréal Ville 16308 (04-17) Service des communications, Denis Coderre Mayor of Montréal Alexandre Taillefer Managing Partner, XPND Capital and President of the Steering Committee Luc Fortin Minister of Culture and Communications, Minister responsible for the Protection and Promotion of the French Language Manon Gauthier Member of the Montréal Executive Committee, responsible for Culture, Heritage, Design, Space for Life and the Status of Women Diane Giard Executive Vice-President, Personal and Commercial Banking, National Bank of Canada Michel Leblanc President and CEO of the Chamber of Commerce of Metropolitan Montreal 4 Artistic, cultural, digital, technological: for her 375th anniversary, Montréal is determined to display her colours proudly. A vector of social identity and cohesion, culture displays and asserts itself as one of the pillars of development for our city, through an abundance of projects and accomplishments, each more fascinating than the last, showcased in this edition of At a Glance 2016, Montréal, Cultural Metropolis. By remembering remarkable stories of history and heritage, new technologies, literature, film and Montréal, Liza Frulla live arts, Montréal stands as an open book on the President, a metropolis Culture Montréal world, whose colourful images convey its relentless that beats to pursuit of excellence. A metropolis that beats to the the energy of energy of its artists, visionaries and entrepreneurs its artists. heartily striving to make it live and grow. In this anniversary year, Montréal is experiencing an extraordinary effervescence. Here we present a sample of majestic and spectacular projects that will enliven, embellish, enchant and transform the city. -
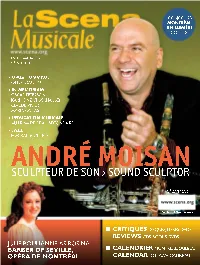
Version Imprimée / Printed ) W [ H 51 Jazz + ISSN 1206-9973 Version Internet ^ Z J I
sm13-5_Cover_NoUPC.qxd 1/30/08 10:17 AM Page 1 www.scena.org sm13-5_pxx_layoutwkc-Ads.qxd 1/27/08 7:16 PM Page 2 sm13-5_pxx_layoutwkc-Ads_2.qxd 1/30/08 10:14 AM Page 3 sm13-5_pxx_layoutwkc-Ads.qxd 1/29/08 11:39 PM Page 4 2008 www.music.mcgill.ca/musimars Lundi 3 mars au vendredi 7 mars 2008 Monday, March 3 to Friday, March 7, 2008 Ensembles Cappella Antica, Valerie Kinslow, directrice Cappella McGill, Peter Schubert, directeur Chanteurs d’Orphée, Peter Schubert, directeur Corno di Caccia Ensemble, Denys Derome, répétiteur McGill CME (Contemporary Music Ensemble), Denys Bouliane, directeur McGill DCS (Digital Composition Studio), Sean Ferguson, directeur McGill Percussion Ensemble, Aiyun Huang, Fabrice Marandola, directeurs McGill Wind Symphony, Alain Cazes, directeur Schulich String Quartet, André Roy, répétiteur Ucello, Matt Haimovitz, répétiteur Collaboration spéciale Société de musique contemporaine du Québec, Walter Boudreau, directeur artistique Solistes Mira Benjamin, violon Rogers Covey-Crumb, ténor (Hilliard Ensemble, Londres) Denys Derome, cor (Orchestre symphonique de Montréal) Dom Richard Gagné, chantre (directeur du Chœur de l’Abbaye de St-Benoît du Lac Memory of et ancien directeur du Chœur de l'Abbaye de Solesmes) Matt Haimovitz, Chloé Dominguez, violoncelles Ages Quenched: Kyoko Hashimoto, Sara Laimon, Julia den Boer, pianos (The Book of Days) Aiyun Huang, Fabrice Marandola, percussion Hank Knox, clavecin Shawn Mativetsky, tabla - Julie Lebel, harmonium Ingrid Schmithüsen, Iris Luypaers, sopranos La Mémoire Erika Donald, -

CV Academic Update June 2019
CHRIS PAUL HARMAN Department of Music Research, Schulich School of Music, McGill University 555 Sherbrooke Street West, Montreal, QC, H3A 1E3 CANADA Phone (office): (514) 398-5540 [email protected] EDUCATION University of Birmingham (UK) Ph.D. Composition, 2012 Portfolio of compositions and dissertation: “Studies in Instrumentation and Orchestration and in the Recontextualization of Diatonic Pitch Materials.” Advisor: Vic Hoyland. PROFESSION Associate Professor of Composition, Schulich School of Music, McGill University (2014-present) Assistant Professor of Composition, Schulich School of Music, McGill University (2005-2014) Autonomous Composer (1990-2005) RESEARCH Awards: 2017 Fellowship: Civitella Ranieri Foundation, Umbertide, Italy. 2007 Jules Léger Prize for New Chamber Music, Canada, for Postludio a rovescio. 2002 Prix de Composition Musicale de la Fondation Prince Pierre de Monaco shortlist, for Amerika. 2001 Jules Légér Prize for new chamber music, for Amerika. Honorary Mention, Gaudeamus International Music Week, Amsterdam, for Uta. 1999 Juno Award nomination, CARAS (Canadian Academy of Recording Arts and Sciences), Best Classical Composition, for Sonata for Viola and Piano. 1995 Juno Award nomination, Best Classical Composition, for Iridescence. 1994 Recommended Work, General Category, International Rostrum of Composers, Paris, for Concerto for Oboe and Strings. 1991 Selected Work, under-30 Category, International Rostrum of Composers, for Iridescence. 1990 Grand Prize, CBC Radio National Competition for Young Composers, for Iridescence. 1986 Finalist, CBC Radio National Competition for Young Composers, for Overture for String Orchestra. Works (selected): 2019 New work (two cellos) ca. 10 min. Partita No. 2 for Solo Violin - 10 min. 2018 White Lines (violin and piano) 14 min. ...with silver bells and cockle shells.. -

La Création Musicale À Montréal De 1966 À 2006 Vue Par Ses Institutions
Collection dirigée par Sophie Stévance La collection Recherches en musique souhaite rassembler la diversité de la recherche en musique – nous sommes tous et toutes des chercheurs ayant comme objet d’étude la musique, quelles que soient les disciplines et les approches adoptées pour mieux la comprendre : musicologie, pédagogie musicale, éducation musicale, histoire de la musique, ethnomusicologie, sociologie de la musique, philosophie de la musique, psychologie, etc. Comité scientifique Serge Lacasse, Francis Dubé, Jean-Philippe Desprès, Ariane Couture, Nicolas Darbon, Valerie Peters, Paul-André Dubois, Monique Desroches Titre paru : Stévance, Sophie (dir.), Serge Lacasse (dir.), Martin Desjardins (dir.), Pour une éthique partagée de la recherche-création en milieu universitaire, 2018. La création musicale à Montréal de 1966 à 2006 vue par ses institutions III La création musicale à Montréal de 1966 à 2006 vue par ses institutions ARIANE COUTURE Nous remercions le Conseil des arts du Canada de son soutien. We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts. Les Presses de l’Université Laval reçoivent chaque année du Conseil des Arts du Canada et de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec une aide financière pour l’ensemble de leur programme de publication. Illustration de couverture : Odile Côté-Rousseau, Désir, 2016, acrylique sur toile, 30 × 40 pouces, Québec, https://www.odile-rousseau-artiste.com/ Maquette de couverture : Laurie Patry Mise en pages : Danielle Motard ISBN papier : 978-2-7637-4656-2 ISBN pdf : 9782763746579 © Les Presses de l’Université Laval Tous droits réservés. Imprimé au Canada Dépôt légal 4e trimestre 2019 Les Presses de l’Université Laval www.pulaval.com Toute reproduction ou diffusion en tout ou en partie de ce livre par quelque moyen que ce soit est interdite sans l’autorisation écrite des Presses de l’Université Laval.