Mémoires 2009
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Journée Du Patrimoine - Samedi 21 Septembre 2013 Préfecture Du Gard Contenu Du Dossier
- Journée du patrimoine - Samedi 21 septembre 2013 Préfecture du Gard Contenu du dossier Présentation de l’institution préfectorale Fiches sur l’hôtel de la préfecture du Gard CV de M. le Préfet Biographie d’Yves Brayer Bilan 2012 de l’État dans le Gard Revue « Civique », L'Intérieur dans ses murs Hors-série spécial Journées européennes du patrimoine, septembre 2013 Présentation de l’institution préfectorale Les préfets dans l’Histoire de l’Antiquité à nos jours • Le mot préfet vient du latin Praefectus qui signifie « placé en tête ». Il désigne l’homme qui est à la tête d’une organisation. • Dans l’Antiquité, le mot préfet désignait surtout un chef militaire. • Après la chute de l’Empire romain, les rois francs sentent la nécessité d’avoir des représentants du pouvoir en province : les comtes. • Sous la dynastie capétienne (987-1328), les représentants du Roi sont les baillis au Nord et les sénéchaux au Sud. Ils disposent de pouvoirs très larges. • A la Renaissance, les représentants du pouvoir royal dans les provinces françaises sont les intendants. • En 1790, après la Révolution française, les intendants disparaissent. Un décret de 1790 crée les départements. La représentation du pouvoir central est confiée à une assemblée locale élue dans chaque département. • Napoléon Bonaparte institue, par la loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800), un préfet dans chaque département. Les grandes dates de la fonction Objectif : assurer l’efficacité des politiques gouvernementales Principe de déconcentration : « On peut gouverner de loin, on administre bien que de près » • 1790 : création des départements; • 1800 : création des préfets (un préfet par département et un sous-préfet par arrondissement); • 1926 : suppression de 100 sous-préfectures dont celle d’Uzès; • 1982 : première loi de décentralisation (le préfet n’est plus l’exécutif du conseil général); • 1992 : loi administration territoriale de la République, charte de la déconcentration. -

Arc Chi Ives S P Poin Nss
Département de la Département des Études et Bibliothèque et de la de la Recherche Documention - - Programme Service du Patrimoine « Histoire de Inventaire des Archives l’archéologie française en Afrique du Nord » ARCHIVES POINSSOT (Archives 106) Inventaire au 15 février 2014 - mis à jour le 16/11/2016 (provisoire) FONDS POINSSOT (Archives 106) Dates extrêmes : 1875-2002 Importance matérielle : 206 cartons, 22 mètres-linéaires Lieu de conservation : Bibliothèque de l’INHA (Paris) Producteurs : Julien Poinssot (1844-1900), Louis Poinssot (1879-1967), Claude Poinssot (1928-2002) ; Paul Gauckler (1866-1911), Alfred Merlin (1876-1965), Gabriel Puaux (1883-1970), Bernard Roy (1846-1919). Modalités d'entrée : Achat auprès de Mme Claude Poinssot (2005) Conditions d'accès et d’utilisation : La consultation de ces documents est soumise à l'autorisation de la Bibliothèque de l’INHA. Elle s’effectue sur rendez-vous auprès du service Patrimoine : [email protected]. La reproduction et la diffusion de pièces issues du fonds sont soumises à l’autorisation de l’ayant-droit. Instrument de recherche associé : Base AGORHA (INHA) Présentatin du contenu : Le fonds comprend les papiers de Julien Poinssot (1844-1900), de Louis Poinssot (1879-1967) et de Claude Poinssot (1928- 2002), et couvre une période de plus de 100 ans, des années 1860 au début des années 2000. Il contient des papiers personnels de Julien et Louis Poinssot, les archives provenant des activités professionnelles de Louis et Claude Poinssot, et les archives provenant des travaux de recherche de ces trois chercheurs. Le fonds comprend également les papiers d’autres archéologues et épigraphistes qui ont marqué l'histoire de l'archéologie de l'Afrique du Nord, Paul Gauckler (1866-1911), Bernard Roy (1846-1919) et Alfred Merlin (1876-1965). -
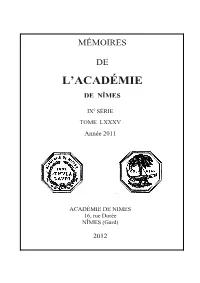
Mémoires 2011
MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE DE NÎMES IXe SÉRIE TOME LXXXV Année 2011 . ACADÉMIE DE NIMES 16, rue Dorée NÎMES (Gard) 2012 TABLE DES MATIÈRES I – SÉANCE PUBLIQUE DU 6 FÉVRIER 2011 BOUSIGES Hugues, préfet du Gard Allocution ..........................................................................................7 CLARY Alain Allocution ........................................................................................15 FOURNIER Jean-Paul Allocution ........................................................................................19 ROGER Jean-Marc, président sortant Compte rendu des travaux académiques de l’année 2010 ..............25 DERONNE Hélène L’artiste, un témoin de son temps....................................................31 PRADEL Yvon Prix Issoire 2011..............................................................................47 II – COMMUNICATIONS DE L’ANNÉE 2011 MATOUK Jean La guerre des monnaies ...................................................................49 PENCHINAT Alain Petite théorie de l’argent .................................................................67 PUECH Charles Les camps de Jalès ..........................................................................85 DERONNE Hélène, Sabine TEULON -LARDIC , Jean-Louis MEUNIER Les esthétiques de la fête au XIX e siècle à travers littérature,.. peinture et architecture, musique.................................................................103 SOURIOU Daniel La main..........................................................................................125 -
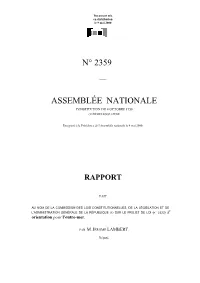
Rapport Lambert
Document mis en distribution le 9 mai 2000 N° 2359 —— ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 ONZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 4 mai 2000. RAPPORT FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE (1) SUR LE PROJET DE LOI (n° 2322) d’ orientation pour l’outre-mer, PAR M. JÉRÔME LAMBERT, Député. —— (1) La composition de cette commission figure au verso de la présente page. Outre-mer. La commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République est composée de : M. Bernard Roman, président ; M. Pierre Albertini, Mme Nicole Feidt, M. Gérard Gouzes, vice-présidents ; MM. Richard Cazenave, André Gerin, Arnaud Montebourg, secrétaires ; MM. Léo Andy, Léon Bertrand, Jean-Pierre Blazy, Emile Blessig, Jean-Louis Borloo, Patrick Braouezec, Mme Frédérique Bredin, MM. Jacques Brunhes, Michel Buillard, Dominique Bussereau, Christophe Caresche, Mme Nicole Catala, MM. Jean-Yves Caullet, Philippe Chaulet, Olivier de Chazeaux, Pascal Clément, Jean Codognès, François Colcombet, François Cuillandre, Henri Cuq, Jacky Darne, Camille Darsières, Jean-Claude Decagny, Bernard Derosier, Franck Dhersin, Marc Dolez, Renaud Donnedieu de Vabres, René Dosière, Renaud Dutreil, Jean Espilondo, Jacques Floch, Claude Goasguen, Louis Guédon, Mme Cécile Helle, MM. Elie Hoarau, Philippe Houillon, Michel Hunault, Henry Jean-Baptiste, Jérôme Lambert, Mmes Christine Lazerges, Claudine Ledoux, MM. Jean-Antoine Léonetti, Bruno Le Roux, Mme Raymonde Le Texier, MM. Jacques Limouzy, Noël Mamère, Thierry Mariani, Roger Meï, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Ernest Moutoussamy, Mme Véronique Neiertz, MM. Robert Pandraud, Christian Paul, Vincent Peillon, Dominique Perben, Henri Plagnol, Didier Quentin, Jean-Pierre Soisson, Frantz Taittinger, Jean Tiberi, Alain Tourret, André Vallini, Alain Vidalies, Jean-Luc Warsmann. -

Répertoire Des Thèses Soutenues En 2008-2009
UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE (PARIS IV) SERVICE DES DOCTORATS RÉPERTOIRE DES THÈSES SOUTENUES ANNÉE 2008-2009 1 RERERECUEILRE CUEIL DES SOUTENANCES DE DOCTORAT Pages Ecole doctorale I - MONDES ANTIQUES ET MEDIEVAUX Etudes grecques 1 Etudes latines 6 Etudes médiévales 19 Histoire du christianisme ancien et civilisation 29 Histoire et civilisation de l'antiquité 32 Hisoire de la philosophie 42 Histoire des religions et anthropologie religieuse 43 Langue française 48 Philosophie 49 Sciences sociales et philosophie de la connaissance 51 Egyptologie 53 HISTOIRE MODERNE ET Ecole doctorale II - CONTEMPORAINE Histoire moderne et contemporaine 57 Histoire des relations internationales et de l'Europe 83 Etudes arabes, civilisations islamiques et orientales 85 LITTERATURES FRANCAISES ET Ecole doctorale III- COMPAREE Littérature comparée 88 Littérature et civilisation françaises 104 Etudes portugaises, brésiliennes et de l'Afrique 87 CIVILISATIONS, CULTURES, Ecole doctorale IV - LITTERATURES ET SOCIETES Etudes romanes (Espagnol) 140 Etudes romanes (Italien) 146 Etudes slaves 150 Etudes anglophones 152 Etudes germaniques 168 2 Ecole doctorale V - CONCEPTS ET LANGAGES Histoire de la musique et musicologie 171 Musique et musicologie 182 Histoire de la philosophie 186 Langue française 197 Linguistique 203 Mathématiques, informatique et applications 206 Philosophie 216 Sciences de l'information et de la communication 226 Sciences sociales et philosophie de la connaissance 231 HISTOIRE DE L'ART ET Ecole doctorale VI - ARCHEOLOGIE Histoire de l'art 234 Théorie -

Guerrilleros Nº
Santa Cruz de Moya Día del Guerrill ero Borredon Guardaremos la estación Voir en page 6 l’avancement de la souscription 4 octobre 2009 : un millier de personnes devant le monument aux Guérilleros, à Santa Cruz de Moya (entre Teruel et Cuenca) . Au sommaire aussi Voir compte-rendu en pages 4 et 5 . En noir : Carmen Negrín, Page 2 Castelnau-Durban Page 7 Manolo Valiente petite- fille de Juan Negrín. Tenant le drapeau de l’Amicale des Page 3 La Résistance catalane Pages 8-9 Disparitions : Pyrénées Orientales : Pepita León, vice- présidente nationale de Page 4 La Résistance cévenole Ricardo Samitier l’Amicale. A gauche : Raymond San Geroteo, du conseil national Page 5 Scientifique et populaire Vincenzo Tonelli de l’Amicale, fondateur du premier MER. Tout à droite : Michel Page 6 Expresar mejor lo esencial Domenec Serra Sans, dont le père et le grand-père furent des diri geants des Page 7 De Toulouse à Mauthausen Page 10 Dommage ! cenetistas de la UNE puis des cadres de l’Amicale. Photo : CF Les olvidados du Train Fantôme Rapatriements forcés vers l’Espagne 65 ans après, un t rou de mémoire à combler : voir page 8 Une réalité trop longtemps méconnue : voir page 1 2 Cornellà de Llobregat EXILI REPUBLICÀ DEL 39 nya , sous la présidence de Julio Jiménez, président de la Fédé- ration d’Associations de Voisins du Baix Llobregat, sont interve- nus : Anna Miñarro, psychologue-psychanalyste sur le thème : Traumas de la guerra y de la dictadura , Narcis Falguera prési dent de notre Amicale, Josefina Piquet niña de la guerra , ex coordinatrice de Las Dones del 36 , Conchita del Bosque niña de la guerra , présidente du Club de Langues et Cultures Espagno les de Ramonville, Antonio Balmón maire de Cornellà de Llobre gat. -

Lettre 129 Re?Dige?E:Mise En Page 1
N° 129 La lettre du TROMBINOSCOPEL’actualité des hommes et des femmes au pouvoir Sommaire de la lettre mensuelle du 6 juillet 2009 Présidence de la République . p. 2 Frédéric Nora Berra, Mitterrand, nommée nouveau ministre secrétaire d'État de la Culture et de aux Aînés la Communication Page 6 Gouvernement . p. 3 Page 8 Assemblée nationale . p. 19 Michel Mercier Marie-Luce devient ministre Penchard, de l’Espace rural et nommée secrétaire de l’Aménagement d’État à du territoire l’Outre-mer Page 12 Sénat . p. 20 Page 16 Conseils généraux . p. 20 André Gerin Geneviève préside la mission Blanc, d’information sur la élue conseiller burqa lancée par l’AN général du Gard Page 19 Préfecture de police . p. 23 Page 20 Préfectures de régions . p. 23 Pierre Bayle Pascal Lelarge, devient préfet nouveau préfet de l’Aisne de l’Yonne Page 24 Préfectures de départements . p. 24 Page 30 Partis politiques . p. 31 Jean Bernard Delpit, Arthuis, nommé directeur élu président du général délégué, nouveau parti directeur financier Alliance centriste de La Poste Page 31 Autres mouvements . p. 31 Page 32 PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE Présidence de la République Jacques TOUBON • Il devra « préparer et assurer la mise en œuvre d’une initiative 2010-Année de l’Afrique » à l’occasion du est chargé de préparer « 2010- 50ème anniversaire de l’indépendance de 14 ex-colonies françaises. Il s’attachera à : « l’achèvement Année de l’Afrique » auprès de de la réforme des principaux instruments de notre relation tant sur le plan économique que politique », à la Nicolas Sarkozy. -

Mémoires-2019.Pdf
MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE DE NÎMES IXe SÉRIE TOME XCIII Année 2019 ACADÉMIE DE NÎMES 16, rue Dorée NÎMES (Gard) 2020 TABLE DES MATIÈRES I – SÉANCE PUBLIQUE DU 3 FÉVRIER 2019 Didier Lauga, préfet du Gard Allocution ................................................................................ 7 Daniel-Jean Valade, au nom de M. Jean-Paul Fournier, sénateur-maire de Nîmes Allocution .............................................................................. 15 Bernard Simon, président sortant Compte rendu des travaux académiques de l’année 2018 ..... 19 Simone Mazauric, président de l’académie Histoires d’Académies ........................................................... 27 Véronique Blanc-Bijon, correspondant À propos de mosaïques de Léda, rencontre entre Nîmes et Arles ................................................................................... 39 II – COMMUNICATIONS DE L’ANNÉE 2019 Jean-Marie Mercier, correspondant Un peintre chez les félibres ou l’adoration d’Auguste Chabaud pour le “Mage de la Provence” .............................................. 69 Michel Belin, vice-président Marcel et Jeanne Encontre, un couple de résistants pendant la guerre 39-45 ......................................................................... 107 Alain Girard, membre non résidant Enfants exposés à Pont-Saint-Esprit .................................... 125 Christian Feller, correspondant Merci M. Darwin (signé Lumbricus terrestris) .................... 143 Claire Torreilles, correspondant Le Vert Paradis de Max Rouquette. Une vie d’écriture -

L'académie Des Sciences Morales Et Politiques
MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE DE NÎMES IXe SÉRIE TOME LXXXX Année 2016 ACADÉMIE DE NIMES 16, rue Dorée NÎMES (Gard) 2017 L’Académie des Sciences, Arts et Lettres de Nîmes n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises au cours de ses séances et dans ses publications. Ces opinions devront être considérées comme propres à leurs auteurs. ISSN 0755-8864 © Académie de Nîmes – 2017 Pour le compte de l’Académie de Nîmes 16, rue Dorée - 30000 Nîmes Ouvrage publié avec l’aide de la ville de Nîmes et du Conseil Général du Gard Dépot Légal : 3e trimestre 2017 le gérant de la publication : Alain AVENTURIER Secrétaire Perpétuel 376 MÉMOIRES DE L’ACADÉMIE DE NÎMES TABLE DES MATIÈRES I – SÉANCE PUBLIQUE DU 7 FÉVRIER 2016 Didier Lauga, préfet du Gard Allocution ....................................................................................7 Jean-Paul Fournier, sénateur du Gard, maire de Nîmes Allocution ..................................................................................13 Jean-Louis Meunier, président sortant Compte rendu des travaux académiques de l’année 2015 .........19 Bernard Fougères, président de l’Académie Des pierres et des hommes ! ......................................................33 Paule Plouvier, membre non résidant Pierre vive : Paule Pascal, une femme sculpteur dans la cité ...41 II – COMMUNICATIONS DE L’ANNÉE 2016 Robert Chalavet, membre non résidant Le noble jeu de mail ..................................................................57 Gabriel Audisio, membre résidant Les cordonniers et leurs -

Recueil Des Actes Administratifs
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ANNÉE : 2005 DIFFUSÉ LE MOIS : novembre 13 décembre 2005 Préfecture de la Lozère – 2 rue de la Rovère – 48005 MENDE Cedex Téléphone : 04.66.49.60.00. – Télécopie : 04.66.49.17.23. – Site Internet :www.lozere.préf.gouv.fr 1 RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS ET DES INFORMATIONS DE LA PRÉFECTURE DE LA LOZÈRE SOMMAIRE BUREAU DU CABINET..........................................................................................................................................1 - Arrêté n° 05-1548 en date du 30 août 2005 portant agrément de M. Yannick CLAUZIER, garde- chasse..............................................................................................................................................................2 - Arrêté n° 05-1549 en date du 30 août 2005 portant agrément de M. Jean-Marc DAUNIS, garde- chasse..............................................................................................................................................................4 - Arrêté n° 05-1550 en date du 30 août 2005 portant renouvellement d'agrément de M. Michel BARRES, garde-chasse ..................................................................................................................................6 - Arrêté n° 05-1551 en date du 30 août 2005 portant renouvellement d'agrément de M. Paul BUFFIERE, garde-chasse...............................................................................................................................8 - Arrêté n° 05-1668 en date du 16 septembre 2005 portant -
Évaluation Des Dispositions Visant À L'information Préventive Des Citoyens Vis-À-Vis Des Risques Naturels Auxquels Ils Peuvent Être Exposés
MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L'AGROALIMENTAIRE ET DE L'ÉNERGIE ET DE LA FORÊT Conseil général de l'environnement Conseil général de l'alimentation, et du développement durable de l'agriculture et des espaces ruraux CGEDD n° 008684-01 CGAAER n° 12153 Évaluation des dispositions visant à l'information préventive des citoyens vis-à-vis des risques naturels auxquels ils peuvent être exposés établi par Nadine Bellurot, inspectrIce générale de l'administration du développement durable Jean Chapelon, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Xavier Meignien, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts Christian de Joannis de Verclos, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts coordonnateur Décembre 2013 Sommaire Résumé ....................................................................................................................4 Liste des recommandations (par ordre d'apparition dans le texte du rapport) 7 Introduction ...........................................................................................................10 1. La présentation de la mission et la méthodologie mise en œuvre...............12 1.1. Le contexte en termes d’impact et d’efficacité..........................................................12 1.2. Le contexte législatif et réglementaire......................................................................13 1.3. La commande...........................................................................................................14 1.3.1. -

Mise En Page 1
Sommaire Avertissement : cette publication reprend l’ensemble des interventions de la journée, mais pas les pro - pos mot à mot des intervenants. w Introduction P.03 w Objectifs initiaux, bilan et enseignements P.05 tirés des PAPI > Trois bilans différents P.05 > Les enjeux financiers des PAPI P.06 > Le bilan quantitatif P.07 w Table ronde : P.12 Bilan, échanges et témoignages sur les PAPI : partage du diagnostic > Les éléments et chiffres clés P.12 > Les freins et faiblesses des PAPI P.17 > Echanges avec la salle P.19 > Le contexte du lancement d’autres PAPI P.21 > Les difficultés rencontrées par les PAPI P.25 > Echanges avec la salle P.26 > Synthèse de la table ronde P.28 w Le contexte et les enjeux de la directive inondations P.30 w Les objectifs du nouveau dispositif P.33 w Table ronde : P.35 Les conditions de réussite du nouveau dispositif > La cohérence entre prévention, urbanisme, aménagement, P.35 gestion des milieux et développement économique > Les leviers et facteurs clés de la réussite : l’organisation d’un dispositif P.39 > Nîmes : une analyse coûts-bénéfices aboutie P.41 > Renforcement des structures porteuses P.43 > Amendement et financement des EPTB P.44 > La vision des élus P.45 > Echanges avec la salle P.46 > Synthèse de la table ronde P.48 w Quelles visions du nouveau dispositif ? P.50 > Bilan sur les PAPI P.50 > Les nouveaux enjeux des PAPI P.51 w Conclusion de la journée par Chantal Jouanno P.53 w Sigles P.57 2 Introduction En France, un tiers des communes est exposé aux risques d’inondations.