Le Libellio D' AEGIS
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

THE THREE MUSKETEERS by Alexandre Dumas
THE THREE MUSKETEERS by Alexandre Dumas THE AUTHOR Alexandre Dumas (1802-1870) was born in a small French village northeast of Paris. His father had been a general under Napoleon, and his paternal grandfather had lived in Haiti and had married a former slave woman there, thus making Dumas what was called a quadroon. Napoleon and his father had parted on bad terms, with Dumas’ father being owed a large sum of money; the failure to pay this debt left the family poor and struggling, though the younger Dumas remained an admirer of the French emperor. Young Dumas moved to Paris in 1823 and took a job as a clerk to the Duke of Orleans (later to become King Louis Philippe), but soon began writing plays. Though his plays were successful and he made quite a handsome living from them, his profligate lifestyle (both financially and sexually) kept him constantly on the edge of bankruptcy. He played an active role in the revolution of 1830, and then turned to writing novels. As was the case with Dickens in England, his books were published in cheap newspapers in serial form. Dumas proved able to crank out popular stories at an amazing rate, and soon became the most famous writer in France. Among his works are The Three Musketeers (1844), The Count of Monte Cristo (1845), and The Man in the Iron Mask (1850). Dumas’ novels tend to be long and full of flowery description (some cynics suggest that this is because he was paid by the word), and for this reason often appear today in the form of abridged translations (if you ever doubt the value of such an approach, take a look at the unabridged version of Victor Hugo’s Les Miserables sometime). -

The Three Musketeers an Adaptation by Jackie Mellor
THE THREE MUSKETEERS AN ADAPTATION BY JACKIE MELLOR GUIN THEATRE BRITAIN©2017 1 CHARACTERS (IN ORDER OF APPEARANCE) PLANCHET (MAN SERVANT TO D’ARTAGNAN) HOT TO TROT (D’ARTAGNANS HORSE) D’ARTAGNAN COMTE DE ROCHEFORT/LORD BUCKINGHAM CAMAMBERT & BRIE (ROCHEFORT HENCHMAN) ATHOS-COMTE DE LA FERE PORTHOS ARAMIS CARDINAL RICHELIEU MILADY QUEEN ANN CONSTANCE LOUISE XIII 2 Act one, Scene 1. Music Cue #1 Opening Gascony outside the stable of D’Artagnan. Enter Planchet, D’Artagnan’s trusted man-servant and all round busy body. With a large shovel and bucket she is obviously looking for something big. Planchet: Hot To Trot, get in here. You may be able to hide from me, you filthy filly, but there’s no hiding that pong. I can see the obnoxiously smelly fumes from here. (We hear a whinny of a horse, like a giggle ). Playing funny are we. You are the only horse I know with a warped sense of humor. If I didn’t know better, I would say you weren’t a real horse at all. (Planchet starts creeping around the stage and as she passes an open stable door, the horse creep out and starts following Planchet’s every move as she continues walking around the stage ). Dear Lord, help my nostrils from exploding. I know you are close, the whiff is getting whiffier. Come out come out wherever you are you four legged beastie. (Behind you) . I’ve got a horse’s behind? You cheeky beggar. (Horse behind me) . Oh no, there isn’t (Oh yes, there is) Oh no, there . -
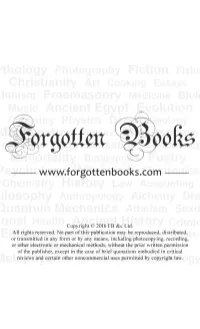
Alexandre Dumas
ALEX ANDRE DUMAS. IN T R O D U C T O RY N O T E S AND F L I S T S O C H A R A C T E R S . B O S T O N L ITTLE BRO N AN D COMPANY. , W , 1 8 9 5 . Co ri ht 1 892 1 8 93 1 89 py g , , 4, BY LITTLE BROW N AND M Y , , CO PAN UNIV E RSITY PRE SS I SO AND ON CAM B RIDG E U . S. A. J OHN W L N S , , C O N T E N T S. N THE TW O DIANA S . INTRODUCTORY OTE LIST OF CHARACT E RS TR D C T HE PAG E OF THE DUKE OF SA VOY . IN O U TORY NOTE LIST OF CHARACTERS D E I N E MARG UERIT E V ALOIS . NTRODUCTORY OT LIST OF LA DAM MONSOREAU I U N E DE . NTROD CTORY OTE LIST OF CHARACT ERS TY- I D TH E FOR FIVE . NTRO UCTORY NOTE LIST OF CHARACTERS E E N TH T HR E M USKE T EERS . INTRODUCTORY OTE LIST OF CHARACTERS TWENTY YEARS AFTER . INTRODUCTORY NOT E LIST OF CHARA CT ERS TH E V M E D E L ICO T BRAG E ONNE . INTRODUCTORY NOTE LIST OF CHARACTERS THE T U IP I BLACK L . NTRO D UCTORY NOTE LIST OF CH ARACT ER S LE C E D’ D N H VALIER HARM ENT AL . INTRO UCTORY OTE LIST OF CHARACT ERS C NEN S 4 O T T . -

El Club Dumas Arturo Pérez-Reverte
El club Dumas Arturo Pérez-Reverte http://www.librodot.com Librodot El Club Dumas Arturo Pérez-Reverte 2 A Cala, que me puso en el campo de batalla 2 Librodot Librodot El Club Dumas Arturo Pérez-Reverte 3 El fogonazo de luz proyectó la silueta del ahorcado en la pared. Colgaba inmóvil de una lámpara en el centro del salón, y a medida que el fotógrafo se movía a su alrededor, ac- cionando la cámara, la sombra provocada por el flash se recortaba sucesivamente sobre cua- dros, vitrinas con porcelanas, estanterías con libros, cortinas abiertas sobre grandes ventanales tras los que caía la lluvia. El juez instructor era joven. Tenía el pelo escaso, revuelto y aún mojado, como la ga- bardina que conservaba sobre los hombros mientras dictaba las diligencias al secretario que escribía sentado en el sofá, con la máquina portátil sobre una silla. El tecleo punteaba la voz monótona del juez y los comentarios en voz baja de los policías moviéndose por la habitación: -… En pijama, con un batín por encima. El cordón de esa prenda causó la muerte por ahorcamiento. El cadáver tiene las manos atadas en la parte anterior del cuerpo con una corba- ta. Su pie izquierdo conserva puesta una zapatilla y el otro se encuentra desnudo… El juez tocó el pie calzado del muerto y el cuerpo giró un poco, despacio, al extremo del tenso cordón de seda que unía su cuello con el anclaje de la lámpara en el techo. El movi- miento fue de izquierda a derecha, y después en sentido inverso y con más corto recorrido hasta centrarse de nuevo en la postura original, como una aguja imantada que recobrase el norte tras breve oscilación. -

Alexandre Dumas Twenty Years After.Pdf
Twenty Years After Dumas, Alexandre Published: 1845 Categorie(s): Fiction, Action & Adventure, Historical, Ro- mance Source: http://www.gutenberg.org 1 About Dumas: Alexandre Dumas, père, born Dumas Davy de la Pailleterie (July 24, 1802 – December 5, 1870) was a French writer, best known for his numerous historical novels of high adventure which have made him one of the most widely read French au- thors in the world. Many of his novels, including The Count of Monte Cristo, The Three Musketeers, and The Man in the Iron Mask were serialized, and he also wrote plays and magazine articles and was a prolific correspondent. Source: Wikipedia Also available on Feedbooks for Dumas: • The Count of Monte Cristo (1845) • The Three Musketeers (1844) • The Man in the Iron Mask (1850) • The Borgias (1840) • Ten Years Later (1848) • The Vicomte of Bragelonne (1847) • The Black Tulip (1850) • Louise de la Valliere (1849) • Ali Pacha (1840) • Murat (1840) Note: This book is brought to you by Feedbooks http://www.feedbooks.com Strictly for personal use, do not use this file for commercial purposes. 2 Chapter 1 The Shade of Cardinal Richelieu. In a splendid chamber of the Palais Royal, formerly styled the Palais Cardinal, a man was sitting in deep reverie, his head supported on his hands, leaning over a gilt and inlaid table which was covered with letters and papers. Behind this figure glowed a vast fireplace alive with leaping flames; great logs of oak blazed and crackled on the polished brass andirons whose flicker shone upon the superb habiliments of the lonely tenant of the room, which was illumined grandly by twin candelabra rich with wax-lights. -

Les Trois Mousquetaires Lavergne ©Luc Du 12 Novembre Au 12 Décembre 2014
LES CAHIERS Numéro 93 Automne 2014 D’APRÈS L’ŒUVRE D’ALEXANDRE DUMAS ADAPTATION ET MISE EN SCÈNE DE FRÉDÉRIC BÉLANGER UNE PRODUCTION DU THÉÂTRE ADVIENNE QUE POURRA PRÉSENTÉE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER D’Artagnan et les trois MOUSQUETAIRES Lavergne ©Luc DU 12 novembre au 12 DÉCEMBRE 2014 L’ÉNIGME CAMUS : NOËL 1933 UNE PASSION ALGÉRIENNE DU 3 AU DU 12 AU 20 DÉCEMBRE 2014 29 NOVEMBRE 2014 Idée originale de Chantal Grenier Scénarisation de Texte et mise en scène Dominique Grenier de Jean-Marie Papapietro Mise en scène de Une coproduction du © Catherine Gauthier Jean Turcotte Théâtre de Fortune Une production du en codiffusion avec le Théâtre Exaltemps Théâtre Denise-Pelletier en codiffusion avec le Théâtre Denise-Pelletier L'ÉQUIPE DU SPECTACLE D’ARTAGNAN ET LES TROIS MOUSQUETAIRES D’après l’œuvre d’Alexandre Dumas Adaptation et mise en scène de Frédéric Bélanger Une production du Théâtre Advienne que pourra présentée par le Théâtre Denise-Pelletier Salle Denise-Pelletier Du 12 novembre au 12 décembre 2014 Distribution Direction du Théâtre Advienne que par ordre alphabétique pourra Guillaume Baillargeon ......................................... Athos Direction artistique ........................ Frédéric Bélanger Maude Campeau ....................... Constance Bonacieux Direction générale ................................. Sarah Balleux Louise Cardinal ................... La reine Anne d’Autriche Guillaume Champoux ........................................Aramis Équipe de production – Robin-Joël Cool ..................... Le duc de Buckingham, -

Filmographie Des Œuvres D'alexandre Dumas Père
FILMOGRAPHIE LES ŒUVRES D’ALEXANDRE DUMAS PERE ADAPTEES A L’ECRAN Constituée par Uwe Jacobs SOMMAIRE ABREVIATIONS page 2 Le chevalier de Maison-Rouge page 2 Le collier de la Reine page 3 Les compagnons de Jéhu page 7 Le comte de Monte-Cristo page 8 La dame de Monsoreau page 24 Les frères corses page 25 Kean page 29 Mémoires d'un médecin page 33 La reine Margot page 34 Robin des bois page 37 Salteador page 38 Souvenirs d'une favorite page 39 La tour de Nesle page 42 Les Trois Mousquetaires-Trilogie- page 46 La Tulipe noire page 76 ABREVIATIONS ESTIMATION (par Uwe Jacobs) DDD : hautement dumasien DD : moyennement dumasien D : médiocrement dumasien sans : non acceptable * : dumasien seulement par le titre DISTRIBUTION P : production producteur, directeur de production, producteur exécutif, éditeur R : réalisateur assistant-réalisateur, direction artistique, direction technique, direction couleurs S : scénario dialogues I : interprètes O : opérateur montage, opérateur cadreur, conseil couleurs, décors, meubles, équipement, technique, costumes, coiffures, maquillage, chorégraphie, escrimeurs, effets spéciaux, script, sons LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE 12 Fra. LE CHEVALIER DE MAISON-ROUGE DDD France 1912 P Pathé Frères R Albert Capellani I Marie-Louise Derval M. Dorival M. Escoffier Paul Capellani Henry Krauss Rolla Norman 53 Ital. IL CAVALIERE DI MAISON ROUGE DDD Italie 1953 R Vittorio Cottafavi I Renée Saint-Cyr ........... Marie Antoinette Alfred Adam ......................... Dixmer Yvette Lebobn .............. sa femme Margot Armando Francioli ...... le capitaine Lindey Marcel Perez .............. le gardien Simon Annie Ducaux Jean Desailly LE COLLIER DE LA REINE 09 Fra. LE COLLIER DE LA REINE DDD France 1909 P Meliès/Louis Feuillade 12 Fra. -

Ou La Ruse D'alexandre Dumas
LE MYSTÈRE DES MOUSQUETAIRES ou la ruse d’Alexandre Dumas Par Sylvain Venayre Tout le monde connaît les Trois Mousquetaires, son algarade, dans une auberge de Meung-sur- l’histoire de cette amitié virile entre quatre jeunes Loire, avec un agent de Richelieu, le comte de hommes du temps de Louis XIII, racontée en 1844 Rochefort ; son amitié, dans la capitale, avec de par Alexandre Dumas. D’Artagnan, Athos, Porthos jeunes mousquetaires un peu plus âgés que lui, et et Aramis sont depuis longtemps entrés dans la connus seulement par leur nom de guerre, Athos, légende de la littérature. Leurs aventures ont fait Porthos et Aramis ; son habileté dans les duels à l’objet de multiples commentaires. Elles ont été l’épée ; son penchant pour la jeune épouse de son souvent adaptées dans d’autres romans, dans des logeur, Constance Bonacieux ; sa participation, pièces de théâtre, des fi lms, des dessins animés. ainsi que celle de ses amis, à l’affaire des ferrets, Des bandes dessinées aussi. par laquelle Richelieu espérait dévoiler la passion inavouable de la reine de France, Anne Tout le monde connaît ces aventures : le cadet de d’Autriche, pour le ministre d’Angleterre, le duc Gascogne d’Artagnan quittant son Béarn natal de Buckingham ; sa présence au siège de la ville pour essayer d’entrer, à Paris, dans le régiment des protestante de La Rochelle dans les armées de mousquetaires du roi dirigé par M. de Tréville ; Louis XIII ; sa tentative d’empêcher l’assassinat de Buckingham par le principal agent de Richelieu, l’histoire de France de Petitot et Monmerqué Milady. -
D'artagnan Capitaine Des Mousquetaires Du
D'ARTAGNAN CAPITAINE DES MOUSQUETAIRES DU ROI HISTOIRE VÉRIDIQUE D'UN HÉROS DE ROMAN PAR CHARLES SAMARAN PARIS - CALMANN-LÉVY - 1912 CHAPITRE PREMIER . — LA LÉGENDE DE D'ARTAGNAN. CHAPITRE II . — AU PAYS NATAL DE D'ARTAGNAN. CHAPITRE III . — LE MIRAGE DE PARIS. CHAPITRE IV . — D'ARTAGNAN AUX GARDES. CHAPITRE V . — D'ARTAGNAN AUX MOUSQUETAIRES. CHAPITRE VI . — D'ARTAGNAN EN MÉNAGE. CHAPITRE VII . — D'ARTAGNAN ET FOUQUET. CHAPITRE VIII . — VERS LE BÂTON DE MARÉCHAL. CHAPITRE IX . — D'ARTAGNAN, GOUVERNEUR DE LILLE. CHAPITRE X . — LA MORT DE D'ARTAGNAN. APPENDICE . — HOMONYMES ET PARENTS DE D'ARTAGNAN. DOCUMENTS. CHAPITRE PREMIER. — LA LÉGENDE DE D'ARTAGNAN. Alexandre Dumas, les Trois mousquetaires et la popularité de d'Artagnan. — Le père du roman historique en France : Gatien Courtils de Sandras, sa vie, ses œuvres. — Les Mémoires de M. d'Artagnan. — Leur mérite littéraire et leur valeur historique. — Athos, Porthos, Aramis et d'Artagnan devant l'histoire. De tous les noms nimbés de gloire que la légende et l'histoire nous ont transmis, peut-être n'en est-il pas de plus populaire, en France et même ailleurs, que celui de d'Artagnan 1. Qu'il serve à désigner les lions les plus redoutés des ménageries ou les larges chapeaux de feutre que le négociant astucieux place sous cette protection illustre, ce nom prestigieux n'est jamais invoqué en vain. Il fait recette. D'Artagnan, c'est le Gascon, disons mieux le Français par excellence, à l'esprit juste et alerte, au corps souple et vigoureux, au cœur bon et compatissant, qu'aucune difficulté ne trouve en défaut, que n'effraie aucun danger, qu'aucune infortune ne laisse insensible, habile enfin au jeu de la finesse comme au jeu de la force, mais toujours loyal et brave comme son épée. -

Sample File Comte De Rochefort Bought One Hun- the Pins to Her Lover
The Key to Paris There are several important locations gardens without the company of a plaining to a guard, "Where does she in Paris (see Map B in the booklet's King's Musketeer. as the gardens ad- think I can get five hundred English center). Each is keyed to a number on join the Louvre Palace. Ten guards guineas! Who does she think I am. the the map and in the text below. The take intruders to Richelieu's house Duke of Buckingham?" entries describe each location's im- #6 (01-50%) or de Treville's house 7. Halles Centrales: PCs can find p9rtance. NPCs at these locations #23 (51-100%) for questioning. clothing or food at this flea-market. might possess information useful to If the PCs ask about Constance or There is a 40% chance (per item) they the PCs. Ofcourse. PCs must obtain a Queen Anne's party. the guards sug- can find anything else common to the favorable result on a Direct Action gest trying Jardin des Plantes #18 or era. including 1- 10 swords or pistols. check to discover this information. the Luxembourg House # 19. Neither 8. Hotel de Ville (City Hall): This Make the players use their wits to Constance nor Queen Anne have is the record center of Paris. It is a uncover the information they need. been here today. matter of public record that Milady After all. there's more to time-travel Those who go inside overhear two de Winter holds the deed to Hotel de than brawling in taverns! ladies speaking: "I don't know how Soubise #9. -

Presentation and Object of the Game: Material
During the reign of Louis XIII, Queen Anne d’Autriche maintained a reckless relationship with the Duke of Buckingham. As a token of her affection, she gave him several diamond pendants that were a gift from the King. Cardinal Richelieu, who had been seeking an opportunity to discredit her in the eyes of the French monarch, learned of the affair and charged his most formidable agent, Milady, with the task of stealing the pendants from Buckingham in England. He then waited for the grand ball in the Queen’s honour in order to confound her. But in secret, the Queen has entrusted D’Artagnan and his brave companions with the mission of bringing the pendants back to her before the opening of the ball at the royal palace of the Louvre… The honour of the Queen is in your hands! Presentation and object of the game: Material: The game is intended for 2 to 5 players. Each player takes either A game board representing the rooms of the Louvre palace, le the role of a Musketeer (D’Artagnan, Athos, Aramis, and Porthos), Quai du Louvre (the street outside the palace), the locations of the or that of the Cardinal and his Henchmen: Milady, Rochefort and the chests (with the Musketeers’ coat of arms), the entrances where the Cardinal’s Guards. Henchmen appear (with the Cardinal’s coat of arms), the Queen’s chamber, and the Queen’s track within the Ballroom (with squares The Musketeers’ goal is to cross the Louvre in order to arrive at the numbered 1 to 15). -

Monta, Notre Maison Commune En Action
LE 1er JOURNAL DES ECOLIERS N° 8 - 25 JUIN 2021 MONTA, NOTRE MAISON COMMUNE EN ACTION L’édito Monta en action p. 2 à 9 Monta, une maison commune en action, une belle Qu’est-ce que la République Française ? p. 10 à 13 école sensibilisée pour la planète. La statue de la Liberté p. 14-15 Le pape François nous invite à s’engager dès Rubrique Histoire p. 16 aujourd’hui dans une conversion écologique intégrale qui prend racine dans le cœur de Rubrique science p. 17 à 21 l’Homme « car nous savons que les choses peuvent Rubrique culturelle p. 22 à 27 changer » Au quotidien, les élèves se mobilisent pour embellir leur environnement et porter attention à A RETROUVER leurs gestes. Une goutte dans l’océan certes, mais SUR LE SITE DE MONTALEMBERT à multiplier avec générosité. Les enfants nous www.institut-montalembert.org portent sur leurs ailes, ils sont fédérateurs, suivons rubrique Maternelle et Ecole : leur chemin, la porte est grande ouverte. la journée dominicaine du vendredi 11 juin Le concours de dessin et de poésie sur le Mme Béatrice Leleu Chef d’établissement 1er degré thème de la paix. Directrice de publication du P’tit Monta MONTA EN ACTION Montalembert appartient à notre maison commune et s’emploie depuis de nombreuses années à favoriser l’aide aux plus démunis auprès d’associations en menant des actions humanitaires concrètes et au sein même de ses murs auprès des élèves en difficulté d’apprentissage. Même nos jeunes élèves se mobilisent et agissent pour faire avancer leur monde en créant des collectifs ambitieux, novateurs et tournés vers autrui.