Revue Celtique, T
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
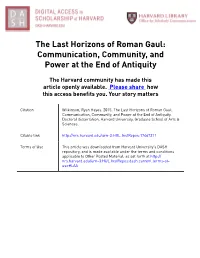
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Wilkinson, Ryan Hayes. 2015. The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467211 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity A dissertation presented by Ryan Hayes Wilkinson to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Ryan Hayes Wilkinson All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Michael McCormick Ryan Hayes Wilkinson The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity Abstract In the fifth and sixth centuries CE, the Roman Empire fragmented, along with its network of political, cultural, and socio-economic connections. How did that network’s collapse reshape the social and mental horizons of communities in one part of the Roman world, now eastern France? Did new political frontiers between barbarian kingdoms redirect those communities’ external connections, and if so, how? To address these questions, this dissertation focuses on the cities of two Gallo-Roman tribal groups. -

The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476)
Impact of Empire 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd i 5-4-2007 8:35:52 Impact of Empire Editorial Board of the series Impact of Empire (= Management Team of the Network Impact of Empire) Lukas de Blois, Angelos Chaniotis Ségolène Demougin, Olivier Hekster, Gerda de Kleijn Luuk de Ligt, Elio Lo Cascio, Michael Peachin John Rich, and Christian Witschel Executive Secretariat of the Series and the Network Lukas de Blois, Olivier Hekster Gerda de Kleijn and John Rich Radboud University of Nijmegen, Erasmusplein 1, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The Netherlands E-mail addresses: [email protected] and [email protected] Academic Board of the International Network Impact of Empire geza alföldy – stéphane benoist – anthony birley christer bruun – john drinkwater – werner eck – peter funke andrea giardina – johannes hahn – fik meijer – onno van nijf marie-thérèse raepsaet-charlier – john richardson bert van der spek – richard talbert – willem zwalve VOLUME 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd ii 5-4-2007 8:35:52 The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476) Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C. – A.D. 476) Capri, March 29 – April 2, 2005 Edited by Lukas de Blois & Elio Lo Cascio With the Aid of Olivier Hekster & Gerda de Kleijn LEIDEN • BOSTON 2007 This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. -

Dedikantinnen Und Dedikanten Von Weihesteinen an Keltische Gottheiten in Der Römischen Provinz Germania Inferior
Dedikantinnen und Dedikanten von Weihesteinen an keltische Gottheiten in der römischen Provinz Germania Inferior Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts (MA) an der Universität Graz vorgelegt von Verena Andrea REITER am Institut für Antike Begutachter: Dr. Wolfgang Spickermann Graz, 2021 Inhaltsverzeichnis Einleitung ...................................................................................................................................................... 3 1 Dedikantennamen ............................................................................................................................... 6 1.1 keltische Dedikantennamen ...................................................................................................... 7 1.2 germanische Dedikantennamen ................................................................................................. 8 1.3 indigenes Namensformular ........................................................................................................ 9 1.4 Geschlecht .................................................................................................................................. 10 1.5 Berufe .......................................................................................................................................... 11 1.5.1 Berufe und Fundorte ........................................................................................................ 11 1.5.2 Berufe und Gottheiten ..................................................................................................... -

Calendar of Roman Events
Introduction Steve Worboys and I began this calendar in 1980 or 1981 when we discovered that the exact dates of many events survive from Roman antiquity, the most famous being the ides of March murder of Caesar. Flipping through a few books on Roman history revealed a handful of dates, and we believed that to fill every day of the year would certainly be impossible. From 1981 until 1989 I kept the calendar, adding dates as I ran across them. In 1989 I typed the list into the computer and we began again to plunder books and journals for dates, this time recording sources. Since then I have worked and reworked the Calendar, revising old entries and adding many, many more. The Roman Calendar The calendar was reformed twice, once by Caesar in 46 BC and later by Augustus in 8 BC. Each of these reforms is described in A. K. Michels’ book The Calendar of the Roman Republic. In an ordinary pre-Julian year, the number of days in each month was as follows: 29 January 31 May 29 September 28 February 29 June 31 October 31 March 31 Quintilis (July) 29 November 29 April 29 Sextilis (August) 29 December. The Romans did not number the days of the months consecutively. They reckoned backwards from three fixed points: The kalends, the nones, and the ides. The kalends is the first day of the month. For months with 31 days the nones fall on the 7th and the ides the 15th. For other months the nones fall on the 5th and the ides on the 13th. -

La Langue Gauloise
LA VOCATION DE L’ARBRE D’OR est de partager ses admirations avec les lecteurs, son admiration pour les grands textes nourrissants du passé et celle aussi pour l’œuvre de contem- porains majeurs qui seront probablement davantage appréciés demain qu’aujourd’hui. Trop d’ouvrages essentiels à la culture de l’âme ou de l’identité de chacun sont aujourd’hui indisponibles dans un marché du livre transformé en industrie lourde. Et quand par chance ils sont disponibles, c’est financiè- rement que trop souvent ils deviennent inaccessibles. La belle littérature, les outils de développement personnel, d’identité et de progrès, on les trouvera donc au catalogue de l’Arbre d’Or à des prix résolument bas pour la qualité offerte. LES DROITS DES AUTEURS Cet e-book est sous la protection de la loi fédérale suisse sur le droit d’auteur et les droits voisins (art. 2, al. 2 tit. a, LDA). Il est également pro- tégé par les traités internationaux sur la propriété industrielle. Comme un livre papier, le présent fichier et son image de couverture sont sous copyright, vous ne devez en aucune façon les modifier, les utili- ser ou les diffuser sans l’accord des ayant-droits. Obtenir ce fichier autre- ment que suite à un téléchargement après paiement sur le site est un délit. Transmettre ce fichier encodé sur un autre ordinateur que celui avec lequel il a été payé et téléchargé peut occasionner des dommages informatiques susceptibles d’engager votre responsabilité civile. Ne diffusez pas votre copie mais, au contraire, quand un titre vous a plu, encouragez-en l’achat. -

The Britons in Late Antiquity: Power, Identity And
THE BRITONS IN LATE ANTIQUITY: POWER, IDENTITY AND ETHNICITY EDWIN R. HUSTWIT Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Bangor University 2014 Summary This study focuses on the creation of both British ethnic or ‘national’ identity and Brittonic regional/dynastic identities in the Roman and early medieval periods. It is divided into two interrelated sections which deal with a broad range of textual and archaeological evidence. Its starting point is an examination of Roman views of the inhabitants of the island of Britain and how ethnographic images were created in order to define the population of Britain as 1 barbarians who required the civilising influence of imperial conquest. The discussion here seeks to elucidate, as far as possible, the extent to which the Britons were incorporated into the provincial framework and subsequently ordered and defined themselves as an imperial people. This first section culminates with discussion of Gildas’s De Excidio Britanniae. It seeks to illuminate how Gildas attempted to create a new identity for his contemporaries which, though to a certain extent based on the foundations of Roman-period Britishness, situated his gens uniquely amongst the peoples of late antique Europe as God’s familia. The second section of the thesis examines the creation of regional and dynastic identities and the emergence of kingship amongst the Britons in the late and immediately post-Roman periods. It is largely concerned to show how interaction with the Roman state played a key role in the creation of early kingships in northern and western Britain. The argument stresses that while there were claims of continuity in group identities in the late antique period, the socio-political units which emerged in the fifth and sixth centuries were new entities. -
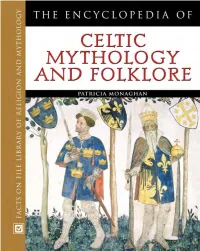
Encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY and FOLKLORE
the encyclopedia of CELTIC MYTHOLOGY AND FOLKLORE Patricia Monaghan The Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore Copyright © 2004 by Patricia Monaghan All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Monaghan, Patricia. The encyclopedia of Celtic mythology and folklore / Patricia Monaghan. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-4524-0 (alk. paper) 1. Mythology, Celtic—Encyclopedias. 2. Celts—Folklore—Encyclopedias. 3. Legends—Europe—Encyclopedias. I. Title. BL900.M66 2003 299'.16—dc21 2003044944 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by Erika K. Arroyo Cover design by Cathy Rincon Printed in the United States of America VB Hermitage 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 This book is printed on acid-free paper. CONTENTS 6 INTRODUCTION iv A TO Z ENTRIES 1 BIBLIOGRAPHY 479 INDEX 486 INTRODUCTION 6 Who Were the Celts? tribal names, used by other Europeans as a The terms Celt and Celtic seem familiar today— generic term for the whole people. -

Test Abonnement
L E X I C O N O F T H E W O R L D O F T H E C E L T I C G O D S Composed by: Dewaele Sunniva Translation: Dewaele Sunniva and Van den Broecke Nadine A Abandinus: British water god, but locally till Godmanchester in Cambridgeshire. Abarta: Irish god, member of the de Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abelio, Abelionni, Abellio, Abello: Gallic god of the Garonne valley in South-western France, perhaps a god of the apple trees. Also known as the sun god on the Greek island Crete and the Pyrenees between France and Spain, associated with fertility of the apple trees. Abgatiacus: ‘he who owns the water’, There is only a statue of him in Neumagen in Germany. He must accompany the souls to the Underworld, perhaps a heeling god as well. Abhean: Irish god, harpist of the Tuatha De Danann (‘people of Danu’). Abianius: Gallic river god, probably of navigation and/or trade on the river. Abilus: Gallic god in France, worshiped at Ar-nay-de-luc in Côte d’Or (France) Abinius: Gallic river god or ‘the defence of god’. Abna, Abnoba, Avnova: goddess of the wood and river of the Black Wood and the surrounding territories in Germany, also a goddess of hunt. Abondia, Abunciada, Habonde, Habondia: British goddess of plenty and prosperity. Originally she is a Germanic earth goddess. Accasbel: a member of the first Irish invasion, the Partholans. Probably an early god of wine. Achall: Irish goddess of diligence and family love. -

Dictionary of Gods and Goddesses.Pdf
denisbul denisbul dictionary of GODS AND GODDESSES second edition denisbulmichael jordan For Beatrice Elizabeth Jordan Dictionary of Gods and Goddesses, Second Edition Copyright © 2004, 1993 by Michael Jordan All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Facts On File, Inc. 132 West 31st Street New York NY 10001 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data denisbulJordan, Michael, 1941– Dictionary of gods and godesses / Michael Jordan.– 2nd ed. p. cm. Rev. ed. of: Encyclopedia of gods. c1993. Includes bibliographical references and index. ISBN 0-8160-5923-3 1. Gods–Dictionaries. 2. Goddesses–Dictionaries. I. Jordan, Michael, 1941– Encyclopedia of gods. II. Title. BL473.J67 2004 202'.11'03–dc22 2004013028 Facts On File books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Facts On File on the World Wide Web at http://www.factsonfile.com Text design by David Strelecky Cover design by Cathy Rincon Printed in the United States of America VBFOF10987654321 This book is printed on acid-free paper. CONTENTS 6 PREFACE TO THE SECOND EDITION v INTRODUCTION TO THE FIRST EDITION vii CHRONOLOGY OF THE PRINCIPAL RELIGIONS AND CULTURES COVERED IN THIS BOOK xiii DICTIONARY OF GODS AND GODDESSES denisbul1 BIBLIOGRAPHY 361 INDEX 367 denisbul PREFACE TO THE SECOND EDITION 6 It is explained in the introduction to this volume and the Maori. -

KELTISCH EN GERMAANS in DE NEDERLANDEN Taal in Nederland En België Gedurende De Late Ijzertijd En De Romeinse Periode
MEMOIRES DE LA SOCIETE BELGE D'ETUDES CEL TIQUES 1 3 KELTISCH EN GERMAANS IN DE NEDERLANDEN Taal in Nederland en België gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse periode Lauran TOORIANS Bruxelles 2000 3 INHOUD Vooraf ........ .......... .. ....................................... 5 I. Archeologie en taal . 9 a. Waar hebben we het over? . 9 Prehistorie en archeologie . 9 Interpretatie alleen door samenhang . 11 Historisch vergelijkende taalwetenschap . 12 Germanen spreken Germaans . 13 b. De kracht van de traditie . 16 Nationale mythen . 16 Van edele Bataven naar ongeciviliseerde Batavieren . 18 De Belgische situatie . 19 c. Het archeologische beeld .......................................... 21 Wie troffen de Romeinen aan? .............................. .... 21 Wat vooraf ging . 22 La Tène ... ... ...... .. ............. .... .......... .... ... .... 24 Kelten . ... ..... .......... ....... ..................... .... 33 En de Germanen . 34 d. Het taalkundige kader . 37 Talen, dialecten en taalfamilies .................................. 37 Verwantschap en verandering . 40 11. Waaraan herkennen we Germaans en Keltisch . 45 a. Germaans ...................... .. ........................ .. .. 45 Kenmerken ................................................. 45 Datering . 49 Voorbeelden ........ ........ ............ .. .... .. ....... ..... 51 b. Keltisch . 53 Waar en wanneer . 53 Kenmerken . 57 Voorbeelden . 58 111. De bronnen .... ... .... ... ..... .. .............................. 63 a. Inleiding: een 'Noordwestblok' . 63 4 b. Stamnamen . -

Bangor University DOCTOR of PHILOSOPHY the Britons in Late
Bangor University DOCTOR OF PHILOSOPHY The Britons in late antiquity power, identity and ethnicity Hustwit, Edwin Award date: 2015 Awarding institution: Bangor University Link to publication General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ? Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 06. Oct. 2021 THE BRITONS IN LATE ANTIQUITY: POWER, IDENTITY AND ETHNICITY EDWIN R. HUSTWIT Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy Bangor University 2014 Summary This study focuses on the creation of both British ethnic or ‘national’ identity and Brittonic regional/dynastic identities in the Roman and early medieval periods. It is divided into two interrelated sections which deal with a broad range of textual and archaeological evidence. Its starting point is an examination of Roman views of the inhabitants of the island of Britain and how ethnographic images were created in order to define the population of Britain as 1 barbarians who required the civilising influence of imperial conquest. -

Tooke's Pantheon of the Heathen Gods and Illustrious Heroes
This is a reproduction of a library book that was digitized by Google as part of an ongoing effort to preserve the information in books and make it universally accessible. https://books.google.com -- - __ |- · |- |- |- |-|--. -:|-· |.…….….….….---- |-· |-|- ·|- ·· · · |-··|- |- |-· |-- |-· |- |- .|- ·|-|-|- | | . .|-|- |- ·-|- · - |×· . |(-)|-|- |- |-|- |- ſ. |- ·-|- |- |-|-|-|- · . · ·|× ·· |-|× |-|-|- · -· |-- |-|- |- |- . |- |- |- -|- |- |- · |- · |- ·-. |- |- ·|- |- |-|-|- ·|- ·· : - · |- ··|-|- |-·|- |- ·|-· |-|- |- |- |- · |- |- |-· |- · ·|-- |-· ·|- |- | .|- |- |- |- |- ·|- · |- |-|- ----· | .|- : · |-|- -- · _ |-├. |- ---- ·:·| |- ·|- |-·|- .- . |-· -.-|-|- |- |- |-- · ·-· )·---- · ·-·|-----· · |-|------ - |- --------|- . | _|- - . -- |-|- . .- -- | _ THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY - º \ , º, y " . * , an TookE's PANTHEON ... , - 2. * , , *... * * * * - , , , , r . of ºpe > * > 2 -> • * * * * * > > → * HEATHEN Gods 3 2 * AND I L II, U S T R I O U S HE R O E. S. REVISED FOR * A CLASSICAL COURSE OF EDUCATION, AND ADAPTED FOR THE USE OF STUDENTS OF EVERY AGE AND OF EITHER SEX. illustrateD WITH ENGRAVINGS FROM NEW AND ORIGINAL DESIGrºg. * º * - * -- B. A. L TIM OR E: PUBLISHED BY WILLIAM & JOSEPH NEAL. 1838, - DISTRICT OF MARYLAND, ss. - BE IT REMEMBERED, that on this fifth day of May, in the forty-first year of the Independence of the United States of America, Edward J. Coale and Nathaniel G. Maxwell, of the said district, have deposited in this office, the title of a book, the right whereof they claim as proprietors in the words