La Langue Gauloise
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
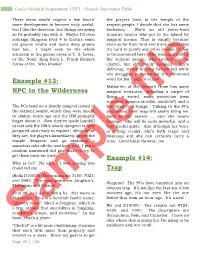
Chaotic Descriptor Table
Castle Oldskull Supplement CDT1: Chaotic Descriptor Table These ideas would require a few hours’ the players back to the temple of the more development to become truly useful, serpent people, I decide that she has some but I like the direction that things are going backstory. She’s an old jester-bard so I’d probably run with it. Maybe I’d even treasure hunter who got to the island by redesign dungeon level 4 to feature some magical means. This is simply because old gnome vaults and some deep gnome she’s so far from land and trade routes that lore too. I might even tie the whole it’s hard to justify any other reason for her situation to the gnome caves of C. S. Lewis, to be marooned here. She was captured by or the Nome King from L. Frank Baum’s the serpent people, who treated her as Ozma of Oz. Who knows? chattel, but she barely escaped. She’s delirious, trying to keep herself fed while she struggles to remember the command Example #13: word for her magical carpet. Malamhin of the Smooth Brow has some NPC in the Wilderness magical treasures, including a carpet of flying, a sword, some protection from serpents thingies (scrolls, amulets?) and a The PCs land on a deadly magical island of few other cool things. Talking to the PCs the serpent people, which they were meant and seeing their map will slowly bring her to explore years ago and the GM promptly back to her senses … and she wants forgot about it. -

Université De Montréal Julius Caesar in Gaul and Germania
Université de Montréal Julius Caesar in Gaul and Germania: Strategy, tactics, and the use of aggressive diplomacy as a tool for war Par Patrick Dakkach Département d’histoire, Université de Montréal, Faculté des arts et des sciences Mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de la Maitrise En Histoire, option Recherche Mai 2021 © Patrick Dakkach, 2021 Université de Montréal Unité académique : Département d’histoire, Université de Montréal, Faculté des arts et des sciences Ce mémoire intitulé Julius Caesar in Gaul and Germania: Strategy, tactics, and the use of aggressive diplomacy as a tool for war Présenté par Patrick Dakkach A été évalué(e) par un jury composé des personnes suivantes Philippe Genequand Président-rapporteur Christian Raschle Directeur de recherche Michael Fronda Membre du jury Résumé Alors que César et ses écrits ont fait l’objet d’une étude approfondie au cours des deux derniers siècles, comment étudier ses commentaires de manière différente? En utilisant une nouvelle approche mise au point par Arthur M. Eckstein dans son œuvre Mediterranean Anarchy, Interstate War, and the Rise of Rome qui soutient que Rome a conquis de manière opportuniste l'Italie et la Méditerranée orientale à travers une série de guerres défensives ou « d’invitations ». La nouveauté de cette approche est son utilisation des paradigmes de la science politique misant surtout sur le concept de l'anarchie réaliste. En tant que telle, cette thèse utilisera le cadre d'Eckstein et l'appliquera au Bellum Gallicum de César pour montrer que, contrairement à l'historiographie traditionnelle, César n'a pas conquis la Gaule par bellicosité et ambition personnelle, mais plutôt à la suite d'invitation directe de ses alliés gaulois le poussant à intervenir défensivement au nom du bellum iustum. -

Lucan's Natural Questions: Landscape and Geography in the Bellum Civile Laura Zientek a Dissertation Submitted in Partial Fulf
Lucan’s Natural Questions: Landscape and Geography in the Bellum Civile Laura Zientek A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Washington 2014 Reading Committee: Catherine Connors, Chair Alain Gowing Stephen Hinds Program Authorized to Offer Degree: Classics © Copyright 2014 Laura Zientek University of Washington Abstract Lucan’s Natural Questions: Landscape and Geography in the Bellum Civile Laura Zientek Chair of the Supervisory Committee: Professor Catherine Connors Department of Classics This dissertation is an analysis of the role of landscape and the natural world in Lucan’s Bellum Civile. I investigate digressions and excurses on mountains, rivers, and certain myths associated aetiologically with the land, and demonstrate how Stoic physics and cosmology – in particular the concepts of cosmic (dis)order, collapse, and conflagration – play a role in the way Lucan writes about the landscape in the context of a civil war poem. Building on previous analyses of the Bellum Civile that provide background on its literary context (Ahl, 1976), on Lucan’s poetic technique (Masters, 1992), and on landscape in Roman literature (Spencer, 2010), I approach Lucan’s depiction of the natural world by focusing on the mutual effect of humanity and landscape on each other. Thus, hardships posed by the land against characters like Caesar and Cato, gloomy and threatening atmospheres, and dangerous or unusual weather phenomena all have places in my study. I also explore how Lucan’s landscapes engage with the tropes of the locus amoenus or horridus (Schiesaro, 2006) and elements of the sublime (Day, 2013). -
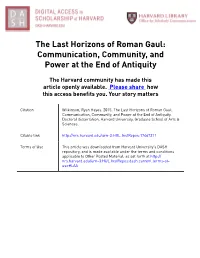
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity
The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Wilkinson, Ryan Hayes. 2015. The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity. Doctoral dissertation, Harvard University, Graduate School of Arts & Sciences. Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:17467211 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity A dissertation presented by Ryan Hayes Wilkinson to The Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of History Harvard University Cambridge, Massachusetts May 2015 © 2015 Ryan Hayes Wilkinson All rights reserved. Dissertation Advisor: Professor Michael McCormick Ryan Hayes Wilkinson The Last Horizons of Roman Gaul: Communication, Community, and Power at the End of Antiquity Abstract In the fifth and sixth centuries CE, the Roman Empire fragmented, along with its network of political, cultural, and socio-economic connections. How did that network’s collapse reshape the social and mental horizons of communities in one part of the Roman world, now eastern France? Did new political frontiers between barbarian kingdoms redirect those communities’ external connections, and if so, how? To address these questions, this dissertation focuses on the cities of two Gallo-Roman tribal groups. -

The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476)
Impact of Empire 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd i 5-4-2007 8:35:52 Impact of Empire Editorial Board of the series Impact of Empire (= Management Team of the Network Impact of Empire) Lukas de Blois, Angelos Chaniotis Ségolène Demougin, Olivier Hekster, Gerda de Kleijn Luuk de Ligt, Elio Lo Cascio, Michael Peachin John Rich, and Christian Witschel Executive Secretariat of the Series and the Network Lukas de Blois, Olivier Hekster Gerda de Kleijn and John Rich Radboud University of Nijmegen, Erasmusplein 1, P.O. Box 9103, 6500 HD Nijmegen, The Netherlands E-mail addresses: [email protected] and [email protected] Academic Board of the International Network Impact of Empire geza alföldy – stéphane benoist – anthony birley christer bruun – john drinkwater – werner eck – peter funke andrea giardina – johannes hahn – fik meijer – onno van nijf marie-thérèse raepsaet-charlier – john richardson bert van der spek – richard talbert – willem zwalve VOLUME 6 IMEM-6-deBlois_CS2.indd ii 5-4-2007 8:35:52 The Impact of the Roman Army (200 BC – AD 476) Economic, Social, Political, Religious and Cultural Aspects Proceedings of the Sixth Workshop of the International Network Impact of Empire (Roman Empire, 200 B.C. – A.D. 476) Capri, March 29 – April 2, 2005 Edited by Lukas de Blois & Elio Lo Cascio With the Aid of Olivier Hekster & Gerda de Kleijn LEIDEN • BOSTON 2007 This is an open access title distributed under the terms of the CC-BY-NC 4.0 License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. -

Dedikantinnen Und Dedikanten Von Weihesteinen an Keltische Gottheiten in Der Römischen Provinz Germania Inferior
Dedikantinnen und Dedikanten von Weihesteinen an keltische Gottheiten in der römischen Provinz Germania Inferior Masterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Master of Arts (MA) an der Universität Graz vorgelegt von Verena Andrea REITER am Institut für Antike Begutachter: Dr. Wolfgang Spickermann Graz, 2021 Inhaltsverzeichnis Einleitung ...................................................................................................................................................... 3 1 Dedikantennamen ............................................................................................................................... 6 1.1 keltische Dedikantennamen ...................................................................................................... 7 1.2 germanische Dedikantennamen ................................................................................................. 8 1.3 indigenes Namensformular ........................................................................................................ 9 1.4 Geschlecht .................................................................................................................................. 10 1.5 Berufe .......................................................................................................................................... 11 1.5.1 Berufe und Fundorte ........................................................................................................ 11 1.5.2 Berufe und Gottheiten ..................................................................................................... -

Was Galatian Really Celtic? Anthony Durham & Michael Goormachtigh First Published November 2011, Updated to October 2016
Was Galatian Really Celtic? Anthony Durham & Michael Goormachtigh first published November 2011, updated to October 2016 Summary Saint Jerome’s AD 386 remark that the language of ancient Galatia (around modern Ankara) resembled the language of the Treveri (around modern Trier) has been misinterpreted. The “Celts”, “Gauls” or “Galatians” mentioned by classical authors, including those who invaded Greece and Anatolia around 277 BC, were not Celtic in the modern sense of speaking a Celtic language related to Welsh and Irish, but tall, pale-skinned, hairy, warrior peoples from the north. The 150 or so words and proper names currently known from Galatian speech show little affinity with Celtic but more with Germanic. Introduction In AD 386 Saint Jerome wrote: Apart from the Greek language, which is spoken throughout the entire East, the Galatians have their own language, almost the same as the Treveri. For many people this short remark is the linchpin of a belief that ancient Celtic speech spread far outside its Atlantic-fringe homeland, reaching even into the heart of Anatolia, modern Turkey. However, we wish to challenge the idea that Galatians spoke a language that was Celtic in the modern sense of being closely related to Welsh or Irish. Galatia was the region around ancient Ancyra, modern Ankara, in the middle of Turkey. Anatolia (otherwise known as Asia Minor) has seen many civilisations come and go over the millennia. Around 8000 BC it was a cradle of agriculture and the Neolithic revolution. The whole family of Indo-European languages originated somewhere in that region. We favour the idea that they grew up around the Black Sea all the way from northern Anatolia, past the mouth of the river Danube, to southern Russia and Ukraine. -

Calendar of Roman Events
Introduction Steve Worboys and I began this calendar in 1980 or 1981 when we discovered that the exact dates of many events survive from Roman antiquity, the most famous being the ides of March murder of Caesar. Flipping through a few books on Roman history revealed a handful of dates, and we believed that to fill every day of the year would certainly be impossible. From 1981 until 1989 I kept the calendar, adding dates as I ran across them. In 1989 I typed the list into the computer and we began again to plunder books and journals for dates, this time recording sources. Since then I have worked and reworked the Calendar, revising old entries and adding many, many more. The Roman Calendar The calendar was reformed twice, once by Caesar in 46 BC and later by Augustus in 8 BC. Each of these reforms is described in A. K. Michels’ book The Calendar of the Roman Republic. In an ordinary pre-Julian year, the number of days in each month was as follows: 29 January 31 May 29 September 28 February 29 June 31 October 31 March 31 Quintilis (July) 29 November 29 April 29 Sextilis (August) 29 December. The Romans did not number the days of the months consecutively. They reckoned backwards from three fixed points: The kalends, the nones, and the ides. The kalends is the first day of the month. For months with 31 days the nones fall on the 7th and the ides the 15th. For other months the nones fall on the 5th and the ides on the 13th. -

The Commentaries of Caesar, by Anthony Trollope
Project Gutenberg's The Commentaries of Caesar, by Anthony Trollope This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org/license Title: The Commentaries of Caesar Author: Anthony Trollope Release Date: November 9, 2017 [EBook #55926] Language: English *** START OF THIS PROJECT GUTENBERG EBOOK THE COMMENTARIES OF CAESAR *** Produced by Chuck Greif and the Online Distributed Proofreading Team at http://www.pgdp.net (This book was produced from scanned images of public domain material from the Google Books project.) Ancient Classics for English Readers EDITED BY THE REV. W. LUCAS COLLINS, M.A. C Æ S A R The Volumes published of this Series contain HOMER: THE ILIAD, BY THE EDITOR. HOMER: THE ODYSSEY, BY THE SAME. HERODOTUS, BY GEORGE C. SWAYNE, M.A. Late Fellow of Corpus Christi College, Oxford. The following Authors, by various Contributors, are in preparation:— VIRGIL. HORACE. ÆSCHYLUS. SOPHOCLES. ARISTOPHANES. CICERO. JUVENAL. XENOPHON. OTHERS WILL FOLLOW. A Volume will be published on the 1st of every alternate Month, price 2s. 6d. T H E C O M M E N T A R I E S OF C Æ S A R BY ANTHONY TROLLOPE WILLIAM BLACKWOOD AND SONS EDINBURGH AND LONDON MDCCCLXX CONTENTS. CHAP. PAGE I. INTRODUCTION, 1 FIRST BOOK OF THE WAR IN GAUL.—CÆSAR DRIVES FIRST THE SWISS AND II. 28 THEN THE GERMANS OUT OF GAUL.—B.C. -

A Friendship
Conversions Wars Cultures Religions and a Family Name MICHAEL L. SENA C OPYRIGHTED , 2012 B Y G R E E N H O R SE P U B L I S H I N G C OMPANY V ADSTENA , S WEDEN EDITED AND REVISED DECEMBER 2013 ii WARS ARE FOUGHT to gain and keep control over wealth. Tribes, clans, countries and other groups that have wealth have the power to wage and win wars. Those without wealth will always be war’s victims. They lack the resources to build effective defences and protect themselves against destructive powers. Besides extermination or assimilation, one consequence of wars for the vanquished is displacement. Defeated peoples are often set adrift. Cultures, or societies, come into existence when a sufficient number of individuals agree on a way of living together, either through consensus or through force. Cultures are sensitive organisms. They are born, sometimes growing and flourishing, oftentimes contracting and vanishing. Even the most powerful civilizations in their times have had to relinquish their positions of dominance, most often because of self destructive actions taken by their leaders. When one culture is diminished, there is always another waiting to take its place. Humankind is the sum total of all those cultures that have gone before. Religion is the codification of a society’s rules that define what is considered right and what is deemed wrong. Societies base their laws on these definitions, and the laws establish the worldly consequences of not upholding or abiding by the rules. Those who are the codifiers, the priests, gain their legitimacy by providing answers to the unanswerable. -

College Caesar
College Caesar Latin Text with Facing Vocabulary and Commentary Geoffrey Steadman College Caesar Latin Text with Facing Vocabulary and Commentary First Edition © 2011 by Geoffrey D. Steadman Revised July 2011, January 2012, February 2012, July 2012 All rights reserved. Subject to the exception immediately following, this book may not be reproduced, in whole or in part, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publisher. The author has made an online version of this work available under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. The terms of the license can be accessed at creativecommons.org. Accordingly, you are free to copy, alter, and distribute this work under the following conditions: (1) You must attribute the work to the author (but not in any way that suggests that the author endorses your alterations to the work). (2) You may not use this work for commercial purposes. (3) If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar license as this one. ISBN-13: 978-0-9843065-7-2 ISBN-10: 0-9843065-7-9 Published by Geoffrey Steadman Cover Design: David Steadman Fonts: Times New Roman [email protected] Table of Contents Pages 35 Lessons by Title…………………………………………………………………....v Preface to the Series……………………………………………………………..vii-viii Introduction…………………………………………………………………….......ix-x Outline of the Bellum Gallicum………………………………………………………xi -

Liste Des Peuples Celtes 1 Liste Des Peuples Celtes
Liste des peuples celtes 1 Liste des peuples celtes Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2013). Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section « Notes et références ». (Modifier l'article [1] ) Cet article a pour vocation de servir d'index des peuples celtes ou à caractère celtique. Le nom latin du peuple est donné entre parenthèses lorsque le nom francisé sert de titre à l'article détaillé. Gaule cisalpine Sud du Pô • Boïens (boii) • Lingons (lingones) • Sénons (senones) Nord du Pô • Cénomans (cenomani) • Insubres (insubri) • Taurins (taurini) • Carni Peuples de moindre importance établies au nord du Pô et dominées un temps par les Insubres : Les peuples de la Gaule cisalpine 391-192 av. J.-C. • Anares • Comasques • Laevi • Libici • Lépontiens (lepontii) • Marici • Orobiens (orobii, orumbovii) • Salasses (salassi) Liste des peuples celtes 2 Gaule transalpine Gaule Belgique Article détaillé : Liste des peuples de la Gaule belgique. Remarque : Tous les peuples belges n'étaient probablement pas des Celtes au sens propre du terme, mais leur aristocratie était celtisée. • Aduatuques • Ambiens (Ambiani) • Atrebates (Atrebates) • Bellovaques (Bellovaci) • Caeroesi • Calètes (Caletes) • Catalaunes • Catuslogues (Catuslogi) • Condruses (Condrusi) • Éburons • Geidumnes (Geidumni) • Leuques (Leuci) • Médiomatriques (Mediomatrici) • Ménapiens ou Ménapes (Menapii) • Morins (Morini) • Nerviens (Nervii) • Pémanes (Paemani) • Rèmes (Remi) • Sègnes (Segni) • Silvanectes (Silvanectes) • Suessions (Suessiones) • Tongres (Tungri) • Trévires (treveri) • Tricasses • Viromanduens (Viromandui) Liste des peuples celtes 3 Gaule Celtique Remarque : La Gaule Celtique était habitée par les Celtes.