Des Grands Ensembles
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

N° 290 Nov / Décembre 2004 N° 290
N° 290 Nov / Décembre 2004 N° 290 LES CABINETS MINISTERIELS 4, allée des Noisetiers - 95670 MARLY-la-VILLE LES CABINETS Tél. : 01 34 68 85 69 • Fax : 01 34 68 85 69 MINISTERIELS Fondateur : Pierre DARIUS (1945) Direction générale : Annick DESSAL Abonnement annuel TTC : 37 Euros (Parution trimestrielle) C.C.P. Paris: 23.964.55 Y C.C.P. Paris : 19.118.21 X M. Jacques CHIRAC Président de la République SIRET: 381 709 211 00027 R.C.S. Pontoise: A 381 709 211 5ème Gouvernement de M. Jean-Pierre RAFFARIN A.P.E. : 221E 1ère ÉDITION Liste arrêtée le 12 Décembre 2004 Dépôt Légal Janvier 2004 LES CABINETS MINISTÉRIELS Imprimeur: Imprimerie de Chabrol 4, allée des Noisetiers - 95670 MARLY-la-VILLE Tél. : 01 34 68 85 69 • Fax : 01 34 68 85 69 189, rue d’Aubervilliers - 75886 PARIS Cedex 18 64 - DROITS DE REPRODUCTION RÉSERVÉS - 01 Ministre des Affaires Est délégué auprès du Ministre : Étrangères : Secrétaire d’État à la Réforme SOMMAIRE M. Michel BARNIER p. 21 Présidence de la République : Ministre Déléguée à de l’État : Sont délégués auprès du Ministre M. Éric WOERTH p. 53 M. Jacques CHIRAC p. 4-5 l’Intégration, à l’Égalité des Chances et à la Lutte contre Ministre déléguée aux Ministre de l’Agriculture de Sénat : l’Exclusion : Affaires Européennes : l’Alimentation, de la Pêche et M. Christian PONCELET p. 6-7 Mme Claudie HAIGNERÉ p. 44 Mme Nelly OLIN p. 36 de la Ruralité : Assemblée Nationale : Ministre délégué à la Coopé- M. Dominique BUSSEREAU p. 25 M. Jean-Louis DEBRÉ p. -

Colombes Mag 041 - Septembre 2018.Indd 1 28/08/2018 18:02 Colombes Mag 041 - Septembre 2018.Indd 2 28/08/2018 18:02 La Photo Du Mois
.fr No 41 e mag LE MAGAZINE DES ACTUALITÉS SEPTEMBRE 2018 DE COLOMBES Dossier 39,2 millions d’euros pour l’éducation Colomboscope Hommage Journées européennes Dynamiques Dominique Frélaut du patrimoine les 15 et Forum des associations nous a quittés 16 septembre samedi 8 septembre colombes mag 041 - septembre 2018.indd 1 28/08/2018 18:02 colombes mag 041 - septembre 2018.indd 2 28/08/2018 18:02 La photo du mois Photo Arnaud de Beauregard UN TRIOMPHE EN BLEU, BLANC, ROUGE ! événement exceptionnel, mobilisation exceptionnelle ! Durant le mois de juillet, tout un pays a vibré pour l’Équipe de France à l’occasion de la Coupe du monde de football en Russie. Après des rencontres fantastiques face à l’Argentine, l’Uruguay et la ÀBelgique, les Bleus avaient rendez-vous le dimanche 15 juillet pour défier en finale la surprenante Croatie sur la pelouse du stade de Moscou. Pour retransmettre ce match historique et permettre aux Colombiens de partager en famille ou entre amis ce moment de fièvre sportive, la Ville a mobilisé effectifs et moyens afin de transformer la place Henri- Neveu en « fan zone » officielle. Écran géant, fanions tricolores, feutres de maquillage et bouteilles d’eau distribués au public à l’entrée… Tout était prêt pour une soirée mémorable ! Plus de 2 000 personnes ont assisté ce jour-là au sacre des Bleus. La rencontre, pleine de suspense et de rebondissements, a fait trembler à l’unisson des supporters de tous âges, qui ont laissé éclater leur joie au coup de sifflet final. Un triomphe auquel aura contribué en deuxième mi-temps le milieu de terrain Steven Nzonzi. -

Archives D'histoire Contemporaine Archives De Bernard Poignant
Archives d’histoire contemporaine Archives de Bernard Poignant POI Établi par Émeline Grolleau, archiviste des AHC, sous la direction d'Odile Gaultier- Voituriez, responsable de la coordination archivistique et documentaire du CEVIPOF et du CHSP 2019 Bernard Poignant © Annie Poignant, Tous droits réservés. 2 Introduction Zone d'identification Référence POI Intitulé Poignant Bernard Dates extrêmes 1975-2017 Niveau de description Fonds Nombre d’articles 9 Importance matérielle (ml) 1.05 Zone du contexte Nom du producteur Bernard Poignant Notice biographique Bernard Poignant est né le 19 septembre 1945 à Vannes (Morbihan). Il passe en 1970 l’agrégation d’histoire et devient professeur à l’École normale de Quimper en 1971 puis à l’université de Bretagne occidentale. Il adhère au Parti socialiste (PS) en 1974 et s’engage dès 1975 au sein de la section socialiste de Quimper comme secrétaire. Il occupe, à partir de ce moment-là, de nombreuses responsabilités au sein du Parti socialiste tant au niveau local que national. De 1978 à 1981, il est premier secrétaire de la fédération du Finistère du PS et, à partir de 1981, il devient membre du comité directeur puis du conseil national et du bureau exécutif du PS. Il est, de 1993 à 2001, président de la Fédération nationale des élus socialistes et républicains (FNESR). Il se présente pour la première fois aux élections municipales en 1977 et l'année suivante, il est candidat aux élections législatives. Il est battu les deux fois. En 1981, il est élu député du Finistère. Il se présente, entre 1978 et 1997, cinq fois aux élections législatives pour la première circonscription du Finistère. -
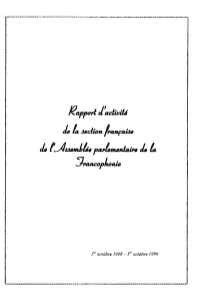
Rapport D'activité De La Section Française De L'assemblée
Rapport d'activité de la section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie 1er octobre 1998 - 1er octobre 1999 - 3 - SOMMAIRE Pages Bureau de la commission de l'Éducation, de la communication et des affaires culturelles 7 Paris, 4 novembre 1998 Bureau de la commission Politique 9 Paris, 26 novembre 1998 Délégation permanente du Bureau 11 Paris, 26 novembre 1998 Séminaire parlementaire : « Les fonctions législative et de contrôle du Parlement » 13 Vientiane (Laos), 14 - 16 décembre 1998 Communications de M. Alain Barrau au nom de la section française : . le contrôle de l'action gouvernementale . le contrôle parlementaire de l'application des lois Assemblée générale de la section française 39 Paris, 23 décembre 1998 Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie 43 Saint-Denis de la Réunion (France), 19 - 21 janvier 1999 Commission de l'Éducation, de la communication et des affaires culturelles 45 Niamey (Niger), 14 - 16 février 1999 - 4 - Audition de M. Charles Josselin, ministre délégué à la coopération et à la francophonie 49 Paris, 17 février 1999 Commission Politique 57 Le Caire (Égypte), 23 - 25 février 1999 Commission de la coopération et du développement 59 Ho Chi Minh Ville (Vietnam), 15 - 19 mars 1999 ••• Rapport de M. Jacques Brunhes au nom de la section française sur "L'économie informelle dans les pays francophones" Commission des Affaires parlementaires 79 Beyrouth (Liban), 15-16 avril 1999 Assemblée générale de la section française 81 Paris, 28 avril 1999 Conférence des Présidents de la Région Europe 83 Bruxelles, 5-6mai 1999 Délégation permanente du Bureau 85 Paris, 1er juin 1999 Bureau de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie 87 Ottawa, 3 juillet 1999 - 5 - XXVème session de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie 89 Ottawa, 5 - 8 juillet 1999 Rapport de M. -

Cabinet Lionel Jospin, Premier Ministre, 1997-2002, Enregistrements Vidéo Réalisés Par Le Service De Presse
Cabinet Lionel Jospin, Premier ministre, 1997-2002, enregistrements vidéo réalisés par le service de presse Répertoire (20030575/1-20030575/680) Archives nationales (France) Pierrefitte-sur-Seine 2003 1 https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_010522 Cet instrument de recherche a été encodé en 2011 par l'entreprise diadeis dans le cadre du chantier de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales sur la base d'une DTD conforme à la DTD EAD (encoded archival description) et créée par le service de dématérialisation des instruments de recherche des Archives Nationales 2 Archives nationales (France) INTRODUCTION Référence 20030575/1-20030575/680 Niveau de description fonds Intitulé Cabinet Lionel Jospin, Premier ministre, 1997-2002, enregistrements vidéo réalisés par le service de presse Date(s) extrême(s) 1997-2002 Nom du producteur • Cabinet du Premier ministre Localisation physique Pierrefitte-sur-Seine DESCRIPTION Présentation du contenu I/HISTORIQUE : Ce fonds a été versé par le service de presse du cabinet de Lionel Jospin, Premier ministre du 3 juin 1997 au 18 juin 2002, et retrace les activités du Premier ministre pendant cette période. II/SERVICE DE PRESSE DU CABINET DU PREMIER MINISTRE : Le service de presse du cabinet du Premier ministre a pour mission de médiatiser l'action du Premier ministre et du gouvernement. A cet effet, il est en liaison avec le Service d'Information du Gouvernement, placé sous l'autorité du Premier ministre et du Secrétariat Général du Gouvernement. Le service de presse joue aussi un rôle important dans les liaisons de Matignon avec l'extérieur (représentation parlementaire, presse, organisations syndicales et professionnelles). -

1 DIRECTION DE LA COMMUNICATION. Les
Archives départementales des Hauts-de-Seine DIRECTION DE LA COMMUNICATION. Les versements présentés ici permettent d'appréhender le développement de la stratégie de communication mise en place par le Département depuis les années 1980. Il est ainsi possible de saisir les priorités données par ce dernier et ce qu'il a voulu faire connaître aux habitants des Hauts-de-Seine. Cela permet aussi de voir comment s'est organisé un service dédié à la communication externe au sein d'une collectivité territoriale qui a vu ses responsabilités et ses compétences augmenter. Les fonds de la Direction de la communication apportent aussi une connaissance globale des services du Département par le biais de leurs actions en communication. La place de la Direction de la communication est en effet centrale au sein du Département puis qu'elle est en relation avec tous les autres services et avec les partenaires du Département. Une étude plus approfondie sur le rôle du directeur de la communication et ses liens étroits avec les présidents du Conseil général peut être suggérée. [1972] - 2015 Histoire administrative : Le département des Hauts-de-Seine a été créé en 1964, suite à la réforme territoriale et administrative de la région parisienne. Il compte 36 communes. La collectivité se dote d'une administration entre 1967 et 1968. Les lois de décentralisation de 1982 et 1983 transfèrent aux collectivités territoriales des compétences auparavant réservées à l'État. La communication devient pour le Département un outil indispensable pour faire connaître ses actions sur le territoire des Hauts-de-Seine. Entre 1982 et 2006, se sont succédés à la tête du Conseil général des Hauts-de- Seine : - Paul Graziani (1982-1988) - Charles Pasqua (1988-2004) - Nicolas Sarkozy (2004-2007) - Patrick Devedjian (2007-2020) La Direction de la communication a été créée en 1989. -

De La République Française
)SSN 0249-3088 Année 1993. — No 37 [1] A.N. (C .R.) 0242-6765 Vendredi 25 juin 1993 DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 10° Législature SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1992-1993 (70e SÉANCE) COMPTE RENDU INTÉGRAL i re séance du jeudi 24 juin 1993 2162 ASSEMBLÉE NATIONALE — 1' SÉANCE DU 24 JUIN 1993 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M . PIERRE-ANDRÉ WILTZER FERMETURES D'ÉCOLES ET DE GARES 1 . Questions orales sans débat (p. 2164). Question de Mme Royal (p . 2176) CONDITIONS D'AT TRIBUTION Mme Ségolène Royal, M . Pascal Clément, ministre délégué DES PRIMES ET AIDES AU LOGEMENT aux relations avec l 'Assemblée nationale. Question de M. Périssol (p . 2164) EFFECTIFS DE POLICE À STRASBOURG MM. Pierre-André Périssol, Hervé de Charette, ministre du logement. Question de M. I.app (p. 2178) TRANSPORTS EN COMMUN DANS LES YVELINES MM. Harry Lapp, Pascal Clément, ministre délégué aux rela- Question de M. Cuq (p . 2166) tions avec l'Assemblée nationale. M::1 . Henri Cuq, Pascal Clément, ministre délégué aux rela- tions avec l'Assemblée nationale. ÉTABLISSEMENTS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE ÉTABLISSEMENTS CHAUSSON Question de M. Genil oy (p . 2179) Question de M. Brunhes (p . 2167) MM. Aloys Geoffroy, Pascal Clément, ministre délégué aux MM. Jacques Brunhes, Gérard Longuet, ministre de l 'indus- relations avec l 'Assemblée nationale. trie, des postes et télécommunications et du commerce exté- rieur. PROBLÈMES FINANCIERS DES COMMUNES CONCURRENCE ÉTRANGÈRE DANS LE SECTEUR DU TEXTILE Question de M. Hage (p. 2168) Quest;an de M. de Boishue (p. 2180) MM. Georges Hage, Gérard Longuet, ministre de l 'industrie. -

Rapprocher L'élu Et Le Citoyen. La « Proximité
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by OpenEdition Mots. Les langages du politique 77 | 2005 Proximité Rapprocher l’élu et le citoyen. La « proximité » dans le débat sur la limitation du cumul des mandats (1998-2000) Rémi Lefebvre Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/mots/127 DOI : 10.4000/mots.127 ISSN : 1960-6001 Éditeur ENS Éditions Édition imprimée Date de publication : 1 mars 2005 Pagination : 41-57 ISBN : 2-84788-077-1 ISSN : 0243-6450 Référence électronique Rémi Lefebvre, « Rapprocher l’élu et le citoyen. La « proximité » dans le débat sur la limitation du cumul des mandats (1998-2000) », Mots. Les langages du politique [En ligne], 77 | 2005, mis en ligne le 31 janvier 2008, consulté le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/mots/127 ; DOI : 10.4000/mots.127 © ENS Éditions Rémi Lefebvre Rapprocher l’élu et le citoyen. La «proximité» dans le débat sur la limitation du cumul des mandats (1998-2000) La proximité est devenue dans le champ politique une référence obligée, un mot d’ordre unanimement mis en avant par le personnel politique et pensé comme un remède à la crise du politique. Dans le contexte de plus en plus in- tériorisé par les élus d’une crise de la représentation, la proximité est perçue comme une manière de ressourcer la légitimité politique et de refonder le lien représentatif en ancrant les pratiques politiques dans l’immédiateté et la con- crétude des problèmes rencontrés par les citoyens1. Elle est devenue ainsi un parangon de modernité. La modernisation politique a longtemps renvoyé à un processus de dépersonnalisation des relations politiques et d’éradication des relations clientélaires de dépendance personnelle. -

Lm970612.Pdf
LeMonde Job: WMQ1206--0001-0 WAS LMQ1206-1 Op.: XX Rev.: 11-06-97 T.: 11:18 S.: 111,06-Cmp.:11,11, Base : LMQPAG 29Fap:99 No:0311 Lcp: 196 CMYK CINQUANTE-TROISIÈME ANNÉE – No 16290 – 7,50 F JEUDI 12 JUIN 1997 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI a 1 200 soldats L’Allemagne accepte une politique de l’emploi Philippe Séguin français au Congo La France a renforcé, mercredi 11 juin, cherche à assurer son dispositif militaire à Brazzaville, où européenne pour éviter le conflit avec Paris aucune médiation n’est parvenue à son emprise faire cesser les hostilités. p. 5 La Banque de France est intervenue pour soutenir le franc L’ALLEMAGNE, d’abord, mais motion favorable à l’inscription sur l’appareil a aussi le président en exercice de d’un « chapitre emploi » dans le Mise en examen l’Union européenne (UE), le Néer- traité Maastricht II devant être landais Wim Kok, et le président adopté à Amsterdam. du RPR de la banque Rivaud de la Commission de Bruxelles, Le Luxembourgeois Jacques La banque Rivaud, qui fut longtemps Jacques Santer, se sont mobilisés, Santer a présenté au nom de la PHILIPPE SÉGUIN a été élu proche du RPR, a été mise en examen mardi 10 juin, pour tenter de don- Commission un projet de résolu- président du groupe RPR de l’As- pour escroquerie. p. 34 ner satisfaction au gouvernement tion en ce sens, de même que le semblée nationale, mardi 10 juin, à de Lionel Jospin qui entend premier ministre des Pays-Bas, le une très large majorité (125 voix mettre l’emploi en tête des priori- social-démocrate Wim Kok. -

Satisfaits De Gennevilliers À 81 % Un Récent Sondage Le Montre : 81 % Des Gennevillois Sont Satisfaits, Voire Très Satisfaits, De Vivre Ici
•• Octobre 2018 •• N°295 s GENNEVILLIERS MAGAZINE TOUS POUR UNE : LA PAIX P. 16 CANTINES : C’EST BON ET C’EST BIO P. 32 SONDAGE Satisfaits de Gennevilliers à 81 % Un récent sondage le montre : 81 % des Gennevillois sont satisfaits, voire très satisfaits, de vivre ici. Au-delà de ce seul bon score, les chiffres disent beaucoup du sentiment des habitants, tous sujets et tous âges confondus. Décryptage en pages 18 à 21. HOKISUSHI 90x65.qxp_Mise en page 1 17/04/2018 15:22 Page1 WATELET 90x135.qxp_Mise en page 1 31/03/2017 08:37 Page1 LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU -30%* UNIQUEMENT SUR PLACE *Pour toute réservation faite le jour même avant 21h (hors boisson et hors dessert). Réservation www.hokisushi-gennevilliers.fr 09 50 92 56 55 32 rue Henri Barbusse - 92230 GENNEVILLIERS Métro Gabriel Péri Asnières Gennevilliers - Ligne 13 ELGEA / SCCV 190x135.indd 1 20/09/2018 09:51 GEN MAG - OCTOBRE 2018.indd 1 24/09/2018 10:27 HOKISUSHI 90x65.qxp_Mise en page 1 17/04/2018 15:22 Page1 WATELET 90x135.qxp_Mise en page 1 31/03/2017 08:37 Page1 LIVRAISON GRATUITE À DOMICILE & BUREAU EN IMAGES p. 6 sondage %* -30 Emportés p. 18/21 UNIQUEMENT 96 % des jeunes se plaisent ici par la foule SUR 29 % des habitants PLACE Le Forum a encore fait le plein se disent très *Pour toute réservation faite satisfaits et 52 % le jour même avant 21h PlutÔT SatisFAIT (hors boisson et hors dessert). plutôt satisfaits… DE VIVRE Réservation À GENNEVILLIERS soit 81 % au total www.hokisushi-gennevilliers.fr 09 50 92 56 55 quand la moyenne 52 % 32 rue Henri Barbusse - 92230 GENNEVILLIERS régionale n’atteint Nspp 1 % Métro Gabriel Péri Asnières Gennevilliers - Ligne 13 que 76 %. -

1 CABINET DU PREFET ET SECRETARIAT GENERAL Au
Archives départementales des Hauts-de-Seine CABINET DU PREFET ET SECRETARIAT GENERAL Au cabinet, qui traite les affaires réservées du Préfet, sont également rattachés des services de police et sécurité, de transmission, de documentation, de relations avec la presse, et une cellule pour les questions de logement. Le secrétariat général de la Préfecture est plus particulièrement chargé des questions de formation et de modernisation, mais il comprend également un service du logement (attributions, expulsions locatives, plan départemental et conventions). 1948 - 2019 Organisation et fonctionnement des services du Cabinet. Organisation. 2876W7 Organisation de la préfecture : annuaire, arrêtés préfectoraux, effectifs, notes de services, plans de salles de réunions (1983-1986). Organisation et fonctionnement des services des étrangers des sous-préfectures d'Antony et de Boulogne-Billancourt : instructions, statistiques, notes, plans des locaux, état numérique des étrangers en résidence dans les Hauts-de-Seine par nationalité (1983-1985). Organisation et fonctionnement du service des étrangers à Nanterre : rapports, notes, correspondance, instructions (1983-1987). Enquête sur le fonctionnement de la DDASS : correspondance, notes, organigramme, rapport d'enquête (1971-1972). 1971 - 1987 2876W8/1 Plan de modernisation de la préfecture : instructions, fiches actions. 1988 - 1989 2876W10 Plan de modernisation de la préfecture et projets de services : rapport d'inspection, plan triennal, documents de communication, projets de services, tableaux de suivi. 1990 - 2001 2876W8/2 Collèges des chefs de services : ordres du jour, comptes rendus, documents de présentation (1996, 1998, 1999) (très lacunaire). Réunions avec les directeurs de préfecture : comptes rendus (1998). 1969 - 1999 2876W9 Affectation et organisation des locaux des services extérieurs de l'Etat : correspondance, notes (1982-1984). -

Les Agnettes Valent Le Coût !
•• Novembre 2019 •• N°307 s GENNEVILLIERS MAGAZINE FOIRE AUX VINS : 22, 23 ET 24 NOVEMBRE P. 12 LA CHASSE AUX TRÉSORS… DE BANLIEUES P. 16 Les Agnettes valent le coût ! Les habitants des Agnettes sont sur la brèche. Ils souhaitent que les engagements pris par l’ANRU (Agence nationale de rénovation urbaine) soient respectés et que le Département apporte aussi sa contribution. La qualité a certes un coût… mais la qualité de vie n’a pas de prix. Pages 18 à 21. SNMV 90X135.qxp_SNMV 105X148 28/06/2019 09:47 Page1 ISOLATION Pour tous vos projets, DESIGN SÉCURITÉ TRYBA est là ! PORTES DIAGNOSTIC OUVERTESET DEVIS du 07 auGRATUITS 17 MARS NOUVEAU MAGASIN Au Pont de la Puce 177, av Henri Barbusse À COLOMBES le carnet de garantie Tryba le carnet de garantie (1) 01 84 20 91 25 selon (1) Suivant carnet de garantie TRYBA. (1) 79, av de la Marne - ASNIÈRES - 01 47 91 25 75 177, av Henri Barbusse - COLOMBES - 01 84 20 91 25 TRYBA_AP_generique_297x210.indd 1 03/07/2018 09:14 TRYBA 90X65.indd 1 05/06/2019 11:56 TOUS LES WEEK-ENDS évènements performances spectacles colloques → Ouvert les mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 19h, le samedi et le dimanche de 9h à 18h. L’exposition est ouverte au public, tous les jours pendant les vacances de JUSQU’AU 30 NOVEMBRE la Toussaint. Fermeture les 1er et 11 novembre. Visite guidée pour les individuels et les familles, les week-ends à 15h et 17h sur réservation 06 16 56 98 52.