Tableaux De Maîtres
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tableaux Des Xixème & Xxème Siècles Art Contemporain
TABLEAUX DES XIXÈME & XXÈME SIÈCLES ART CONTEMPORAIN Lundi 27 mars 2017 à 14h30 Drouot-Richelieu PEINTRES D’ASIE TABLEAUX DU XIXème SIÈCLE, IMPRESSIONNISTES & MODERNES ART CONTEMPORAIN 6 RESPONSABLE DE LA VENTE Charlotte Reynier-Aguttes 01 41 92 06 49 [email protected] DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT SPÉCIALISTE Charlotte Reynier-Aguttes RESPONSABLE ART CONTEMPORAIN SPÉCIALISTE JUNIOR Ophélie Guillerot 01 47 45 93 02 [email protected] RESPONSABLE DU DÉPARTEMENT À LYON Valérianne Pace 04 37 24 24 28 [email protected] RELATIONS ASIE Aguttes拍卖公司可提供中文服务(普通话及粤语), 请直接联系 [email protected] AGUTTES NEUILLY 164 bis, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Tél. : 01 47 45 55 55 ADMINISTRATION GESTION DU STOCK ET DES CONTRATS RECHERCHES BIBLIOGRAPHIQUES Anne-Marie Roura Cyrille de Bascher Angèle Coulard 01 41 92 06 48 01 47 45 93 03 Alexandra Sion [email protected] [email protected] PEINTRES D’ASIE TABLEAUX DU XIXème SIÈCLE, IMPRESSIONNISTES & MODERNES ART CONTEMPORAIN Lundi 27 mars 2017 à 14h30 Drouot-Richelieu - Salle 5 Expositions publiques - Aguttes Neuilly Le 9 mars (10h-13h & 14h-18h), le 10 (10h-13h) Du 13 au 16 mars (10h-13h & 14h-18h), le 17 (10h-13h) Du 20 mars au 23 mars (10h-13h & 14h-18h) Expositions complètes Drouot-Richelieu - 9 rue Drouot - 75009 Paris Tél : 01 48 00 20 05 Samedi 25 mars (11h-18h) Lundi 27 mars (11h-12h) AGUTTES NEUILLY Catalogue et résultats visibles sur www.aguttes.com 164 bis, avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine Enchérissez en live sur Tél. : 01 47 45 55 55 AGUTTES LYON-BROTTEAUX Important : Les conditions de vente sont visibles en fin de catalogue 13 bis, place Jules Ferry Nous attirons votre attention sur les lots suivis de +, °, *, #, ~ pour lesquels 69006 Lyon s’appliquent des conditions particulières décrites en fin de catalogue. -

Jordi Colomer Au Pays De Gulliver. Échelle, Rêve Et Nature
sommaire sommaire X Cinecito contents X François Piron Debout les morts Rousing the dead X Simo Bernard Marcadé X Les Villes X Anarchitekton Marie-Ange Brayer X Prototipos X Papamovil X Babelkammer X Mario Flecha La table de Monsieur Malik Mr Malik’s table X Un crime Jacinto Lageira X Arabian stars Christine Van Assche X Conversation entre Conversation between Jordi Colomer et / and Marta Gili X Père Coco et quelques objets trouvés en 2001 X 2 Av X Le Dortoir Gloria Picazo X Fuegogratis X No Future X En la pampa Marti Peran X Pozo almonte X José Luis Barrios Jordi Colomer au pays de Gulliver Jordi Colomer in the land of Gulliver X Escenita Tocopilla X Notices techniques / Technical notes X Biographies / Biographies X Bibliographie / Bibliography X Expositions / Exhibitions Prototipos (2004). Sept maquettes d’étranges chars d’assaut en carton blanchi sont posées sur le plateau d’une longue table métallique qui ploie, d’évidence pas sous le poids du matériau, mais peut-être sous celui de la mélancolie. Objets de peu de réalité : répliques de répliques, ils surgissent d’une image fugace du passé. Ce sont sur des photographies de manifestations de la CNT -FAI (Confederacion nacional del trabajo- Federación anarquista ibérica) en 1936 à Barcelone qu’apparaissent ces engins guerriers artisanaux, blindés de carnaval, construits à partir de véhicules réquisitionnés et habillés de carapaces métalliques à l’aube de la guerre civile espagnole, semblables à ces insectes cuirassés en gladiateurs pour effrayer leurs prédateurs, plus défensifs qu’offensifs. Velléitaires armes de carton-pâte contre la menace, on ne peut plus réelle, d’un retour de l’ordre en train de s’instaurer, ces véhicules n’ont presque pas existé : les photographies d’époque les montrent exhibés lors de parades, fièrement présentés à une foule persuadée d’une victoire facile et rapide, mais ils n’ont finalement jamais été utilisés. -

Bg-Afrique-141218-100.Pdf
ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 EXPERTS Patrick Caput Expert CNE, Expert SFEP 14, quai des Célestins – 75004 Paris – +33 (0)6 03 26 78 20 [email protected] Bernard Dulon Expert CNE Expert près la Cour d’Appel de Paris 18, boulevard Montmartre – 75009 Paris – +33 (0)6 07 69 91 22 [email protected] assistés d’Emmanuelle Menuet Expert SFEP 17, rue Vauthier – 92100 Boulogne – +33 (0)6 70 89 54 87 [email protected] Pour accéder à la page web de notre vente veuillez scaner ce QR Code Nous adressons nos sincères remerciements à messieurs Alain-Michel Boyer, Bertrand Goy, Bernard de Grunne et Louis Perrois Première de couverture : lot 18 ; page 1 : lot 27 ; page 113 : lot 7 ; page 115 : lot 36 ; en quatrième de couverture : lot 63 ARTS D’AFRIQUE ET D’OCÉANIE VENDREDI 14 DÉCEMBRE 2018 PARIS - DROUOT - SALLE 4 - 15 H30 EXPOSITIONS PUBLIQUES Hôtel Drouot - salle 4 Jeudi 13 décembre de 11h à 21h Vendredi 14 décembre de 11h à 14h Téléphone pendant l’exposition +33 (0)1 48 00 20 04 CONTACT Raphaële Laxan +33 (0)1 47 70 48 00 [email protected] 5, rue La Boétie - 75008 Paris - tél. +33 (0)1 47 42 78 01 - fax. +33 (0)1 47 42 87 55 [email protected] - www.binocheetgiquello.com o.v.v. agrément n°2002 389 - Habilité pour la vente : Alexandre Giquello QUELQUES ŒUVRES DE LA COLLECTION HUBERT GOLDET 1 2 Étrier de poulie de métier à tisser Baoulé, Côte d’Ivoire Étrier de poulie de métier à tisser Gouro, Côte d’Ivoire Bois dur à patine brun foncé noir granuleuse, noix de corozo Bois dur à patine brun foncé noir H. -

La Clé Des Champs Urbains En Gironde
SPIL a c l é d e s c h a m pRIT s u r b a i n s e n G i r o n d e #30 Mai 2007 GRATUIT Mai #30 LA MATIÈRE ET L’ESPRIT La belle ou la bête Le prêtre Manes, au III° siècle, affirmait que le monde dépendait de deux puissances adverses : la Lumière contre les Ténèbres, le Bien contre le Mal. Et l’on se moque souvent de cette façon de penser simpliste et brutale où la réalité se limite à un échiquier à deux cases. Cases qui pourraient se décliner à l’infini suivant nos désirs et nos croyances : matière et esprit, Eros et Thanatos, Orient et Occident, inné et acquis, santé et maladie, 0 et1, etc. « Au moment de la résolution, les tonalités délicates s’épaississent, l’arc-en-ciel du réel et le grain subtil de nos vies s’effacent pour se réduire à deux pôles contraires. » Ces dualismes sont toujours décevants car ils délaissent la complexité et le chatoiement des êtres, leurs variétés singulières et leurs histoires personnelles. La sagesse populaire sait bien d’ailleurs que personne n’est tout bon ou tout méchant et que le charbon est une forme de diamant. Mais quand il faut choisir, quand la décision doit remplacer la finesse des délibérations, alors les positions se raidissent, le contraste augmente, il faut trancher. Au moment de la résolution, les tonalités délicates s’épaississent, l’arc-en-ciel du réel et le grain subtil de nos vies s’effacent pour se réduire à deux pôles contraires. -

Picasso - Enseignant Primaire.Pdf
DOSSIER PEDAGOGIQUE ECOLE ÉLÉMENTAIRE Dossier pédagogique. Enseignant Primaire 1 Carrières de Lumières SOMMAIRE I – PRÉPARATION DE LA VISITE 1. Présentation du site 3 2. Les Carrières, l’exposition immersive et les programmes scolaires 4 3. Les objectifs d’apprentissage 5 4. Méthode du dossier : de la préparation au réinvestissement en classe 7 5. La chronologie de la vie et de l’œuvre de Pablo Picasso 8 6. Histoire des arts : la peinture espagnole de Goya, Picasso, Rusinol, Zuloaga, Sorolla 9 7. Plan repère des Carrières 10 8. Informations et réservation 11 II – PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DU CYCLE 2 Parcours de l’exposition immersive 12 III – APRÈS LA VISITE 1. Découverte des tableaux des maîtres espagnols et de Picasso 14 2. Fiche de correction des questionnaires 21 Qu’as-tu retenu? Quiz bilan 23 II – PENDANT LA VISITE POUR LES CLASSES DU CYCLE 3 Parcours de l’exposition immersive 25 III – APRÈS LA VISITE 1. Découverte des tableaux des maîtres espagnols et de Picasso 27 2. Initiation à l’Histoire des arts 38 3. Fiche de correction des questionnaires 40 Qu’as-tu retenu? Quiz bilan 46 2 AVANT LA VISITE 1 – Présentation du site Au pied de la cité des Baux-de-Provence, au cœur des Alpilles, se trouve un lieu chargé de mystère : le Val d’Enfer. Ce vallon aux concrétions minérales exceptionnelles a inspiré les artistes depuis toujours : Dante y planta le décor de La Divine Comédie alors que Gounod y créa son opéra Mireille. Plus tard, Cocteau est venu réaliser, au sein même des carrières, Le Testament d’Orphée. -
![Miranda, 10 | 2014, « Images on the Move: Circulations and Transfers in Flm » [En Ligne], Mis En Ligne Le 31 Décembre 2014, Consulté Le 16 Février 2021](https://docslib.b-cdn.net/cover/9641/miranda-10-2014-%C2%AB-images-on-the-move-circulations-and-transfers-in-flm-%C2%BB-en-ligne-mis-en-ligne-le-31-d%C3%A9cembre-2014-consult%C3%A9-le-16-f%C3%A9vrier-2021-3089641.webp)
Miranda, 10 | 2014, « Images on the Move: Circulations and Transfers in Flm » [En Ligne], Mis En Ligne Le 31 Décembre 2014, Consulté Le 16 Février 2021
Miranda Revue pluridisciplinaire du monde anglophone / Multidisciplinary peer-reviewed journal on the English- speaking world 10 | 2014 Images on the Move: Circulations and Transfers in film De la circulation des images au cinéma Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/miranda/6144 DOI : 10.4000/miranda.6144 ISSN : 2108-6559 Éditeur Université Toulouse - Jean Jaurès Référence électronique Miranda, 10 | 2014, « Images on the Move: Circulations and Transfers in film » [En ligne], mis en ligne le 31 décembre 2014, consulté le 16 février 2021. URL : http://journals.openedition.org/miranda/6144 ; DOI : https://doi.org/10.4000/miranda.6144 Ce document a été généré automatiquement le 16 février 2021. Miranda is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. 1 SOMMAIRE Images on the Move: Circulations and Transfers in film De la circulation des images au cinéma Introduction Zachary Baqué Theorizing film movement: space and rhythm Approche théorique du mouvement : espace et rythme au cinéma L’image-espace : propositions théoriques pour la prise en compte d’un « espace circulant » dans les images de cinéma Antoine Gaudin Le tambour rythmique : pour un cinéma de la régression improductive Massimo Olivero Generic approaches to movement on screen Mouvement et genres au cinéma The paradoxes of cinematic movement: is the road movie a static genre? Anne Hurault-Paupe Circulation dans Cars 2 (John Lasseter - Brad Lewis, 2011) et Drive (Nicolas Winding Refn, 2011) Yann Roblou Choreographing Genre in Kill Bill Vol. 1 & 2 (Quentin Tarantino, 2003 & 2004) David Roche Circulation of Films in the Digital Age Nouvelles technologies et circulation des oeuvres A travers deux métafilms contemporains : les espaces numériques, nouveaux territoires de l'ontologie cinématographique Julien Achemchame De la pellicule au pixel. -

Des Voix En Voie. Les Femmes, C(H)Œur Et Marges Des Avant-Gardes
THÈSE Pour obtenir le grade de DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ DE GRENOBLE préparée dans le cadre d’une cotutelle entre l’Université de Grenoble et l'Université de Turin Spécialité : LLSH / Lettres et Arts / Recherches sur l'Imaginaire Arrêté ministériel : le 6 janvier 2005 -7 août 2006 Présentée par Elisa BORGHINO Thèse dirigée par Mme Franca BRUERA et codirigée par M. Jean-Pol MADOU préparée au sein des Laboratoire LLS de l'Université de Savoie et Dipartimento di Scienze del Linguaggio e Lettterature Moderne e Comparate dans les Écoles Doctorales Langues, Littératures et Sciences Humaines (50) et Culture Classiche e Moderne Des voix en voie. Les femmes, c(h)œur et marges des avant-gardes Thèse soutenue publiquement le 28 septembre 2012, devant le jury composé de : Monsieur Jean-Pol Madou Université de Savoie (Président du jury) Madame Franca BRUERA Université de Turin (Secrétaire du jury) Madame Silvia CONTARINI Université Paris Ouest-Nanterre La Défense (Membre du jury) Madame Laura COLOMBO Université de Vérone (Membre du jury) Université Joseph Fourier / Université Pierre Mendès France / Université Stendhal / Université de Savoie / Grenoble INP Elisa Borghino, Des voix en voie RÉSUMÉ Des voix en voie. Les femmes, c(h)oeur et marges des avant-gardes étudie le dense réseau de relations établies par quelques figures féminines qui ont inspiré des projets et des recherches au sein des avant-gardes historiques dans le panorama français du début du XXe siècle. La présente étude s'intéresse à des femmes – Sonia Delaunay, Claire Goll, Marie Laurencin, Hélène d'Œttingen, Valentine de Saint-Point et Elsa Triolet – qui ont travaillé de concert avec les représentants majeurs des avant-gardes émergentes, en donnant naissance à des projets et à des collaborations à travers l'Europe. -

Art Action En Indonésie Art Action in Indonesia Iwan Wijono
Document généré le 30 sept. 2021 05:35 Inter Art actuel Art action en Indonésie Art Action in Indonesia Iwan Wijono Numéro 83, hiver 2002–2003 URI : https://id.erudit.org/iderudit/45986ac Aller au sommaire du numéro Éditeur(s) Les Éditions Intervention ISSN 0825-8708 (imprimé) 1923-2764 (numérique) Découvrir la revue Citer cet article Wijono, I. (2002). Art action en Indonésie. Inter, (83), 2–23. Tous droits réservés © Les Éditions Intervention, 2003 Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne. https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/ Cet article est diffusé et préservé par Érudit. Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. https://www.erudit.org/fr/ A rt a ct i o n en Indonésie iu»fc _____H___B Iwan WIJONO X J_ff * __^^____ll^__pl^*' • • B sr*^^- >«J 5^'. Art action en Indonesiejwan WIJONO Ce texte ne prétend pas rendre compte de l'ensemble du développement de l'art corporel et de l'art action (plus souvent appelés arts de la performance) en Indonésie. Il se concentre plutôt sur le développement de la performance qui a émergé des secteurs sociopolitique et artistique de Java et des régions environnantes, où l'art de la performance est maintenant consi déré comme très important au sein même de la communauté artistique et dans le discours sur l'art contemporain indonésien. -

Jeudi 6 Juin 2019
Thierry de MAIGRET Jeudi 6 juin 2019 Paris - Hôtel Drouot Jeudi 6juin2019 5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. +33 (0)1 44 83 95 20 - Fax +33 (0)1 44 83 95 21 www.thierrydemaigret.com - [email protected] Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agrément n° 2002 - 280 AUTOGRAPHES – PHOTOGRAPHIES ESTAMPES ANCIENNES et MODERNES SCULPTURES et TABLEAUX des XIXème et XXème siècles ART NOUVEAU – ART DÉCO VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES HÔTEL DROUOT - Salle 10 9, rue Drouot - 75009 PARIS Jeudi 6 juin 2019, à 13 heures 30 Experts : Thierry BODIN, Les Autographes Louis RANÇON 45, rue de l’Abbé Grégoire – 75006 Paris 12, rue de la Visitation – 35000 Rennes Tél. : + 33 (0)1 45 48 25 31 Tél. : + 33 (0)2 23 20 05 18 Antoine ROMAND Amaury de LOUVENCOURT – Agnès SEVESTRE-BARBÉ 22, rue Bisson – 75020 Paris 8, rue Drouot – 75009 Paris Tél. : + 33 (0)6 07 14 40 49 Tél. : + 33 (0)1 42 89 50 20 Sylvie COLLIGNON Jean-Marc MAURY 45, rue Sainte-Anne – 75001 Paris 29, avenue de Paris – 92320 Chatillon Tél. : +33 (0)1 42 96 12 17 Tél. : + 33 (0)6 85 30 36 66 Contact à l’Étude : Juliette BLONDEAU – [email protected] EXPOSITIONS PUBLIQUES : Mercredi 5 juin de 11 heures à 18 heures - Jeudi 6 juin de 11 heures à 12 heures Téléphone pendant l’exposition et la vente : + 33 (0)1 48 00 20 10 L’ensemble des tableaux non photographiés au catalogue sont reproduits sur thierrydemaigret.com 1ère de couverture : lot n° 189 (détail) - 4ème de couverture : lot n° 124 (détail) Experts : AUTOGRAPHES Thierry BODIN, Les Autographes (lots 1 à 11) Syndicat Français des Experts Professionnels en Œuvres d’Art 45, rue de l’Abbé Grégoire – 75006 Paris Tél. -

Bruxelles, 2013 Art and Literature Scientific and Analytical Journal
Art and Literature Scientific and Analytical Journal Texts 4.2013 Bruxelles, 2013 EDITORIAL BOARD Chief editor Burganova M. A. Pletneva A. A. (Russia) — Candidate of Sciences, research associate of Russian Bowlt John Ellis (USA) — Doctor of Language Institute of the Russian Academy Science, Professor of Slavic Languages of Sciences; and Literatures in University of Southern Pociechina Helena (Poland) — Doctor California; of Science; Profesor of the University of Burganov A. N. (Russia) — Doctor of Warmia and Mazury in Olsztyn; Science, Professor of Stroganoff Moscow Pruzhinin B. I. (Russia) — Doctor of State Art Industrial University, Full-member Sciences, Professor, editor-in-chief of of Russia Academy of Arts, National Artist of Problems of Philosophy; Russia, member of the Dissertation Council Ryzhinsky A. S. (Russia) — Candidate of of Stroganoff Moscow State Art Industrial Sciences, Senior lecturer of Gnesins Russian University; Academy of Music; Burganova M. A. (Russia) — Doctor of Sahno I. M. (Russia) — Doctor of Sciences, Science, Professor of Stroganoff Moscow Professor of Peoples’ Friendship University State Art Industrial University, Full-member of Russia; of Russia Academy of Arts, Honored Artist of Sano Koji (Japan) Professor of Russia, member of the Dissertation Council Toho Gakuyen University of Music of Stroganoff Moscow State Art Industrial (Japan) — Professor of Toho Gakuyen University, editor-in-chief; University of Music; Glanc Tomáš (Germany) — Doctor of Shvidkovsky Dmitry O. (Russia) — Vice- Science of The Research -
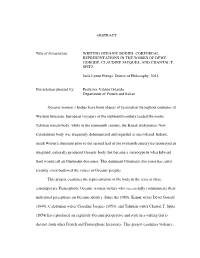
ABSTRACT Title of Dissertation
ABSTRACT Title of dissertation: WRITING OCEANIC BODIES: CORPOREAL REPRESENTATIONS IN THE WORKS OF DÉWÉ GORODÉ, CLAUDINE JACQUES, AND CHANTAL T. SPITZ Julia Lynne Frengs, Doctor of Philosophy, 2013 Dissertation directed by: Professor Valérie Orlando Department of French and Italian Oceanic women’s bodies have been objects of fascination throughout centuries of Western literature. European voyagers of the eighteenth century lauded the exotic Tahitian female body, while in the nineteenth century, the Kanak (indigenous New Caledonian) body was frequently dehumanized and regarded as uncivilized. Indeed, much Western literature prior to the second half of the twentieth century has portrayed an imagined, culturally produced Oceanic body that became a stereotype in what Edward Said would call an Orientalist discourse. This dominant Orientalist discourse has, until recently, overshadowed the voices of Oceanic peoples. This project examines the representation of the body in the texts of three contemporary Francophone Oceanic women writers who successfully communicate their individual perceptions on Oceanic identity. Since the 1980s, Kanak writer Déwé Gorodé (1949), Caledonian writer Claudine Jacques (1953), and Tahitian writer Chantal T. Spitz (1954) have produced an explicitly Oceanic perspective and style in a writing that is distinct from other French and Francophone literatures. This project examines violence, specifically sexual violence, and treatments of the damaged body in the literature of Gorodé, Jacques, and Spitz, who turn the body into a political instrument. The display of sexual violence in these works forces the body into a public position, fostering a discussion and critique of the politics of Oceanic communities. Additionally, this dissertation discusses the political body, which is often either represented as in isomorphism with the land, or as rupturing the confinement endured in colonial-imposed institutions. -
MODERNITÉS PLURIELLES DOCUMENT D’AIDE À LA VISITE POUR LES RELAIS DU CHAMP SOCIAL CRÉDITS Textes Rédigés Par Catherine Lascault
PRÉPAREZ VOTRE VISITE ! MODERNITÉS PLURIELLES DOCUMENT D’AIDE À LA VISITE POUR LES RELAIS DU CHAMP SOCIAL CRÉDITS Textes rédigés par Catherine Lascault En couverture : Œuvre 12 Tamara de LEMPICKA (Tamara GORSKA, dit), Jeune fille en vert: © Coll. Centre Pompidou / Service de la documentation photographique © Coll. Centre Pompidou / Service de la documentation photographique du MNAM du MNAM / Dist. RMN-GP / Dist. RMN-GP © Succession Picasso © Tamara Art Heritage / Adagp, Paris Œuvre 14 © Coll. Centre Pompidou / Service de la documentation photographique Page 6 du MNAM / Dist. RMN-GP © G. Meguerditchian © Man Ray Trust / Adagp, Paris Œuvre 15 Pages 8 et 9 © Coll. Centre Pompidou / Service de la documentation photographique © coll. Centre Pompidou / G. Meguerditchian / dist. RMN-GP, © D.R du MNAM / Dist. RMN-GP © coll. Centre Pompidou / J. Faujour / dist. RMN-GP, © Adagp, 2013 © Tamara Art Heritage / Adagp, Paris Œuvre 16 Œuvres n°1, 2, 3, 9, 13 © Coll. Centre Pompidou / Jacques Faujour / Dist. RMN-GP © Coll. Centre Pompidou / Philippe Migeat / Dist. RMN-GP © domaine public © Adagp, Paris Œuvre 17 Œuvre 4 © Coll. Centre Pompidou / Jean-Claude Planchet / Dist. RMN-GP © Adagp, Paris © Mate Mestrovic Œuvre 5 Œuvre 18 © Coll. Centre Pompidou / Philippe Migeat / Dist. RMN-GP © Coll. Centre Pompidou / Service de la documentation photographique du MNAM © droits réservés / Dist. RMN-GP Œuvre 6 © Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. / Adagp, © Musée d’Orsay Paris Œuvre 7 Œuvre 19 © Coll. Centre Pompidou / Jacques Faujour / Dist. RMN-GP © Coll. Centre Pompidou / Jacqueline Hyde / Dist. RMN-GP © droits réservés © Adagp, Paris Œuvre 8 Œuvre 20 © Coll. Centre Pompidou / Philippe Migeat / Dist.