Le Canal Du Midi Au 17E Siècle
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

BT2 N°284, Les Trains Et L'imaginaire .Pdf
² N°284 Février 1986 Les trains et l'imaginaire Depuis plus de cent cinquante ans, le chemin de fer organise l'espace et modifie les distances et les perceptions. Dès sa création, le train a suscité l'enthousiasme ; très vite il a aussi provoqué l'inquiétude –parfois à bon droit -, et souvent la crainte qu'il inspirait venait tout droit des fantasmes des voyageurs ou des artistes … Car le train et son environnement ont toujours été objets de création pour les architectes, les peintres, les écrivains, les cinéastes. … Tantôt ces artistes ont noté leurs impressions et sentiments, tantôt ils ont fait du chemin de fer un personnage de leur œuvre, tout au-moins un décor jamais neutre. Cette brochure vous propose un reportage, depuis les années 1830 jusqu'à nos jours, parmi les œuvres littéraires et pastiques inspirées par ce sujet. Source d'angoisse ou de volupté ? Comment Hugo, Zola, Cendrars, Butor ont-ils parlé de ces voyages, paysages et personnages ferroviaires ? Comment Monet, Delvaux ou Bilal les ont-ils mis en images ? Et pour finir, du tortillard au TGV, comment nos contemporains vivent-ils la transformation du rail ? Car le train de la fin du XIX° siècle ouvre, lui aussi, des portes à notre imaginaire ! Mots-clefs angoisse, B.D., cinéma, fantastique, gare, imaginaire, littérature, luxe, métaphore,nostalgie, peinture, poésie, progrès, rail, temps, train, volupté. 1 SOMMAIRE Ouverture 3 Le choc de la nouveauté 5 Nouvelle structuration de l'espace et du temps 8 Sentiments mêlés 11 L'enthousiasme 15 Locomotives 16 Rails 17 Gares 18 Évasion -

Sous-Série 1 E-Dépôt
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS INVENTAIRE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 1 E-DÉPÔT ARCHIVES COMMUNALES MODERNES DE LA VILLE D’AUCH (1790-1945) établi par Lionel MACÉ-RAMÈTE adjoint administratif principal sous la direction de Pierre DEBOFLE conservateur en chef du Patrimoine préparé pour la publication en ligne par Pascal GENESTE conservateur général du Patrimoine AUCH – 2003, 2020 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DES ARCHIVES MODERNES D’AUCH SOMMAIRE Le classement des archives modernes d’Auch, qui fait suite aux inventaires des archives anciennes, publiés au début du XXe siècle, respecte le cadre fixé pour les archives communales. Série D Administration générale de la commune. Série E État civil – Étrangers, naturalisation. Série F Population – Économie sociale – Statistiques. Série G Contributions – Administrations financières. Série H Affaires militaires. Série I Police – Hygiène publique – Justice. Série K Élections – Personnel. Série L Finances de la commune. Série M Édifices communaux – Monuments et établissements publics. Série N Biens communaux – Terres – Bois – Eaux. Série O Travaux publics – Voirie – Moyens de transports – Régime des eaux. Série P Cultes. Série Q Assistance et prévoyance. Série R Instruction publique – Science, arts et lettres. 1 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DES ARCHIVES MODERNES D’AUCH Administration générale de la commune (série D) 2 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DES ARCHIVES MODERNES D’AUCH Administration générale de la commune CONSEIL MUNICIPAL 1 D / 1 Généralités -
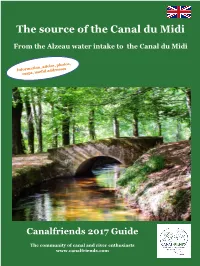
The Source of the Canal Du Midi
The source of the Canal du Midi From the Alzeau water intake to the Canal du Midi Canalfriends 2017 Guide The community of canal and river enthusiasts www.canalfriends.com This is YOUR guide The Canalfriends.com community platform was created in 2014 to share our passion for inland waterways with fellow enthusiasts, be they waterways professionals or tourists. In this spirit, we have created this collaborative guide for you to download for free. Having joined the "Acteur Canal du Midi" network in September 2016, the year of 350th anniversary of the canal du midi, we wanted to organise a special "Discovery Weekend " of the its channels and supply systems. The Acteur network and professionals (restaurant owners, accommodation providers, fish farmers) contributed to the success of this weekend. This digital guide, created in collaboration with Acampo association and the Museum & Gardens of the Canal du Midi, will assist you in discovering this magnificent territory, whether on your own, with family or friends. It will also be useful in planning your trip. The guide will be updated throughout the year to include suggestions, advice and useful addresses. For more in-depth information, download our free e-guide Garonne Canal and River available in French and English. Tell us the type of information you would like to find in this guide. Contact us to list your business, activity or accommodation. Once you have done the itineraries in the guide, do not hesitate to let us have your comments on your experience. Emails us on [email protected] and be kept informed of guide updates. -

Le Canal Du Midi
CONSTRUIRE Le Canal du Midi ET TRANSMETTRE LA MÉMOIRE Classé par l’Unesco comme une pièce Programme de l’Andra sur la mémoire des centres de stockage de déchets radioactifs CONSTRUIRE ET TRANSMETTRE LA MÉMOIRE LE CANAL DU MIDI remarquable du patrimoine mondial, le Programme de l’Andra sur la mémoire canal du Midi est le résultat d’un projet des centres de stockage de déchets radioactifs e ambitieux mené au xvii siècle. Sa réali- Cette collection d’ouvrages de référence a sation doit beaucoup à l’opiniâtreté de > Le Canal du Midi pour objet de rendre compte des avancées du Exemple de gestion sur la durée de la mémoire d’un ouvrage de génie civil programme mémoire de l’Andra. Elle se fonde son promoteur, Pierre-Paul Riquet. Mais, en particulier sur des études scientifiques c’est aux enjeux liés à la « mémoire » de dans différents domaines, qui nourrissent une cette infrastructure exceptionnelle, et à réflexion pluridisciplinaire sur les mécanismes sa transmission de génération en géné- en jeu dans les processus de construction et de transmission de la mémoire. ration, que s’intéresse cet ouvrage, en s’appuyant sur une étude commanditée par l’Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (Andra) et réali- sée par le spécialiste de l’environnement Frédéric Ogé. Nourrie par une enquête menée sur le terrain, l’analyse révèle les analogies qui existent entre ce canal, qui a traversé les siècles, et les installations de stockage des déchets radioactifs, actuelles et futures. CONSTRUIRE ET TRANSMETTRE LA MÉMOIRE ÉTUDES SCIENTIFIQUES CONSTRUIRE ET TRANSMETTRE LA MÉMOIRE Le Canal du Midi Classé par l’Unesco comme une pièce Programme de l’Andra sur la mémoire des centres de stockage de déchets radioactifs CONSTRUIRE ET TRANSMETTRE LA MÉMOIRE LE CANAL DU MIDI remarquable du patrimoine mondial, le Programme de l’Andra sur la mémoire canal du Midi est le résultat d’un projet des centres de stockage de déchets radioactifs e ambitieux mené au xvii siècle. -

The Canal Du Midi
A BRIEF HISTORY OF THE CANAL DU ]VIIDI ln October 1666 Louis 14th signed the edict authorising the construction of a canal designed to join the Atlantic to the Mediterranean (le canal des deux mers). Such an operation had been considered a couple of times previously, in 1539 and 1598, by reason of transporting merchandise via the long and frequently hazardous sea route (weather and Barbary pirates) from southern France around the lberian peninsula to Bordeaux. So who was chosen to carry out this amazing feat of civil engineering? obviously a respected engineer. But flo, Pierre-Paul Riquet, a tax collector. The farmer of the Gabelle or salt tax in Languedoc. He was appointed collector in 1630 and was also a munitions provider to the Catalonian Army. Riquet became extremely wealthy and on being given permission by the King to levy his own taxes became even more wealthy. This in turn allowed him to execute grand projects with great technical expertise. He was created Baron de [\llonrepos in 1662 and died in 1681, just 9 months prior to the completion of the first section from Sete to Toulouse, known as the canal royal de Languedod'. Following the Revolution the canal was nationalised and renamed Ie canal du Midiin 1793. ln 1810 Napoleon 1 created la compagnie du canal du Midi and then sold off the state held shares to his family and friends. It was only in 1856 that the dream became reality, the Atlantic and the t\llediterranean were joined with the completion of the canal lateral it la Garonne from Toulouse to Castets-en-Dorthe at the head of the navigable stretch of the river Garonne. -

Énergie : L'union Des Producteurs D'electricité Des Pyrénées Occidentales Par L
LA HOUILLE BLANCHE 147 ÉLECTRICITÉ Un bel exemple de coordination des transmissions d'énergie : L'Union des Producteurs d'Electricité des Pyrénées Occidentales par L. BARBILLION, Professeur à la Faculté des Sciences de V Université de Grenoble Dans cette même revue, nous avons consacré, Il y a quelques Si au bout des quarante ans qui marquent la période de réelle semaines, une étude spéciale, très justifiée, à la grande Société activité des transports de puissance, les proportions d'énergie de l'Énergie Électrique du Littoral Méditerranéen. L'étude mises en jeu, les distances couvertes, les chiffres des populations ci-après est relative à un autre groupement, l'U. P. E. P. 0. desservies sont aujourd'hui infiniment plus importantes que (Union des Producteurs d'Electricité des Pyrénées Occidentales). les facteurs de même nature qui caractérisent la première trans L'U. P. E. P. 0., organisation extrêmement souple et extrême mission d'énergie électrique réellement industrielle due à Aristide ment puissante, est bien aussi, si l'on veut, une Société comme BERGES (Vallée de l'Isère, centre de production Lancey, courant l'Énergie du Littoral, mais c'est une Société fédéraliste, grou- monophasé, 1890), il n'y a là au fond que des différences d'échelles. ¿es gr^nc/s r~e^sec9<jx c/& //csn^pori a/'&ner-g/e' é/ec/r/gy* c/a *Svc/- Oae^f, c/uA7âS£/'/*- Cert/r^s/&f ¿Jpenc/e' c/es Céisennes , e/ /ear //*$<$//ònpour /'U./fê.f^O* O Cen/r¿i/(? />uc/rc3u//qtJ& ^aOj&r&n/e- % ,, -fherrntcfu<£ nar> e^dher^n/e O „ <âc//téren/e Ogne <g SO Ai/ wMtfMPM. -

Les Trains En Cartes Postales
Collection Cartes Postales LES TRAINS Collection Christian ROUSSEL Les Trains en Cartes Postales Sommaire I. Les premiers réseaux ferroviaires français........................................................................ 3 Compagnie des chemins de fer de l'Est.................................................................................. 3 Compagnie des chemins de fer de l'Ouest.............................................................................. 5 Compagnie du chemin de fer du Nord ................................................................................... 7 Compagnie des chemins de fer du Midi et du Canal latéral à la Garonne ............................. 8 Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans ................................................................... 8 Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée.................................... 9 Les autres réseaux ................................................................................................................ 12 II. La SNCF ................................................................................................................ 21 Les Affiches ......................................................................................................................... 21 Le Matériel roulant............................................................................................................... 22 III. Quelques exemples étrangers ....................................................................................... -

Train Platforming Problem in Busy and Complex Railway Stations Lijie Bai
Train platforming problem in busy and complex railway stations Lijie Bai To cite this version: Lijie Bai. Train platforming problem in busy and complex railway stations. Other. Ecole Centrale de Lille, 2015. English. NNT : 2015ECLI0017. tel-01316564 HAL Id: tel-01316564 https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01316564 Submitted on 17 May 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. N o d’ordre: 2 7 6 ÉCOLE CENTRALE DE LILLE THÈSE présentée en vue d’obtenir le grade de DOCTEUR en Spécialité : Génie Industriel par Lijie BAI DOCTORAT DELIVRE PAR L’ECOLE CENTRALE DE LILLE Titre de la thèse : Train platforming problem in busy and complex railway stations Ordonnancement des trains dans une gare complexe et à forte densité de circulation Soutenue le 28 Août 2015 devant le jury d’examen : Président M. Frédéric SEMET Professeur, CRIStAL, École Centrale de Lille Rapporteur M. Saïd HANAFI Professeur, LAMIH-UVHC, Université de Valenciennes Rapporteur M. Joaquin RODRIGUEZ Directeur de Recherche, IFSTTAR Rapporteur M. Louis-Martin ROUSSEAU Professeur, CIRRELT, École Polytechnique de Montréal Examinateur M. Frédéric SEMET Professeur, CRIStAL, École Centrale de Lille Examinateur M. Ouajdi KORBAA Professeur, ISITCom-Sousse-Tunisie Invité M. -

Rothschild Frères, Maison De Commerce Et Banque, Fondée À Paris En 1817, Et Nationalisés En 1982 (Loi N°82-155 Du 11 Février 1982)
ARCHIVES NATIONALES DU MONDE DU TRAVAIL BANQUE ROTHSCHILD 132 AQ (1995 057) Introduction INTRODUCTION Activités banque, finances Présentation de l’entrée Ce fonds est entré aux Archives nationales, site de Paris, en 1972. Relevant d'un contrat de dépôt officiellement signé le 28 juin 1972 par la Banque Rothschild, il a été transféré au Centre des archives du monde du travail à Roubaix en 1995, sous le numéro d'entrée 1995 057. La gestion du fonds est passée successivement de la Banque Rothschild (1972-1982), à l'Européenne de Banque (1982-1990), à la Barclays qui rachète la précédente (1991-1994), à Eric de Rothschild (1994-2004), à The Rothschild Archive (Londres) depuis 2004. Il s'agit du fonds Rothschild qui se compose de deux sous-fonds : – le sous-fonds Rothschild Frères, maison de commerce et banque, fondée à Paris en 1817, et nationalisés en 1982 (Loi n°82-155 du 11 février 1982). Bien que formellement devenus publics (loi Archives de 1979), ces documents relèvent d'activités bancaires privées remontant au XIXe siècle et à la première moitié du XXe siècle et sont communiqués sous l'égide du contrat de dépôt stipulant l'accord préalable du déposant. – le sous-fonds Archives familiales contenant des archives privées de différents membres de la famille Rothschild, obéissant aux mêmes règles de communication. Très volumineux, il a fait l'objet de plusieurs opérations successives de classement depuis les années 1950 : Le classement des Archives nationales, site de Paris Il commence bien avant le dépôt aux Archives nationales, soit dès les années 1950, suite à la prospection de Bertrand Gille, conservateur à la Section des archives économiques et sociales des Archives nationales. -

Le Rachat Du Canal Du Midi En
Financial valuation methods in a world under political control: The Case of the Canal du Midi (1897 – 1901) Jean-Guy DEGOS Professor, University of Bordeaux (France) [email protected] Abstract The French canal du Midi, built by Pierre-Paul Riquet in the 17th century was the greatest construction project of its time. It enjoyed a natural monopoly and was protected because the other transport competitors were not able to challenge it for many years. The vagaries of three centuries of economic progress and political changes, associated with the considerable development of railway and road transport have limited its benefits. Revolutions and the French Republic weakened its position. Its owners were obliged to sell their property to the French State, because they were engaging in bad business and the government of the 19th century insisted control of all means of transport in the event of possible wars. Its sale resulted in contradictory analyzes that enable to take on the old techniques of evaluation of assets with very long operating timelines. It is also an interesting case of application of institutionalism and neo-institutionalism, which seek to explain the influence of the institutional environment - - here the State government, and French republican institutions – on the Organizations - here the Canal du Midi companies -. Keywords: Arbitration - Waterways - Railway – Contestable market - Natural monopoly – Neo Institutionalism - Methods of valuation - Perpetual annuity. 1 - Introduction The study of major projects in infrastructure is of interest to historians regarding business, finance and accounting for many reasons. Unlike in the battlefield, which highlights the affluent characters (kings, governments, marshals and generals) - and chronicles of the daily life, major projects can be the subject of multi-dimensional analysis and can acknowledge both the important characters and smaller players. -
Des Trains Aux Couleurs Du « Midi »
PATRIMOINE Des trains aux couleurs du « Midi » FERROVIAIRE Jusqu’en 1934, Toulouse fut le centre d’un réseau bien particulier, la « Compagnie des Che- mins de fer du Midi ». Un réseau modeste mais qui avait su tenir son rang en construisant d’audacieuses lignes pyrénéennes et en choisissant, avant les autres, l’électrifi cation. Ci-dessous, la nouvelle 'était la plus petite des AINSI DE L'ÉLECTRIFICATION obtiennent que ce soit en « cou- gare Matabiau, rebâtie compagnies ferroviaires, des voies et de la traction élec- rant continu à haute tension de entre 1903 et 1905. la seule qui n'avait pas de trique. La Compagnie du Midi fut 1 500 volts », pas du tout l'« alternatif Les blasons des villes C desservies par ligne vers la capitale ni de gare la première à faire ce choix, tout monophasé 12 000 volts 16 2 / 3 Hz » la Compagnie décorent dans Paris. Elle avait de bien simplement parce qu'à la diffé- déjà en usage sur la moitié des la façade. beaux « débarcadères » comme rence des autres compagnies, elle lignes de la compagnie. D'où une À droite 1 (sud Méditerranée) : notre gare Matabiau, totalement avait peu de gisements de charbon coûteuse reconversion qui n'amé- Toulouse*, Lodève, reconstruite en 1905 ou la gare sur son territoire et beaucoup de liorera pas les affaires dans des Albi, Carcassonne, Saint-Jean à Bordeaux et sa ma- montagnes où construire barrages années 20 où l'État pousse aussi la Béziers, Sète, gnifi que verrière Eiffel, mais son et conduites forcées. Dès 1909, un compagnie à construire à grands Perpignan, Montpellier, Rodez, Castelnaudary, réseau était modeste : une grande vaste plan est décidé pour électri- frais la ligne du Somport (Pau-Can- Narbonne, Mende et Foix. -
Download This Article in PDF Format
192 LA HOUILLE BLANCHE CONGRÈS DE L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE du Sud-Ouest L'Électrification des Chemins de Fer du Midi. Par M. BACHELLERY, Ingénieur en chef du matériel et de la traction de la Compagnie des Chemins de fer du Midi. C'est en 1902 que se posa pour la première fois pour la Compa Les nouveaux essais eurent lieu sur la section d'Illc à Yille gnie des Chemins de 1er du Midi le problème de Iav traction élec franche dans les Pyrénées-Orientales. Sur ce parcours de 24 kilo trique, à l'occasion de la concession de la ligne à voie étroite mètres on installa, en vue d'étudier les meilleures conditions de Yillefranche-Ycrnct-lcs-Bains à Bourg-Madame. d'établissement des lignes caténaires, six types différents d'équi Cette ligne, établie dans une région des plus montagneuses, pements ; on procéda à des essais complets sur six locomotives se présentait dans des conditions de tracé et de profil assez compaprésentées par divers constructeurs suivant un programme com rables à celles de îa ligne du Fayet à Chamonix construite quel mun tracé par la Compagnie. ques années auparavant et où l'exploitation électrique avait En présence des résultats favorables obtenus, la Compagnie donné toute satisfaction. décidait de procéder immédiatement à l'électrification, d'une En conséquence, la Compagnie du Midi se décida en laveur part de la ligne de Perpignan à Yillefranche (47,kilomètres), afin d'une solution analogue. d'utiliser les installations déjà réalisées, et d'autre part de la sec Elle lit choix du système à courant continu et à troisième tion de Pau à Montrejeau avec ses embranchements de Picrrefitte, rail et adopta pour la tension sur le rail 850 volts, chiffre qui, Bagnères, Arrcau et Luchon représentant 215 kilomètres de à cette époque, n'avait pas encore été atteint en Europe pour lignes dont une grande partie à fort trafic et sur lesquelles les un conducteur de ce genre.