Origines a - Origines
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
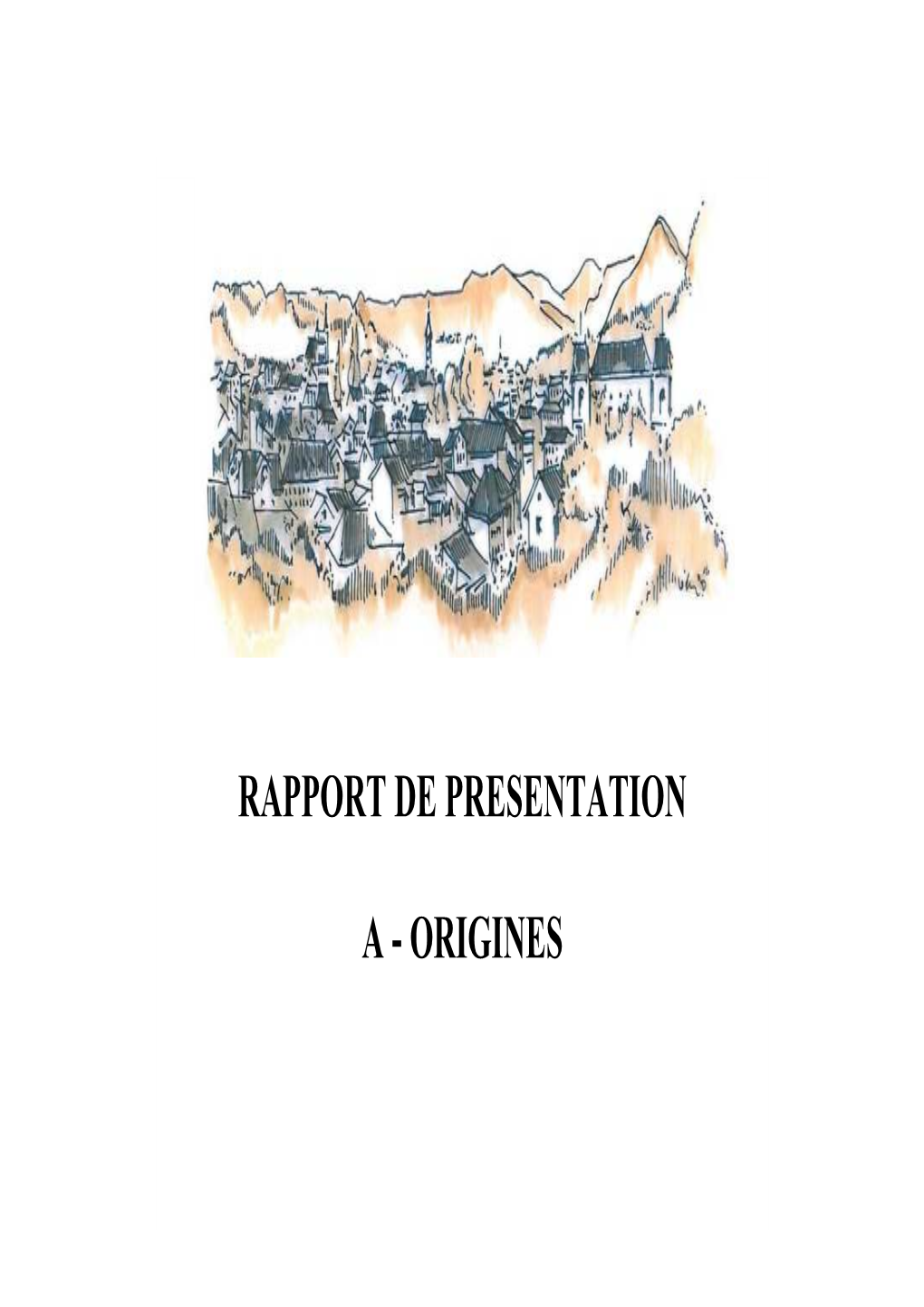
Load more
Recommended publications
-

Diagnostic MAIA BS Bagnères
Diagnostic local Personnes âgées V1 bis : décembre 2015 Sommaire 1. Présentation du territoire 2. Découpage administratif 3. Démographie 4. Population des communes 5. Données socio-économiques 6. Etat de santé 7. Consommations de soins 8. Offre de soins libérale et ambulatoire 9. La filière gériatrique 10. Les établissements d’hébergement 11. Les services à domicile 12. Les service sociaux 13. La prévention, l’aide aux aidants et les associations d’usagers 14. Synthèse (Ancien découpage cantonal ) Faiblesses : Forces : • Un relatif enclavement, Présentation • Territoire à taille humaine surtout en période hivernale du territoire Situé au centre sud du département, le bassin de santé de Bagnères se Bassins de vie compose essentiellement d’un bassin de vie. Ce bassin de vie comprend la partie ouest des Baronnies Un bassin de santé à dominante rurale Superficie : 429 km2 (/4464 dans le 65) Densité de 45 ha/km2 (/51 dans le 65) Population rurale à 85% Forces Faiblesses • Le canton de la Haute-Bigorre • Des communes périphériques Découpage qui regroupe une grande partie relevant plutôt des secteurs du territoire du BS administratifs de Lourdes ou administratif Tarbes Cantons (2015) et Bassins de santé Compte-tenu du nouveau découpage cantonal , le bassin de santé de Bagnères se compose : De l’ensemble des 14 communes du canton de la HAUTE- BIGORRE De 11 des 71 communes du canton de la VALLEE DE L'ARROS ET DES BAÏSES De 3 des 15 communes du canton du MOYEN ADOUR De 2 des 17 communes du canton d’OSSUN De 1 des 27 communes du canton -

Secteur Pastoral Du Haut-Adour Les Messes Et Les Divers Temps De Prière Lourdes Sont Généralement Affichés Sous Le Porche Des Différentes Églises
Secteur pastoral du Haut-Adour Les messes et les divers temps de prière Lourdes sont généralement affichés sous le porche des différentes églises. Nous vous proposons quelques possibilités pour vous rendre en pèlerinage accompagné à Lourdes aux dates En semaine, la messe est célébrée : suivantes : en l’église de Campan le mercredi à 9 h en l’église de Bagnères du mardi au jeudi à 8 h Dimanche 15 juin en la chapelle du Carmel à Bagnères le lundi et le Dimanche 6 juillet samedi à 11 h et le vendredi à 18 h Dimanche 27 juillet en la chapelle de la maison de retraite Saint Frai du Dimanche 10 août Pastorale des Réalités lundi au samedi à 11 h (rue Nansouty à Bagnères) Dimanche 24 août (sauf le jeudi) Dimanche 28 septembre du Tourisme et des Loisirs Le dimanche, la messe est célébrée : Programme : voir affiche au porche de l’église en l’église de Bagnères à 10 h 30 et à 18 h 30 Départ du car à 13 h 30, retour vers 19 h. dans les villages voir les affiches sous le porche … visites d’églises... Merci de vous inscrire auprès de l’agence DUBAU en la chapelle de la maison de retraite St Frai à 10 h (THOMAS COOK VOYAGE), 12 place Lafayette à Vous pouvez également vous joindre à la communauté des Carméli- Bagnères, au plus tard le vendredi précédant le pèleri- tes de l’Enfant-Jésus pour prier la liturgie … pèlerinages à Lourdes... nage du dimanche. des heures et autres temps forts. COORDONNÉES Pèlerinage Bagnères-Lourdes à pied (25 km environ) : Le mercredi 6 août Abbé Antoine MERILLON Départ à 7 h de l’Accueil Notre-Dame, 24 rue Gambetta 11 rue Pasteur à Bagnères, retour vers 19 h en bus (prévoir un pique- 65200 BAGNERES-DE-BIGORRE Tél : 05 62 95 27 30 Chapelle de Roumé nique et chaussures de marche). -

Ensembles Paroissiaux
Pierrefitte E.P. DU PAYS TOY LES DOYENNÉS - ENSEMBLES Préchac Barèges Saint-Pastous PAROISSIAUX - COMMUNES Betpouey Silhen (Commune de Boô-Silhen) Chèze Souin (Commune d’Artalens) Esquièze-Sère Septembre 2020 Soulom Esterre Vier-Bordes Gavarnie Villelongue Gèdre Grust DOYENNÉ D’ARGELÈS. Héas (N.-D. de) Luz Doyen : Abbé Gustave Zarabé. E.P. D’ESTREM DE SALLES ET DU VAL Saint-Sauveur (Commune de Luz) D’AZUN Saligos Sassis Agos-Vidalos E.P. D’ARGELÈS-SAINT-SAVIN Sazos Arcizans-Dessus Sère-Esquièze (Commune de Esquièze-Sère) Adast Arras Sers Arcizans-Avant Arrens-Marsous Viella Argelès-Gazost Aucun Viey Balagnas (Commune de Lau-Balagnas) Ayzac-Ost Villenave (Commune de Luz) Lau-Balagnas Bun Vizos (Commune de Saligos) Saint-Savin Estaing Uz Gaillagos Vieuzac (Commune d’Argelès) Gez Marsous (Commune de Arrens-Marsous) Ost (Commune de Ayzac-Ost) Ouzous E.P. DE PIERREFITTE-DAVANTAYGUES Poueylaün (N.-D. de) ET DE CAUTERETS Salles-Argelès Arbouix (Commune de Ayros-Arbouix) Sère-en-Lavedan Artalens Sireix Asmets (Commune de Boô-Silhen) Vidalos (Commune de Agos-Vidalos) Ayros-Arbouix Beaucens Paroisses rattachées à l'Ensemble paroissial d'Asson Boô-Silhen (diocèse de Bayonne) Bordes (Commune de Vier-Bordes) Arbéost Cauterets Ferrières Nestalas (Commune de Pierrefitte-Nestalas) Ortiac (Commune de Villelongue) 1 Lortet Gembrie DOYENNÉ DE LANNEMEZAN Lutilhous Ilheu Mauvezin Izaourt Doyen : Abbé Dominique Aubian. Mazères-de-Neste Loures-Barousse Mazouau Mauléon-Barousse Montastruc Ourde E.P. DE LANNEMEZAN Montégut Sacoué Anères Montoussé Sainte-Marie Aventignan Montsérié Saléchan Avezac-Prat-Lahitte Nestier Samuran Bazus-Neste Nistos Sarp Bégole Orieux Siradan Bernadets-Dessus Péré Sost Bize Pinas Thèbe Bizous Prat (Commune d’Avezac-Prat-Lahitte) Troubat Burg Rebouc (Commune de Hèches) Caharet Réjaumont Campistrous Saint-Laurent de Neste Cantaous Saint-Paul E.P. -
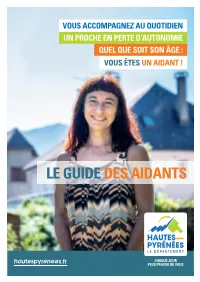
Le Guide Des Aidants
VOUS ACCOMPAGNEZ AU QUOTIDIEN UN PROCHE EN PERTE D’AUTONOMIE QUEL QUE SOIT SON ÂGE : VOUS ÊTES UN AIDANT ! LE GUIDE DES AIDANTS CHAQUE JOUR hautespyrenees.fr PLUS PROCHE DE VOUS 1 SOMMAIRE © P. Meyer Editorial .......................................................................................... p.3 Ce guide vous propose des infos pratiques ......................... p.4 Les services du Département et le rôle du pole partenaires aidants .................................... p.5 J’aide un proche âgé ................................................................... p.7 J’aide un proche en situation de handicap .......................p.15 J’aide un proche atteint d’une maladie ..............................p.18 Services infi rmiers (SSIAD) ....................................................p.22 Services d’aide à domicile (SAAD) ......................................p.24 Faire face à la douleur et au deuil ........................................p.30 Une autre approche avec mon proche ................................p.31 Mémento du droit du travail ...................................................p.32 TOUS CONCERNÉS ! Des centaines de personnes accompagnent au quotidien un proche, plus ou moins âgé, en situation de maladie ou de handicap. Mais parce qu’elles sont, le plus souvent, une soeur, un frère, un enfant, une mère, un père, un conjoint, leur situation n’est pas reconnue à sa juste valeur. Or, les missions de ces aidants sont bien réelles et exigeantes : nursing, soins, accompagnement à l’éducation et à la vie sociale, démarches administratives, coordination, vigilance permanente, soutien psychologique, activités domestiques… Leur rôle est essentiel dans notre société. Face à une crise sanitaire inédite, ils l’ont plus que jamais démontré. Nous, le Département et l’ensemble des acteurs traitant de la question des proches aidants, avons décidé de nous mobiliser pour eux. Nous veillons notamment à leur apporter des clés pour leur permettre de mieux vivre leur situation d’aidant sans négliger leur propre vie et leur santé. -

BT2 N°284, Les Trains Et L'imaginaire .Pdf
² N°284 Février 1986 Les trains et l'imaginaire Depuis plus de cent cinquante ans, le chemin de fer organise l'espace et modifie les distances et les perceptions. Dès sa création, le train a suscité l'enthousiasme ; très vite il a aussi provoqué l'inquiétude –parfois à bon droit -, et souvent la crainte qu'il inspirait venait tout droit des fantasmes des voyageurs ou des artistes … Car le train et son environnement ont toujours été objets de création pour les architectes, les peintres, les écrivains, les cinéastes. … Tantôt ces artistes ont noté leurs impressions et sentiments, tantôt ils ont fait du chemin de fer un personnage de leur œuvre, tout au-moins un décor jamais neutre. Cette brochure vous propose un reportage, depuis les années 1830 jusqu'à nos jours, parmi les œuvres littéraires et pastiques inspirées par ce sujet. Source d'angoisse ou de volupté ? Comment Hugo, Zola, Cendrars, Butor ont-ils parlé de ces voyages, paysages et personnages ferroviaires ? Comment Monet, Delvaux ou Bilal les ont-ils mis en images ? Et pour finir, du tortillard au TGV, comment nos contemporains vivent-ils la transformation du rail ? Car le train de la fin du XIX° siècle ouvre, lui aussi, des portes à notre imaginaire ! Mots-clefs angoisse, B.D., cinéma, fantastique, gare, imaginaire, littérature, luxe, métaphore,nostalgie, peinture, poésie, progrès, rail, temps, train, volupté. 1 SOMMAIRE Ouverture 3 Le choc de la nouveauté 5 Nouvelle structuration de l'espace et du temps 8 Sentiments mêlés 11 L'enthousiasme 15 Locomotives 16 Rails 17 Gares 18 Évasion -

Recueil Des Actes Administratifs Normal Août 2008
Recueil des Actes Administratifs - Préfecture des Hautes Pyrénées - Normal n°8 publié le 01/09/2008 Août 2008 http://www.hautes-pyrenees.sit.gouv.fr/actes3/public Sommaire DDAF Aménagement rural, forêt 2008242-02 - Arrêté d'autorisation de défrichement de bois et forêt sur la commune de CASTERA-LOU Eau,environnement, aménagement foncier 2008217-19 - reconnaissance d'aptitude technique de garde particulier DDASS 65 Etablissements et professions de sante 2008225-01 - Arrêté fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire des hautes-Pyrénées Inspection et promotion de la santé 2008219-09 - Arrêté ARH portant révision du montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au Centre Hospitalier de LOURDES 2008219-10 - Arrêté ARH portant révision du montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué aux Hôpitaux de LANNEMEZAN 2008219-11 - Arrêté ARH portant révision du montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au Centre Hospitalier de BIGORRE 2008219-12 - Arrêté ARH portant révision du montant des ressources d'assurance maladie versées sous forme de dotation ou de forfait annuel attribué au Centre Hospitalier de BAGNERES DE BIGORRE 2008231-03 - arrêté fixant le montant des ressources d'assurance maladie au titre de l'activité du mois de juillet 2008 au CH de bigorre 2008231-04 - arrêté del'ARH fixant les montants des ressources d'assurance maladie au titre de l'activité -

Sous-Série 1 E-Dépôt
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS INVENTAIRE DÉTAILLÉ DE LA SOUS-SÉRIE 1 E-DÉPÔT ARCHIVES COMMUNALES MODERNES DE LA VILLE D’AUCH (1790-1945) établi par Lionel MACÉ-RAMÈTE adjoint administratif principal sous la direction de Pierre DEBOFLE conservateur en chef du Patrimoine préparé pour la publication en ligne par Pascal GENESTE conservateur général du Patrimoine AUCH – 2003, 2020 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DES ARCHIVES MODERNES D’AUCH SOMMAIRE Le classement des archives modernes d’Auch, qui fait suite aux inventaires des archives anciennes, publiés au début du XXe siècle, respecte le cadre fixé pour les archives communales. Série D Administration générale de la commune. Série E État civil – Étrangers, naturalisation. Série F Population – Économie sociale – Statistiques. Série G Contributions – Administrations financières. Série H Affaires militaires. Série I Police – Hygiène publique – Justice. Série K Élections – Personnel. Série L Finances de la commune. Série M Édifices communaux – Monuments et établissements publics. Série N Biens communaux – Terres – Bois – Eaux. Série O Travaux publics – Voirie – Moyens de transports – Régime des eaux. Série P Cultes. Série Q Assistance et prévoyance. Série R Instruction publique – Science, arts et lettres. 1 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DES ARCHIVES MODERNES D’AUCH Administration générale de la commune (série D) 2 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU GERS – INVENTAIRE DES ARCHIVES MODERNES D’AUCH Administration générale de la commune CONSEIL MUNICIPAL 1 D / 1 Généralités -

1 / Rapport De Présentation LIVRET 1 – Diagnostic Socio-Économique
Schéma de Cohérence Territoriale de la Haute-Bigorre Elaboration du Schéma de Cohérence Territoriale de la Haute-Bigorre 1 / Rapport de présentation LIVRET 1 – Diagnostic socio-économique Version pour le Conseil Communautaire d’arrêt Juin 2018 O1 P / ERapport R A – de GUITTONprésentation / LIVRET OTT 1 –- Diagnostic ECOVIA socio- économique Version pour Conseil communautaire d’arrêt Juin 2018 page 1 Schéma de Cohérence Territoriale de la Haute-Bigorre SOMMAIRE CHAPITRE 1 - LE TERRITOIRE DE LA HAUTE BIGORRE, CONTEXTE ET CARACTERISTIQUES ................................. 4 1.1. HISTOIRE ET ORGANISATION ADMINISTRATIVE ............................................................................................... 5 1.2. CONTEXTE GENERAL ET SITUATION DE LA HAUTE BIGORRE ........................................................................... 6 1.3. LA HAUTE BIGORRE, UN TERRITOIRE DE PATRIMOINES RICHES A VALORISER .............................................. 11 CHAPITRE 2 - LE DEVELOPPEMENT HUMAIN .................................................................................................. 17 2.1. ELEMENTS DE DEMOGRAPHIE : ETAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES .............................................................. 18 2.2. POPULATION ACTIVE, RELATIONS DOMICILE-TRAVAIL ET REVENUS ............................................................. 31 2.3. EMPLOIS, ACTIVITES, FILIERES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ............................................................. 34 2.4. QUESTIONS ESSENTIELLES & PRINCIPAUX ENJEUX POUR LE DEVELOPPEMENT -

Carte Découverte
CARTE DÉCOUVERTE Hitte TARBES Hiis Montgaillard Orignac Château de Mauvezin Cieutat Antist Parc de loisirs de la Demi Lune Mauvezin Lannemezan Zoo d’Asson Abbaye de l’escaladieu A 64 Ordizan L’Escaladieu TOULOUSE Trébons Capvern LOURDES Mérilheu Argèles Bagnères Astugue Hauban 1 Pouzac Neuilh Uzer Bettes BAGNÈRES Lies DE BIGORRE Labassère 2 3 Gerde Col des Palomières 5 Marsas Grottes de Asque Médous Asté Banios LES PLAINES D’ESQUIOU Espace Préhistoire Parc Animalier des Pyrénées Col du Couret Gourge d’Asque Cascade du Pan Labastide 4 Beaudéan Esparros 6 CAMPAN 10 Cascade du Pountil Chemin d’Angoué Lesponne ARGELÈS GAZOST Pic du Montaigu 7 Falaises du Trassouet 2339 m Le Peyras Col de la Courade Cascade de Magenta 12 11 Ste Marie de Campan e Lac d’Aygue Rouye t t Donjon des AIgles i h e r Col de Beyrède y 8 e P e d 24 n i La Séoube Lac d’Isaby LE CHIROULET 9 m e h C 17 18 Col d’Aspin Pic du Midi 1489m Lac d’Ourrec Lac de Peyrelade Bon 2877 m Sarrat de 22 Lac Vert 19 20 PAYOLLE Lac d’Oncet Artigues Lac Bleu Cascade d’Arizes Lac de Payolle Cascade du Garet 21 14 13 Col du Tourmalet 15 2115 m Aigles d’Aure CAUTERETS/ Tournaboup LA MONGIE PONT D’ESPAGNE BARÈGES 16 Lac de Montarrouye Lac Arou 23 ARREAU PLATEAU DU LIENZ Hourquette d’Ancizan Lac de Gréziolles 1564m Lac de Campana Pic de l’Arbizon LUZ-SAINT-SAUVEUR 2831m Néouvielle Pic de Layré Lac dets Coubous ESPAGNE GAVARNIE 2422 m RÉSERVE NATURELLE DU NÉOUVIELLE Départs de randonnées 14 Hiking trails / Senderismo Légende Départs VTT Mountain bike trail / Excursiones VTT Départs VTT de descente Cultural heritage / Patrimonio Cycling trail / Excursiones VTT Parcours de pêche Fishing spots / Lugares para pescar Découverte des villages du nord Les ouvertures pouvant varier selon les Circuits de découverte Découverte des Baronnies 89 km 1h55 42 km du Tourmalet Pic du Midi 1h20 Les visites périodes, merci de vous renseigner auprès du Autour du Col du Tourmalet site concerné ou de l’Office de Tourisme. -

Tigf Region Lacq 3 Hautes Pyrenees Tarbes
Type de point Code point Dénomination Zone d'équilibrage Zone de Sortie NTR Département Commune PIC 18 1ER REGIMENT DE HUSSARDS PARACHUTISTES TIGF REGION LACQ 3 HAUTES PYRENEES TARBES PIC 170 ACIERS ET ENERGIES DU TARN TIGF TOULOUSE 8 TARN SAINT JUERY PIC 229 AGRALIA TIGF COUDURES 0 LANDES SAMADET PIC 47 AIA BORDEAUX TIGF GUYENNE 3 GIRONDE BORDEAUX PIC 197 AKZO NOBEL PULP AND PERFORMANCE CHEMICALS TIGF GUYENNE 4 GIRONDE AMBES PIC 82 AME MERIGNAC TIGF GUYENNE 3 GIRONDE MERIGNAC PIC 175 AREAL TIGF GUYENNE 4 LOT-ET-GARONNE SAINTE-MAURE-DE-PYRIAC PIC 232 ARJO WIGGINS TIGF BARBAIRA 10 PYRENEES ORIENTALES AMELIE-LES-BAINS-PALALDA PIC 299 ARKEMA France LANNEMEZAN TIGF REGION LACQ 5 HAUTES PYRENEES LANNEMEZAN PIC 276 ARKEMA France / GRL TIGF REGION LACQ 0 PYRENEES ATLANTIQUES LACQ PIC 63 ARKEMA France MONT TIGF REGION LACQ 0 PYRENEES ATLANTIQUES ORTHEZ PIC 165 ARTERRIS TIGF BARBAIRA 2 AUDE BRAM PIC 104 ARTERRIS LESPINASSE TIGF TOULOUSE 1 HAUTE-GARONNE LESPINASSE PIC 17 AUBERT & DUVAL FORTECH TIGF BARBAIRA 6 ARIEGE PAMIERS PIC 279 BASF HEALTH AND CARE PRODUCTS France TIGF MURET 2 HAUTE-GARONNE BOUSSENS PIC 94 BMS CIRCUITS TIGF REGION LACQ 5 PYRENEES ATLANTIQUES BAYONNE PIC 69 BOUYER LEROUX STRUCTURE COLOMIERS TIGF TOULOUSE 0 HAUTE-GARONNE COLOMIERS PIC 44 BOUYER LEROUX STRUCTURE GIRONDE SUR DROPT TIGF GUYENNE 2 GIRONDE GIRONDE-SUR-DROPT PIC 128 CAPA LE VERNET TIGF BARBAIRA 7 ARIEGE LE VERNET PIC 218 CASAUS MAUBOURGUET TIGF REGION LACQ 8 HAUTES PYRENEES MAUBOURGUET PIC 240 CEA CESTA LE BARP TIGF GUYENNE 3 GIRONDE LE BARP PIC 177 CECA TIGF GUYENNE -

Carte Planning Déploiement FTTH 2018-2024
Déploiements FTTH ORANGE Période 2018 2024 ± Saint-lanne Castelnau-Riviere-Basse Madiran Heres Soublecause Labatut-riviere Légende Hagedet Caussade-riviere Lascazeres 2018 Villefranque Estirac Auriebat 2019 Sombrun Sauveterre 2020 Maubourguet Lahitte-toupiere 2021 Monfaucon Vidouze Larreule Lafitol e Buzon Gensac 2022 Nouilhan Ansost Barbachen Liac 2023 Caixon Segalas Artagnan 2024 Sarriac-bigorre Vic-En-Bigorre Rabastens-De-Bigorre Sanous Estampures Villenave-pres-bearn Mingot Saint-lezer Frechede Camales Moumoulous Bazillac Lacassagne Senac Mazerolles Pujo Saint-sever Escaunets Ugnouas Bernadets Villenave -de-rustan Escondeaux Mansa -debat Talazac -pres-marsac n Bouilh Lameac Fontrailles Seron Marsac Lescurry Peyrun -devant Antin Siarrouy Tostat Tarasteix Castera-lou Lapeyre Andrest Sarniguet Jacque Trouley Trie-Sur-Baise Guizerix Peyret Soreac Bouilh -labarthe Lubret-saint-luc Aurensan -saint-andre Oroix Gayan -pereu Lalanne-trie Sadournin Lagarde Dours ilh Osmets Sariac Casterets Chis Louit Marseillan Larroque -magnoac Oursbelille Luby Vidou Puntous Garderes Pintac Bazet Chelle-debat -betmont Thermes Collongues Puydarrieux Castelnau Sabalos Castelvieilh Tournous -magnoac Villembits Hachan -Magnoac Bours Oleac Mun -darre Barthe Betbeze Orleix Pouyastruc Cabanac Lamarque Luquet Borderes-Sur-L-Echez -debat Campuzan -rustaing Organ Aries-espenan Lizo Aubarede Lustar Lalanne s Sere Betpouy Deveze Marquerie Sentous Thuy -rustaing Aureilhan Boulin Cizos Pouy Hourc Peyriguere Bugard Vieuzos Coussan Tournous Villemur Goudon Ibos Souyeaux Bonnefont -

Zonages Agricoles Hautes-Pyrénées Classement En Zone Défavorisée Pour Paiement De L'indemnité Compensatoire Carte 1-3 De Handicaps Naturels (ICHN)
Atlas des Zonages agricoles Hautes-Pyrénées Classement en zone défavorisée pour paiement de l'indemnité compensatoire Carte 1-3 de handicaps naturels (ICHN) Découpage infra-communaux Non défavorisée (65) SAINT CASTELNAU Zone défavorisée simple (112) LANNE RIVIERE-BASSE Piémont (57) Montagne (172) MADIRAN Haute montagne (85) HERES LABATUT SOUBLECAUSE RIVIERE HAGEDET CAUSSADE RIVIERE VILLEFRANQUE LASCAZERES ESTIRAC AURIEBAT SOMBRUN SAUVETERRE MAUBOURGUET LAHITTE TOUPIERE MONFAUCON LAFITOLE LARREULE VIDOUZE BUZON ANSOST NOUILHAN GENSAC BARBACHEN LIAC CAIXON SEGALAS ARTAGNAN SARRIAC RABASTENS VIC-EN-BIGORRE BIGORRE DE SANOUS BIGORRE VILLENAVE MINGOT ESTAMPURES PRES FRECHEDE BEARN SAINT-LEZER CAMALES BAZILLAC SAINT X SENAC SEVER MAZEROLLES U MOUMOULOUS ESCAUNETS A LACASSAGNE DE E BERNADETS D RUSTAN DEBAT VILLENAVE N UGNOUAS PUJO PRES O MARSAC C MANSAN FONTRAILLES S LESCURRY BOUILH TALAZAC E DEVANT MARSAC PEYRUN LAMEAC ANTIN SERON TOSTAT ANDREST GUIZERIX CASTERA TROULEY TRIE TARASTEIX SIARROUY SARNIGUET JACQUE LAPEYRE PEYRET LOU LABARTHE SUR BOUILH LUBRET AUBAREDE LARROQUE SAINT SAINT BAISE ANDRE CASTERETS AURENSAN SOREAC PEREUILH SADOURNIN LAGARDE GAYAN OSMETS LUC LALANNE TRIE SARIAC DOURS MARSEILLAN OROIX CHIS LOUIT MAGNOAC CHELLE LUBY VIDOU PUNTOUS BAZET DEBAT THERMES PINTAC COLLONGUES BETMONT PUYDARRIEUX OURSBELILLE CASTELNAU MAGNOAC GARDERES SABALOS CASTELVIEILH TOURNOUS MAGNOAC BOURS MUN DARRE N HACHAN BARTHE ORLEIX A N BETBEZE OLEAC LAMARQUE VILLEMBITS Z A DEBAT RUSTAING U N P ORGAN E BORDERES CABANAC P M S LALANNE LUQUET LUSTAR A SUR-L'ECHEZ