Union Des Comores
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Centre Souscentreserie Numéro Nom Et Prenom
Centre SousCentreSerie Numéro Nom et Prenom MORONI Chezani A1 2292 SAID SAMIR BEN YOUSSOUF MORONI Chezani A1 2293 ADJIDINE ALI ABDOU MORONI Chezani A1 2297 FAHADI RADJABOU MORONI Chezani A4 2321 AMINA ASSOUMANI MORONI Chezani A4 2333 BAHADJATI MAOULIDA MORONI Chezani A4 2334 BAIHAKIYI ALI ACHIRAFI MORONI Chezani A4 2349 EL-ANZIZE BACAR MORONI Chezani A4 2352 FAOUDIA ALI MORONI Chezani A4 2358 FATOUMA MAOULIDA MORONI Chezani A4 2415 NAIMA SOILIHI HAMADI MORONI Chezani A4 2445 ABDALLAH SAID MMADINA NABHANI MORONI Chezani A4 2449 ABOUHARIA AHAMADA MORONI Chezani A4 2450 ABOURATA ABDEREMANE MORONI Chezani A4 2451 AHAMADA BACAR MOUKLATI MORONI Chezani A4 2457 ANRAFA ISSIHAKA MORONI Chezani A4 2458 ANSOIR SAID AHAMADA MORONI Chezani A4 2459 ANTOISSI AHAMADA SOILIHI MORONI Chezani D 2509 NADJATE HACHIM MORONI Chezani D 2513 BABY BEN ALI MSA MORONI Dembeni A1 427 FAZLAT IBRAHIM MORONI Dembeni A1 464 KASSIM YOUSSOUF MORONI Dembeni A1 471 MOZDATI MMADI ADAM MORONI Dembeni A1 475 SALAMA MMADI ALI MORONI Dembeni A4 559 FOUAD BACAR SOILIHI ABDOU MORONI Dembeni A4 561 HAMIDA IBRAHIM MORONI Dembeni A4 562 HAMIDOU BACAR MORONI Dembeni D 588 ABDOURAHAMANE YOUSSOUF MORONI Dembeni D 605 SOIDROUDINE IBRAHIMA MORONI FoumboudzivouniA1 640 ABDOU YOUSSOUF MORONI FoumboudzivouniA1 642 ACHRAFI MMADI DJAE MORONI FoumboudzivouniA1 643 AHAMADA MOUIGNI MORONI FoumboudzivouniA1 654 FAIDATIE ABDALLAH MHADJOU MORONI FoumbouniA4 766 ABDOUCHAKOUR ZAINOUDINE MORONI FoumbouniA4 771 ALI KARIHILA RABOUANTI MORONI FoumbouniA4 800 KARI BEN CHAFION BENJI MORONI FoumbouniA4 840 -

ETUDE ECOLOGIQUE DE LA FORET DU MONT KARTHALA (Grande-Comore): Ethnobotanique, Typologie, Régénération Naturelle, Evolution S
UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET ECOLOGIE VEGETALES Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies de Biologie et Ecologie Végétales OPTION : ECOLOGIE VEGETALE APPLIQUEE ETUDE ECOLOGIQUE DE LA FORET DU MONT KARTHALA (Grande-comore): Ethnobotanique, Typologie, Régénération naturelle, Evolution spatio-temporelle et Zonation potentielle en site de conservation Présenté par : Andilyat MOHAMED ABDEREMANE (Maître es sciences) Soutenu publiquement : le 27 Novembre 2007 Devant la commission d’examen composée de : Président : Professeur RAJERIARISON Charlotte Rapporteur : Docteur ROGER EDMOND Examinateurs : Docteur RABARISON Harison Docteur RAKOTOARIMANANA Vonjison ANNEE UNIVERSITAIRE 2006 -2007 i UNIVERSITE D’ANTANANARIVO FACULTE DES SCIENCES DEPARTEMENT DE BIOLOGIE ET ECOLOGIE VEGETALES Mémoire pour l’obtention du Diplôme d’Etudes Approfondies de Biologie et Ecologie Végétales OPTION : ECOLOGIE VEGETALE APPLIQUEE ETUDE ECOLOGIQUE DE LA FORET DU MONT KARTHALA (Grande-comore): Ethnobotanique, Typologie, Régénération naturelle, Evolution spatio-temporelle et Zonation potentielle en site de conservation Présenté par : Andilyat MOHAMED ABDEREMANE (Maître es sciences) Soutenu publiquement : le 27 Novembre 2007 Devant la commission d’examen composée de : Président : Professeur RAJERIARISON Charlotte Rapporteur : Docteur ROGER EDMOND Examinateurs : Docteur RABARISON Harison Docteur RAKOTOARIMANANA Vonjison ANNEE UNIVERSITAIRE 2006 -2007 ii Remerciements : Ce travail est un des résultats de la collaboration -

UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNION DES COMORES Unité – Solidarité – Développement --------- ! DIRECTION GENERALE DE L’ANACEP ---------- _________________________________________________ PROJET DE FILETS SOCIAUX DE SECURITES Accord de Financement N° D0320 -KM RAPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITES N° 05 Période du 1 er juillet au 31 décembre 2017 Février 2018 1 SIGLES ET ABREVIATIONS ACTP : Argent Contre Travail Productif ACTC : Argent Contre Travail en réponses aux Catastrophes AG : Assemblée Générale AGEX : Agence d’Exécution ANACEP : Agence Nationale de Conception et d’Exécution des Projets AGP : Agence de Paiement ANO: Avis de Non Objection AVD : Agent Villageois de Développement ANJE : Amélioration du Nourrisson et du Jeune Enfant BE : Bureau d’Etudes BM : Banque Mondiale CCC : Comité Central de Coordination CG : Comité de Gestion CGES : Cadre de Gestion Environnementale et Sociale CGSP : Cellule de Gestion de Sous Projet CI : Consultant Individuel CP : Comité de Pilotage CPR : Cadre de politique de Réinstallation CPS Comité de Protection Sociale CR : Comité Régional DAO : Dossier d’appel d’offre DEN : Directeur Exécutif National DGSC : Direction Générale de la Sécurité Civile DP : Demande de Proposition DER : Directeur Exécutif Régional DNO : Demande de Non Objection DSP : Dossier de sous- projet FFSE : Facilitateur chargé du Suivi Evaluation HIMO : Haute Intensité de Main d’Œuvres IDB : Infrastructure de Bases IDB C : Infrastructure De Base en réponse aux Catastrophes IEC : Information Education et Communication MDP : Mémoire Descriptif du Projet MWL : île de Mohéli -

Arret N°16-016 Primaire Ngazidja
H h ~I'-I courcon5t~liorwr~ UNION DES COMORES Olll\;I\IHliWif,!' Unité - Solidarité - Développement ARRET N° 16-016/E/P/CC PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS DE L'ELECTION PRIMAIRE DE L'ILE DE NGAZIDJA La Cour constitutionnelle, VU la Constitution du 23 décembre 200 l, telle que révisée; VU la loi organique n° 04-001/ AU du 30 juin 2004 relative à l'organisation et aux compétences de la Cour constitutionnelle; VU la loi organique n° 05-014/AU du 03 octobre 2005 sur les autres attributions de la Cour constitutionnelle modifiée par la loi organique n° 14-016/AU du 26juin 2014; VU la loi organique n° 05-009/AU du 04 juin 2005 fixant les conditions d'éligibilité du Président de l'Union et les modalités d'application de l'article 13 de la Constitution, modifiée par la loi organ ique n? 10-019/ AU du 06 septembre 2010 ; VU la loi n° 14-004/AU du 12 avril 2014 relative au code électoral; VU le décret n° 15- 184/PR du 23 novembre 2015 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles autonomes; VU l'arrêt n? 16-001 /E/CC du 02 janvier 2016 portant liste définitive des candidats à l'élection du Président de l'Union de 2016; VU l'arrêté n° 15- 130/MIIDIICAB du 01 décembre 2015 relatif aux horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote pour l'élection du Président de l'Union et celles des Gouverneurs des Iles Autonomes; VU le circulaire n? 16-037/MIIDIICAB du 19 février 2016 relatifau vote par procuration; VU la note circulaire n° 16-038/MIIDIICAB du 19 février -
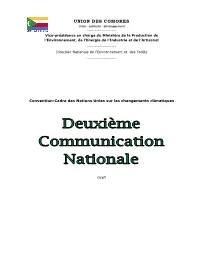
Union Des Comores
UNION DES COMORES Unité - solidarité - développement ------------------- Vice-présidence en charge du Ministère de la Production de l’Environnement, de l’Energie de l’Industrie et de l’Artisanat ------------------- Direction Nationale de l’Environnement et des Forêts ------------------- Convention-Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques Draft Table des matières Table des matières ........................................................................................ 2 Liste des figures et illustrations .................................................................... 7 Acronymes et abréviations .......................................................................... 10 CHAPITRE I. CIRCONSTANCES NATIONALES ............................................... 12 1.1. Caractéristiques géographiques ............................................................. 12 1.1.1. Situation géographique ......................................................................... 12 1.1.2. Géologie et géomorphologie ................................................................. 12 1.1.3. Le climat ............................................................................................ 15 1.1.4. Océanographie .................................................................................... 17 1.1.5. Les ressources en eau .......................................................................... 18 1.1.6. Utilisation des terres ............................................................................ 20 1.1.7. Biodiversité ........................................................................................ -

Mapping Population Distribution from High Resolution Remotely Sensed Imagery in a Data Poor Setting
remote sensing Article Mapping Population Distribution from High Resolution Remotely Sensed Imagery in a Data Poor Setting Sophie Mossoux 1,*, Matthieu Kervyn 2, Hamid Soulé 3 and Frank Canters 4 1 Department of Geography, Cartography and GIS Research Group, Physical Geography, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium 2 Department of Geography, Physical Geography, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium; [email protected] 3 Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique, Observatoire Volcanologique du Karthala, 169 Moroni, Comoros; [email protected] 4 Department of Geography, Cartography and GIS Research Group, Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussels, Belgium; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +32-2-629-33-84 Received: 13 August 2018; Accepted: 3 September 2018; Published: 5 September 2018 Abstract: Accurate mapping of population distribution is essential for policy-making, urban planning, administration, and risk management in hazardous areas. In some countries, however, population data is not collected on a regular basis and is rarely available at a high spatial resolution. In this study, we proposed an approach to estimate the absolute number of inhabitants at the neighborhood level, combining data obtained through field work with high resolution remote sensing. The approach was tested on Ngazidja Island (Union of the Comoros). A detailed survey of neighborhoods at the level of individual dwellings, showed that the average number of inhabitants per dwelling was significantly different between buildings characterized by a different roof type. Firstly, high spatial resolution remotely sensed imagery was used to define the location of individual buildings, and second to determine the roof type for each building, using an object-based classification approach. -

Remerciements
SOWO LA MKOßE signifie « voie publique » en shikomor ancien. YA MKOßE est le nom du premier fe (doyen d’un clan et magistrat d’une chefferie) à avoir aménagé et entretenu des chemins pour relier les villages de la côte Est de Ngazidja entre Malé et Hantsindzi. Damir BEN ALI REMERCIEMENTS Ce numéro de ya mkoþe est le fruit d'un partenariat modèle développé entre deux institutions scientifiques, le CNDRS (Centre National de Docu- mentation et de Recherche Scientifique, Moroni) et le LACITO du CNRS (UMR 7107 “Langues et Civilisations à Tradition Orale”), Paris. L’appui financier du Service de Coopération et d'Action Culturelle de l’Ambassade de France à Moroni a permis la formation d'une secrétaire d'édition, sous la direction de Madame Françoise LE GUENNEC-COPPENS et l’encadrement technique de Madame Françoise PEETERS, respectivement chercheur et ingénieur au LACITO, ainsi que l'acquisition d'un équipement informatique en vue de l’édition de nos prochains numéros. Par l'intérêt qu'il a toujours témoigné à l'égard de la recherche et du développement, Monsieur Gérard SOURNIA, chef de Service de Coopération, a joué un rôle clef dans l’octroi des subventions nécessaires à la réalisation de ce projet. Je lui adresse mes plus chaleureux remerciements. Nous remercions également KomEdit pour son travail de promotion et de diffusion de la revue. Enfin que Mohamed AHMED-CHAMANGA accepte notre reconnaissance pour son aide bienveillante et désintéressée. ya mkoþe est publié par le Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique des Comores (CNDRS), sous la direction du Directeur Général de l’Institution. -

RNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement
UNIONRNAP DES COMORES Unité – Solidarité – Développement Vice-Présidence en charge du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche, de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de l’Urbanisme Direction Générale de l’Environnement et des Forêts Draft Stratégie d’Expansion du Système National des Aires Protégées Aux Comores 2017 – 2021 26 octobre 2017 Les opinions exprimées dans cette publication ne reflètent pas nécessairement celles du PNUD, du GEF, ni du Gouvernement Comorien. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Fouad ABDOU RABI Coordinateur du projet RNAP, PNUD/ GEF [email protected] Youssouf Elamine Y. MBECHEZI Directeur Général de l’Environnement et des forêts (DGEF) Directeur du Projet RNAP-Comores (PNUD/ GEF) [email protected] Eric LACROIX AT projet RNAP [email protected] ; [email protected] Publié par : DGEF-PNUD/ GEF Comores Droits d’auteur : ©DGEF-PNUD/ GEF Comores. © Parcs nationaux des Comores. La reproduction de cette publication à des fins non commerciales, notamment éducatives, est permise et même encouragée sans autorisation écrite préalable du détenteur des droits d’auteur à condition que la source soit dûment citée. Page de garde : Photo 1,: Îlot de la Selle, Parc national Shisiwani. © Eric Lacroix PNC Citation : DGEF Comores (2017). Stratégie d’expansion du système national des aires protégées aux Comores. 2017 - 2021. Vice-Présidence en charge du Ministère de l’agriculture, de la pêche, de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, Direction générale de l’environnement et des forêts. Projet PNUD/ GEF : Système national des aires protégées aux Comores. 158 p + Annexes 16 p. -

Etude Du Comportement D'un Mur En Maçonnerie Sous L'effet D'un
Programme des Nations-Unies pour le Développement en Union des Comores Programme Environnement/ Réduction des risques et des catastrophes EVALUATION DE VULNERABILITE AUX RISQUES D’INONDATION EN UNION DES COMORES ANWADHUI Mansourou Août 2012 Remerciements A l’issu de ce travail, je tiens à exprimer mes sentiments de gratitude au Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Union des Comores, plus particulièrement au Programme Environnement/ Réduction de risques de catastrophes dans l’engagement d’accompagner le pays à la gestion des crises, au relèvement et l’appui institutionnel, de m’avoir confier cette étude durant mon stage professionnel dans la structure et de l’avoir financé pour mieux cerner l’analyse descriptive de l’aléa inondation dans les îles comoriennes. Mes premiers remerciements vont à l’ensemble du personnel associé au Programme et plus particulièrement à : - Madame Anliyat MZE AHMED ABDALLAH, Chargée du Programme Réduction de Risques et de Catastrophes - Monsieur Karim Ali Ahmed, Associé au Programme Environnement - M. Youssouf Mbechezi, Assistant du Représentant Résident - M. Abdou Salam SAADI, Analyste de programme/ Unité Gouvernance - Dalila Ahamed, Programme Associate UNDP - M. Maturafi K.Mabaé, Associé au Programme (Programme Manager Support Unit) - Madame Raichat MOHAMED, Associée aux Ressources Humaines - M. Ali Soumail, Spécialiste des opérations PNUD - M. Darkaoui SAID HALIDI, Assistant aux finances - M. Abdillah Ahmad, Assistant au registry PNUD - M. Abdallah Mzé, chauffeur au PNUD Qui dès mes premiers pas de la vie professionnelle, m’ont accueillis, conseillés, soutenus et accompagnés avec confiance jusqu’aujourd’hui. C’est avec votre encouragement que j’ai pu réaliser cette étude. Les mêmes sentiments de reconnaissance s’adressent également à la Direction Générale de la Sécurité Civile (DGSC), la Direction Générale de la météo, l’Observatoire du Volcan Karthala (OVK), ainsi que les CROSEP dans les îles d’avoir facilitées les visites de terrain. -

Evaluation of Dubai Cares' Support to Quality Basic
VALUATION OF UBAI ARES E D C ’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS FINAL REPORT JANUARY 2015 EVALUATION OF DUBAI CARES’ SUPPORT TO QUALITY BASIC EDUCATION IN COMOROS ISLANDS Contents Acronyms and abbreviations ........................................................................................................ 4 Executive summary ...................................................................................................................... 6 Brief program description and context ............................................................................................... 6 Purpose and expected use of the evaluation ..................................................................................... 6 Objectives of the evaluation ............................................................................................................... 6 Evaluation methodology ..................................................................................................................... 6 Principal findings and conclusions ...................................................................................................... 7 Key recommendations ........................................................................................................................ 7 Lessons learned for future programs .................................................................................................. 8 I. Audience and use of the evaluation ................................................................................... -

Communauté De Simboussa Badjini
UNION DES COMORES __________ ILE AUTONOME DE LA GRANDE - COMORE ___________ CREDIT / IDA 3868 - COM Fonds d'Appui au Développement Communautaire (FADC) Secrétariat Exécutif Régional BP 2494 – Moroni – Quartier Mahandi - Bd Karthala Tél. : (269) 73 28 89/73 28 78 - Fax : 73 28 89 Email : [email protected] ______________________________________________________ Communauté de Simboussa Badjini P LAN DE D EVELOPPEMENT L OCAL 2010 – 2015 1 Sommaire Chapitre I : Introduction : Chapitre II : Résumé du rapport Chapitre III : Analyse des données socio - économiques 1. Localisation 2. Aperçu historique 3. Situation Administrative 4. Situation Démographique 5. Organisations Sociales 6. Les Organisations extérieures opérantes dans le village 7. Environnement 8. La situation des services sociaux et des infrastructures de base 9. Activités économiques Chapitre IV : Plan d’investissement du village 10. Le plan quinquennal d’investissement du village ANNEXES Annexe 1 : Fiches de collecte de données socio - économiques Annexe 2 Les abré viations Annexe 3 : Adresses des partenaires au développement 2 I NTRODUCTION 1 - C ONTEXTE GENERAL Ce document est le rapport sur le Plan de Développement Local (PDL) de la communauté de Simboussa. C’est un village situé dans la région de Badjini dans la préfecture du Sud Est de l’île Autonome de la Grande - Comore. Ce document est le fruit d’un travail intense d’enquêtes et d’analyses des données socio - économiques du village qui a réuni toutes les différentes couches sociales : jeunes, femmes, homme s, notables et personnes vulnérables. Le travail a été fait 3 mois durant et consist ait à identifier et analyser secteur par secteur les potentialités, les contraintes et à dégager les solutions pour relever le défi en matière de développement communautair e. -

La Fonction Du « Grand Mariage » Dans La Politique Comorienne : Cas Des Maires-Notables Des Communes En Grande-Comore
FACULTE DE DROIT, D’ECONOMIE, DE GESTION ET DE SOCIOLOGIE ------------------------- DEPARTEMENT DE SOCIOLOGIE ------------------------- MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETUDES APPROFONDIES D.E.A La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . Présenté par : CHAKIRA Ibouroi Soilihi Le 15 Janvier 2014 Membres du jury : Présidente du jury : Professeur RAMANDIMBIARISON Noeline Juge : Docteur ETIENNE Stefano Raherimalala Sous la direction de : Pr RAMANDIMBIARISON Jean Claude Année universitaire : 2012 – 2013 La fonction du « Grand mariage » dans la politique comorienne : cas des Maires-notables des communes en Grande-Comore . REMERCIEMENTS Avant d’adresser mes vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à l’élaboration de ce travail de mémoire, je tiens à remercier DIEU tout puissant de m’avoir donné force et santé depuis le début de mes études jusqu’à maintenant. Je témoigne mes remerciements à : Monsieur ANDRIAMAMPANDRY Todisoa, Chef de Département Sociologie, qui n’a pas ménagé ses efforts et ses conseils pour la réussite de notre formation. Mes vifs remerciements vont à l’endroit : Des membres de Jury, qui ont eu l’obligeance de me consacrer une partie de leur temps, que je sais précieux, pour parcourir ce document et y apporter leurs avis. Des membres du corps enseignant et administratif de la filière Sociologie de la Faculté de Droit, d’Economie, de Gestion et de Sociologie (DEGS) de l’Université d’Antananarivo. Ils ont su partager généreusement leur savoir et leur compétence ci chère. Mes profondes gratitudes s’adressent à : Monsieur le Professeur RAMANDIMBIARISON Jean Claude , Directeur du présent mémoire, pour ses conseils précieux et ses orientations bénéfiques à sa réalisation.